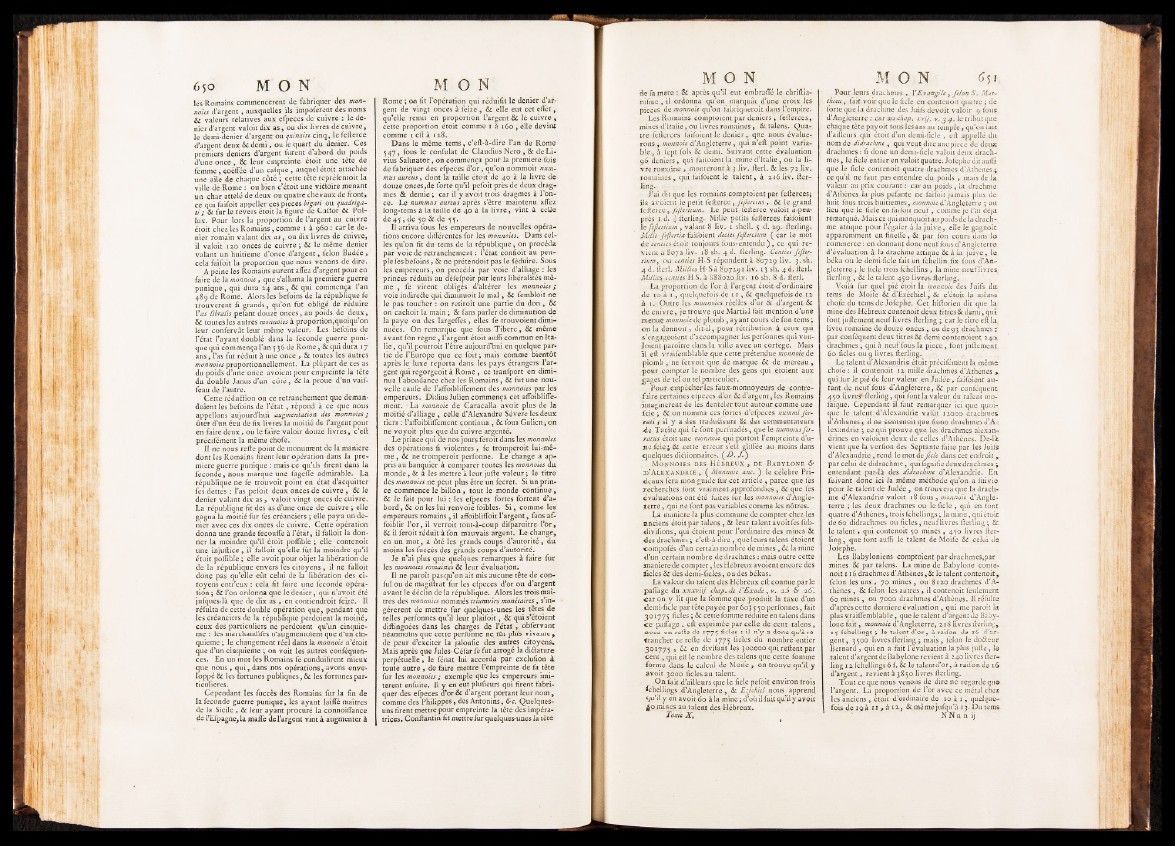
les Romains commencèrent de fabriquer des mon-
nous d’argent, auxquelles ils impoferent des noms
& valeurs relatives aux efpeces de cuivre : le denier
d'argent valoir dix a s , ou dix livres de cuivre,
le demi-denier d’argent ou quinaire cinq, le fefterce
d’argent deux 8c demi, ou le quart du denier. Ces
premiers deniers d’argent turent d’abord du^ poids
d’une once , 8c leur empreinte étoit une tête de
femme , coëffée d’un calque , auquel etoit attachée
une aile de chaque côté ; cette tête repréfentoit la
ville de Rome : ou bien c’étoit une vittoire menant
un char attelé de deux ou quatre chevaux de front,
ce qui faifoit appeller ces pièces bigati ou quadriga-
ti; & fur le revers étoit la figure de Caftor 8c Pol-
lux. Pour lors la proportion de l’argent au cuivre
étoit chez les Romains, comme 1 à 960 : car le denier
romain valant dix as , ou dix livres de cuivre,
il valoit 1 20 onces de cuivre ; & le même denier
valant un huitième d’once d’argent, félon Budee,
cela faifoit la proportion que nous venons de dire.
A peine les Romains eurent affez d’argent pour en
faire de la monnoie , que s’alluma la première guerre
punique, qui dura 24 ans, 8c qui commença l’an
489 de Rome. Alors les befoins de la république fe
trouvèrent li grands, qu’on fut oblige de réduire
Vas libralis pelant douze onces, au poids de deux,
8c toutes les autres monnoies à proportion,quoiqu’on
leur confervât leur même valeur. Les befoins de
l’état l’ayant doublé dans la fécondé guerre punique
qui commença l’an 5 36 de Rome, & qui dura 17
ans, l’as fut réduit à une once , & toutes les autres
monnoies proportionnellement. La plupart de ces as
du poids d’une once avoient pour empreinte la tête
du double Janus d’un côté, 8c la proue d’un vaif-
feau de l’autre.
Cette rédüftion ou ce retranchement que deman-
doient les befoins de l’é ta t , répond à ce que nous
appelions aujourd’hui augmentation des monnoies ;
ôter d’un écu de fix livres la moitié de l’argent pçur
en faire deux, ou le faire valoir douze livres, c’eft
précifément la même chofe.
Il ne nous refte point de monument de la maniéré
dont les Romains firent leur opération dans la première
guerre punique : mais ce qu’ils firent dans la
fécondé, nous marque une fageflë admirable. La
république ne fe trouvoit point en état d’acquitter
fes dettes : l’as pefoit deux onces de cuivre, & le
denier valant dix a s , valoit vingt onces de cuivre.
La république fit des as d’une once de cuivre ; elle
gagna la moitié fur fes créanciers ; elle paya un denier
avec ces dix onces de cuivre. Cette opération
donna une grande fecouffe à l’étât, il falloit la donner
la moindre qu’il étoit poffible ; elle contenoit
une injuftice, il falloit qu’elle fût la moindre qu’il
étoit poffible ; elle avoit pour objet la libération de
de la république envers fes citoyens , il ne falloit
donc pas qu’elle eût celui de la libération des citoyens
entr’eux : cela fit faire une fécondé opération
; 8c l’on ordonna que le denier, qui n’avoit été
jufques-là que de dix as , en contiendrait fei^e. Il
réfulta de cette double opération que, pendant que
les créanciers de la république perdoient la moitié,
ceux des particuliers ne perdoient qu’un cinquième
: les marchandifes n’augmentoient que d’un cinquième
; le changement réel dans la monnoie n’étoit
que d’un cinquième ; on voit les autres conféquen-
ces. En un mot les Romains fe conduifirent mieux
que nous, qui, dans nos opérations, avons enveloppé
8c les fortunes publiques, 8c les fortunes particulières.
Cependant les fuccès des Romains fur la fin de
la fécondé guerre punique, les ayant laiffé maîtres
de la Sicile , & leur ayant procuré la connoiffance
de l’Efpagne,la malle de l’argent vint à augmenter à
Rome ; on fit l’opération qui réduifit le denier d’af-
gent de vingt onces à feize , 8c elle eut cet effet,
qu’elle remit en proportion l’argent 8c le cuivre ,
cette proportion étoit comme 1 à 160, elle devint
comme r eft à 128.
Dans le même tems, c’eft-à-dire l’an de Rome
547, fous le confulat de Claudius Nero, & de Li-
vius Salinator, on commença pour la première fois
de fabriquer des efpeces d’o r , qu’on nommoit num-
mus aurais y dont la taille étoit de 40 à la livre de
douze onces,de forte qu’il pefoit près de deux drag-
mes & demie ; car il y avoit trois dragmes à l ’once.
Le nummus aureus après s’être maintenu affez
long-tems à la taille de 40 à la livre, vint à celle
d e4 5 , de 50 8c de 55.
Il arriva fous les empereurs de nouvelles opérations
encore différentes fur les monnoies. Dans cel-'
les qu’on fit du tems de la république, on procéda
par voie de retranchement : l’état confioit au peuple
fes befoins, & ne prétendoit pas le féduire. Sous
les empereurs, on procéda par voie d’alliage : les
princes réduits au défefpoir par leurs libéralités même
, fe virent obligés d’altérer les monnoies;
voie indireéfe qui diminuoit le mal, 8c fembloit ne
le pas toucher : on retirait une partie du don , &
on cachoit la main ; 8t fans parler de diminution de
la paye ou des largeffes, elles fe trouvoient diminuées.
On remarque que fous Tibere, 8c même
avant fon régné, l’argent étoit auffi commun en Italie
, qu’il pourrait l’être aujourd’hui en quelque partie
de l’Europe que ce foit ; mais comme bientôt
après le luxe reporta dans les pays étrangers l’argent
qui regorgeoit à Rome , ce tranfport en diminua
l’abondance chez les Romains, 8c fut une nouvelle
caufe de l’affoibliffement des monnoies par les
empereurs. Didius Julien commença cet affoibliffe-
ment. ' La monnoie de Caracalla avoit plus de la
moitié d’alliage , celle d’Alexandre Sévere les deux
tiersrvl’affoibliffement continua , 8c fous Galien,on
ne voyoit plus que du cuivre argenté.
Le prince qui de nos jours feroit dans les monnoies
des opérations li violentes , fe tromperait lui-même
, 8c ne tromperoit perfonne. Le change a appris
au banquier à comparer toutes les monnoies du
monde, & à les mettre à leur jufte valeur ; le titre
des monnoies ne peut plus être un fecret. Si un prince
commence le billon , tout le monde continue ,
8c le fait pour lui : les efpeces fortes fortent d’ar
bord, 8c on les lui renvoie foibles. S i, comme les
empereurs romains, il affoibliffoit l’argent, fans af-
foiblir l’o r , il verrait tout-à-coup difparoître l’o r ,
8c il feroit réduit à fon mauvais argent. Le change,
en un mot, a ôté les grands coups d’autorité, du
moins les fuccès des grands coups d’autorité.
Je n’ai plus que quelques remarques à faire fur
les monnoies romaines 8c leur évaluation.
Il ne paroît pas qu’on ait mis aucune tête de con-
ful ou de magiftrat fur les efpeces d’or ou d’argent
avant le déclin de la république. Alors les trois maîtres
des monnoies nommés triumvirs monétaires, s ingérèrent
de mettre fur quelques-unes les têtes de
telles perfonnes qu’il leur plaifoit, 8c qui s’étoient
diftinguées dans les charges de l’état , obfervant
néanmoins que cette perfonne ne^ fût phft vivante ,
de peur d’exciter la jaloufie des autres citoyens.
Mais après que Jules-Céfar fe fut arrogé la diâature
perpétuelle, le fénat lui accorda par exclufion à
toute autre , de faire mettre l’empreinte de fa tête
fur les monnoies ; exemple que les empereurs imitèrent
enfuite. Il y en eut plufieurs qui firent fabriquer
des-efpeces d’or 8c d’argent portant leur nom ,
comme des Philippes, des Antonins, &c. Quelques-
uns firent mettre pour empreinte la tête des impératrices.
Conftantin fit mettre fur quelques-unes la tête
de famefe : 8c après qu’il eut embraffé le chriftia-
nifme, il ordonna qu’on marquât d’une croix les
pièces cle monnaie qu’on fabriquerait dans l’empire.
Les Romains comptoient par deniers , fefterces,
mines d’Italie, ou livres romaines, & talens. Quatre
fiefterces faifoient le denier, qne nous évalue-
rons ÿ,monnoie d’Angleterre, qui n’eft point variable,,
à fept fols 8c demi. Suivant cette évaluation
96 deniers , qui faifoient la mine d’Italie, ou la livre
ro.maine y monteront à,3 liv. fterl. 8t les 72 liv.
romaines, qui faifoient le talent, à 216 liv. fter->
ling> ■ jj| ■ ' '
J’ai dit que les romains comptoient par fefterces;
ils avoient le petit fefterçe , fefiercius, 8c le. grand
fefterce, fejhnium. Le. petit fefterce valoit à-peu-
près 1 d. ^fterling. Mille petits fefterces failoient
le fefiextium , valant 8 liv.- 1 Shell. 5 d. 29. fterling.
Mille'fejlcrtia faifoient deciesfeflacium ( car le mot
de centies étoit toujours,fous-entendu) , ce qui revient
à 8072 liv. 18 sh, 4 d. fterling. Centies fefier-
tium, ou centies H-S répondent à 80729 liv. 3. sh.
4 d. fterl. Millies H-S à 897291 liv. 13 sh. 4 d. fterl.
Millïes, centies:H S. à 888020 liv. 16 sh. 8. d. fterl.
La proportion de l’or à l’argenj: étoit d’ordinaire
de ïo à 1 , .quelquefois de 1 1 , 8c quelquefois de 12
à i>b Outre le,s monnoies réelles d’or 8t d’argent 8c
de cuivre, je trouve que Martial fait mention d’une
menuè monnoie de plomb , ayant cours de fon tems;
on la donnoit, dit-il, pour rétribution à ceux qui
.s’engageoient d’accompagner les perfonnes qui vou-
loient paraître dans la ville avec un çortege. Mais
il eft v.raifemblable que cette prétendue monnoie de
plomb , ne fervoit que de marque 5c de mereau ,
pour compter le nombre des gens qui étoient aux
«âges dè tel ou tel particulier.
Pour empêcher les faux-monnoyeurs de contrefaire,
cerraines efpeces d’or 8cd’argent,les,Romains
imaginèrent de les denteler tout autour comme une
feie ; 8c on nomma ces fortes d’efpeces num mi Jer-
rati ; il y a des traducteurs 8c des commentateurs
de- Tacite qui fe font periuadés, que le nummus fer-
ratus é.toit une monnoie qui portoit l’empreinte d'urne
feie; 8c cette erreur s’eft gliffée au moins dans
quelques dictionnaires.. ( D . J. )
Monnoies des Hébaeùx , de Babylone &
d ’Alexandrie , ( Monnoie anc. ) le célébré Pri-
deaux fera mon guide fur cet article , parce que les
recherches font vraiment approfondies , 8c que fes
évaluations ont été faites fur les monnoies d’Angle-
xerre, qui ne font pas, variables comme les nôtres.
La maniéré la plus commune de compter chez les
anciens étoit par talens, & leur talent avoit fes fub-
divifions, qui étoient pour l’ordinaire des mines &
des drachmes ; c’eft-à dire, que leurs talens étoient
compofés d’un certain nombre de mines , 8c la mine
d’un certain nombre de drachmes: mais outre cette
maniéré de compter, les Hébreux avoient encore des
Gicles 8c des demi-ficles, ou des békas.
La valeur du talent des Hébreux eft connue par le
paffage du xxxviij chap. de l'Exode, v. z5 & z6.
car on y lit que la fomme que produit la taxe d’un
demi-ficle par tête payée par 603 550 perfonnes, fait
301775 ficles ; 8c cette fomme réduite en talens dans
c e paffage , eft exprimée par celle de cent talens,
avec un refte de 1775 fic^es : il n’y a donc qu’à retrancher
ce,refte de 177.5 ûc^es du nombre entier
3 0 1 7 7 5 ,8c en divifant les 300000 qui reftent par
c en t, qui eft le nombre des talens que cette fomme
forme dans le calcul de Moïfe , on trouve qu’il y
avoit 3000 ficles au talent.j V jj
On fait d’ailleurs que le ficle pefoit environ trois
fchellings d’Angleterre, 8t E^échiel nous apprend,
qu’il y en avoit 60 à la mine ; d’où, il fuit qu’il y avoit
minesau talent des Hébreux.
Tome AT,
Pour leurs drachmes , VEvangile, félon S. Matthieu
, fait voir que le ficle en contenoit quatre ; de
forte que la drachme des Juifs devoit valoir 9 fous
d’Angleterre : car au chap. xvij. v. 3 4 . le tribut que
chaque tête payoit touilesans au temple, qu’on laie
d’ailleurs qui étoit d’un demi-ficle , eft appellé du
nom de didrachme , qui veut dire une piece de deux:
drachmes : fi donc un demi-ficle valoit deux drachmes
, le ficle entier en valoit quatre. Jofephe dit auffi
que le ficle contenoit quatre drachmes d’Athènes ;
ce qu’il ne faut pas entendre du poids , mais de la
valeur au prix courant : car au poids, la drachme
d’Athènes la plus pefante ne faifoit jamais plus de
huit fous trois huitièmes, monnoie d’Angleterre ; au
lieu que le ficle en faifoit neu f, comme je l’ai déjà
remarqué. Mais çè qui manqùoit au poids de la drachme
attique pour l’egaler à la ju ive, elle le gagnoit
apparemment en fineffe, & par fon cours dans le
commerce : en donnant donc neuf fous d’Angleterre
d’évaluation à la drachme attique 8c à.la juive, le
béka ou le demi-ficle fait un feneilin fix fous d’Angleterre;
le ficle trois fchellins , lamine neuf livres
fterfing , 8c le talent 450 livres fterling.:
Voilà fur quel pie etoit la monnoie des Juifs du
tems de Moïle 8c d’Ez^chiel, & c’ètpjt la même
choiTe du tems de jofephe. Cet hiftorien dit que la
mine des Hébreux contenoit deux titres & demi, qut
font juftement neuf livres fterling ; carie titre eft la.
livre romaine de douze onces , pu de 93 drachmes i
par conféquent deux titres 8c demi contenoient 240,
drachmes, qui à neuf fous ,1a piece, font juftemenc
60 ficles ou 9 livres fterling.
Le talent d’Alexandrie étprtDrécifémënt la même
chofe: il contenoit 12 mille drachmes d’Athènes >
qui fur le pié de leur valeur en Judée, faifoient autant
de neuf fous d’Angleterre, 8c par conféquent
450 livres* fterling, qui font la valeur du talent mo-
faïque. Cependant il faut remarquer ici que quoique:
le talent d’Alexandrie valût 12000 drachmes
d’Athènes , il ne contenoit que, ,6oop drachmes d’A-.
lexandric ; ce qui prouve quelles drachme^ alexan-.
drines en valoient deux de celles d’Athènes. De-Ià
vient que la verfion des Septante faite par les Juifs
d’Alexandrie, rend le mot de ficle dans cet endroit ,
par celui de didrachme, qui fignifie deux drachmes j
entendant par-là des didrachme d’Alexandrie. En
fuivant donc ici la même méthode qu’on a luivie
pour le talent de Judée, on trouvera que la drachme
d’Alexandrie valoit 18 fous, monnoie d’Angle-
terre ; les deux drachmes ou le ficle , qui en font
quatre d’Athènes, trois fchellings ; la mine, qui étoit
de 60 didrachmes ou ficles, neuf livres fterling ; 8c
le talent, qui contenoit 50 minés , 450 livres fterling
, que font auffi le talent de Moïfe 8c celui de
Jofephe.
Les Babyloniens comptoient par drachmes,par
mines 8c par talens. La mine de Babylone contenoit
116 drachmes d’Athènes, & le talent contenoit,
félon les uns , 70 mines , ou 8120 drachmes d’Athènes
, 8c félon les autres , il contenoit feulement
.60 mines , ou 7000 drachmes d’Athènes. Ilréfulte
d’après cette derniere évaluation , qui me paroît la
plus vraiffemblable, que le talent d’argent de Baby-
. lone fait, monnoie d’Angleterre, 218 livres fterling,
15 fchellings ; le talent d’o r , à raifon de 16 d’argent,
3500 livres fterling ; mais , félon le doûeur
Bernard, qui en a fait l’évaluation la plus jufte, le
talent d’argent de Babylone revient à 240 livres fterling
12 fchellings 6 f. 8c le talent d’o r, à raifon de 16
d’argent, revient à 3850 livres fterling.
Tout ce que nous venons de dire ne regarde que
l ’argent. La proportion de l’or avec ce métal chez
les anciens , étoit d’ordinaire de 10 à 1 , quelquefois
de ioà 11 > à 12,, 8t.mêmejufqu’à 13. Du tems
N N n n ij