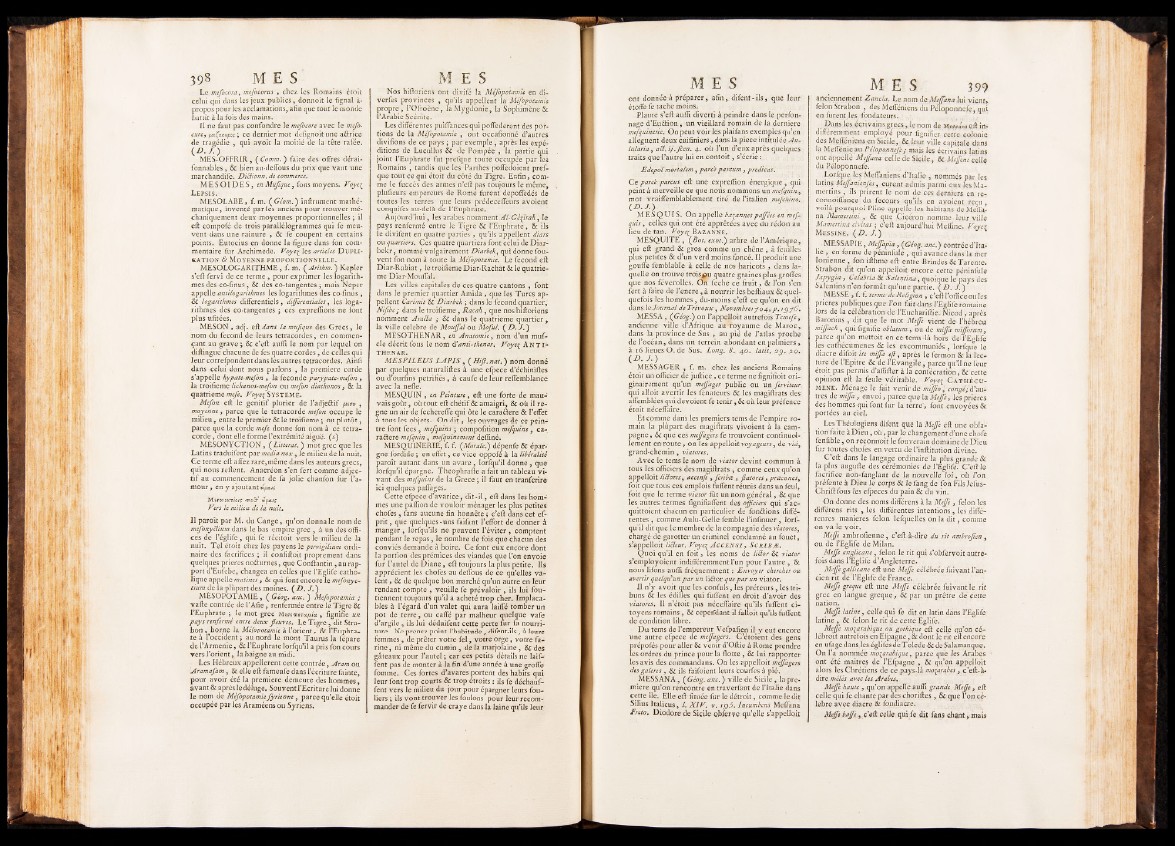
Le mefocora, mtfocorus , chez les Romains étoit
celui qui dans les jeux publics, donnoit le lignai à-
propos pour les acclamations, afin que tout le monde
battît à la fois des mains.
Il ne faut pas confondre le mefocore avec le mefo-
cure, ptÇoxxpoç ; ce dernier mot defignoit une a&rice
de tragédie , qui avoit la moitié de la tête rafée.
( d . j . ) m i
MES-OFFRIR, ( Comm. ) faire des offres derai-
fonnables, 6c bien au-deffous du prix que vaut une
marchandife. Diclionn. de commerce.
M E S O ID E S , en Mujîque, fons moyens. Voye^
L epsris. ■
MESOLABE, f. m. ( Gèom.) infiniment mathématique,
inventé parles anciens pour trouver mé-
chaniquement deux moyennes proportionnelles ; il
efl compofé de trois parallélogrammes qui fe meuvent
dans une rainure , 6c fe coupent en certains
points. Eutocius en donne la figure dans fon commentaire
fur Archimede. Voyeç les articles Duplication
& Moyenne proportionnelle.
MESOLOGARITHME, f. m. {Arithm. ) Kepler
s’efl fervi de ce terme, pour exprimer les logarithmes
des co-finus, 6c des co-tangentes ; mais Neper
appelle anùLogarithmes les logarithmes des co-finus ,
6c logarithmes différentiels, diffierentiales, les logarithmes
des co-tangentes ; ces exprefiions ne font
plus ufitées.
MESON, adj. eftdans la mujîque des Grecs, le
nom du fécond de leurs tetracordes, en commençant
au grave ; 6c c’efl: aufli le nom par lequel on
diftingue chacune de fes quatre cordes, de celles qui
leur correfpondent dans les autres tetracordes. Ainfi
dans celui dont nous parlons , la première corde
s’appelle hypate-mefon., la fécondé parypâte-mefon ,
la troifieme lichanos-mefon ou mefon diathonos , & la
quatrième mefe. Voye{ SYSTEME.
Mefon efl le génitif plurier de l’adje&if /mw ,
moyenne, parce que le tetracorde mefon occupe le
milieu, entre le premier 6c le troifieme ; ou plutôt,
parce que la corde mefe donne fon nom à ce tetracorde
, dont elle forme l’extrémité aiguë. (s)
MÉSONYCTION, ( Litterat. ) mot grec que les
Latins traduifent par media nox, le milieu de la nuit.
Ce terme efl affez rare,même dans les auteurs grecs,
qui nous refient. Anacréon s’en fert comme adjectif
au commencement de fa jolie chanfon fur l’amour
, en y ajoutant wpaiç
Mirovor-Tioiç irod’ eopaii
Vers le milieu de la nuit.
Il paroît par M. du Cange, qu’on donna le nom de
mefonyclium dans le bas empire grec , à un des offices
de l’églife, qui fe récitoit vers le- milieu de la
nuit. Tel étoit chez les payensle pervigilium ordinaire
des facrifîces ; il confifloit proprement dans
quelques prières nofturnes, que Conflantin, au rapport
d’Eufebe, changea en celles que l’Eglife catholique
appelle matines, & qui font encore le mefonyc-
tium de la plûpart des moines. {D . J .)
MÉSOPOTAMIE , ( Géog. anc, ) Mefopotamia ;
vafle contrée de l’A fie, renfermée entre le Tigre 6c
1 Euphrate ; le mot grec MteovroTet/j.ia , lignifie un
pays renferme entre deux fleuves. Le Tigre , dit Stra-
bon, borne la Mèfopotamie à l’orient, 6c l’Euphrate
à l’occident ; au nord le mont Taurus la fépare
de l’Arménie, 6c l’Euphrate lorfqu’il a pris fon cours
vers l’orient, la baigne au midi.
Les Hébreux appellerent cette contrée, Aram ou
Aramafam, & elle efl fameufe dans l’écriture fainte,
pour avoir été la première demeure des hommes
avant & après le déluge. Souvent l’Ecriture lui donne
le nom de Mèfopotamie fyrienne, parce qu’elle étoit
occupée par les Araméens ou Syriens.
Nos hifloriens ont divifé la Mèfopotamie en di-
verfes provinces , qu’ils appellent la Mèfopotamie
propre, l’Ofroène, lâMygdonie, la Sophimène &
l’Arabie Scénite. •
Les différentes puiffances qui poffederent des portions
de la Mèfopotamie , ont occafionné d’autres
divifions de ce pays ; par exemple, après les expéditions
de Lucullus 6c de Pompée , la partie qui
joint l’Euphrate fut prefque toute occupée par les
Romains , tandis que les Parthes poffedoient prefque
tout ce qui étoit du côté du Tigre. Enfin, comme
le fuccès des armes n’efl pas toujours le même,
plufieurs empereurs de Rome furent depoffedés de
toutes les terres que leurs prédeceffeurs avoient
conquifes au-delà de l ’Euphrate.
Aujourd’hui, les arabes nomment Al-Gèfirah, le
pays renfermé entre le Tigre 6c l’Euphrate, & ils
le divifent en quatre parties , qu’ils appellent diars
ou quartiers. Ces quatre quartiers font celui de Diar-
bekr, nommé vulgairement Diarbek, qui donne fôû-
vent fon nom à toute la Mèfopotamie. Le fécond efl
Diar-Rabiat, le troifieme Diar-Rachat & le quatrième
Diar-Mouffal.
Les villes capitales de ces quatre cantons , font
dans le premier quartier Amida, que les Turcs appellent
Carèmit 6c Diarbek ; dans le fécond quartier,
Nifibe ; dans le troifieme, Racah, que nos hifloriens
nomment Aracla ; 6c dans le quatrième quartier ,
la ville célébré de Mouffal ou Moful. {D .J . )
MÉSOTHENAR, en Anatomie y nom d’un muf-
cle décrit fous le nom d'anti-thenar. Voye{ A n t i -
THENAR.
MES P ILEUS L A P IS , ( Hiß. nat. ) nom donné
par quelques naturalifles à une efpece d’échinifles
ou d’ourfins pétrifiés, à caufe de leur reffemblance
avec la nefle.
MESQUIN , en Peinture, efl: une forte de mauvais
goût, oii tout efl chétif 6c amaigri, 6c où il regne
un air de fechereffe qui ôte le eara&ere & l’effet
à tous les objets. On d it , les ouvrages de ce peintre
font fiées , mefquins ; compofition mefquine , ca-,
raétere mefquin, mefquinement deffiné.
MESQUINERIE, f. f. {Morale.) dépenfe 6c épargne
fordide ; en effet, ce vice oppofé à la libéralité
paroît autant dans un avare, lorfqu’il donne, que
lorfqu’il épargne. Theophrafle a fait un tableau v ivant
des mefquins de la Grece ; il faut en tranferire
ici quelques paffages.
Cette efpece d’avarice, dit- il, efl dans les hommes
une paffion de vouloir ménager les plus petites
chofes, fans aucune fin honnête $ c’efl dans cet efi-
prit, que quelques-uns faifant l’effort de donner à
manger , lorfqu’ils ne peuvent l’éviter , comptent
pendant le repas, le nombre de fois que chacun des
conviés demande à boire. Ce font eux encore dont
la portion des prémices des viandes que l’on envoie
fur l’autel de Diane, efl toujours la plus petite. Ils
apprécient les chofes vau deffous de ce qu’elles valent
, 6c de quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte , veuille fe prévaloir , ils lui fou-
tiennent toujours qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura laiffé tomber un
pot de terre, ou caffé par malheur quelque vafe
d’argile, ils lui déduifent cette perte fur fa nourriture.
Ne prenez point l’habitude, difent-ils, à leurs
femmes, de prêter votre fe l, votre o rge, votre farine
, ni même du cumin , de la marjolaine, 6c des
gâteaux pour l’autel ; car ces petits détails ne laiP
lent pas de monter à la fin d’une année à une groffe
fomme. Ces fortes d’avares portent des habits qui
leur font trop courts 6c trop étroits : ils fe déchauffent
vers le milieu du jour pour épargner leurs fou-
liers ; ils vont trouver les foulons pour leur recommander
de fe fervir de craye dans la laine qu’ils leur
ont donnée à préparer, afin, difent - ils, que leur
étoffe fe tache moins;
Plaute s’efl. auffi diverti à peindre dans Ie.perfon-,
nage d’EiiÉHon, un vieillard romain de la derniej-e
7nèfquinerie. On peut voir lés plaifans exemples qu’en
allèguent deux eùifiniers, dans la. piece intitulée Au-
lularia. , acl. ij.fcen. 4. où l’un d’eux après quelques'
traits que l’autre lui en contoit, s’écrie :. .
Edepol mortalem, parce parcüm , préditas'.
Ce parchparcus efl une expreflion énergique | qui
peint à merveille ce que noiis nommons un mefquin-r
mot vraiffemblablement tiré de l’italien mejthino..
(D .J ^ - T V :
M ES Q U I S. On appelle ba^annes paffées en mefi,
quis, cèllés qui ont été apprêtées avec du rédon au
lieu de tan; Voye{ Bazanne.
MESQUITE , {Bot. exot.) arbre de l’Amérique,
qui efl grand & gros comme un chêne, à feuilles
plus petites & d’un verd moins foncé. Il produit une
gouffe femblable à celle de .nos haricots,, dans laquelle
on trouve trois^m quatre graines plus groffes
que nos féverolles. On feche ce fruit, & l’on s’en
fert à faire de l’encre, à nourrir les befliaux 6c quelquefois
les hommes, du-moins e’efl ce qu’on en dit
dans le Journalde-Trévoux, Novembre 1 y 04, p. igyif.
MESSA y f Géog.) on I’appelloit autrefois T^iefé,
ancienne ville d’Afrique au¥oyaume de Maroc,
dans la province de Sus , au pié de l’atlas proche
de l’océan, dans un terrein abondant en palmiers ,
à 16 lieuesO.de Sus. Long. 8. 40. latit. 29, 20.
( D . J . ) S È .
MESSAGER , f. m. chez les anciens Romains
étoit un officier de juflice , ce terme ne fignifioit originairement
qu’un meffiager public ou un ferviteur,
qui alloit avertir les fénateurs 6c les magiflrats des
affemblées qui dévoient fe tenir, 6c où leur préfence
étoit néceffaire.
Et comme dans les premiers temsde l’empire romain
la plûpart des magiflrats vivoient à la campagne
, 6c que ces mejfagers fe trouvoient continuellement
en route, on les appelloit voyageurs y de vid}
grand-chemin , viatores.
Avec le tems le nom de viator devint commun, à
tous les officiers des magiflrats , comme ceux qu’on
appelloit liclores, accenji , feribee , flatores , protconeSy
fioit que tous ces emplois fuffent réunis dans un feul,
foit que le terme viator fût un nom général, & que
les autres termes fignifiaffent des officiers qui s’ac-
quittoient chacun en particulier de fonctions différentes
, comme Aulu-Gelle femble Finfinuer, lorf-
qu il dit que le membre de la compagnie des viatores,
chargé de garotter un criminel condamné au fouet,
s’appelloit licteur. Voye^AccENSl, Scr ibæ .
Quoi qu’il en foit, les noms de liclor 6c viator
s’emploÿoient indifféremment l’un pour l’autre , &
nous lifons auffi fréquemment : Envoyer chercher où
avertir quelqu'un par un liélor que par un viator.
Il n’y avoit que les confuls, les préteurs, les tribuns
6c les édifies qui fuffent en droit d’avoir des
viatores. Il n’étoit pas néceffaire qu’ils fuffent citoyens
romains, 6c cependant il falloit qu’ils fuffent
de condition libre.
Du tems de l’empereur Vefpafien il y eut encore
une autre efpece de mejfagers. C ’étoient des gens
prépofés pour aller 6c venir d’Oflie à Rome prendre
les ordres du prince pour la flotte , 6c lui rapporter
les avis des commandans. On les appelloit mejfagers
des galeres, & ils faifoient leurs 'courfes à pié.
MESSANA, ( Géog. anc. ) ville de Sicile , la première
qu’on rencontre en traverfant de l’Italie dans
cette île. Elle efl fituée fur le détroit, comme le dit
Silius Italicus, l. XIV . v. 19S, Incumbcns Meffana
Freto, Diodore de Sicile obferve qu’elle s’appelloit
anciennement Zancla. Le nom àeMejfana lui vient,
félon Strabon , des Mefféniens du Péloponnefe, qui
en furentles, fondateurs.
Dans les. éçrivains grecs, le nom de M\toçlm efl indifféremment
employé pour fignifier cette colonie
des Mefféniens;en Sicile., & leur ville capitale dans
la Meffénie au Péloponnefe; mais les écrivains latins
ont appelle Meffana celle de Sicile., 6c Mtffene celle
du: Péloponnefe.
Lorfque, les Meffaniens d’Italie , nommés par les
latins MJfani'enfes, eurent admis parmi eux les Ma-
mertins , ils prirent le nom de ces derniers en re-
connoiffance du fecours qu’ils en avoient reçu,
voilà pourquoi Pline appelle les habitans de Meflàr
na Marnertini y 6c que Cicéron nomme leur ville
Mamertinà civitas ; c’efl aujourd’hui Meffine. Voyez
Messine. {D . J .) x
MESSAP1E , Meffapia, {Géog. anc.)' contrée d’Italie
y en forme de péninfule , qui avance dans la mer
Ionienne , fon iflhme efl entre Brindes & Tarente.
Strabon dit qu’on appelloit encore cette péninfule
Japygia y Calabria & Sàlentinay quoique le pays des
Salentins n’en formât.qù’une partie. {D . J .)
MESSE , f. f. terme, de Religion, c ’efl l’office ou les
prières publiques que Bon fait dans l’Eglife romaine
lors de la célébration de l’Euchariftie. Nicod , après
Baronius , dit que le mot Meffie vient de. l’hébreu
mijfach -, qui fignifie oblatum , ou de miffa mijforùm,
parce qu’on mettoit en ce tems-là hors deil’Eglife
les catnécitmenes 6c les excommuniés , lorfque le
diacre difoit ite miffa efi, après le fermon & la lecture
de l’Epître 6c de l’Evangile, parce qu’ilne leur
étoit pas permis d’affifler à la confécration, & cette
opinion efl la feule véritable. Voye£ C a th é cu -
mene. Ménage le fait venir de miffio,' congé/cl’au-
tres de m ijft, envoi, parce que la Meffie, les prières
des hommes qui font fur la terriT, font envoyées &
portées au ciel.
Les Théologiens difent que la Meffie efl une oblation
faite à D ieu , où , par le changement d’une chofe
fenfible, on reconnoît le fouverain domaine de Dieu
fur toutes chofes en vertu de l’inflitution divine.
C ’efl dans le langage ordinaire la plus grande &
la plus augufle des cérémonies de l’Eglife. C ’efl le
facrifice non-fanglant de la nouvelle lo i, où l’on
préfente à Dieu le corps & le fang de fon Fils Jefus-
Chriflfous les efpeces du pain & du vin.
On donne des noms différens à la Meffie , félon les
différens rits , les différentes intentions, les .différentes
maniérés félon lefquelles on la dit, comme
on va le voir.
Meffie ambrofienne, c’efl-à-dire du rit ambrojîen ,
ou de l’Eglife de Milan.
Meffie anglicane, félon le rit qui s’obfervoit autrefois
dans l’Eglife d’Angleterre.
Meffie gallicane efl une Meffie célébrée fuivant l’ancien
rit de l’Eglife de France.
Meffie greque efl une Meffie célébrée fuivant le rit
grec en langue greque, 6c par un prêtre de cette
nation,.
Meffie latine, celle qui fe dit en latin dans l’Eglife.
latine , 6c félon le rit de cette Eglife.
Meffie mozyirabique ou gothique efl celle qu’on cé-
lébroit autrefois en Efpagne, & dont le rit efl encore
en ufage dansfles églifes de Tolede 6c de Salamanque.
On l’a nommée mo^arabique, parce que les Arabes
ont été maîtres de l’Efpagne , 6c qu’on appelloit
alors les Chrétiens de ce pays-là mozarabes , c ’efl-à-
dire mêlés avec les Arabes.
Meffie haute , qu’on appelle auffi grande MeJJe, efl
celle qui fe chante par des chorifles , 6c que Bon célébré
avec diacre & foudiacre.
Meffie baffie, c’efl celle, qui fe dit fans chant y mais