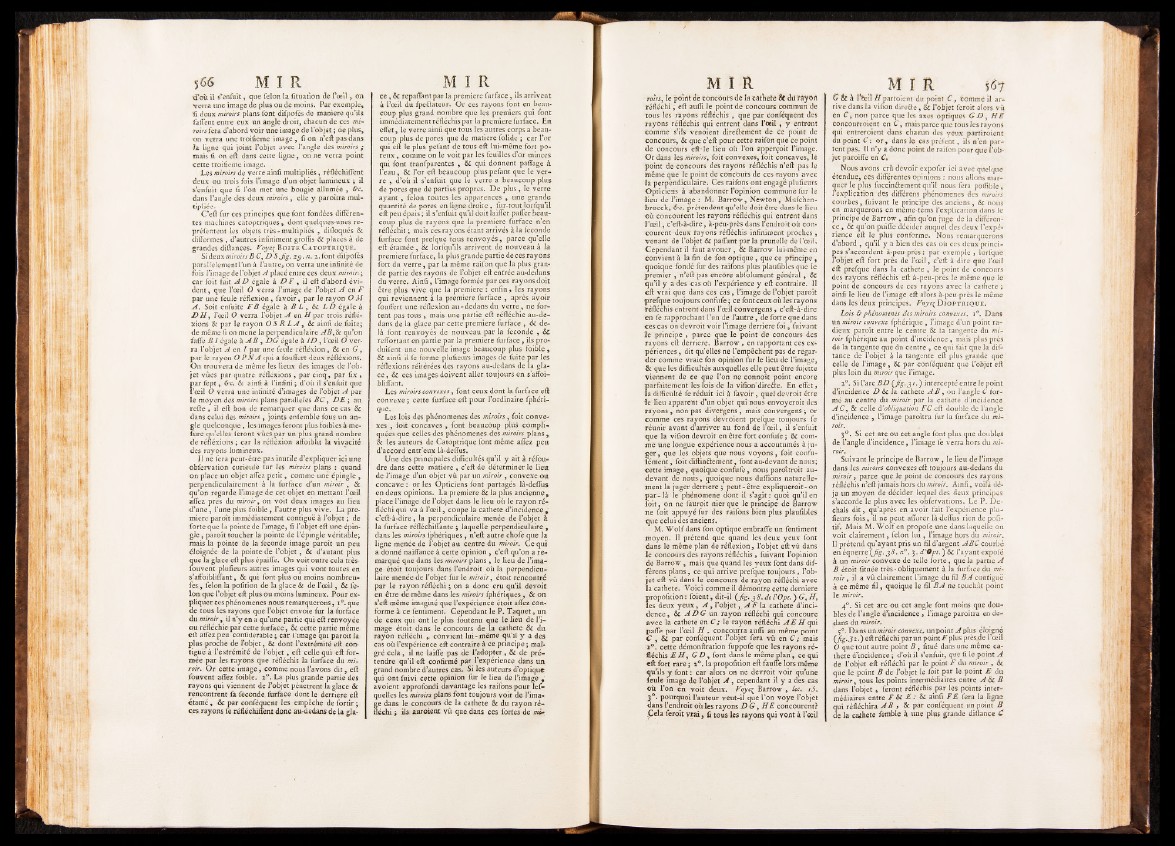
d’où ïl s'enfuit, que félon la fituatïon de l'oe il, Oïl
Verra une image de plus ou de moins. Par exemple,
fi deux miroirs plans font difpofés de maniéré qu’ils
faffent entre eux un angle droit, chacun de ces miroirs
fera d’abord voir une image de l’objet ; de plus,
■ on verra une troifieme image , fi on n’eft pas dans
la ligne qui joint l’objet avec l’angle des miroirs ;
mais fi on eft dans cette ligne, on ne verra point
oette troifieme image.
Les miroirs de verre ainfi multipliés, réfléchiflent-
■ deux ou trois fois l’image d’un objet lumineux ; il
s’enfuit que fi l’on met une bougie allumée , &c.
dans l’angle des deux miroirs, elle y paroîtra multipliée.
C ’eft fur ces principes que font fondées différentes
machines catoptriqueç, dont quelques-unes re-
préfentent les objets très-multipliés , difloqués &
difformes , d’autres infiniment groffis 8c placés à de
grandes diftances. Voye^ Bo ite C ato ptriq ue.
Si deux miroirs B C, D SJig. zg .n. 2. font difpofés
parallèlement l’un à l’autre, on verra une infinité de
fois l’image de l’objet^ placé entre ces deux miroir0;
car foit fait A D égale à D F , il eft d’abord évident
, que l’oeil O verra l’image de l’objet A en F
par une feule réflexion, fa voir, par le rayon O M
A . Soit enfuite F B égale à B L , 8c L D égale à
D H , l’oeil O verra l’objet A en H par trois réfléxions
& par le rayon O S R L A , 8c ainfi de fuite;
de même fi on mene la perpendiculaire A B y8c qu’on
faffe B I égale à A B , D G égale à I D , l’oeil O verra
l’objet A en I par une feule réfléxion , & en G ,
par le rayon O P N A qui a fouffert deux réfléxions.
On trouvera de même les lieux des images de l’objet
vûes par quatre réfléxions , par cinq, par fix ,
par fept, &c, & ainfi à l’infini ; d’où il s’enfuit que
l ’oeil O verra une infinité d’images de l’objet A par
le moyen des miroirs plans parallèles B C , D E ; au
refte , il eft bon de remarquer que dans ce cas 8c
dans celui des miroirs , joints enfemble fous un angle
quelconque, les images feront plus foibles à me-
fure qu’elles feront vues par un plus grand nombre
de réfléxions ; car la réfléxion affoiblit la vivacité
des rayons lumineux.
Il ne fera peut-être pas inutile d’expliquer ici une
obfervation curieufe lur les miroirs plans : quand
on place un objet affez petit, comme une épingle ,
perpendiculairement à la furface d’un miroir , &
qu’on regarde l’image de cet objet en mettant l’oeil
affez près du miroir, on voit deux images au lieu
d’une, l’une plus foible, l’autre plus vive. La première
paroît immédiatement contiguë à l’objet ; de
forte que la pointe de l’image, fi l’objet eft une épingle
, paroît toucher la pointe de l ’épingle véritable;
mais la pointe de la fécondé image paroît un peu
éloignée de la pointe de l’objet, 6c d’autant plus
que la glace eft plus épaiffe. On voit outre cela tr,ès-
fouvent plufieurs autres images qui vont toutes en
s’affoibliffant, & qui font plus ou moins nombreu-
fes, félon la pofition de la glace & de l’oe il, 8c félon
que l’objet eft plus ou moins lumineux. Pour expliquer
ces.phénomenes nous remarquerons, i°. que
de tous les. rayons que l’objet envoie fur la furface
du miroir, il n’y en a qu’une partie qui eft renvoyée
ou réfléchie par cette furface, 8c cette partie meme
eft affez peu confidérable ; car l’image qui paroît la
plus proche de l’objet, & dont l’extrémité eft contiguë
à l’extrémité de l’objet, eft celle qui eft formée
par les rayons que réfléchit la furface du miroir.
Or cette image, comme nous l’avons dit, eft
fouvent affez foible. 20. La. plus grande partie des
rayons qui viennent de l’objet pénètrent la glace 8c
rencontrent fa fécondé, furface dont le derrière eft
étamé, 8c par conféquent les empêche de fortir ;
ces rayons fe réfléchiflent donc au-dedans de la glac
e , & repaflant par la première furface, ils arrivent
à l’oeil du fpeflateur. Or ces rayons font en beaucoup
plus grand nombre que les premiers qui font
immédiatement réfléchis par la première furface. En
effet, le verre ainfi que tous les autres corps a beaucoup
plus de pores que de matière folide ; car l’or
qui eft le plus pelant de tous eft lui-même fort poreux
, comme on le voit par les feuilles d’or minces
qui font tranfparentes , & qui donnent paffage à
l’eau, & l’or eft beaucoup plus pefant que le verre
, d’où il s’enfuit que le verre a beaucoup plus
de pores que de parties propres. De plus, le verre
ayant , félon toutes les apparences , une grande
quantité de pores en ligne droite , fur-tout lorfqu’il
eft peu épais ; il s’enfuit qu’il doit laiffer paffer beaucoup
plus de rayons que la première furface n’en
réfléchit ; mais ces rayons étant arrivés à la fécondé
furface font prefque tous renvoyés, parce qu’elle
eft étamée , 8c lorfqu’ils arrivent de nouveau à la
première furface, la plus grande partie de ces rayons
fort du verre, par la même railon que la plus grande
partie des rayons de l’objet eft entrée au-dedans
du verre. Ainfi, l’image formée par ces rayons doit
être plus vive que la première : enfin, les rayons
qui reviennent à la première furface , après avoir
fouffert une réflexion au-dedans du verre, ne for-
tent pas tous, mais une partie eft réfléchie au-dedans
de la glace par cette première furface , 8c delà
font renvoyés de nouveau par la fécondé , 8c
reffortant en partie par la première furface, ils pro-
duifent une nouvelle image beaucoup plus foible ,
$C ainfi il lë forme plufieurs images de fuite par les
réflexions réitérées des rayons au-dedans de la glac
e , 8c ces images doivent aller toujours en s’affoi-
bliflant.
Les miroirs convexes, font ceux dont la furface eft
convexe ; cette furface eft pour l’ordinaire fphéri-
que.
Les lois des phénomènes des miroirs , foit convexes
, foit concaves , font beaucoup plus compli-*
quées que celles des phénomènes des miroirs plans ,
& les auteurs de Catoptrique font même affez peu
d’accord entr’eux là-deffus.
Une des principales difficultés qu’il y ait à réfoudre
dans cette matière , c’eft de déterminer le lieu
de l’image d’un objet vu par un miroir, convexe ou
concave : or les Opticiens font partagés là-deffus
en deux opinions. La première 8c la plus ancienne,
place l’image de l’objet dans le lieu où le rayon réfléchi
qui va à l’oe il, coupe la cathetc d’incidence
c’eft-à-dire, la perpendiculaire menée de l’objet à
la furface réfléchiffante ; laquelle perpendiculaire ,
dans les miroirs fphériques , n’eft autre chofe que la
ligne menée de l ’objet au cçptre du miroir. Ce qui
a donné naiffance à cette opinion , c’eft qu’on a remarqué
que dans les miroirs plans , le lieu de l’image
étoit toujours dans l’endroit où la perpendiculaire
menée de l’objet fur le miroir, étoit rencontré
par le rayon réfléchi ; on a donc cru qu’il devoit
en être de même dans les miroirs fphériques , & on
s’eft même imaginé que l’expérience étoit affez conforme
à ce fentiment. Cependant le P. Taquet, un
de ceux qui ont le plus foutenu que le lieu de l’image
étoit dans le concours de la cathete 8c du
rayon réfléchi y convient lui - même qu’il y a des
cas où l’expérience eft contraire à ce principe ; malgré
ce la, il ne laiffe pas de l ’adopter, 8c de prétendre
qu’il eft confirmé par l’expérience dans un
grand nombre d’autres cas. Si les auteurs d’optique
qui ont fuivi cette opinion fur le lieu de l’image
avoient approfondi davantage les raifons pour lesquelles
les miroirs plans font toujours voir de l’image
dans le concours de la cathete & du rayon réfléchi
; ils. auroient vu que. dans ces fortes de mU
roiri, le pôïrtt dé côncôuts de la câtheté èt dit râÿôft
Infléchi'; eft aufli le point de concours commun de
tous les râyôns réfléchis , qiie par conféquent des
rayons réfléchis qui entrent dans l’teil , y entrent
comme s’ils venoiént direélement de te point de
concours, & que c’eft pour cette raifon que ce point
de Concours eïLle lieu où l’on âpperçoit l’image.
Or dans les miroirs, foit convexes, foit concaves, lè
point de concours des rayons réfléchis n’eft pas le
même que le point de concours de ces rayons avec
la perpendicuIairCi Ces raifons ont engagé plufieurs
Opticiens à abandonner l’opinion commune fur le
lieu de l’imâge : M. Barrow, Newton, Mufchen-
broeck, &c. prétendent qu’elle doit être dans le lieu
où concourent les rayons réfléchis qui entrent dans
l ’oe il, c’eft-à-dire, à-peu-près dans l’ettdroit où corn
courent deux rayons réfléchis infiniment proches ÿ
venant dé l’objet 8t paffant parla prunelle de l’oeiL
Cependant il faut avouer , 8c Barrow lui-même en
convient à la fin de fon optique, que ce principe ,
quoique fondé fur des raifons plus plaufibles que le
premier , n’êft pas eticôre absolument général, 8c
qu’il y a des cas où l’expérience y eft contraire. Il
eft vrai que dans ces cas, l’image de l’objet paroît
prefque toujours confufe ; ce font ceux où les rayons
réfléchis entrent dans l’oeil convergens, c’eft-à-dire
en fe rapprochant l’un de l’autre, de forte que dans
ces cas on devroit voir l’image derrière fo i, fuivant
le principe , parce que le point de concours des
rayôns eft derrière. Barrow, en rapportant ces expériences
, dit qu’elles ne l’empêchent pas de regarder
comme vraie fon opinion fur le lieu de l’image,
& que les difficultés auxquelles elle peut être fujette
viennent de Ce que l’on ne connoît point encore
parfaitement les lois de la vifion'direâe. En effet,
la difficulté fe réduit ici à favoir, quel devroit être
le lieu appare'nt d’un objet qui nous envoyeroit des
rayons , non pas divergens, mais convergens ; or
comme ces rayons devroient prefque toujours fe
réunir avant d’arriver au fond de l’oe il, il s’enfuit
que la vifion devroit en être fort confufe ; 8c comme
une longue expérience nous a accoutumés à juger
, que les objets que nous voyons, foit confu-
fément, foit diftinétement, font au-devant de nous;
cette image, quoique confufe, nous paroîtroit au-
devant de nous , quoique nous duffions naturellement
la juger derrière ; peut-être expliquéroit-on
p a r- là le phénomène dont il s’agit : quoi qu’il en
foit, On rte fauroit nier que le principe de Barrow
ne foit appuyé fur des raifons bien plus plaufibles
que celui des anciens.
M. Wolf dans fon optique embraffe un fentiment
moyen. Il prétend que quand les deux yeux font
dans le même plan de réflexion, l’objet eft vfî dans
le concours des rayons réfléchis, fuivant l’opinion
de BafroW , mais que quand les yeux font dans dif-
férens plans, ce qui arrive prefque toujours , l’objet
eft vu dans le concours de rayon réfléchi avec
la cathete. Voici comme il démontre cette derniere
propofition: foient , dit-il (7%. 3 8. de ÛOpt. ) G, H,
les deux yeux, A , l’objet, A F la cathete d’incidence
, & A D G un rayon réfléchi qui concoure
avec la cathete en C ; le rayon réfléchi A E H qui
paffe par l’oeil H , concourra aufli au même point
C , 8c par conféquent l’objet fera vu en C ; mais
i ° . cette démonftration fuppofe que les rayons réfléchis
E H 9 G D , font dans le même plan, ce qui
eft fort rare ; 20. la propofition eft fauffe lors même
qu’ils y font: car alors on ne devroit voir qu’une
leule image de l’objet A , cependant il y a des cas
où l’on en voit deux. Foyeç Barrow , lec. iS.
30. pourquoi l’auteur veut-il que l ’on voye l’objet
dans l’endroit où les rayons D G , H E concourent?
.Cela feroit v ra i, fi tous les rayons qui vont à l’oeil
G ét à I’fteîï H partoient du point C , 'comme il arrive
dans la vifion direfte, 8c l’objet feroit alors vu
én C , non parce que les axes optiques G D , H È
éoncouïroient en C , mais parce que tous les rayons
qui entrevoient dans chacun des yeux partiroient
du point C : o r , dans le cas prefent, ils n’en partent
pas. Il n’y a donc point de raifon pour que l ’objet
paroiffe en <7*
Nous avons crû devoir expofer ici avec quelque
étendue, cës différentes opinions : nous allons marquer
le plus fuccinftement qu’il nous fera poffible *
l’explication des différens phénomènes des miroirs
courbes, fuivant le principe des anciens, 8c nous
en marquerons en même-téms l’explication dans le
principe de Barrow , afin qu’on juge de la différence
, 8c qu’on puiffe décider auquel des deux l’expérience
eft le plus conforme. Nous remarquerons
d’abord , qu’il y a bien des cas où ces deux principes
s’accordent à-peu-près : par exemple , lorfque
Pobjct eft fort près de l’oeil, c’eft à-dire que l’oeil
eft prefque dans la cathete , le point de concours
des rayons réfléchis eft à-peu-près le même que lë
point de concours de ces rayons avec la cathete ;
ainfi le lieu de l’image eft alors à-peu-près le même
dans les deux principes. Voye%_ D io ptr iq u e *
Lois & phénomènes des miroirs cônvexes, i°. Dans
un miroir convexe fphériqüe , l’image d’uri point radieux
paroît entre le centre 8c la tangente du /ni-
roir fphériqüe au point d’incidence , mais plus près
dé la tangente que du centre , ce qui fait que la dif-
tancé de l’objet à la tangente eft plus grande que
celle de l’image, 8c par conféquent que l’objet eft
plus loin du miroir que l’image.
20. Si l’arc BD (Jîg.31.) intercepté entre le point
d’incidence D 8c la cathete A B , ou l’angle C formé
au centre du miroir par la cathete d’incidence
A C , & celle à'obliquation F C eft double de l’angle
d’incidence , l’image paroîtra fur la furface du miroir.
30. Si cet arc ou cet angle font plus que doubles
de l’angle d’incidence, l ’image fe verra hors du mi-
Suivant le principe de Barrow, le lieu de l’image
dans les miroirs convexes eft toujours au-dedans du
miroir, parce que le point de concours des rayons
réfléchis n’eft jamais hors du miroir. Ainfi, voilà déjà
un moyen de décider lequel des deux principes
s’accorde le plus avec les obfervations. Le P. De-
chals dit, qu’après en avçir fait l’expérience plu-*
fleurs fois, il ne peut affurer là-deffus rien de pofi-
tif. Mais M. W olf en propofe une dans laquelle ori
voit clairement, félon lu i , l’image hors du miroir.
Il prétend qu’ayant pris un fil d’argent A B C courbé
en équerre (fig. 38. n°. 3. d'Qpt. ) 8c l’ayant expofé
à un miroir convexe de telle forte, que la partie A
B étoit fituée très - obliquement à la furface du miroir
, il a vu clairement l’image du fil B A contiguë
à ce même fil, quoique le fil B A ne touchât point
le miroir.
40. Si cet arc ou cet angle font moins que doubles
de l’angle d’incidence, l’image paroîtra en de-*
dans du miroir.
ç°. Dans un miroir cônvexét un point A plus éloigné
eft réfléchi par un point .F plus préside i’oeil
O que tout autre point B , fitué dans une même cathete
d’incidence ; d’où il s’enfuit, que fi le point A
de l’objet eft réfléchi par lé point F du miroir , &
que le point B de l’objet le foit par le point E' du
miroir, tous les points intermédiaires entre A 8c B
dans l’objet , feront réfléchis par les points intermédiaires
entre F 8c E : 8c ainfi F E fera la ligne
qui réfléchira A B , 8c par conféquent un point B
de la cafhete femble à une plus grande diftance C