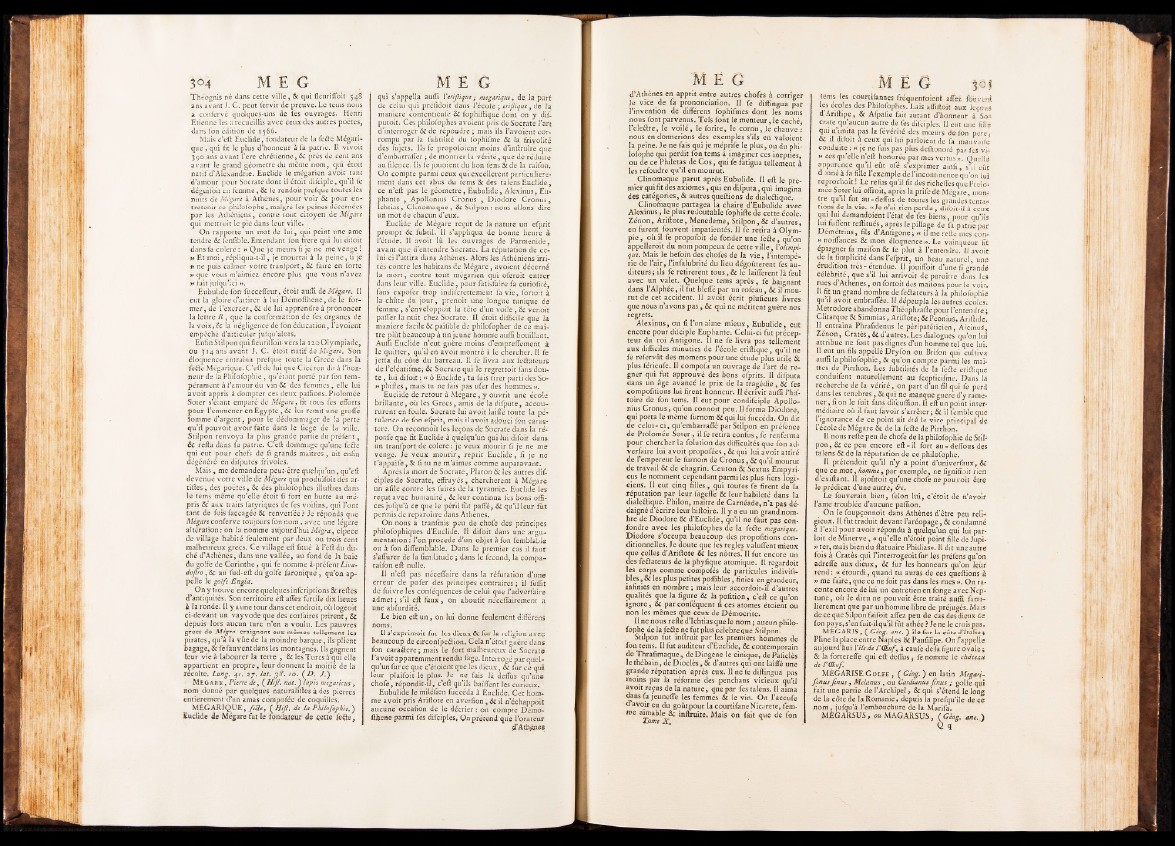
S04 M E G
Théognis né dans cette ville , & qui fleurifloit 548
ans avant J. C. peut fervir de preuve. Le tems nous
a confervé quelques-uns de les ouvrages. Henri
Etienne les a recueillis avec ceux des autres poëtes,
dans Ton édition de 1566.
Mais c’eft: Euclide, fondateur de la feûe Mégari-
que, qui fit le plus d’honneur à fa patrie. Il vivoit
390 ans avant l’ere chrétienne, 6c près de cent ans
avant le grand géomètre du même nom, qui étoit
natif d’Alexandrie. Euclide le mégarien avoit tant
d’amour pour Socrate dont il étoit difciple, qu’il le
déguifoit en femme, & le rendoit prefque toutes les
nuits de Mégare à Athènes, pour voir 6c pour entretenir
ce philofophe, malgré les peines décernées
par les Athéniens, contre tout citoyen de Mègarc
qui mettroit le pié dans leur ville. .
On rapporte un mot de lui, qui peint une ame
tendre 6c fenfible. Entendant fon frere qui lui difoit
dans fa colere : « Que je meurs fi je ne me venge !
» Et m oi, répliqua-t-il, je mourrai à la peine, fi je
t> ne puis calmer votre tranfport, 6c faire en forte
» que vous m’aimiez encore plus que vous n’avez
» fait jufqu’ici ».
Eubulide fon fucceffeur, étoit aulîi de Mégare. Il
eut la gloire d’attirer à lui Démolihe.ne, de le former,
de l’exercer, 6c de lui apprendre à prononcer
la lettre R , que la conformation de fei. organes de
la voix, 6c la négligence de fon éducation, l’avoient
empêché d’articuler jufqu’alors.
EnfinStilpon qui fieu rilfoit- vers la noOlympiade,
ou 314 ans avant J. C. étoit natif de Megan. Son
éloquence entraîna prefque toute la Grece dans la
feéle Mégarique. C ’eft de lui que Cicéron dir à l ’honneur
de la Philofophic , qu’étant porté par fon tempérament
à l’amour du vin 6c des femmes , elle lui
avoit appris à dompter ces deux pallions. Ptolomée
Soter s’étant emparé de Megan, fit tous fes efforts
pour l’emmener en Egypte ,6c lui remit une groffe.
lomme d’argent, pour le dédommager de la perte
qu’il pouvoit avoir faite dans le liege de la ville.
Stilpon renvoya la plus grande partie du préfent,
& refia dans fa patrie. C ’eft dommage qu’une feftc
qui eut pour chefs de fi grands maîtres, ait enfin
dégénéré en difputes frivoles.
Mais, me demandera peut-être quelqu’un, qu’eft
devenue votre ville de Mégare qui produifoit des âr-
tiftes, des poëtes, 6c des philofophes illuftres dans
le tems même qu’elle étoit fi fort en butte au mépris
6c aux traits faryriques de fes voifins, qui l’ont
tant de fois Taccagée 6c renverfée? Je réponds que
Mégare conferve toujours fon nom, avec une légère
altération: on la nomme aujourd’huiMégra, efpece
de village habité feulement par deux ou trois cent
malheureux grecs. Ce village eft fitué à l’eft du duché
d’Athènes, dans une vallée, au fond de la baie
du golfe de Corinthe, qui fe nomme à-préfentAiv<z-
doßro, & au fud-eft du golfe faronique, qu’on appelle
le golfe Engia.
On y trouve encore quelques infcriptions & refies
d’antiquités. Son territoire eft affez fertile dix lieues
à la ronde. Il y a une tour dans cet endroit, où logeoit
ci-devant un vayvode que des corfaires prirent, 6c
depuis lors aucun turc n’en a voulu. Les pauvres
grecs de Mégra craignent eux-mêmes tellement les
pirates, qu’à la vue de la moindre barque, ils plient
bagage, & fe fau vent dans les montagnes. Ils gagnent
leur vie à labourer la terré , & les Turcs à qui elle
appartient en propre, leur donnent la moitié de la
récolte. Long. 41. 2 j . lat. $8. 10. (Z>. ƒ.)
Meg AR E, Pierre de, ( Litß. nat. ) lapis megaricus ,
nom donné par quelques naturaliftes à des pierres
entièrement d’un amas compofée de coquilles.
MEGARIQUE, fecte, (H iß . de la Philofophie. )
Euclide de Mégare fut le fondateur de cette feéle,
M E G
qui s*appella aufli Verijlique ; megarique, de la part
de celui qui préfidoit dans l’école ; eriflique, de la
maniéré contentieufe 6c fophiftique dont on y difi
putoit. Ces philofophes avoient pris de Socrate l’art
d’interroger 6c de répondre ; mais ils i’avoient corrompu
par la fubtilité du fbphifme 6c la frivolité
des fujets. Ils fe propofoient moins d’inftruire que
d’embarrafler ; de montrer la vérité, que de réduire
au filence. Ils fe jouoient du bon fens & de la raifon.
On compte parmi ceux qui excellèrent particulièrement
dans cet abus du tems & des talens Euclide,
ce n’eft pas le géomètre, Eubulide, Alexinus, Eu-
phante , Apollonius Cronus , Diodore Cronus,
Ichtias, Clinomaque, & Stilpon : nous allons dire
un mot de chacun d’eux.
Euclide de Mégare reçut de la nature un efprit
prompt 6c fubtil. Il s’appliqua de bonne heure à
l’étude. Il avoit lû les ouvrages de Parmenide,
avant que d’entendre Socrate. La réputation de celui
ci l’attira dans Athènes. Alors les Athéniens irrités
contre les habitans de Mégare, avoient décerné
la mort, contre tout mégarien qui oferoit entrer
dans leur ville. Euclide, pour fatisfaire fa curiofité,
fans expofer trop indiicrettement fa v ie , fortoit à
la chûte du jour, prenoit une longue tunique de
femme, s’enveloppoit la tête d’un voile, 6c venoit
palier la nuit chez Socrate. Il étoit difficile que la
maniéré facile 6c paifible de philofopher de ce maître
plût beaucoup à un jeune homme aulfi bouillanr.
Aufli Euclide n’eut guère moins d’empreflement à
le quitter, qu’il en avoit montré à le chercher. Il fe
jetta du côté du barreau. Il Te livra aux fe&ateurs
de l’eléatifme; 6c Socrate qui le regrettoit fans doute
, lui difoit : « ô Euclide , tu fais tirer parti des So-*
» phiftes, mais tu ne fais pas ufer des hommes ».
Euciide de retour à Mégare, y ouvrit une école
brillante, où les Grecs, amis de la difpute, accou- •
rurent en foule. Socrate lui avoit laifîe toute la pé-
tulence de fon efprit, mais il avoit adouci fon caractère.
On reconnoît les leçons de Socrate dans la ré-
ponfe que fit Euclide à quelqu’un qui lui difoit dans
un tranfport de colere : je veux mourir fi je ne me
venge. Je veux mourir, reprit Euclide, fi je ne
t ’appaife,& fi tu ne m’aimes comme auparavant.
Après la mort de Socrate, Platon 6c les autres disciples
de Socrate, effrayés, cherchèrent à Mégare
un afile contre les fuites de la tyrannie. Euclide les
reçut avec humanité, 6c leur continua fes bons offices
jufqu’à ce que le péril fût pafle, 6c qu’il leur fût
permis de reparoître dans Athènes.
On nous a tranfmis peu de chofe des principes
philofophiques d’Euclide. Il difoit dans une argumentation
: l’on procédé d’un objet à fon femblable
ou à fon difîemblable. Dans le premier cas il faut
s’aflùrer de la fimilitude ; dans le fécond, la compa-
raifon eft nulle.
Il n’eft pas nécefîaire dans la réfutation d’une
erreur de pofer des principes contraires ; il fuffit
de fuivre les conféquences de celui que l’aclverfaire
admet ; s’il eft faux, on aboutit néceflairement a
une abfurdité.
Le bien eft un, on lui donne feulement différens
noms.
Il s’exprimoit fur les dieux & fur la religion avec
beaucoup de circonfpeûion. Cela n’étoit guère dans
fon caraâere; mais le fort malheureux de Socrate
l ’a voit apparemment rendu fage. Interrogé par quelqu’un
fur ce que c’étoient que les dieux, & fur ce qui
leur plaifoit le plus. Je ne fais là deflùs qu’une
chofe, répondit-il, c’eft qu’ils haïflent les curieux.
Eubulide le miléfien fuccéda à Euclide. Cet homme
avoit pris Ariftote en averfion, 6c il n’échappoit
aucune occafion de le décrier : on compte Démo-
ftftene parmi fes difçiples, Qn prétend que l’orateur
.d’Athènes
‘M E G
d’Athènes en apprit entre autres chofes à corriger
le vice de fa prononciation; Il fe diftingua par
l’invention de différens fophifmés dont les noms
nous font parvenus. Tels font le menteur, le caché;
l ’e ledre, le v o ilé , le forite, le cornu, je chauve :
nous en donnerions des exemples s’ils en valoient
la peine. Je ne fais qui je méprife le plus, ou du philofophe
qui perdit fon tems à imaginer ces inepties,
ou de ce Philetas de C o s , qui fe fatigua tellement à
les refoudre qu’il en mourut.
Clinomaque parut après Eubulide. Il eft le premier
qui fit des axiomes, qui en difputa, qui imagina
des catégories, & autres queftions de diaieâique.
Clinofhaque partagea la chaire d’Eubulide avec
Alexinus, le plus redoutable fophifte de cette école.
Zénon* Ariftote, Menedeme* Stilpon, & d’autres,
en furent fouvent impatientés. Il fe retira à Olym-
p ie , où il fe propofoit de fonder une feéte, qu’on
àppelleroit du nom pompeux de cette v ille, Yolimpi-
que. Mais le befoin des chofes de la v ie , l’intempérie
de l’a ir, l’infalubrité du lieu dégoûtèrent fes auditeurs
; ils fe retirèrent tous, 6c le laiflerent là feul
avec un valet. Quelque tems après, fe baignant
dans l’Alphée, il fut bleffé par un rofeau, 6c il mourut
de cet accident. Il avoit écrit plufieurs livres
que nous n’avons pas, & qui ne méritent guère nos
regrets.
Alexinus, ou fi l’on aime mieux, Eubulide, eut
encore pour difciple Euphante. Celui-ci fut précepteur
du roi Antigone. Il ne fe livra pas tellement
aux difficiles minuties de l’école eriftique, qu’il ne
fe refervât des momens pour une étude plus utile &
plus férieufe. Il compofa un ouvrage de l’art de régner
qui fut approuvé des bons efprits. Il difputa
dans un âge avancé le prix de la tragédie, 6c fes
compofitions lui firent honneur; Il écrivit aufli l’hif-
toire de fon tems. Il eut pour condifciple Apollonius
Cronus, qu’on connoit peu. Il forma Diodore,
.qui porta le même furnom & qui lui fuccéda. On dit
de celui - c i, qu’embarrafle par Stilpon en préfenee
de Ptolomée Soter, il fe retira confus, fe renferma
pour chercher la folution des difficultés que fon ad-
verfaire lùi avoit propofées , 6c qui lui avoit attiré
de l’emperetir le furnom de Cronus, 6c qu’il mourut
de travail 6c de chagrin. Ceuton 6c Sextus Empyri-
cus le nomment cependant parmi les plus fiers logiciens.
Il eut cinq filles, qui toutes fe firent de°la
réputation par léur fageflè & leur habileté dans la
dialeétique. Philon, maître de Carnéade, n’a pas dédaigné
d’écrire leur hiftoire. Il y a eu un grand nombre
de Diodore 6c d’Euclide, qu’il ne faut pas con- j
fondre avec les philofophes de la lè fte megarique.
Diodore s’occupa beaucoup des propofitions conditionnelles.
Je doute que fes réglés valuflent mieux
que celles d’Ariftote & les nôtres. Il fut encore un
des feôateurs de la phyfique atomique. Il regardoit
les corps comme compofés de particules indivifi-
bles, 6c les plus petites poflibles, finies en gfandeur,
infinies en nombre ; mais leur accordoit-il d’aütres
qualités que la figure 6c la pofition, c’eft ce qu’on
ignore, & par conféquent fi ces atomes éteient ou
non les mêmes que ceux de Démocrite.
Il ne nous refte d’Ichtias que le nom ; aucun philofophe
de la feéte ne fut plus célébré que Stilpon.
Stilpon fut inftruit par les premiers hommes de
Ton tems. Il fut auditeur d’Euelide, 6c contemporain :
de Thrafimaque , deDiogene le cinique, de Pàficlès !
le thébain, de Dioclès, & d’autres qui ont laifle une
grande réputation après eux. Il ne le diftingua pas !
moins par la réforme des penchans vicieux qu’il j avoit reçus de la nature, que par fes talens. Il aima :
dans fa jeunefle les femmes & le vin. On l’accufe
d avoir eu du goût pour la courtifane Nicarete, femme
aimable & inftruite. Mais on fait que de fon I
Tome AT,
;MÊ G m
tèms les courtifannes fréquentoient allez ftjüvëht
les écoles des Philofophes. Lais afliltoit aux leçons
d Ariftipe, & Afpâfie fait autant d’honneur à So-
crate^qu’aucun autre de fes difçiples; Il eut une filië
qui n’imita pas la févérité des moeurs de fôn pere*
6c il difoit à ceux qui lui parlôient de fa mauvaife
conduite : « je ne fuis pas plus defhonoré par fes vi-
» ces qu elle n’eft honorée par mes vertus». Quelle
apparence qu’il eût ofë s’exprimer ainfi, s’il eût
dmnéà fa fille l’exemple de l’incontinence qu’on lui
reprochoit ! Le refus qu’il fit des richefles que Ptoldi
mée Soter lui offroit, après la prife dû Mégare, mon-
tre qu’il fut ^au-deflùs de toutes les grandes tentai
tions de la vie. «Je n’ai rien perdu, difoit-il à ceux
qui lui demandoiént l’état de fes biens, pouf qu’ils
lui fuflent reftitués, après le pillage de fa patrie par
Démétrius, fils d’Antigone ; « il me refte mes con-
» noiflances & mon éloquence ». Le vainqueur fit
épargner fa maifon & fe plut à l’entendre. Il avoit
de la fimplicité dans l’efprit, un beau naturel, une
très - etendue. Il jouifloit d’une fi grande
célébrité, que s’il lui arrivoit de paroître dans le,s
rues d’Athenes, on fortoit des mailbns pour le voir;
II fit Un grand nombre de fettateurs à la philofophië
qu’il avoit embraflee. II dépeupla les autres écoles;
Metrodore abandonna Théophrafte pour l ’entendre ;
Clitafque & Simmias, Ariftote; & Peonius, Ariftide.
II entraîna Phrafidenus le péripatéticien, Âicinu$,
Zenon, Crates, 6c d’autres. Les dialogues qu’on lui
attribue ne font pas dignes d’un homme tel que lui;
II eut un fils appelle Dryfon ou Brifon qui cultiva
aufli la philofophie, & qu’on compte parmi les maîtres
de Pirrhon. Les fubtilités de là feftë eriftiquë
conduifent naturellement au fcepticifme. Dans là
recherche de la vérité, on part d’un fil qui fe perd
dans les tetiebres, & qui île manque guere d’y ramener
, fi on le fuit fans difeuflion. Il eft un point inter^
médiaire où il faut favoir s’arrêter ; & il femble qué
l’ignorance de ce point ait été le vice principal dô
l’école de Mégare 6c de la feâe de Pirrhon.
Il nous refte peu de chofe de la philofophie de StiL
pon, & ce peu encore eft - il fort au - deflous dçs
talens & de la réputation de ce philofophe.
Il prétendoit qu’il n’y a point d’univerfaux, &C
que ce mot, homme, par exemple, ne fignifioir rien
d’exiftant. Il ajoûtoit qu’une chofe ne pouvoit être
le prédicat d’une autre, &c.
Le fouverain bien, félon lui, c ’étôit de h’avoif
l’ame troublée d’aucune paflîon.
On le foupçonnoit dans Athènes d’être peu reli-»
gieux. Il fût traduit devant l’aréopage, 6c condamné
à l ’exil pour avoir répondu à quelqu’un qui lui par-
loit de Minerve, « qu’elle n’étoit point fille de Jupi-
>> ter, mais bien du ftatuaire Phidias». Il dit une autre
fois à Cratès qui l’interrogéoitfur les préfens qu’on
adrefle aux dieux, 6c lur les honneurs qu’on leùr
rend : « étourdi, quand tu auras de ces queftions à
» me faire, qüe ce ne fëit pas dans les rues ». On raconte
encore de lui un entretien en fonge avec Neptune,
où le dieu ne pouvoit être traité aufli familièrement
que par un homme libre de préjugés. Mais
de ce que Silpon faifoit allez peit de cas des dieux de
fon pays, s’en fuit-il qu’il fût athée ? Je ne le eroispas.
MÉGARIS, ( Géog. ané. ) île fur la côte d’Italie ;
Pline la place entre Naples 6c Paufilipe. On l’appelle
aujourd’hui P île de P OEuf, à caufe de fa figure ovale;
& la forterefle qui eft deflùs * fe nomme le château
de P OEuf
MÉGAR1SE Golfe , ( Géog. ) en latin Megar\-
fenus Jinus , Melanus, ou Cardianus jinus ; golfe qui
. fait une partie de l’Archipel, 6c qui s’étend le long
de la côte de la Romanie, depuis la prefqu’île de ce
nom, jufqu’à l'embouchure de la Marifa.
MÉGARSUS, MAGARSUS, ( Géog. anc. )
Q q