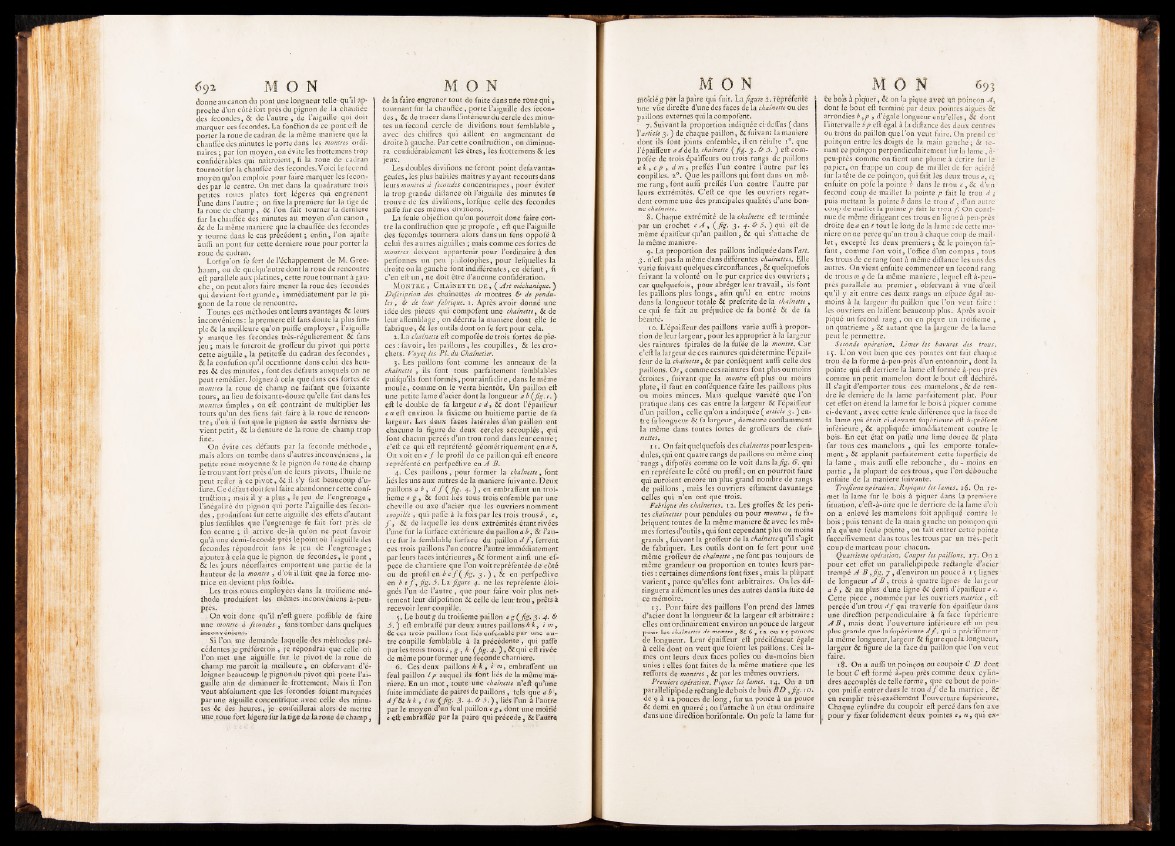
donne au canon du pont une longueur telle- qu’il ap- 1
proche d’un côté fort près du pignon de la chauiïée
des fécondés, & de l’autre , de l’aiguille qui doit :
marquer ces fécondés. La fonûion de ce pont eft de
porter la roue de cadran de la même maniéré que la
chauffée des minutes le porte dans les montres ordinaires
; par fon moyen, on évite les frottemens trop
conlidérables qui naîtroient, fi la roue de cadran
tournoitlur la chauffée des fécondés. Voici le fécond
moyen qu’on emploie pour faire marquer les fécondés
par le centre. On met dans la quadrature trois
petites roues plates fort légères qui engrenent
l’une dans l'autre ; on fixe la première fur la tige de
la roue de champ, 8c l’on fait tourner la derniere
fur la chauffée des minutes au moyen d’un canon ,
& de la même maniéré que la chauffée des fécondés
y tourne dans le cas précédent ; enfin, l’on ajufte
aufli un pont fur cette derniere roue pour porter la
roue de cadran.
Lorfqu’on fe fert de l’échappement de M. Gree-
baam, ou de quelqu’autre dont la roue de rencontre
eft parallèle au* platines, cette roue tournant à gauche
, on peut alors faire mener la roue des fécondés
qui devient fort grande, immédiatement par le pignon
de la roue de rencontre.
Toutes ces méthodes ont leurs avantages 8c leurs
inconvéniens : la première eft fans doute la plus fim-
ple &c la meilleure qu’on puiffe employer, l’aiguille
y marque les fécondés très-régulierement & fans
jeu ; mais le lurcroit de groffeur du pivot qui porte
cette aiguille , la petiteffe du cadran des fécondés,
& la confufion qu’il occafionne dans celui des heures
8c des minutes, font des défauts auxquels on ne
peut remédier. Joignez à cela que dans ces fortes de
montres la roue de champ ne faifant que foixante
tours, au lieu defoixante-douze qu’elle fait dans les
montres fimples , on eft contraint de multiplier les
tours qu’un des fiens fait faire à la roue de rencontre,
d’où il fuit que le pignon de cette derniere devient
petit, & la denture de la roue de champ trop
fine.
On évite ces défauts par la fécondé méthode,
mais alors on tombe dans d’autres inconvéniens, la
petite roue moyenne & le pignon de roue de champ
fe trouvant fort près d’un de leurs pivots, l’huile ne
peut refter à ce pivot, 8c il s’y fait beaucoup d’u-
fure. Ce défaut doitfeul faire abandonner cette conf-
truttion ; mais il y a plus , le jeu de l’engrenage ,
l’inégalité du pignon qui porte l’aiguille des fécondés
, prodififent fur cette aiguille des effets d’autant
plus fenfibles que l’engrenage fe fait fort près de
ion ceiitre ; il arrive de-là qu’on ne peut favoir
qu’à une demi-feconde près le point oit l’aiguiJle des
fécondés rçpondroit fans le jeu de l’engrenage ;
ajoutez à cela que le pignon de fécondés, le pont,
8c les jours néceffaires emportent une partie de la
hauteur de la montre , d’où il fuit que la force motrice
eu devient plus fpible-
Les trois roues employées dans la troifieme méthode
produifent les mêmes inconvéniens à-peu-
près.
; On vqit donc qu’il n’eft guère poffible de faire
une montre à fécondés , fans tomber dans quelques
inconvéniens.
Si l’on me demande laquelle des méthodes précédentes
je préférerois, je répondrai que celle où
l’on une aiguille fur. le pivot de la roue de
champ me paroît la meilleure , en obfervant d’éloigner
beaucoup lç pignon du pivot qui porte l’aiguille
afin de diminuer le frottement, Mais fi l’on
veut absolument que les fécondés foient marquées
par une aiguille concentrique, avec celle des minutes
8c des heures.,, je eonfejllerai alors de mettre
ppe roue fort légère fur la tige de la roue de champ,
de la faire engrener tout de fuite dans nrte roue qui,
tournant fur la chauffée, porte l’aiguille des fécondés
, 8c de tracer dans l’intérieur du cercle des minutes
un fécond cercle de divifions, tout femblable ,
avec des chiffres qui aillent en augmentant de
droite à gauche. Par cette conftruâion, on diminuera
confidérablement les êtres, les frottemens & les
jeux.
Les doubles divifions ne feront point defavanta-
geufes, les plus habiles maîtres y ayant recours dans
leurs montres à fécondés concentriques, pour éviter
la trop grande diftance où l’aiguille des minutes fe
trouve dé fes divifions, lorfque celle des fécondés
paffe fur ces mêmes divifions.
La feule objeôion qu’on pourroit donc faire contre
la conftru&ion que je propofe , eft que l’aiguille
des fécondés tournera alors dans un fens oppofé à
celui des autres aiguilles ; mais comme ces fortes de
montres doivent appartenir pour l’ordinaire à des
perfonnes un peu pùilofophes, pour lefquelles la
droite ou la gauche font indifférentes, ce défaut, li
c’en eft un, ne doit être d’aucune confidération.
Montre , C haînette de , ( Art méchanique. )
Defcription des chaînettes de montres & de pendules
, & de leur fabrique, i . Après avoir donné une
idée des pièces qui compofent une chaînette, & de
leur affemblage, on décrira la maniéré dont elle fe
fabrique , 8c les outils dont on fe fert pour cela.
i . La chaînette eft compofée de trois fortes de pièces
: favoir, les paillons, les coupilles, & les crochets.
Voye{ les PI. du Chainetier.
3. Les paillons font comme les anneaux de la
chaînette , ils font tous parfaitement femblables
puifqu’ils font formés , pour ainfi dire, dans le même
moule, comme on le verra bientôt. Un paillon eft
une petite lame d’acier dont la longueur a b (fig. 1. )
eft le double de fa largeur c d , 8c dont l’épaiffeur
en eft environ la fixieme ou huitième partie de fa
largeur. Les deux faces latérales d’un paillon ont
chacune la figure de deux cercles accouplés, qui
font chacun percés d’un trou rond dans leur centre;
c’eft ce qui eft repréfenté géométriquement en a b.
On voit en e ƒ le profil de ce paillon qui eft encore
repréfenté en perfpe&ive en^f B.
4. Ces paillons, pour former la chaînette, font
liés les uns aux autres de la maniéré fuivante. Deux
paillons a b , d f (fig. 4. ) , en embraffent un troifieme
e g , & font liés tous trois enfemble par une
cheville ou axe d’acier que les ouvriers nomment
coupille , qui paffe à la fois par les trois trous b , e,
ƒ , 8c de laquelle les deux extrémités étant rivées
l’iine fur la furface extérieure du paillonab, & l’autre
fur la femblable furface du paillon d f , ferrent
ces trois paillons l’un contre l’autre immédiatement
par leurs faces intérieures, 8c forment ainfi une ef-
pece de charnière que l’on voit repréfentée de côté
ou de profil en b e ƒ ( fig. 3 . ) , & en perfpe&ive
en b e f , fig. 5. La figure 4. ne les repréfente éloignés
l’un de l’autre, que pour faire voir plus nettement
leur difpofition 8c celle de leur trou, prêts à
recevoir leur coupille.
5. Le bout g du troifieme paillon eg (fig. 3 . 4. &
5. ) eft embraffé par deux autres paillons h k, i m,
6c ces trois paillons font liés enfemble par une autre
coupille femblable à la précédente, qui paffe
par les trois trous i , g , h ( fig. 4. ) , 8c qui eft rivée
de même pour former une fécondé charnière.
6. Ceç deux paillons h k , i m, embraffent un
feul paillon l p auquel ils font liés de la même maniéré.
En un mot, toute une chaînette n’eft qu’une
fuite immédiate de paires de paillons, tels que a b ,
d f& ch k , i m (fig- 3- 4- & 5. ) , liés l’un à l’autre
par le moyen d’un feul paillon eg, dont une moitié
e eft embraflec par la paire qui précédé, 8c l’autre
ffiôitïég pair là paire qui fuit. La figure à.. rëpréfenfê
tme vue direfte d’une des faces de la chaînette ou des
paillons externes qui la compofent.
7. Suivant la proportion indiquée ci deffus ( dans
ï’article 3 . ) de chaque paillon, 8c fuivant la maniéré
dont ils fônt joints enfemble, il en réfulte i°. que
l’épaiffeur a a? de la chaînette (fig. 3. & 6. ) eft compofée
de trois épaiffeurs ou trois rangs de paillons
ak , c p , dm , preffés l ’un contre l’autre par les
coupilles. 20. Que les paillons qui font dans un même
rang, font aufli prefles l ’un contre l’autre par
leurs extrémités. C’eft ce que les ouvriers regardent
comme une des principales qualités d’nne bonne
chaînette.
8. Chaque extrémité de la chaînette eft terminée
par un crochet c A , (fig. '3. 4. & S . ) qui eft de
même épaiffeur qu’un paillon, 8c qui s’attache de
la même maniéré.
9. La proportion des paillons indiquée dans Y art.
3 . n’eft pas la même dans différentes chaînettes. Elle
varie fuivant quelques circonftances, & quelquefois
fuivant la volonté ou le pur caprice des ouvriers ;
car quelquefois, pour abréger leur travail, ils font
les paillons plus longs , afin qu’il en entre moins
dans la longueur totale 8c prelcrite de la chaînette ,
ce qui fe fait au préjudice de fa bonté 8c de fa
beauté.
10. L’épaiffeur des paillons varie aufli à proportion
de leur largeur, pour les approprier à la largeur
des rainures fpirales de la füfée de la montre. Car
c ’eft la largeur de ces rainures qui détermine l’épaiffeur
de la chaînette, 8c par confécjuent aufli celle des
paillons. O r , comme ces rainures font plusoumoins
étroites , fuivant que la montre eft plus ou moins
plate, il faut en conféquence faire les paillons plus
ou moins minces. Mais quelque variété que l ’on
pratique dans ces cas entre la largeur 8c l’épaiffeur
d’un paillon, celle qu’on a indiquée ( article 3 . ) entre
fa longueur 8c fa largeur, demeure conftamment
la même dans toutes fortes de grofleurs de chaînettes.
11. On fait quelquefois des chaînettes pour les pendules,
qui ont quatre rangs de paillons ou même cinq
* r angs, difpofés comme on le voit dans la fig. 6. qui
en repréfente le côté ou profil ; on en pourroit faire
qui auroient encore un plus grand nombre de rangs
de paillons , mais les ouvriers eftiment davantage
celles qui n’en ont que trois.
Fabrique des chaînettes. 12. Les groffes 8c les petites
chaînettes pour pendules ou pour montres, fe fabriquent
toutes de la même maniéré 8c avec les mêmes
fortes d’outils, qui font cependant plus ou moins
grands , fuivant la groffeur de la chaînette qu’il s’agit
de fabriquer. Les outils dont on fe fert pour une
même groffeur de chaînette, ne font pas toujours de
même grandeur ou proportion en toutes leurs parties
: certaines dimenfions font fixes, mais la plupart
Varient, parce qu’elles font arbitraires. On les dif-
tinguera aifément les unes des autres dans la fuite de
ce mémoire,
13. Pour faire des paillons l’on prend des lames
d’acier dont la longueur 8c la largeur eft arbitraire :
elles ont ordinairement environ un pouce de largeur
pour les chaînettes de montre , 8 c 6 , 12 ou 15 pouces
de longueur. Leur épaiffeur eft précifément égale
à celle dont on veut que foiént les paillons. Ces lames
ont leurs deux faces polies ou du-moins bien
unies i elles font faites de la même matière que les
refforts de montres , 8c par les mêmes ouvriers.
Première opération. Piquer les lames. 14. On a un
parallelipipede re&angle de bois de buis BD ,fig. / o .
de 9 à 12 pouces de long, fur un pouce à un pouce
8c demi en quarré ; on l’attache à un étau ordinaire
dans-ùne direttion horifontale. On pofe la lame fur'
6e bois a piquer, &c oh ja piqué avec un poinçon A ,
dont le bout eft terminé pâr deux pointes aiguës 8c
arrondies b ,p -, d^égale longueur entr’elles, 8c dont
l’intervalle bp eft égal à la diftance des deux centres
ou trous du paillon que Lon veut faire, On prend ce
poinçon entre les doigts de la main gauche ; 8c tenant
ce poinçon perpendiculairement fur la lame , à-
peu-près comme on tient une plume à écrire fur le
papier, on frappe un coup de maillet de fer âciéré
fur la tête de ce poinçon, qui fait les deux trous feî c;
enfuite ôn pofe la pointe b dans le trou c , 8c d’un
fécond coup de maillet la pointe p fait le troii d ;
puis mettant la pointe b dans le trou d , d’un autre
coup de maillet la pointe /»'fait le trou f . On continue
de même dirigeant ces trous en ligne à-peu-près
droite de a en t tout le long de la lame : de cette maniéré
on ne perce qu’un trou à chaque coup de maillet
, excepté les deux premiers ; 8c le poinçon faifant
, comme l’on vo it, l’office d’un compas , tous
les trous de ce rang font à même diftance les uns des
autres. On vient enfuite commencer un fécond rang
de trous m q de la même maniéré, lequel eft à-peu-
près parallèle au premier, obfervant à vue d’oeil
qu’il y ait entre ces deux rangs un efpace égal au-
moins à la largeur du paillon que l’on veut faire :
les ouvriers en laifl’ent beaucoup plus. Après avoir
piqué un fécond rang , on en pique un troifieme ,
un quatrième , 8c autant que la largeur de la lame
peut le permettre.
Seconde opération. Limer lés bavures des trous i
15. L’on voit bien que ces pointes ont fait chaque
trou de la forme à-peu-près d’un entonnoir, dont la
pointe qui eft derrière la lame eft formée à-peu-près
comme un petit mamelon dont le bout eft déchiré.
Il s’agit d’emporter tous ces mamelons, 8c de rendre
le derrière de la lame parfaitement plat. Pour
cet effet on étend la lame fur le bois à piquer comme
ci-devant, avec cette feule différence que la face de
la lame qui étoit ci-devant fupérieure eft à-préfent
inférieure, 8c appliquée immédiatement contre le
bois. En cet état on paffe une lime douce 8c plate
fur tous ces mamelons , qui les emporte totalement
, 8c applanit parfaitement cette fuperficie de
la lame , mais aufli elle rebouche , du - moins en
partie , la plupart de ces trous, que l’on débouche
enfuite de la maniéré fuivante.
Troifieme opération. Repiquer les lames. 16. On remet
la lame fur le bois à piquer dans la première
fituation, c ’eft-à-dire que le derrière de la lame d’où
on a enlevé les mamelons foit appliqué contre le
bois ; puis tenant de la main gauche un poinçon qui
n’a qu’une feule pointe , on tait entrer cette pointe
fucceffivement dans tous les trous par un très-petit
coup de marteau pour chacun.
Quatrième opération. Çouptr les paillons. 17. On a
pour cet effet un parallelipipede reâangle d’acier
trempé A B ,fig, j , d’environ un pouce à 15 lignes
de longueur A B , trois à quatre lignes de largeur
a b , 8c au plus d’une ligne 8c demi d’épaiffeur a c.
Cette piece , nommée par les ouvriers matrice, eft
percée d’un trou d f qui traverfe fon épaiffeur dans
une direftion perpendiculaire à fa face fupérieure
A B , mais dont l’ouverture inférieure eft un peu
plus grande que la fupérienre d f , qui a précifément
îa même longueur, largeur 8c figure que la longueur,
largeur 8c figure de la face du paillon que l’on veut
faire.
18. On a aufli un poinçon ou coupoir C D dont
le bout C eft formé à-peu près comme deux cylindres
accouplés de telle forme, que ce bout de poinçon
puifle entrer dans le trou d f de la matrice , 8c
en remplir très-exaâement l’ouverture fupérieure*
Chaque cylindre du coupoir eft percé dans fon axe
pour y fixer folidement deux pointes e, n , qui ex