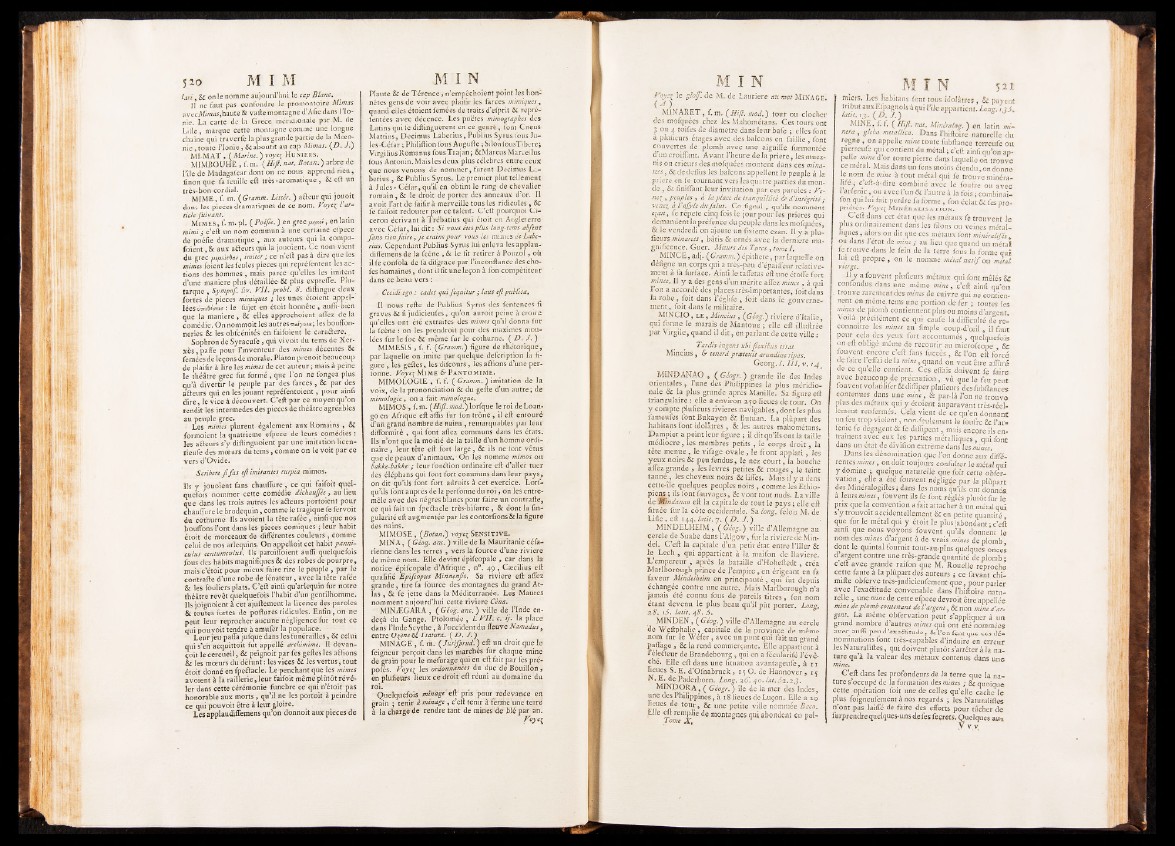
hri Sc on le nomme aujourd’hui le cap Blanc.
Il ne faut pas confondre le promontoire Mimas
avecAfûra*«,haute & vafte montagne d’Afiedans l ’Ionie.
La carte de la Grece méridionale par M. de
Lille, marque cette montagne comme une longue
chaîne qui traverfe la plus grande partie de la Moeo-
nie, toute l’Ionie, & aboutit au cap Mimas. (D . J;)
MI-MAT , ( Marine. ) voye{ HUNIERS.
MIMBOUHÉ , f. m. (Hijl. nat. Botan.) arbre de
l ’île de Madagascar dont on ne nous apprend rien,
linon que fa feuille eft très-aromatique, & eft un
très-bon cordial. . . .
MIME, f. m. ( Gramm. Littér. ) a fleur qui jouoit
dans les pièces dramatiques de ce nom. Voye{ Varticle'fuivant.
Mimes , f. m. pl. ( Poéjie. ) en grec , en latin
mimi ; c’eft un nom commun à une certaine efpece
de poéfie dramatique , aux auteurs qui la compo-
foient, & aux afleurs qui la jouoient. Ce nom vient
du grec /xi/sttUbai, imiter; ce n’eft pas à dire que les
mimes Soient les feules pièces qui représentent les actions
des hommes , mais parce qu’elles les imitent
d’une maniéré plus détaillée & plus expreffe. Plutarque
, Sympof. liv. VII. probl. 8. diftingue deux
fortes de pièces mimiques ; les unes étoient appell
e s oVo0m/«- : le fujet en étoit honnête , auffi-bien
que la maniéré, & elles approchoient allez de la
comédie. On nommoit les autresiraïywa.\ les bouffonneries
& les obfcénités en faifoient le caraôere. ,
Sophron de Syracufe, qui vivoit du tems de Xer-
x è s , palfe pour l’inventeur des mimes décentes &
femées de leçons de morale.. Platon prenoit beaucoup
de plaifir à lire les mimes de cet auteur ; mais à peine
le théâtre grec fut formé, que l ’on ne fongea plus
qu’à divertir le peuple par des farces, & par des
aâeurs qui en les jouant repréfentoient, pour ainfi
dire, le vice à découvert. C ’eft par ce moyen qu’on
rendit les intermèdes des pièces de théâtre agréables
au peuple grec.
• Les mîmes plurent- également aux Romains , &
formoient la quatrième efpece de leurs comédies :
les a&eurs s’y diftinguoient par une imitation licen-
tieufe des moeurs du tems, comme on le voit par ce
vers d’Ovide.
Scribere.fi/as ejl imitantes turpia mimos.
Ils y jouoient fans chauffure, ce qui faifoit quelquefois
nommer cette cofnédie dèchaujfée , au lieu
que dans les trois autres les a&eurs portaient pour
chaulfure le brodequin, comme le tragique fe fervoit
du cothurne Ils avoient la tete rafee , ainfi que nos
bouffons l’ont dans les pièces comiques ; leur habit
étoit de morceaux de différentes couleurs , comme
celui .de nos arlequins- On appelloit cet habit panni-
culus ceritümculus. iîsparoiffoient aulfi quelquefois
fous des habits magnifiques & des robes de pourpre,
mais c’était pour mieux faire rire le peuple , par le
contraire d’une robe de fénateur, avec la tête rafée
& les fouliers plats. C ’eft ainfi qu’arlequin fur notre
théâtre revêt quelquefois Thabit d’un gentilhomme.
Ils joignoient à cet ajuftement la licence des paroles
& toutes fortes de poftures ridicules. Enfin, on ne
peut leur reprocher aucune négligence fur tout ce
qui pouvoit tendre à amufér la populace.
Leur jeu paffa jufque dans les funérailles, & celui
qui s’en acquittait fut appelle archimime. Il dêvan-
çoit le cercueil, & peignoit par fes geftes les avions
& les moeurs du défunt : les vices & les vertus * tout
étoit donné en fpe&acle. Le penchant que les mimes
avoient à la raillerie, leur faifoit même plutôt révéler
dans cette cérémonie funebre ce qui n'était pas
honorable aux morts, qu’il ne les portait à peindré
ce qui pouvoit être à leur gloire.
Lesapplaudiffemens qu’on donnoit aux pièces de
Plaute & de Térence, n’empêchoient point les honnêtes
gens de voir avec plaifir les farces mimiques,
quand elles étoient femées de traits d’efprit 8i repré-'
fentées avec décence. Les poètes mimographes des
Latins qui le diftinguerent en ce genre , font Cneus
Mattius, Decimus Laberius, PubliusSyrus fous Jules
-Céfar ; Philiftion fous Augufte ; SilonfousTibere;
VirgiliusRomanus fousTrajan; &Marcus Marceilus
fous Antonin. Mais les deux plus célébrés entre ceux
que nous venons de nommer, furent Decimus Laberius
, & Publius Syrus. Le premier plut tellement
à Jules - Céfar, qu’il en obtint le rang de chevalier
romain , & le droit de porter des anneaux d’or. Il
avoit l’art de faifir à merveille tous les ridicules, 8c
fe faifoit redouter par ce talent. C ’eft pourquoi Cicéron
écrivant à Trébatius qui étoit en Angleterre
avec Céfar, lui dit : Si vous êtes plus long-tems abfent
fans rien faire, je crains pour vous les mimes de Laberius.
Cependant Publius Syrus lui enleva les applau-
diffemens de la fcène , & le fit retirer à Pouzol, oîi
il fe confola de fa difgrace par l’inconftancedes cho-
fes humaines, dont il fit une leçon à fon compétiteur
dans ce beau vers :
Cecidi ego : cadet qui fequitur ; laits ejl publica.
Il nous refte de Publius Syrus des fentences fi
graves & fi judicieufes, qu’on auroit peine à croire
qu’elles ont été extraites des mimes qu’il donna fur
la fcène: on les prendrait pour des maximes moulées
fur le foc 8c même fur le cothurne. (D . J . )
MIMESIS , f. f. (Gramm.) figure de rhétorique,
par laquelle on imite par quelque defcription la figure
, les geftes , les difcours, lesaûions d’une per-
fonne. Voyeç Mime & Pantomim e.
M1MOLOGIE , f. f. ( Gramm. ) imitation de la
voix, de la prononciation 8c du gefte d’un autre; de
mimologie, on a fait mimologue.
MIMOS-, f. m. (Hijl. mod.) lorfque le roi deLoan-
goen Afrique eft afîis fur fon trône , il eft entouré
d’un grand nombre de nains , remarquables par leur
difformité , qui font affez communs dans fes états.
Ils n’ont que la moitié de la taille d’un homme ordinaire
, leur tête eft fort large, 8c ils ne font vêtus
que dé peaux d’animaux. On les nomme mimos ou
bakke-bakke'; leur fonélion ordinaire eft d’aller tuer
des éléphans qui font fort communs dans leur pays,
on dit qu’ils font fort adroits à cet exercice. Lorf-
qu’ils font auprès de la perfonne du ro i, on les entremêle
avec des nègres blancs pour faire un contrafte,
ce qui fait un fpe&acle très-bifarre , 8: dont la fin-
gularité eft augmentée par les contorfions & la figure
des nains.
MIMOSE, (Botan;) voyeç Sen sitiv e.
MINA, (Géog. anc.) ville de la Mauritanie céfa-
rienne dans les terres , vers la fource d’une riviere
de même nom. Elle devint épifcopale , car dans la
notice épifcopale d’Afrique , n°. 49 , Cæcilius eft
qualifié Epifcopus Minnenjîs. Sa riviere eft allez
grande, tire fa fource des montagnes du grand Atlas
, 8c fe jette dans la Méditerranée. Les Maures
nomment aujourd’hui cette riviere Cèna.
■ MINÆGARA, (Géog. anc,) ville de l’Inde en-
déçà du Gange. Ptolomée , l. V il. c. ij.lz . place
dans l’Inde Scythe, à l’occident du fleuve Namadus ,
entre OJène8c Tiatura. ( D . J.)'
MINAGE , f. m. ( Jurifprud.) eft un droit que le
feigneur perçoit dans les marchés fur chaque mine
de grain pour le mefurage qui en eft fait par fes pré-
pofés. Voye{ les ordonnances du duc de Bouillon ,
en plufieurs lieux ce droit eft réuni au domaine du
foi.
Quelquefois minage eft pris pour redevance en
grain ; tenir à minage , c’en: tenir à ferme line terré
à la charge de rendre tant de raines de blé par an.
Voye^
Y
Voyeç le glàjf. de M. de Lauriere au moi MîtfAGË.
( J )
MINARET, f. m. (Hijl. mod.) tour ou clocher
des mofquées .chez les Mahométans. Ces tours ont
3 ou 4 toifes de diamètre dans leur bafe ; elles font
à plufieurs étages avec des balcons en faillie , font
couvertes de plomb avec une aiguille furmontée
d’un croiflant. Avant l’heure de la priere, les muez-
nis ou crieurs des mofquées montent dans ces minarets
, &ded.effus les balcons appellent le peuple à la
priere en fé tournant vers les quatre parties du monde
, & finiffant leur invitation par ces paroles : Ve-
ne^ , peuples , a la place de tranquillité & d'intégrité •
venes^a l ajyle du falut. Ce lignai , qu’ils nomment
e{an, fe répété cinq fois le jour pour les prières qui
demandent la préfence du peuple dans les mofquées,
8c le vendredi on ajoute un fixieme ezan. II y a plu-
fieurs minarets , bâtis 8c ornés avec la derniere magnificence.
Guer. Moeurs des Turcs, tome I.
MINCE, adj. (Gramm.) épithete, par laquelle on
défigne un corps qui a très-peu d’épaiffeur relativement
à fa furface. Ainfi le taffetas eft une étoffe fort
mince. Il y a des gens d’un mérite affez mince, à qui
l ’on a accordé des places très-importantes, foit dans
la rob e, foit dans l’églife , foit dans le gouvernement
, foit dans le militaire.
MINCIO, le , Mincius, (Géog.) riviere d’Italie,
qui forme le marais de Mantoue ; elle eft illuftrée
par Virgile, quand il dit, en parlant de cette ville :
Tàrdis ingens ubi fexibus errât
Mincius, & tenera preetexit arundine ripas.'
Georg. L. I I I . v. 14 1
MINDANAO , ( Gèogr. ) grande île des Indes
orientales, l’une des Philippines la plus méridionale
& la plus grande après Manille. Sa figure eft
triangulaire : elle a environ 250 lieues de tour. On
y compte plufieurs rivières navigables, dont les plus
fameufes font Bukayen Sc Butuan. La plupart des
habitans font idolâtrés , 8c les autres mahométans.
Dampier a peint leur figure ; il dit qu’ils ont la taille
médiocre, les membres petits , le corps dro it, la
tête menue , le vifage o vale, le front applari, les
yeux noirs & peu fendus, le nez court, la bouche
affez grande , les Ievres petites & rouges, le teint
tanné , les cheveux noirs & liffes. Mais il y a dans
cette-île quelques peuples noirs , comme les Ethio-
piens ; ils font fauvages, & vont tout nuds. La ville
de Mindanao eft la capitale de tout le pays ; elle eft
fituée fur la côte occidentale. Sa long, félon M. de
Lifte, eft 144. latit. 7. (D . J .)
MINDELHEIM , ( Géog. ) ville d’Allemagne au
cercle de Suabe dans l’Algotv, fur la riviere de Min-
del. C ’eft la capitale d’un petit état entre Piller 8c
le Lech , qui appartient à la maifon de Bavière.
L ’empereur , après la bataille d’Hoheftedt , créa
Marlborough prince de l’empire, en érigeant en fa
faveur Mindelheim en principauté, qui fut depuis
échangée contre une autre. Mais Marlborough n’a
jamais été connu fous de pareils titres, fon nom
étant devenu le plus beau qu’il pût porter. Lons,
a.8, iS. latit. 48. 6.
MINDEN, ( Géog. ) ville d’Allemagne au cercle
de ‘Weftphalie , capitale de la province de même
nom fur le "Wefer, avec un pont qui fait un grand
paffage , & la rend commerçante. Elle appartient à
1 électeur de Brandebourg , qui en a fécularifé l’évêché.
Elle eft dans une fituation avantageufe, à n
lieues S. E. d’Ofnabruck, 15 O. de Hannover , 1 5
N. E. de Paderborn. Long. %6. 40. lat.Sz.33.
MINDORA, ( Géogr. ) île de la mer des Indes, I
une des Philippines, à 18 lieuès de Luçon. Elle a 20
lieues de tour, 8c une petite ville nommée Baco.
Elle eft remplie de montagnes qui abondent en pal-
■ Tome X ,
ftiîôî'5. Les fiàbîtâns font tous idolâtres , & payent
tribut aux Efpagnols à qui l’îie appartient. Lons. /
laùt. ,3 . (D . J . ) ^ B
MINE, f. f, ( Hijl. nat. Mincraiog. ) en latin mi»
nera, ghba. mcialhui. Dans l’hiftoire naturelle du
regne , on appelle mine toute fubftance terreufe ou
pieçreufe qui contient du métal ; c’eft ainfi qu’on ap-
pelle mine d’or toute pierrq daqs laquelle on trouve
ce métal. Mais dans un fens moins étendu, on donne
le nom de mine à tout métal qui fe trouve minéra-
life,; c’eft-à-dire combiné avec le foufre ou avett
1 arfemc, ou avec l’un & Paiitre â la fois ; combinai-
fon qui lui fait.perdre fa forme , fon éclat & fes pro.
priétés. Voye^ Min ér a l isa t io n .
C eft dans cet état que les métaux fe trouvent 1&
plus ordinairement dans les filons ou veines métalliques
, alors on dit que ces métaux font minèralifès >
ou dans l’état de mine ; au lieu que quand un métal
fe trouve dans le fein de la terre fous la forme qui
lui eft: propre , on le nomme métal natif ou màat
vierge.
Il y a fouvent plufieurs métaux qui font mêlés &
confondus dans une même, mine, c’eft ainfi qu’on
. trouve rarement des mines de cuivre qui ne contiennent
en même, tems une portion de fer ; toutes les
v«>zes de plomb contiennent plus ou moins d’argent.
Voilà précifément ce qui caufé la difficulté de rc-
connoître les mines au Ample coup-d!oeil , il faut
pour cela des yeux fort accoutumes, quelquefois
| ip n eft obligé même de recourir au microfcope 8c
fouvent encore c’eft fans fuçsès & l’on eft forcé
de faire l’effai de la jnuu, quand on veut être allure
de; ce qu’elle contient. Ces effais doivent fe faire,
avec beaucoup de précaution, vù que le feu peut
fouventvolatiliferStdiffiper plufieurs desfubftances
contenues ;dans une mine . & par-là l’on ne trouve
plus des métaux qui y étoient auparavant très-réel*
leme.nt renfermes. Cela vient dé ce qu’en donnant
un feu trop violent, uon-feulement le foufre & l’ar-
fenic fe dégagent & fe diffipent, mais encore ils en-
traînent avec eux les parties métalliques , qui font
dans un état de divifion extrême dans les mines.
Dans les dénomination que l’on donne aux différentes
mines , on doit toujours confultcr le métal qui
y domine ; quelque naturelle que fort cette obfer-
vation, elle a été fouvent négligée par la plupart
des Minéralogiftes; dans les noms qu’ils ont donnés,
à leurs mines, fouvent ils fe font réglés plutôt fur le
prix que la convention a fait attacher .à un métal qui
< :s,y trouvoit accidentellement St cn petite quantité
que fur le métal qui ÿ étoit le plus jabondant; c’eft
amfl que nous voyons fouvent qu’ils donnent le
nom des mines,d’argent à de vrais mines de.plomb
donfie quintal, fournit toutiau-plus quelques onces
d’argent contre une, très-grande quantité de plomb-
e’eft avec grande raifon que M. Rouelle reproché
cette faute à la plupart des auteurs j ce fayant chi-
mifte; obfèrye très-judicieufement que, pour parler
avec l’exafritude convenable dans l’hiftoire natu-
■ relie , une mine de cette efpece devrait être appeilée
mine de plomb contenant de l'argent, & non mine d'ar. ‘
gçnt. La même obfervation peut s’appliquer à un
grand nombre d’autres mines qui ont été nommées '
ayec auffi peu d exaêiitude, & l’on fent que cés dénominations
font ires capables d’induire en erreur
les Naturaliftes, qui doivent plutôt s’arrêter à la nature
qu’à la valeur des métaux contenus dans une
mine.
. G’eft dans les profondeurs de la terre que la nature
s’occupè de la formation des mines ; fie quoique
cette opération foit une de celles qu’elle cache le
plus foigneufement à nos regards ; les Naturaliftes
n’ont pas laiffé de faire des efforts pour tâcher de
furprendre quelques-uns de fes feçrets. Quelques au.
.V v,v,