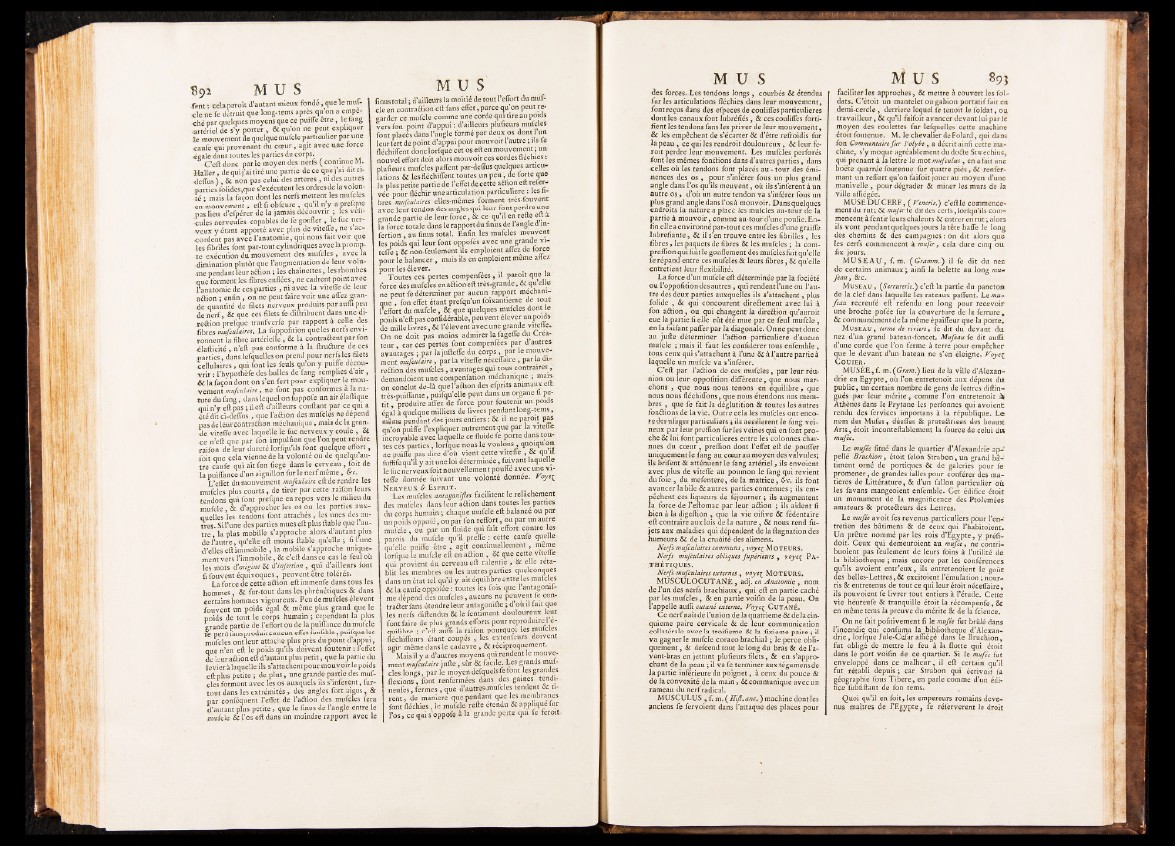
fan t: relaparoît d’autant mieux fondé, que le mur-
■ cie ne fe détruit que long-rems après qn’on a empe-
■ ché par quelcjnes moyens que cç puiffe être, le fang
artériel de s’y porter , & qu’on ne peut expliquer
Je mouvement de quelquemufele particulier par une
caufe qui provenant du coeur, agit avec une force
-égaledans tontes les parties du corps,
C ’eft donc par le moyen des nerfs f continue M.
Haller, de qui j’ai tiré une partie de ce que j’ai dit ci-
deffus,) , & non pas celui des arteres , m des autres -
parties folides,que s’exécutent les ordres de la volon- ;
-té ; mais la façon dont les nerfs mettent les mincies
en mouvement , eft fi obfcnre , qu il n y a prelipie
pas lieu d’efpérer de là jamais découvrir ; lesveli-
eules nerveufes capables de fe gonfler , le fuc nerveux
yétant apporté avec plus de vîteffe, ne s accordent
pas avec l’anatomie, qui nous fait voir que
les fibriles font par-tout cylindriques avec la prompte
exécution du mouvement des mufcles, avec la
-diminution plutôt que l’augmentation de leur volu-
■ me pendant leur aftion ; les chaînettes, les rhombes
-que forment les fibres enflées, ne cadrent pointavee
l'anatomie de ces. parties , ni avec la vîteflè de leur
aftion ; enfin, on ne peut faire voir une affez grand
e quantité de filets nerveux produits par auffi peu
de nerf, & que ces filets fe diftribuent dans une di-
reélion prefque trànfverfe par rapport à celle des
fibres mufculaires. La fuppofition que les nerfs environnent
la fibre artérielle , 6c la contraflent par fon
élaftiqité, n’eft pas conforme à la ftruâure de ces
parties, dans lefouelles on prend pour nerfs les filets
cellulaires , qui font les feuls qu’on y puiffe découvrir
: l’hypothèfe des bulles de fang remplies d’a ir ,
& la façon dont on s’en fert pour expliquer le mouvement
mufeulaire , ne font pas conformes à la nature
du fang, dans lequel on fuppofe un air élaftique
qui n’ y eft pas s il eft d’ailleurs confiant par ce qui a
été dit ci-deflus , que l’affion des mufcles ne dépend
pas de leur contraôion méchanique , mais de la grande
vîteffe avec laquelle le fuc nerveux y coule , 6c
ce n’eft que par fon impulfion que l’on peut rendre
■ raifon de leur dureté lorfqu’ils font quelque effort,
foit que cela vienne de la volonté ou de quelqu’au-
tre caufe qui ait fon fiege dans le cerveau, foit de
la puiffanee d’un aiguillon fur le nerf même, &c.
L’effet du mouvement mujiulain eft de rendre les
mufcles plus courts, de tirer par cette raifon leurs
tendons qui font prefque en repos vers le milieu du
mufcle, & d’approcher les os ou les parties auxquelles
les tendons font attachés, les unes des^au-
tres. Sil’une des parties mues eft plus ftable que l’autre
, la plus mobille s’approche alors d’autant plus
d e l’autre, qu’elle eft moins ftable qu’elle ; fi l’une
-d’elles eft immobile B la mobile s’approche uniquement
vers ! ’immobile, 6c c’eft dans ce cas le fenl oft
les mots d’origine 6c à'infer don , qui d’ailleurs font
fi fouvent équivoques, peuvent être tolérés.
finus total ; d’ailleurs la moitié de toutl’effort du mufcle
La force de cette aclion eft immenfe dans tous les
hommes, 6c fur-tout dans les phrénétiques & dans
certains hommes vigoureux. Peu de mufcles élevent
fouvent un poids égal 8t même plus grand que le
poids de tout le corps humain ; cependant la plus
grande partie de l’effort ou de la puiffanee du mufcle
fe perd fans produireaucun effet fenfible, puifque les
mufcles ont leur attache plus près du point d’appui,
que n’en eft le poids qu’ils doivent foutenir : l’effet
de leur aftion eft d’autant plus petit, que la partie du
levieràlaquelle ils s’attachent pour mouvoir le poids
eft plus petite ; de plus , une grande partie des muf-
cles formant avec les os auxquels ils s’inferer.t, fur-
tout dans les extrémités, des angles fort aigus, &
par conféquent l’effet de l’action des mufcles fera
d’autant plus petite, que le finus de l’angle entré le
mufcle 6c l’os eft dans un moindre rapport avec le
en contraSidn eft fans effet, parce qu’on peut regarder
ce mufcle comme une corde qui tire au poids
vers fon point d’appui : d’ailleurs plUfieurs mufcles
font placés dans l’angle formé par deux ôs dont l’un
leur fert de point d’appui pour mouvoir 1 autre ; ils le
fléchiffent donc lorfque cet os eft en mouvement ; un
nouvel effort doit alors mouvoir ces cordes fléchies :
plufieurs mufcles paffent par-deffus quelques articu-
ations 8c les fléchiffent toutes un p eu, de forte que
la plus petite partie de f effet de cette a&ion eft reler-
vée pour fléchir une articulation particuliere : les fibres
mufculaires elles-mêmes forment très-fouvent
avec leur tendon des angles qui leur font perdre une
grande partie de leur force, & ce qu’il en refte eft à.
la force totale dans le rapport du finus de l’angle d m-
fertion , au finus total. Enfin les mufcles meuvent
les poids qui leur font oppofés avec une grantle vi-
teffe ; & non-feulement ils emploient affez de force
pour le balancer , mais ils en emploient même affez
pour les élever. A
Toutes ces pertes compenfées, il paroit que ja
force des mufcles enaftioneft très-grande, 6: qu elle
ne peut fe déterminer par aucun rapport mechani-
que , fon effet étant prefqu’un foixantieme de tout.
Peffort du mufcle, & que quelques mufcles dont le
poids n’eft pas confidérable, peuvent élever unpofos
de mille livres, 6c l’éleventavecunegrande vîteffe.
On ne doit pas moins admirer la fageffe du Créateur
, car ces pertes font compenfées. par d autres
avantages ; par la jufteffe du corps , par le mouvement
mufeulaitc , par la vîteffe néeeffaire , par la dt-
reûion des mufcles, avantages qui tous contraires ,'
demandoient une compenfation méchanique ; mais,
on conclut de-Ià quel’aâion des efprits animaux elt
très-puiffante, puifqu’elle peut dans un organe fi petit
, produire a l fa de force pour foutenir un poids
égal à quelque milliers de livres pendant long-tems ,
même pendant des jours entiers : 8c il ne paroit pas
qu’on puiffe l’expliquer autrement que par la vitelle
incroyable avec laquelle ce fluide fe porte dans toutes
ces parties , lorfque nous le voulons , quoiquon
ne puiffe pas dire d’où vient cette vîteffe , & qu il
fuffife qu’il y ait une loi déterminée, fuivant laquelle
le fuc nerveux foit nouvellement pouffé avec une vi-
teffe donnée fuivant une volonté donnée. Voyt{
Nerveux & Es pr it .
Les mufcles antagonifies facilitent le relâchement
des mufcles dans leur aftion dans toutes les parties
du corps humain ; chaque mufcle eft balance ou par
. un poids oppofé, ou par fon reffort, ou par un autre
mufcle, ou par un fluide qui fait effort contre les
parois du mulcle qu’il preffe : cette caufe quelle
qu’elle puiffe être , agit continuellement, meme
lorfque le mufcle eft en aftion , 6c que cette vîteffe
qui provient du cerveau eft ralentie , & elle rétablit
les membres ou les autres parties quelconques
dans un état tel qu’il y ait équilibre entre les mufcles
& la caufe oppolée : toutes les fois que l’antagomf-
me dépend des mufcles, aucuns ne peuvent fe centra
ler fans étendre leur antagonifte ; d’où il fuit que
les nerfs diftendus & le fentiment douloureux leur
font faire de plus grands efforts pour reproduire 1 e-
quilibre ; c’eft aufli la raifon pourquoi les mufcles
fléchiffeurs étant coupés , les extenfeurs doivent
agir même dans le cadavre, 6c réciproquement.
Mais il y a d’autres moyens qui rendent le mouvement
mufculaire jufte, sûr & facile. Les grands mufcles
longs, par le moyendefquelsfefont les grandes
flexions, font renfermées dans des.gaines tendi-
neufes, fermes , que d’autresunufcles tendent 6c tirent
, de maniéré que pendant que les membranes
font fléchies, le mufcle refte étendu 6c appliqué fur
l’o s , ce quis’oppofe à la grande perte qui fe feroitdes
forces. Les tendons longs , courbés & étendus
furies articulations fléchies dans leur mouvement,
font reçus dans des efpecesde couliffes particulières
dont les canaux font lubréfiés , & ces couliffes fortifient
les tendons fans les priver de leur mouvement,
& les empêchent de s’écarter 6c d’être refroidis fur
la peau , ce qui les rendroit douloureux, 6c leur fe-
roit perdre leur mouvement. Les mufcles perforés
font les mêmes fondions dans d’autres parties, dans
celles où les tendons font placés au - tour des éminences
des os , pour s’inlérer fous un plus grand
angle dans l’os qu’ils meuvent, où ils s’inferent à un
autre os , d’où un autre tendon va s’inférer fous un
plus grand angle dans l’os à mouvoir. Dans quelques
endroits la nature a placé les mufcles au-tour de la
partie à mouvoir, comme au-tour d’une poulie. Enfin
elle a environné par-tout ces mufcles d’une graiffe
lubrefiante, & il s’en trouve entre les fibrilles , les
fibres, les paquets de fibres 6c les mufcles ; la com-
preffion qui fuit le gonflement des mufcles fait qu’elle
fe répand entre ces mufcles & leurs fibres, & qu’elle
entretient leur flexibilité.
La force d’un mufcle eft déterminée par la fociété
ou l’oppofition des autres , qui rendent l’une ou l ’autre
des deux parties auxquelles ils s’attachent, plus
folide , & qui concourent directement avec lui à
fon aétion, ou qui changent la direction qu’auroit
eue la partie fi elle eût été mue par ce feul mufcle,
en la faifant paffer par la diagonale. On ne peut donc
au jufte déterminer l’aCtion particulière d’aucun
mufcle ; mais il faut les confiderer tous enfemble ,
tous ceux qui s’attachent à l’une 6c à l’autre partie à
laquelle un mufcle va s’inférer.
C ’eft par l’aCtion de ces mufcles, par leur réunion
ou leur oppofition différente, que nous marchons
, que nous nous tenons en équilibre, que
nous nous fléchi ffons, que nous étendons nos membres
, que fe fait la déglutition & toutes les autres
fondions de la vie. Outre cela les mufcles ont encore
des ufages particuliers ; ils accélèrent le fang veineux
par leur preffion fur les veines qui en font proche
6c lui font particulières entre les colonnes charnues
du coeur , preffion dont l’effet eft de pouffer
uniquement le fang au coeur au moyen des valvules;
ils brifent & atténuent le fang artériel, ils envoient
avec plus de vîteffe au poumon le fang qui revient
du foie , du mefentere, delà matrice, &c. ils font
avancer la bile & autres parties contenues ; ils empêchent
ces liqueurs de ïéjourner ; ils augmentent
la force de l’eftomac par leur adion ; ils aident fi
b ie n à la digeftion , que la vie oifive & fédentaire
eft contraire aux lois de la nature, & nous rend fu-
jets aux maladies qui dépendent de la ftagnation des
humeurs & de la crudité des alimens.
Nerfs mufculaires communs, voye^ MOTEURS.
Nerfs mufculaires obliques Juptrieurs , yoye^ PATHÉTIQUES.
Nerfs mufculaires externes , voye^ MOTEURS.
MUSCULOCUTANÉ , adj. en Anatomie ,. nom
de l’un des nerfs brachiaux, qui eft en partie caché
par les mufcles, & en partie voifin de la peau. On
l’appelle auffi cutané externe. Voyeç C u tané.
Ce nerf naît de l’union de la quatrième & de la cinquième
paire cervicale & de leur communication
collatérale avec la troifieme & la fixieme paire ; il
va gagner le mufcle coraco brachial ; le perce obliquement
, & defeend tout le long du bras & de l’avant
bras en jettant plufieurs filets, & en s’approchant
de la peau ;il va fe terminer auxtégumensde
la partie inférieure du poignet, à ceux du pouce &
de la convexité de la main , & communique avec un
rameau du nerf radical.
MUSCULUS , f. m. ( Hiß. anc. ) machine dont les
anciens fe fervoient dans l’attaque des places pour
faciliter les approches, & mettre à côuvert les fol-
dats. C ’étoit un mantelet ou gabion portatif fait en
demi-cercle, derrière lequel fe tenoit le foldat, ou
travailleur, & qu’il faifoit avancer devant lui par le
moyen des roulettes fur lefquelles cette machine
étoit foutenue. M. le chevalier de Folard, qui dans
fon Commentaire fur Polybe , a décrit ainfi cette machine,
s’y moque agréablement du do£te Stwechius,
qui prenant à la lettre le mot mufculus, en a fait une
boëte quarrée foutenue fur quatre piés, & renfermant
un reffort qu’on faifoit jouer au moyen d’une
manivelle , pour dégrader & miner les murs de la
ville affiégée.
MÜSEDUCERF, ( Ventrie.') c’eft le commencement
du rut; & mufer fe dit des cerfs, lorfqu’ils commencent
à fentir leurs chaleurs & entrer en rut ; alors
ils vont pendant quelques jours la tête baffe le long
des chemins & des campagnes : on dit alors que
les cerfs commencent à mufer, cela dure cinq ou
fix jours.
M U S E A U , f. m. ( Gramm. ) il fe dit du nez
de certains animaux i ainfi la belette au long mu*
feau, &c.
Museau , (Serrurerie.) c’eft la partie du paneton
de la clef dans laquelle les rateaux paffent. Le mu-
feau recreufé eft refendu en long pour recevoir
une broche pofée fur la couverture de la ferrure ,
& communément de la même épaiffeur que la porte.
MUSEAU, terme de rivière, fe dit du devant du
nez d’un grand bateau-fonceL Mufeau fe dit auffi
d’une corde que l’on ferme à terre pour empêcher
que le devant d’un bateau ne s’en éloigne. Voye^
C ouier.
MUSÉE, f. m. (Gram.') lieti de la ville d’Alexandrie
en Egypte, où l’on entretenoit aux dépens du
public, un certain nombre de gens de lettres diftin-
gués par leur mérite, comme l’on entretenoit à*
Athènes dans le Prytane les perfonnes qui avoient
rendu des fervices importans à la république. Le
nom des Mufes, déeffes & proteélrices des beaux:
Arts, étoit inconteftablement la fource de celui du
mufie.
Le mufèe fitué dans le quartier d’Alexandrie ap-
pellé Bruchion, étoit félon Strabon, un grand bâtiment
orné de portiques 6c de galeries pour fe
promener, de grandes falles pour conférer des matières
de Littérature, & d’un fallon particulier où
les favans mangeoient enfemble. Cet édifice étoit
un monument de la magnificence des Ptolemées
amateurs & prote&eurs des Lettres»
Le mufle avoit fes revenus particuliers pour l’entretien
des bâtimens & de ceux qui l’habitoient.
Un prêtre nommé par les rois d’Egypte, y préfi-
doit. Ceux qui demeuroient au mufle, ne contri-
buoient pas feulement de leurs foins à l’utilité de
la bibliothèque ; mais encore par les conférences
qu’ils avoient entr’eu x, ils entretenoient le goût
des belles-Lettres, & excitoient l’émulation ; nourris
& entretenus de tout ce qui leur étoit néceffaire,
ils pouvoient fe livrer tout entiers à l’étude. Cette
vie héureufe & tranquille étoit la récompenfe, &
en même tems la preuve du mérite & de la fcience.
On ne fait pofitivement fi le mufle fut brûlé dans
l’incendie qui confuma la bibliothèque d’Alexandrie
, lorfque Jule-Cefar affiégé dans le Bruchion,
fut obligé de mettre le feu à la flotte qui étoit
dans le port voifin de ce quartier. Si le mufle fut
enveloppé dans ce malheur, il eft certain qu’il
fut rétabli depuis ; car Strabon qui écrivoit fa
géographie fous Tibere, en parle comme d’un édi?
nce fubfiftant de fon tems.
Quoi qu’il en foit, les empereurs romains devenus
maîtres de l’Egypte, fe réierverent le droit