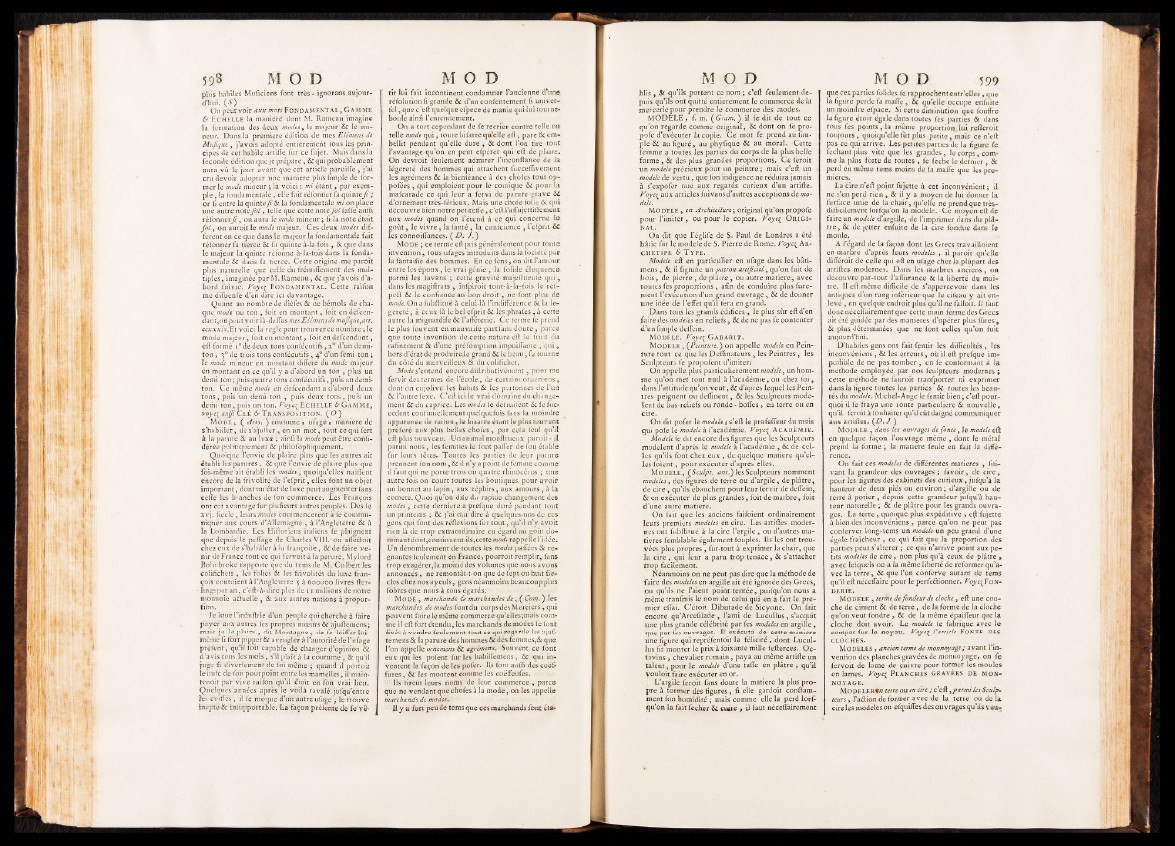
plus habiles Muficiens font très - ignorans âiijôur- JH9 Ig I On pCutvoiï aux mots FONDAMENTAL, GAMME
& Echelle la maniéré' dont M. Rameau imagine
la formation des deux modes, le majeur 6c le mineur.
Dans la première édition de mes Elément de
Mujique , j’avois adopté entiéremerit tous les principes
de cet habile 'artifte fur ce fujét. Mais dans la
fécondé édition que je prépare , & qui probablement
aura vu le jour avant que cet articlfe pàroiffe , j’ai
cru devoir adopter une manière plirè fimple de former
le mode mineur ; la voici : mi étant, pat exemple,
la fondamentale, elle fait réfonnerfa qüinte j î ;
or fi entre la quinte^ & la fondamentale mi on place
une autre note f o l , telle que cette note yè/faffe aufîi
réfonnerf i , on aura le mode mineur ; fi la note étoit
f o l , on auroit le mode majeur. Ces deux modes different
en ce que dans le majeur la fondamentale fait
réfonnér fa tierce 6c fa quinte à-la-fois , & que dans
le majeur la quinte réfonne à-la-fois dans la fondamentale
6c dans fa tierce. Cette origine me paroît
plus naturelle que celle du frémiffement des, multiples.,
imaginée par M. Rameau, 6c que j’avois d’abord
lu'iviei Voye[ Fondamental. Cette raifon
me difoenfe d’en dire ici davantage.
Quant au nombre de dièfes & de bémols de chaque
mode ou ton , foit en montant, foit en defcén-
dant,onpeut voir W-dzRusmcsElémensdcmuJique^art.
ccxxxiv. Et voici la réglé pour trouver ce nombre ; le
mode majeur, foit en montant, foit en defcendant,
eft formé i° de deux tons confécutifs, 2° d’un demi-
ton , 30 de trois tons confécutifs , 4® d’un fémi-ton ;
le mode mineur en montant différé du mode majeur
en montant en ce qu’il y a d’abord un ton , plus un
demi ton ; puis quatre tons confécutifs, puis un demi-
ton. Ce même mode en defcendant a d’abord deux
tons, puis un demi-ton , puis deux tons, puis un
demi-t,on, puis un ton. Echelle & G amme,
voÿe^aiiffi C l É & TRANSPOSITION. ( 0 )
Mo d e , ( Ans. ) coutume., ufage, maniéré dé
s’habiller , de s’a ju lte fen un mot , toüt ce qui fert
à la parure & au luxe ; ainfi là mode peut être cbnfi-
dérée politiquement & philofophiquement.
Quoique l’envie de plaire plus que les autres ait
établi les parures, 6c que l’envie de plaire plus que
foi-même ait établi 1 es modes, quoiqu’elles naiflent
encore de la frivolité de l’efprit, elles font un objet
important, dont un'état de luxe peut augmenter fans
eefle les branchés de fon commerce. LesxFrançOis
ont cet avantage fur plufieurs autres peuples. Dès le
xvj. fiecle , \eurs;modes commencèrent'à fecommuniqueraux
cours d’Allemagne , à l’Angleterrè & à
la Lombardie. Les Hiftoriens italiens le plaignent
que depuis lé paffage de Charles VIII.-on affé&oit
chez eux de s’habiller à la françoife, & de faire venir
de France tout ce qui fervoità la parure. Mylord
Boliirbroke rapporte que du temsde M. Colbert les
'colifichets , les folies & les frivolités du luxe fran-
çois'coutoicnt à l’Angleterre '5 à 600000 livres fter-
■ lings par an, c’eft-à-dire plus de 11 millions de notre
monnoie aèluelle , & aux autres nations à proportion.
Je loue l’induflrie d’un peuple qui cherche à faire
payer aux autres fes proprés moeurs & ajiiïtémens;
mais j e le plains , dit. Montagne, de fe làiffer lui-
îricme fi fdrt pipper & aveugler à l’autorité de l’ufage
préfenr, qu’il foit capable de changer d’opinion 6c
d’avis tous les mois, s’il plaît à la coutume , & qu’il
juge fi diverfemettt de foi mêitie ; quand il portoii
lebufc de fon pourpoint entre-les mamelles ; il'main-
tenoit par vive raifon qu’il étoit en fon vrai'’lié».
Quelques années après le vbilà ravalé jufqu’ehtre
l'es cuiffes -, il fe moque d’un autre ufage ,1 e trouve
ineptéi& inlïipportable. La façon préfente de fe vêtir
lui fait incontinent condamner l’ancienne d’tiné,
réfolution fi grande 6c d’un confentement fi univer-
fel, que c ’eft quelque efpece de manie qui lui tourne*
boule ainfi l’entendement.
On a tort cependant de fe recrier contre telle ou
telle mode qui, toute bifarre qu?elle eft, parc 6c embellit
pendant qu’elle dure , & dont l’on tire tout
l’avantage qu’on en peut efpérer qui eft de plaire.
On devroit feulement admirer l’inconftance de la
légèreté des hommes qui attachent fucceflivement
les agrémens 6c la bienîéance à des chofes tout op-
pofées , qui emploient pour le comique 6c pour la
mafcarade ce qui leur a fervi de parure grave ÔC
d’ornement très-férieux. Mais une chofe folie 6c qui
découvre bien notre petiteffe, c’eft l’afïujettiffement
aux modes quand on l’étend à ce qui concerne le
goût, le vivre * la fanté , la confidence , l’efprit 6C
les connoiffances. ( D . J.')
Mode ; ce terme eft pris généralement pour toute
invention, tous ufages introduits dans la lociété par
la fantaifie des hommes. En ce fens, on dit l’amour
entre les époux,-le vrai génie , la folide éloquence
parmi les favans ; cette gravité majeftueufe qui,
dans les magiftr-ats 9 infpiroit tout-à-Ia-fois le réf-
peft 6c la confiance au bon droit, ne font plus de
mode. On a fubftitué à celui-là l’indifférence. 6c la légèreté
, à ceux-là le bel efprit 6c les phrafes , à cette
autre la- mignardife & l’afféterie. Ce terme fe prend
le plus fouvent enmauvaife part fans doute , parce
que toute invention de cette nature eft le fruit du
rafinement & d’une préfomption.impuiffante , qui »
hors d’état de produireje grand & le beau, fe tourne
du côté du merveilleux & du colifichet.
Mode s’entend encore diftributivémènt, pour me
fervir des termes de l’école, de certains ornemens ,
dont on enjolive les habits & les perlonnes de l’un
& l’autre fexe. C ’eft ici le vrai domaine du changement
& du caprice. Les modes fe délruilent & fe (accèdent
continuellement quelquefois fans la moindre
apparence de railbn, le bizarre étant le plus fouvent
préféré aux-plus'belles chofes , par cela feul qu’il
eft plus nouveau. Un animal monftrueux paroît-il
parmi noffs, les femmes le font palier de fon étable
fur leurs têtes. Toutes les parties de leur parure
prennent fon nom, 6c il n’y a point de femme comme
il faut qui ne porte trois ou quatre rhinocéros ; une
autre fois on court toutes les boutiques pour avoir
un bonnet au-lapin-, aux zéphirs, aux amours, à la
comefe. Quoi qu’on dife du rapide changement des
modes , cette derniere.a prefque duré pendant tout
un printeins ; 6c j’ai ouï dire à quelques-uns de ces
gens qui font des réflexions fur tout., qu’il n’y a voit
rien là de trop extraordinaire eu égard au goût dominant
dont,continuent-ils,cette mode rappelle l’idée.
Un dénombrement de toutes les modes pzffées & régnantes
feulement en France, pourroit remplir, fans
trop exagérer,la moitié des volumes que nous avons
annoncés , ne remontât-t-on que de fept ou huit dégelés
chez nos ayeuls, gens néanmoins beaucoup plus
fôbrès que nous à tons égards.
Mode , marchands & marchandes de , ( Com.') les
marchandes de modes {ont du corps desMerciers, qui
peuvent faire le même commerce qu’elles;mais comme
il eft fort étendu, les marchands de modes fe font
fixés à vendre feulement tout ce qui regarde les ajuf*
temens& la parure des hommes & des femmes,& que
l ’on appelle oriitmens & agrémens. Souvent ce font
eux qui les pofent furies habillemens, & qui in-
véntentTà façon de les pofer. Ils font auffi des coë&
fures, & les montent comme les eoëffeufes.
• Ils tirent leurs noms de leur commerce, parce
que rie vendant que chofes à la mode, on les appelle
marchands de modes.
Il y a fort peu de tems que ces marchands font éta»*
blis , & qu’ils portent ce nom ; c’eft feulement depuis
qu’ils ont quitté entièrement le commerce de la
mercerie pour prendre le commerce des modes.
MODELE, f. m. ( Gram. ) il fe dit de tout ce
qu’on regarde comme original, 6c dont on fe pro-
pofe d’exécuter la copie. Ce mot fe prend au fimple
& au figuré, au phyfique 6c au moral. Cette
femme a toutes les parties du corps de la plus belle
forme , & des plus grandes proportions. Ce feroit
un modelé précieux pour un peintre ; mais c’eft un .
modèle de vertu , que fon indigence ne réduira jamais
à s’expofer nue aux regards curieux d’un artifte.
Voye^ aux articles fuivansd’autres acceptions de mo*
de U.M
odèle , en Architecture ; original qu’on propofe
pour l’imiter, ou pour le copier. Voye1 Or ig in
a l .
On dit que Féglife de $. Paul de Londres a été
bâtie fur le modèle de S. Pierre de Rome. Voye{ A r-
ch et ip e & T y p e .
Modèle eft’ en particulier en ufage dans les bâti-
mens , & il fignifie un patron artificiel, qu’on fait de
bois, de pierre , de plâtre, ou autre matière, avec
toutes fes proportions , afin de conduire plus fixement
l’exécution d’un grand ouvrage, 6c de donner
une idée de l ’effet qu’il fera en grand.
Dans tous les grands édifices , le plus sûr eft d’en
faire dos modèles en reliefs, 6c de ne pas fe contenter
d’un fimple deflein.
Modèle. Voye^ G a b a r it .
Mopele , {Peinture.') on appelle modèle en Peinture
tout ce que lesDeffinateurs , les Peintres, les
Sculpteurs fe propofent d’imiter;
On appelle plus particulièrement modèle, un homme
qu’on met tout nud à l’académie, ou chez fo i,
dans l’attitude qu’on veut, & d’après lequel les Peintres
peignent ou deflinent, & les Sculpteurs mode-
lent de bas-reliefs ou ronde - boffes, en terre ou en
cire.
On dit pofer le modèle ; c’eft le profefleur du mois
qui pofe le modèle à l’académie. Voye[ Acad ém ie.
Modèle fe dit encore des figures que les Sculpteurs
modèlent d’après le modèle à l’académie , 6c de celles
qu’ ils font chez eux , de quelque matière qu’elles
foient, pour exécuter d’après elles.
Modèle, {Sculpt. ant.) les Sculpteurs nomment
modelés, des figures de terre ou d’argile, de pLâtre,
de cire , qu’ils ébauchent pour leur fervir de deflein,
& en exécuter de plus grandes, foit de marbre, foit
d’une autre matière.
On fait que les anciens faifoient ordinairement
leurs premiers modèles en cire. Les artiftes modernes
ont fubftitué à la cire l’argile , ou d’autres matières
femblable également fouples. Ils les ont trouvées
plus propres , lur-tout à exprimer la chair, que
la cire, qui leur a paru trop tenace, & s’attacher
trop facilement.
Néanmoins on ne peut pas dire que la méthode de
faire des modèles en argille ait été ignorée des Grecs,
ou qu’ils ne l’aient point tentée, puifqu’on nous a
jnême tranfmis le nom de celui qui en a fait le premier
effai. C’étoit Dibutade de Sicyone. On fait
encore qu’Arcelilade , l’ami de Lucullus, s’acquit
une plus grande célébrité par fes modèles en argille,
que par fes ouvrages. Il exécuta de cette maniéré
une figure qui repréfentoit la félicité, dont Lucullus
fit monter le prix à foixante mille fèfterces. Oc-
tavius , chevalier romain, paya au même artifte un
talent, pour le modèle d’une tafle en plâtre , qu’il
vouloit faire exécuter en or.
L’argile feroit fans doute la matière la plus propre
à former des figures, fi elle gardoit conftam-
ment fon humidité ; mais comme elle la perd lorf-
jqu’on la fait fecher 6c cuire , il faut néccffairement
que ces parties folides fe rapprochent entr’elles , que
la figure perde fa maffe , Ôc qu’elle occupe enfuite
un moindre efpace. Si cette diminution que fouffre
la figure étoit égale dans toutes fes parties & dans
tous fes points, la même proportion. lui refteroit
toujours, quoiqu’elle fût plus petite , mais ce n’eft
pas ce qui arrive. Les petites parties de la figure fe
fechant plus vîte que les grandes, le corps, comme
la plus forte de toutes , fe feche le dernier , &
perd en même tems moins de fa maffe que les premières.
La cire n’eft point fujette à cet inconvénient ; il
ne/s’en perd rien , 8c il y a moyen de lui donner la
furface unie de la chair, qu’elle ne prend que trèsr
difficilement lorfqu’on la modèle. Ce moyen eft de
faire un modèle d’argilfe, de l’imprimer dans du plâtre
, & de jetter enfuite de la cire fondue dans le
moule.
A l’égard de la façon dont fes Greçs travailloient
en marhre d’après leurs modèles , il paroît qu’elle
différait de celle qui eft en ufage chez la plupart des
artiftes modernes. Dans fes marbres anciens, on
découvre par-tout l’affurance & la liberté du maître.
Il eft même difficile de s’appercevoir dans les
antiques d’un rang inférieur que le cifeau y ait enlevé
, en quelque endroit plus qu’il ne fallait. Il faut
donc néceffairement que cette main ferme des Grecs
ait été guidée par des maniérés d’opérer plus fûres ,
& plus déterminées que ne font celles qu’on fuit
aujourd’hui.
D ’habiles gens ont fait fentir les difficultés , les
inconvéniens , & les erreurs, où il eft prefque im-
poffible de ne pas tomber, en fe conformant à la
méthode employée par nos fculpteurs modernes ;
cette méthode ne fauroit tranfporter ni exprimer
dans la figure toutes les parties 6c toutes les beautés
du modèle. Michel-Ange le fentit bien ; c’eft pourquoi
il fe fraya une route particulière & nouvelle,
qu’il feroit à fouhaiter qu’il eût daigné communiquer
aux artiftes. {D. J )
MODELE , dans les ouvrages de fonte, le modèle eft
en quelque façon l’ouvrage même , dont le métal
prend la forme ; la matière feule en fait la différence.
On fait ces modèles de différentes matières , fui-
vant la grandeur des ouvrages $ Cavoir, de cire ,
pour les figures des cabinets des curieux, jufqu’à la
hauteur de deux pies ou environ ; d’argille ou de
terre à potier , depuis cette grandeur jufqu’à hauteur
naturelle ; & de plâtre pour les grands ouvrages.
La terre , quoique plus expéditive , eft fujette
à bien des inconvéniens , parce qu’on ne peut pas
conferver long-tems un modèle un peu grand d’une
égale fraîcheur , ce qui fait que la proportion des
parties peut s’alterer ; ce qui n’arrive point aux petits
modelés de cire, non plus qu’à ceux de plâtre ,
avec lefquels on a la même liberté de reformer qu’avec
la terre, & que l’on conferve autant de tems
qu’il eft néceffaire pour le perfectionner. Vçye^Fo n d
e r ie .
MODELE , terme de fondeur de cloche , eft une couche
de ciment 6c de terre, de la forme de la cloche
qu’on veut fondre , & de la même épaiffeur que la
cloche doit avoir. Le modèle le fabrique avec le
compas fur le noyau. Voye[ l'article Fo n t e DES
CLOCHES.
MODELES, ancien terme de monnayage; avant l’invention
des planches gravées de monnoyage, on fe
fervoit de lame de cuivre pour former fes moules
en lames. Voye{ Pl a n c h e s g r a v é e s d e m o n n
o y a g e .
MODELER«« terre ou tn cire ; c’eft t parmi les Sculpteur
s , l’aCtion de former av e c de la terre ou d e là
cire les modèles ou efquiffes des ouvrages qu’ils yeu^.