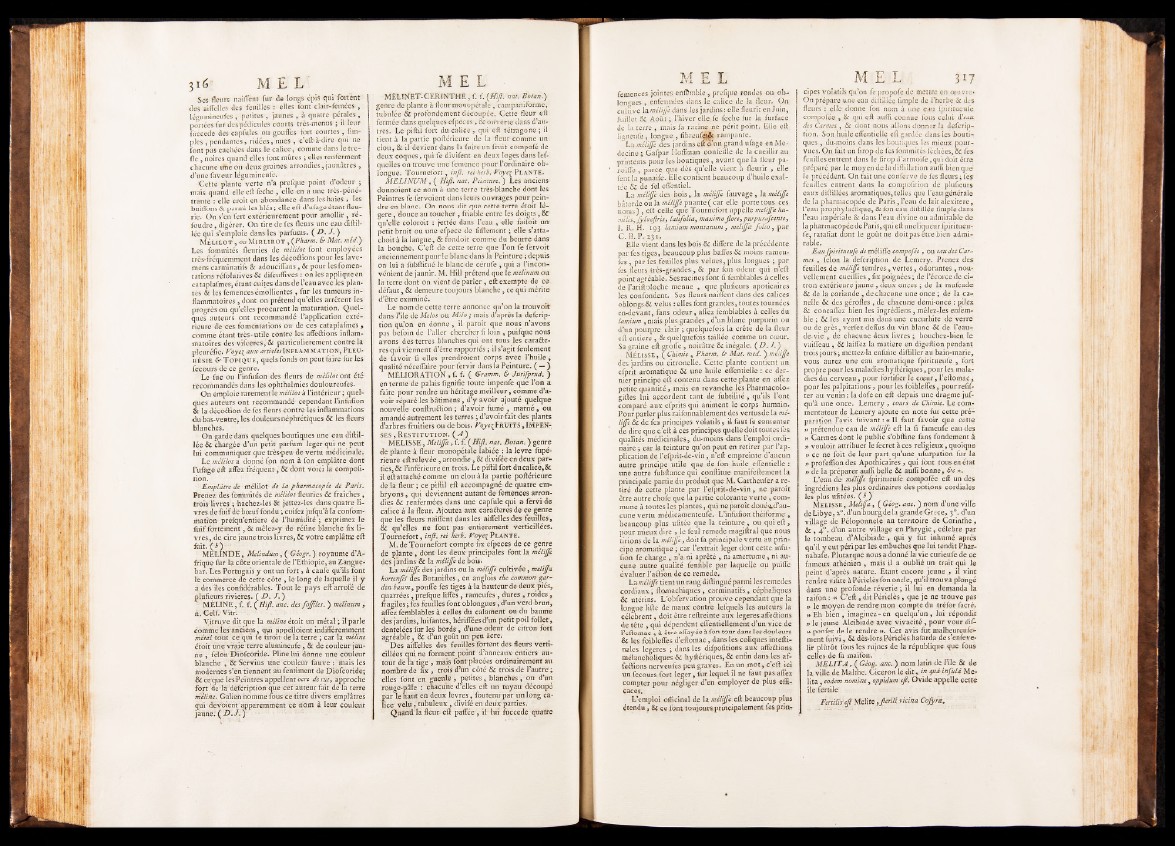
Ses fleurs naiflent fur de longs épis qui'fartent 1
des aiflèlles des feuilles' : elles font elair-femées ,
légumineufes , petites, jaunes , à quatre pétales , I
portées fur despédicules courts très-menus ; il leur
fiïccede des capfules ou gouffes fort courtes , fim-
ples , pendantes, ridées, nues , c’eft-à-dire qui ne
font pas cachées dans le calice * comme dans le trèfle
, noires quand elles font mûres ; elles renferment
chacune ifïie ou- deux graines arrondies, jaunâtres ,
d’une faveur légumineufèi -
Cette plante verte n’a prefque point d odeur ;
mais quand elle eft feèhe , elle en a une tres-pene-
trante : elle croît en abondance dans les haies , les
buiffons & parmi les blés ; elle eft d’ufage étant fleurie.
On. s’en fert extérieurement pour amollir , réfoudre
, digérer. On tire de fes fleurs une eau diftil-
léequi s’emploie dans les parfums. ( D . J.')
MÉLILOT , omMirlirot , (Pharm. & Mat. méd.)
Les fommités fleuries de mélilot font employées
très-fréquemment dans les décoétions pour les lave-
mens carminatifs & adouciffans, & pour les fomentations
réfolutives & difeuffives : on les applique en
cataplafmes, étant cuites dans de l’eau avec les plantes
& les femences émollientes -, fur les tumeurs inflammatoires
, dont on prétend qu’elles arrêtent les
progrès ou qu’elles procurent la maturation. Quelques
auteurs ont recommandé l’application extérieure
de ces fomentations ou de ces cataplafmes ,
comme étant très - utile contre les affections inflammatoires
des vifeeres, & particulièrement contre la
pleuréfie. Voyc{ aux- articles ÏNFLAM m ation, PLEURÉSIE
6* T opique, quels fonds on peut faire fur les
fecours de ce genre.
Le füc ou l’infufion des fleurs de mélilot ont été
recommandes dans les ophthalmies douloureufés.
On emploie rarement le mélilot à l’intérieur ; quelques
auteurs ont recommandé cependant l’infufion
& la décodion de fes fleurs contre les inflammations
du bas-ventre, les douleurs néphrétiques & les fleurs
blanches.
On garde dans quelques boutiques une eau diftil-
lée & chargée d’un petit parfum legerqui ne peut
lui communiquer que très-peu-de vertu médicinale;
Le mélilot a donné fon nom à fon emplâtre dont?
Pufage eft aflez fréquent, & dont voici la compofi-
tion.
Emplâtre, de mélilot de la pharmacopée de Paris.
Prenez: des fominités de mélilot fleuries & fraîches,
trois- livres ; haehez-les & jéttez-les dans quatre livres,
de fuif de boeuf fondu ; cuifez jufqu’à la confom-
mattati prefqu’entiere de l’humidité ; exprimez le
fuif fartement, & melez-y de réfine blanche fix liv
r e s d e cire jaune trois livres, & votre emplâtre eft
fait. ( h ) ’
MELINDE, Melinditm, ( Géogr. ). royaume d’Afrique
fur la côte orientale de PEthiopie, au Zangue-
bar. Les Portugais y ont un fort, à caufe qu’ils font
le commerce de-cette côte , le long de laquelle il y
à des fiés confidérables. Tout le pays eftarrofé de
plufieursrivières. (Z ) . / . )
MÉLINE, f. f. ( Hifi. anc. desfojjilts. ) mdinüm ,
h. Gelf.* Vitn
Vitruve dit que la méline étoit un métal ; il parle
Comme lès'ancièns, qui appelloient indifféremment
métal tout c e qui fe droit-de la terre ; car la méline
étoit tifie vraie terre alumineufe, & de couleur jaune
, félon Diofcoride. Pline lui donne une couleur
blanche , & Sefvius iine cOülèüV fauve : triais les
modernes s’en tiennent aufentiment de Diofcoride;
&ce'que les Peintres appellent ocre de rut, approche
fort ’de là;'dèfcription que cet auteur fait de là terre
meline. Galiéji nomme fous cè titre divers emplâtres
qui devaient apparemment ce nom à leur couleur
jaune; ( D\ J. J
MÊL1NÉT-CERINTHE, f. f. (Hiß. nat. Botan.)
genre de plante à fleur mouopétale, campaniforme,
tubulée & profondément découpée. Cette fleur eft
fermée dans quelques efpeces, Ôc ouverte dans d’autres.
Le piftil fort du calice, qui eft tétragone ; il
tient à la partie poftérieure de la fleur comme un
clou, & il devient dans la fuite un fruit eompofé de
deux coques, qui fe divifent en deux loges dans lef-
quelles on trouve une fernen ce pour l’ordinaire ob-
longue. Tournefort, in f i . r ù kerb. P'oye^ Plante.
MEL1N UM , ( Hiß* nat. Peinture. ) Les anciens
dbnnoient ce nom à une terre très-blanche dont les
Peintres fe fervoient dans leurs ouvrages pour peindre
en blanc. On nous dit que cette terre étoit legere
, douce au toucher , friable entre les doigts , &
qu’elle coloroit : jettée dans l’eau , elle faifoit un
petit bruit ou une efpeee de fifflement ; elle s’atta-
choit à la langue, & fondait comme du beurre dans
la bouche. C’eft de cette terre que l’on fe fervoit
anciennement pour le blanc dans la Peinture ; depuis
on lui a fubftitué le blanc de cérufe , qui a l’inconvénient
de jaunir. M. Hill prétend que le melinum ou
la terre dont on vient de parler , eft exempte de ce*
défaut,. & demeure toujours blanche, ce qui mérite
d’être examiné.
Le nom de cette terre annonce qu’on la trouvoii
dans l’île de Melos ou Milo ; mais d’après la deferip-
rion qu’on en donne ,. il paroît que nous n’avons
pas. bejfoin de l’aller chercher fl loin , puifque nous
avons des terres blanches qui ont tous les eara&e-
res qui viennent d’être rapportés ; il s’agit feulement
de favoir li elles prendroient corps avec l’huile,
qualité néceffaire pour fervir dans la Peinture. ( — )
MÉLIORATION, f. f. ( Gramm. & Jurifprud. )
en terme de palais lignifie toute impenfe que l’on a
faite pour rendre un héritage meilleur, comme d’avoir
réparé les bâtimens, d’y avoir ajouté quelque
nouvelle conftru&ion ; d’avoir fumé , marné , ou
amande autrement les terres ; d’avoir-fait des plants
d’arbres fruitiers ou de bois. ^ o y e^ F R U iT S , Im p e n s
e s , R e s t i t u t i o n . ( A )
MELISSE, Melifa, f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) genre
de plante à fleur monopétale labiée : la levre fupé-
rieure eft relevée, arrondie, & divifée en deux parties,
& l’inférieure en trois. Le piftil1 fort du calice, &
il eft attaché comme un clou à la partie poftérieure
de la fleur ; ce piftil eft accompagné de quatre embryons
, qui deviennent autant de femences arrondies
& renfermées dans une capfule qui a férvi de
calice à la fleur. Ajoutez aux earaéïeresde ce genre
que les fleurs naiflent dans les aiffellesdes feuilles ,
& qu’elles ne font pas- entièrement verticillées.
Tournefort, inß. rei kerb. Voye{ P l a n t e .
M. de Tournefort compte fix efpeces de ce genre
de plante, dont les deux principales font la mélijfi
des j ardins & la mélijje de bois.
La mélijje des jardins ou la mélijje cultivée, meliffu
hortenfis des Botaniftes, en angl’ois tko common gar-
den kaum, pouffe fes tiges à-la hauteurde deux pies,
quarrées, prefque liftes, rameufes , dures, roides ,
fragiles ; fes feuilles font oblongues-, d’un verd brun,
affez femblables à celles du calament ©u du baume
des jardins, luifantes, hériffées d’un petit poil follet-,
dfentelées fur les bords, d’une odeur de citron fort
agréable, & d’un goût un peu âcre.
Des aiffeMés des feuilles fortent des; fleurs verticillées
qui, ne forment point d’anneaux-entiers autour
de là tige , mais font placées ordinairement au
nombre dë üx , trois d’un côté & trois.de l’autre ;
elles font en gueule, petites; blanches, ou d’un
rouge-pâle : cHacune d’elles eft un tuyau découpé
par le naut en deux levres, foutenu-par un long calice
velu/tubuleux , divifé en deux parties. -
Qaand la fleur- eft paffée , il lur fuccede quatre
femences jointes enfêmble, prefque rondes ou ob-
lon^ues , enfermées dans le calice de la fleur. On
cultive la mélijj'e dans les jardins : elle fleurit en Juin,
Juillet & Août ; l’hiver elle fe feche fur la furface
de la terre , mais fa racine ne périt point. Elle eft
ligneufe, longue , fibreufqj^t rampante.
La m é lijje des jardins eft d’un grand ufage en Médecine
; Gafpar Hoffman confeilie de la cueillir au
printems pour les boutiques, avant que la fleur pa-
roifle , parce que dès qu’elle vient à fleurir , elle
fent la punaife. Elle contient beaucoup d’huile exal- .
tée & de fel effentiel.
La mèlifife des bois, la mélifie fauvage , la mélifie
bâtarde ou la mélifie puante ( car elle porte tous ces
noms) , eft celle que Tournefort appelle melifia hu-
milis,fylvefiris, latifolia, maximo fiore, purpurafeente,
I. R. H. 193 lamium m o n ta n um , inelifioe f o l i o , par
C . B. P. 231.
Elle vient dans les bois & différé de la précédente
par fes tiges, beaucoup plus baffes & moins rameufes
, par les feuilles plus velues, plus longues ; par
les fleurs très-grandes , & par fon odeur qui n’eft
point agréable. Ses racines font fi femblables à celles
de l’arifloloche menue , que plufieurs apoticaires
les confondent. Ses fleurs naiflent dans des calices
oblongs & velus : elles font grandes, toutes tournées
en-devant, fans odeur, affez femblables à celles du
lam ium , mais plus grandes , d’un blanc purpurin ou
d’un pourpre clair ; quelquefois là crête de la fleur
eft entière , & quelquefois taillée comme un coeur.
Sa graine eft greffe, noirâtre & inégale. (D . T.) _
MÉLISSE,.( C h im ie , P h a rm . & M a t . m ed . ) m é lijje
des jardins ou citronelle. Cette plante contient un
efprit aromatique & une huile effentielle : ce dernier
principe eft contenu dans cette plante en affez
petite quantité, mais en revanche les Pharmacolo-
giftes lui accordent tant de fubtilité, qu’ils l’ont
comparé aux efprits qui animent le corps humain.
Pour parler plus raifonnablement des vertus de la m é -
l if ie ôc de fes principes volatils, il faut fe contenter
de dire que c’eft à ces principes quelle doit toutes fes
qualités médicinales, du-moins dans l’emploi ordinaire
; car la teinture qu’on peut en retirer par l’application
de l’efprit-de-vin, n’eft empreinte d’aucun
autre principe utile que de fon huile eflentielle :
unè autre fubftance qui conftitue manifeftement la
principale partie du produit que M. Cartheufer a retiré
de cette plante par l’efprit-de-vin, ne paroît
être autre chofe que la partie colorante v e r te , commune
à toutes les plantes, qui ne paroît doué^d’au-
pune vertu médicamenteufe. L’infufion théiforme ,.
beaucoup plus ufitée que la teinture ou qui e ft ,
pour mieux dire , le feul remede magiftral que nous
tirions de la m é l i j je ,^ doit fa principale vertu au principe
aromatique ; car l’extrait leger dont cette infu-
fion fe charge , n’a ni aprêté , ni amertume, ni aucune
autre qualité fenfible par laquelle ou puiffe
évaluer l ’a&ion de ce remede.
La m é lijje tient un rang diftingué parmi les remedes
çordiaux J ftomachiques, carminatifs , céphaliques
& utérins. L’obfervation prouve cependant que la
longue lifte de maux contre lefquels les auteurs la
célèbrent, doit être reftreinte aux legeres affe&ioils
de tête , qui dépendent effentiellement d’un vice de
l’eftomac , à être effayée à fon tour dans les douleurs
& les foibleffes d’eftomac, dans les coliques intefti-
nales legeres ; dans les difpofitions aux affe&ions
mélancholiques & hyftériques, & enfin dans les affections
nerveufes peu graves. En un .mot,, c’eft ici
un fecours, fort leger, lur lequel il ne faut pas^affez
compter pour négliger d’en employer de plus efficaces.
L’emploi officinal de X zm é li jj e cft. beaucoup plus
étendu, ce font toujoursprincipalement feaprincipes
volatils qu’on fe propofe de mettre en oeuvre»
On prépare une eau diflillée Ample de l’herbe & des
fleurs ; elle donne fon nom à une eau Ipiritueufe
compofée , & qui eft auffi connue fous celui d’eau.
des Carmes , & dont nous allons donner la deferip-
tion. Son huile effentielle eft gardée dans les boutiques
, du-moins dans les boutiques les mieux pourvues.
On fait un firop de fes fommités féchées, & fes
feuilles entrent dans le firop d’armoife, qui doit être
préparé par le moyen de la diftillation auffi bien que
le précédent. On fait une conferve de fes fleurs ; fes
feuilles entrent dans la compofition de plufieurs
eaux diftillées aromatiques,telles que l’eau générale
de la pharmacopée de Paris, l’eau de lait alexitere,
l’eau prophylactique, & fon eau diftillée fimple dans
l’eau impériale & dans l’eau divine ou admirable de
lapharmacopée de Paris, qui eft uneliqueur fpiritueu-
fe, ratafiat dont le goût ne doit pas être bien admirable.
• Eau JpiritueuJe de méliffe compofée , ou eau des Carmes
, félon la defeription de Lemery. Prenez des
feuilles de mélijje tendres, vertes, odorantes , nouvellement
cueillies, fix poignées ; de l’écorce de citron
extérieure jaune , deux onces ; de la mufeade
& de la coriande , de chacune une once ; de la ca-
nelle & des gérofles , de chacune demi-once : pilez
& concaffez bien les ingrédiens, mêlez-Jes enfem-
ble ; Sc les ayant mis dans une. cucurbite de verre
ou de grès, verfez deffus du vin blanc & de l’eau-
de-vie , de; chacune deux livres ; bouchez-bien le
vaiffeau , & laiffez la matière en digeftion pendant
trois jours ; mettez-la enfuite diftiller au bain-marie,
vous aurez une eau aromatique fpiritueufe , fort
propre pour les maladies hyftériques, pour les maladies
du cerveau, pour fortifier le coeur, l’eftomac,
pour les palpitations, pour les foibleffes, pourrefif-
ter au venin : la dofe en eft depuis une dragme jufqu’à
une once. Lemery , cours de Chimie. Le commentateur
de Lemery ajoute en note fur cette préparation
l’avis fuivant ; « Il faut favoir que cette
» prétendue eau de mélijje eft la fi fameufe eau des
» Carmes dont le public s’obftine fans fondement à
» vouloir attribuer le fecret à ces religieux, quoique
» ce ne foit de leur part qu’une ufurpation fur la
» profeffion des Apothicaires , qui font tous en état
» de la préparer auffi belle & auffi bonne, &c ».
L’eau de mélifie fpiritueufe compofée eft un des
ingrédiens-les plus ordinaires despptions cordiales
les plus ufitées. ( h )
Melisse, Melijfa, ( Géog. anc. ) nom d’une ville
de Libye, z°. d’un bourg de la grande Greee, 30. d’un
village de Péloponnefe au territoire de Corinthe,
& 4P. d’un autre village en Phrygie, célébré par
le tombeau d’Alcibiade , qui y fut inhumé après
qu’ il y eut péri par les embûches que lui tendit Phar-
nabafe. Plutarque nous a donné la vie curieiife de ce
fameux athénien , mais il a oublié un trait qui le
peint d’après nature. Etant encore jeune , il vint
rendre vifite à Périelèsfon oncle, qu’il trouva plongé
dans une profonde rêverie ; il lui en demanda la
raifon : « C’eft , dit Périclès, que je ne trouve pas
» le moyen de rendre mon compte du tréfor facré-.
» Eh bien , imaginez - en quelqu’un, lui répondit
» le jeune Alcibiade avec vivacité, pour vour di fi»
» penfer de le rendre ». Cet avis fut malheureufe^
ment fuivi r & dès-lors Périclès. hafarda de s’enfeve-
lir plutôt fous les rujnes de l'a république que fous
celles- de fa maifou. ' . '.
ME L IT A , (Géog. anc. j nom latin de Pile & de
la ville de Malthe. Cicéron le dit,, in quârinfulâ Me-
lita , eodem nomine, oppidum efi. Ovide appelle- cette
île fertile'
FertiUïefi Melite , f iM vicina Cojyrct,