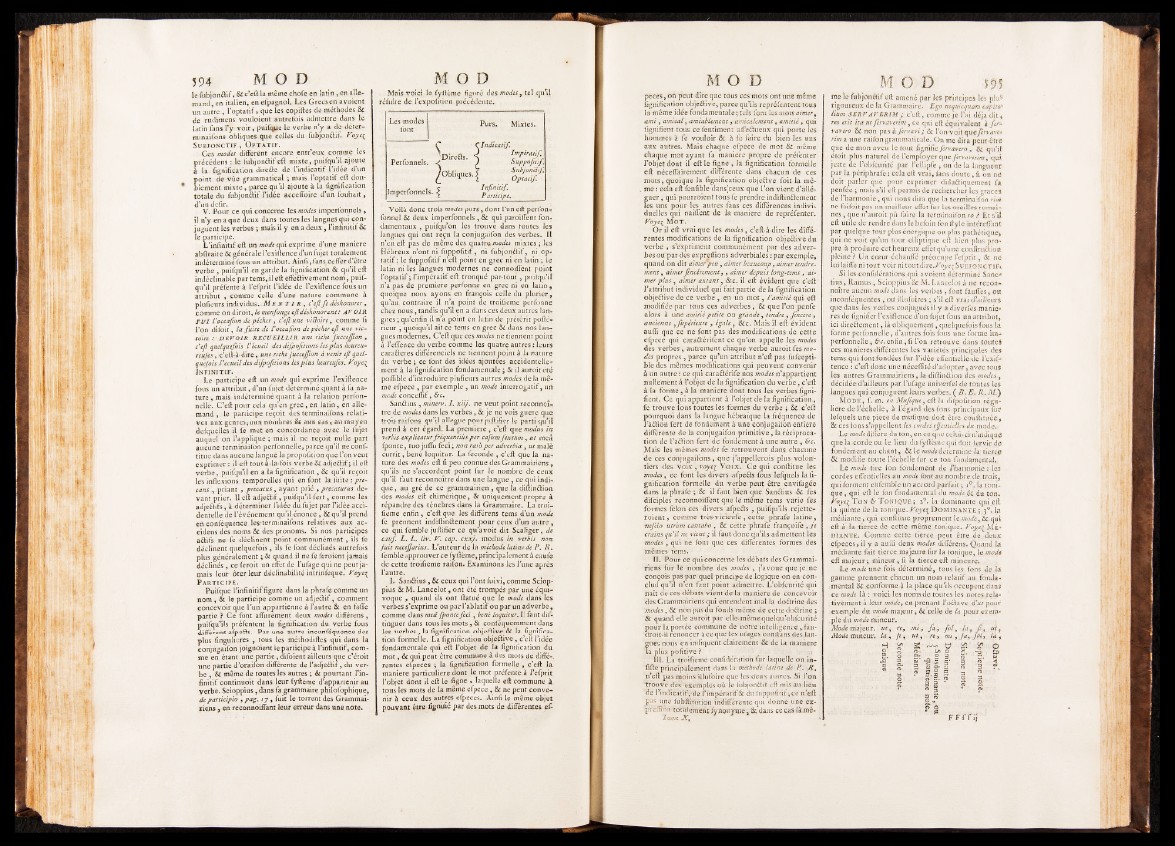
594 MOD
le fubjonttif, & c’eft la même chofe en latin, en aile»*
mandé en italien, en efpagnpl. Les Grecs en a voient
un autre , l’optatif, que les copiftes de méthodes &
de rudimens vouloient autrefois admettre dans le
latin fans l’y voir, puifque le verbe n’y a de déter-
minaifons obliques que celles du fubjonéfcif. Voye^
Subjonctif , O p t a t if . '
Ces modes different encore entr’eux comme les
précédé!» : .le fubjon&ifeft mixte, piiifq.u’il ajoute
à la fignification direâe de l’indicatif l’idée d’un
point de vûe grammatical ; mais l’optatif eft doublement
mixte , parce qu’il ajoute à la fignification
totale du fubjonftif l’idée acceflbire d’un fouhait,
d’un defir. . . .
V. Pour ce qui concerne les modes imperfonnels,
il n’y en a que deux dans toutes les langues qui conjuguent
les verbes ; mais il y en a deux, l’infinitif &
le participe.
L’infinitif eft un mode qui exprime d’une maniéré
abftraite & générale l’exiftence d’unfujet totalement
indéterminé fous un attribut. Ainfi, fans eeffer d’être
verbe , puifqu’il en garde la fignification & qu’il eft
indéclinable par tems,il eft effectivement nom, puifqu’il
préfente à l’efprit l’idée de l’exiftence fous un
attribut , comme celle d’une nature commune à
plufieurs individus.. ME n t i r , c'ejtJe déshonorer,
comme on diroit, le ménfonge ejldéshonorant: AVOIR
FUI l'occafion de pécher, c'eft une victoire, comme fi
l ’on diloit, la fuite de l'occa(ion de pécher ejl une victoire
r DEVOIR RECUEILLIR une riche Juccefjion ,
c'ejî quelquefois l'écueil des dij'pojitions les plus heureu-
reujes, c’eft-à-dire, une riche fucceffion à venir ejl quel-
qiufois l'ecueil des difpofuions Us plus heureufes. Voyei
In f in it if .
Le participe eft un mode qui exprime l’exiftence
fous un attribut, d’un fujet déterminé quant à fa nature
, mais indéterminé quant à la relation perfon-
nelle. C’eft pour cela qu’en grec ,en latin, en allemand
,. le participe reçoit des terminaifons relatives
aux genres, aux nombres & aux cas, au moyen
defquelles il fe met en concordance avec le fujet
auquel on l’applique ; mais il ne reçoit nulle part
aucune terminaifon perfonnelle, parce qu’il ne conftitue
dans aucune langue la propoficion que l’on veut
exprimer : il eft tout-à-la-fois verbe & adjeétif ; il eft
verbe, puifqu’il en a la fignification , & qu’il reçoit
les inflexions temporelles qui en font la fuite : pre-
eans , priant , precatus , ayant prié , precaturus devant
prier. Il eft adjeftif, puifqu’il fert, comme les
adjeChfs, à déterminer l’idée du fujet par l’idée accidentelle
de l’événement qu’il énonce, & qu’il prend
en conféquence les'terminaifons relatives aux ac-
cidens des noms & des pronoms. Si nos participes
aâifs ne fe déclinent point communément, ils fe
déclinent quelquefois , ils fe font déclinés autrefois
plus généralement ; & quand il ne fe feroient jamais
déclinés , ce feroit un effet de l’ufage qui ne peut jamais
leur ôter leur déclinabilité intrinfeque. Poye^
Pa r t ic ip e .
Puifque l’infinitif figure dans la phrafe comme un
nom , & le participe comme un ad jeôif, comment
concevoir que l ’un appartienne à l’autre & en faffe
partie ? Ce font affurément deux modes différens,
puifqu’ils préfentent la fignification du verbe fous
différens afpéâs. Par une autre inconféquence des
plus fingulieres , tous les méthodiftes qui dans la
conjugaifon joignoient le participe à l’infinitif, comme
en étant une partie, difoient ailleurs que c’étoit
line partie d’oraifon différente de l’adjeftif, du verbe
, & même de toutes les autres ; & pourtant l’infinitif
continuoit dans leur fyftème d’appartenir au
verbe. Scioppius, dans fa grammaire philofophique,
de participio , pag. t y , fuit le torrent des Grammairiens
, en reconnoiftant leur erreur dans une note.
M O D
Mais voici le fyftème figuré des modes, tel qu’i|
refaite de l’expofition précédente.
Les modes Purs. Mixtes.
font
P 1 vindicatif.
•Direfls. < H
Perfonnels A ) Suppofitif.
/Obliques. | ^
Imperfonnels. | B H H
Voilà donc trois modes p u r s, dont l’un eft perfon-
fonnel & deux imperfonnels , & qui paroiffent fondamentaux
, puifqu’on les trouve dans toutes les
langues qui ont reçu la conjugaifon des verbes. Il
n’en eft pas de même des quatre modes mixtes ; les
Hébreux n’ont ni fuppofitif, ni fubjonftif, ni op-
tarif : le fuppofitif n’eft point en grec ni en latin ; le
latin ni les langues modernes ne connoiflent point
^’optatif ; l’impératif eft tronqué par-tout , puiiqu’il
n’a pas de première perfonne en grec ni en latin ,
quoique nous ayons en françois celle du plurier,
qu’au contraire il n’a point de troifieme perfonne
chez nous, tandis qu’il en a dans ces deux autres langues
; qu’enfin il n’a point en latin de prétérit pofté*
rieur , quoiqu’il ait ce tems en grec & dans nos langues
modernes. C ’eft que ces modes ne tiennent point
à l’effence du verbe comme les quatre autres: leurs
caraâeres différenciels ne tiennent point à la nature
du verbe ; ce font des idées ajoutées accidentelle^
ment à la fignification fondamentale ; & il auroit été
poflible d’introduire plufieurs autres modes.delà même
efpece , par exemple , un mode interrogatif, un
mede conceflif, &c.
Sanftius , minerv. 1. xii). ne veut point reconnoî^
tre de modes dans les verbes, & je ne vois guere que
trois raifons qu’il allégué pour juftifier le parti qu’il
prend à cet égard. La première , c’eft que modus in
verbis explicatur fréquentiùs per cafum fextum , ut meâ
fponte, tuo juflu feci ; non rarà per adverbia , ut malè
currit, benè loquitur. La fécondé , c’eft que la nature
des modes eft fi peu connue des Grammairiens ,
qu’ils ne s’accordent point fur le nombre de ceux
qu’il faut reconnoître dans une langue , ce qui indique
, au gré de ce grammairien , que la diftin&ion
des modes eft chimérique, & uniquement propre à
répandre des ténèbres dans la Grammaire. La troifieme
enfin , c’eft que les différens tems d’un mode
fe prennent indiftinftement pour ceux d’un autre,
ce qui femble juftifier ce qu’avoit dit Scaliger, de
cauf. L. L. liv. V’. cap. ex xj. modus in verbis non
fu i t neceffarius. L’auteur de la méthode Latine de P. R.
femble approuver ce fyftème, principalement à caufe
de cette troifieme raifon. Examinons les l ’une après
l’autre.
I. Sari&ius, & ceux qui l’ont fuivi, comme Scioppius
& M. Lancelot, ont été trompés par une équivoque
, quand ils ont ftatué que le mode dans les
verbes s’exprime ou par l’ablatif ou par un adverbe,
comme dans meâ fponte fe c i, benè loquitur. Il faut distinguer
dans tous les mots, & conféquemment dans
les verbes , la fignification objeâive & la fignification
formelle. La figpification obje&ive , c’eft l’idée
fondamentale qui eft l’objet de la fignification du
mot, & qui peut être commune à des mots de diffé-,
rentes efpeces ; la fignification formelle , c’eft la
maniéré particulière dont le mot préfente à l’efprit
l’objet dont il eft le ligne , laquelle eft commune à
tous les mots de la même efpece , & ne peut conve-
I nir à ceux des autres efpeces. Ainfi le même objet
pouvant être lignine par des mots de différentes ef-
M O D
peeeâ, ôrt peut dire que tous ces mots ont une même
lignification objective, parce qu’ils repréfentent tous
la même idée fondamentale; tels font les mots aimer,
ami , amical} amiablemene ,■ amicalement, amitié , qui
lignifient tous ce fentimenr affeéhieux qui porte les
hommes à fe vouloir & à fe faire du bien les uns
aux autres. Mais chaque efpece de mot Si même
chaque mot ayant fa maniéré propre de préfenter
l’objet dont il eft le ligne , la fignification formelle
eft néceflairement différente dans chacun de ces
mots, quoique la lignification obje&ve foit la même
: cela eft fenfible dans]ceux que l’on vient d’alléguer
, qui pourroient tous fe prendre indiftinftement
les uns pour les autres fans ces différences individuelles
qui naiffent de la maniéré de repréfenter.
Poye[ Mo t .
Or il eft vrai que les modes, c’eft-à-dire les différentes
modifications de la fignification obje&ive du
verbe , s’expriment communément par des adverbes
où par des expreflîons adverbiales : par exemple,
quand on dit aimer peu, aimer beaucoup, aimer tendrement
, aimer Jîncérement, , aimer depuis long-tems , aimer
plus, aimer autant, &c. il eft évident que c’eft ’
l ’attribut individuel qui fait partie de la fignification
obje&ive de ce verbe , en un mot, l'amitié qui eft
modifiée par tous ces adverbes, & que l’on penfe
alors à une amitié petite ou grande, tendre, jincere,
ancienne ,fupèrieure , égale, &c. Mais il eft évident
auffi que ce ne font pas des modifications de cette
efpece qui eara&érifent ce qu’on appelle les modes
des verbes, autrement chaque verbe auroit les modes
propres , parce qu’un attribut n’eft pas fufeepti-
ble des mêmes modifications qui peuvent convenir
à un autre : ce qui carattérife nos modes n’appartient
nullement à l’objet de la fignification du verbe, c’eft
à la forme, à la maniéré dont tous les verbes lignifient.
Ce qui appartient à l’objet de la fignification,
fe trouve fous toutes les formes du verbe ; & c’eft
pourquoi dans la langue hébraïque la fréquence de
raâion fert de fondement à une conjugaifon entière
différente de la conjugaifon primitive, la réciproça-
tion de l’a&ion fert de fondement à une autre , &c.
Mais les mêmes modes fe retrouvent dans chacune
de ces conjugaifons, que j’appellerois plus volontiers
des voix , voye[ V o ix . Ce qui conftitue les
modes,, ce font les divers afpefts fous lefquels la fignification
formelle du verbe peut être envifagée
dans la phràfe ; & il faut bien que Sanâtius & fes
difciples reconnoiffent que le même tems varie fes
formes félon ces divers afpe&s , puifqu’ils rejettè-
toient, comme très-vic'ieufe , cette phrafe latine,
nefeio utriim cahtabo , & cette phrafe françoife , je
crains qu'il ne vient ; il faut donc qu’ils admettent les
modes, qui ne font que ces différentes formes des
mêmes tems.
II. Pour ce qui concerne les débats des Grammairiens
fur le nombre des modes , j’avoue que je ne
conçois pas par quel principe de logique on encon-
clud qu’il n’en faut point admettre. L’obfcurité qui
naît de ces débats vient de la maniéré de concevoir
des Grammairiens qui entendent mal la doâxine des
modes, & nbn pas du fonds même de cette do&rine ;
& quand elle auroit par elle-même quelquobfcurité
pour la portée commune de nôtre intelligence , fau-
droit-il renoncer à ce que les ufages conftans des langues
notis en indiquent clairement & de la maniéré
la plus pofitive ?
III. La troifieme confidératio'n fur laquelle on.in-
fifte principalement dans la méthode latine de P. R.
n’eft pas moins'illufoire que les deux autres. Si l’on
'trouve des 'exemples où le fubjon&if eft mis au.lieu
'de l’mdicàtify'de l’impératif & du luppofitif ■, ce n ’.eft
pas une lubftitution indifférente qui donne une ex-
preffiwn-'tptàlemenc fynonyme x & dans ce cas là'juê-
M O D m
Aie le fubjônétif eft amené par les principes les plu$
rigoureux de la Grammaire. Ego nequicqtiam capito*
lium s e r v a v e r i m ; c’eft, comme je l’ai déjà dit *
res erit ita utfervaverim h ce qui eft équivalent à fer-
vavero &c non pas à fervavi ; & l’on voit quefervave*
rima une raifon grammaticale. On me dira peut-être
que de mon aveu le tout lignifie fervavero , & qu’il
étoit plus naturel de l’employer que fervaverinij qui
jette de l’obfcurité par l’ellipfe j ou de la langueur
par la périphrafe : cela eft vrai, fans doute, fi on né
doit parler que pour exprimer dida&iquement fa
penfée ; mais s’il eft permis de rechercher les grâces
dé l’harmonie, qui nous dira que la terminaifon riut
ne faifoit pas un meilleur effet fur les oreilles romai*
nés, que n’auroit pu faire la terminaifon ro ? Et s’il
eft utile de rendre danslebefoin fonllyle intéreffarit
par quelque tour plus énergique ou plus pathétique3
qui ne voit qu’un tour elliptique eft bien plus propre
à produire cet heureux effet qu’une conftru&ioii
pleine ? Un coeur échauffé préocupe l’efprit, & ne
lui laifle ni tout voir ni tout dire.^oyer Subjonctif»
Si les confidérations qui avoient déterminé Sartc-»
tius, Ramus, Scioppius & M. Lancelot à ne recon*
noître aucun mode dans les verbes, font fâuffes, où
inconféquentes , où illufoires ; s’il eft vrai d’ailleurs
que dans les verbes conjugués il y a diverfes manie-4
res de fignifier l’exiflence d’un fujet fous un attribut,
ici dire&ement, là obliquement, quelquefois fous lâ
forme perfonnelle, d’autres fois fous une forme im-
perfonhel’ley &c. enfin,fi l’on retrouve dans toutes
ces maniérés différentes les variétés principales des
tems qui font fondées fur l’idée effentielle de l’exiG*
tence : c’eft donc une néceflité d’adopter, avec tous
les autres Grammairiens, la diftinéliort des modes ,
décidée: d’ailleurs par l’ufage üniverfel de toutes les
langues qui conjuguent leurs verbes. ( B. E . R. M.')
Mo d e , f. m. eh Mujîque, eft la difpoûtion régulière
de l’échelle, à l'égard dès fôns principaux fut1
lefc|uels une pi.ec.e de mufique doit être conflit liée 3
& ces foos.s’appellent les cordes eJfentulUs du mode.4
Le modediffete du ton, en ce que celui-ci n’indiq.ué
que la.corde, ou le lieu du fyftème qui doit-lervir dé
fondement au chant, & le môdeÂéietmine la- tiercé
& modifie toute l'échelle fur ce ton fondamental..
Le mode tire fon fondement de l’harmonie i les
cordes èffentielles au mode font au nombre de trois*
qui forment enfemble un accord parfait ; i°. la ionique
, qui eft le fon fondamental du mode & du ton*
P-oye^'ToH ^ T oniq ue; z°. la dominante qui eft
la quinte de la tonique. Voyc^ D ominante.;,}0, la
méchante, qui conftitue proprement le mode, & qui
eft à la tierce de cette même;.tonique. Voyt{ Mâ-
diante. Comme cette tierce peut être de• deux
efpeces * il y a auffi deux modes différons. Quand la
méchante fait tierce majeure fur la tonique, le modi
èft majeur ; mineur, fi la tierce eft mineure.
Le mode une fois déterminé, tous les fons de la
gamme prennent chacun un nom relatif au fondamental
& conforme à la place qu’ils occupent dans
ce mode là : voici les noms de toutes les notes-relativement
à leur modet en prenant l’ocfave d'ut pour
exemple du mode majeur* & celle de la pour exemple
du mode mineur.
Mode majeur, ut, tey mi:i fa 9 fo l , •/</, Ji:i ut $
Mode mineur, la , f i , ut , re , mi, fa y JqI» la *
o ô
M F F F f i ;