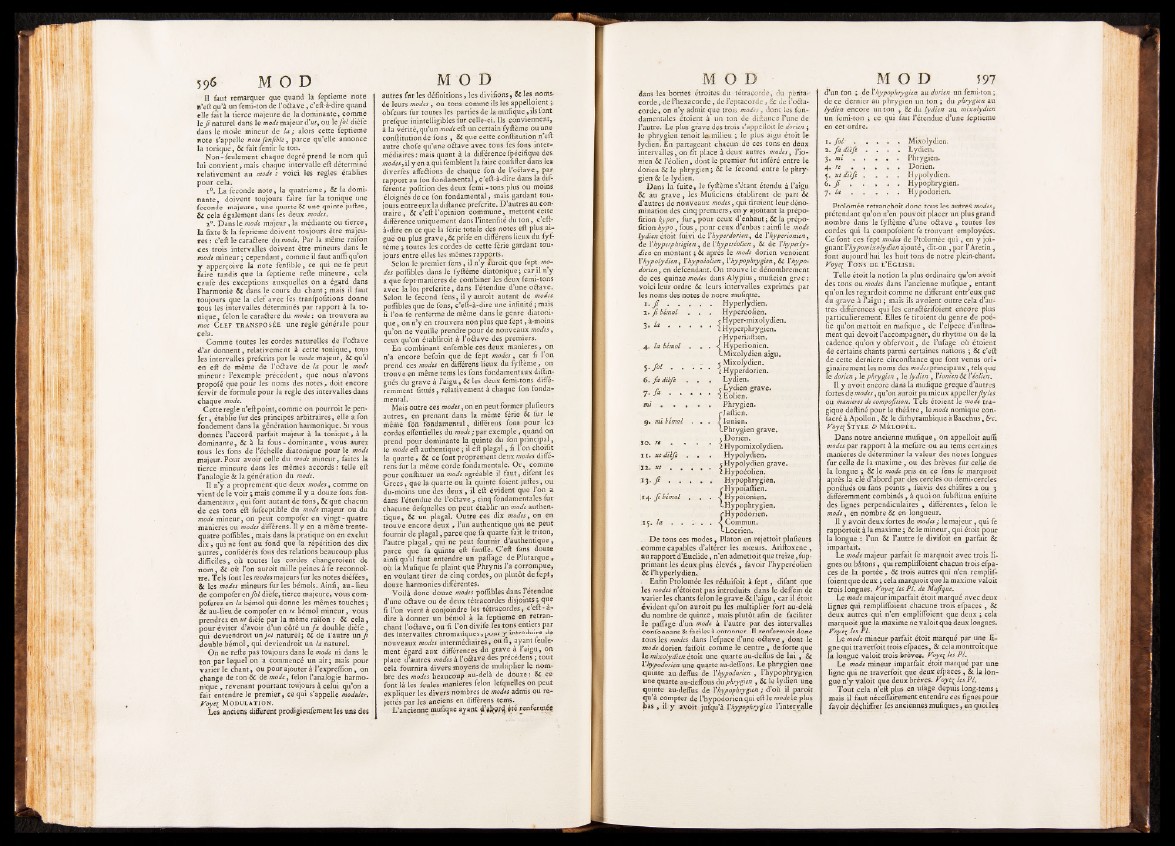
59<S M O D
Il faut remarquer que quand la feptieme note
n’eft qu’à un femi-ton de l’o â a v e , e’eft-à-dire quand
elle fait la tierce majeure de la dominante, comme
le Ji naturel dans le mode majeur d’wr, ou le fo l dièfe
dans le mode mineur de la ; alors cette ïeptieme
note s’appelle note fenjible, parce qu’elle annonce
la tonique, ôc fait fentir le ton.
Non-feulement chaque degré prend le nom qui
lui convient, mais chaque intervalle eft déterminé
relativement au mode : voici les réglés établies
pour cela.
i° . La fécondé note, la quatrième, & la dominante,
doivent toujours faire fur la tonique une
fécondé majeure, une quarte & une quinte juftes,
& cela é gaiement dans les deux modes.
i° . Dans le mode majeur, la médiante ou tierce,
la fixte & la feptieme doivent toujours être majeures
: c’eft le caraftere du mode. Par la même raifon
ces trois intervalles doivent être mineurs dans le
mode mineur ; cependant, comme il faut aufli qu’on
y apperçoive la note fenfible, ce qui ne fe peut
faire tandis que la feptieme refte mineure, cela
caufe des exceptions auxquelles on a égard dans
l’harmonie & dans le cours du chant ; mais il faut
toujours que la clef avec fes.tranfpofitions donne
tous les intervalles déterminés par rapport à la tonique,
félon le caraâere du mode : on trouvera au
mot C lef transposée une réglé générale pour
cela.
Comme toutes les cordes naturelles de l’oôave
d'ut donnent, relativement à cette tonique, tous
les intervalles prefcrits par le mode majeur, & qu’il
en eft de même de l ’o&ave de la pour le mode
mineur: l’exemple précédent, que nous n’avons
propofé que pour les noms des notes, doit encore
fervir de formule pour la réglé des intervalles dans
chaque mode.
Cette réglé n’eft point, comme on pourroit le pen-
fe r , établie fur des principes arbitraires, elle a fon
fondement dans la génération harmonique. Si vous
donnez l’accord parfait majeur à la tonique, à la
dominante, & à la fous - dominante, vous aurez
tous les fons de l’échelle diatonique pour le mode
majeur. Pour avoir celle du mode mineur, faites la
tierce mineure dans les mêmes accords : telle eft
l’analogie & la génération du mode.
Il n’y a proprement que deux modes, comme on
vient de le voir ; mais comme il y a douze fons fondamentaux
, qui font autant de tons, & que chacun
de ces tons eft fufceptible du mode majeur ou du
mode mineur, on peut compofer en vingt-quatre
maniérés ou modes différens. Il y en a même trente-
quatre poflibles, mais dans la pratique on en exclut
d ix, qui ne font au fond que la répétition des dix
autres, confidérés fous des relations beaucoup plus
difficiles, où toutes les cordes changeroient de
nom, & où l’on auroit mille peines à le reconnoî-
tre. Tels font les modes majeurs fur les notes diéfées,
& les modes mineurs fur les bémols. Ainfi, au-lieu
de compofer en fol dièfe, tierce majeure, vous com-
poferez en la bémol qui donne les mêmes touches ;
& au-lieu de compofer en re bémol mineur, vous
prendrez en ut dièfe par la même raifon : & cela,
pour éviter d’avoir d’un côté un fa double dièfe,
qui deviendroit un fol naturel ; & de l’autre un Ji
double bémol, qui deviendroit un la naturel.
On ne refte pas toujours dans le mode ni dans le
ton par lequel on a commencé un air ; mais pour
varier le chant, ou pour ajouter à l ’expreffion, on
change de ton & dé mode, félon l’analogie harmonique
, revenant pourtant toujours à celui qu’on a
fait entendre le premier, ce qui s’appelle moduler.
Foye{ Modulation.
L e s a n c i e n s d if f e r e n t p r o d ig i e u f em e n t l e s u n s d e s
M O D
autres fur les définitions, les divifions, & les noms-
de leurs modes, ou tons comme ils les appelloient ;
obfcurs fur toutes les parties de la mufique, ils font
prefque inintelligibles fur celle-ci. Ils conviennent,
à la vérité, qu’un mode eft un certain fy ftème ou une
conftitution de fons , & que cette conftitution n’eft
autre chofe qu’une o&ave avec tous fes fons intermédiaires
: mais quant à la différence fpécifique des
modes y il y en a qui femblent la faire confifter dans les
diverfes affections de chaque fon de l’oCtave, par
rapport au fon fondamental, c ’eft-à-dire dans la différente
pofition des deux femi - tons plus ou moins
éloignés de ce fon fondamental, mais gardant toujours
entre eux la diftance prefcrite. D ’autres au contraire,
& c’eft l ’opinion communè, mettent cette
différence uniquement dans l’intenfite du ton, e eft*-
à*dire en ce que la férié totale des notes eft plus aiguë
ou plus grave, & prife en différens lieux du fy f
tème } toutes les cordes de cette férié gardant toujours
entre elles'les mêmes rapports.
Selon le premier fens, il n’y auroit que fept mû*
des poflibles dans le fyftème diatonique ; car il n’y
a que feprmanieres de combiner les deux femi-tons
avec la loi prefcrite, dans l’étendue d’une o&ave.
Selon le fécond fens, il y auroit autant de modes
poflibles que de fons, c’eft-à-dire une infinité ; mais
li l’on fe renferme de même dans le genre diatonique
, on n’y en trouvera non plus que fept, à-moins
qu’on ne veuille prendre pour de nouveaux modes,
ceux qu’on établiroit à l’oftave des premiers.
En combinant enfemble ces deux maniérés, on
n’a encore befoin que de fept modes, car li 1 on
prend ces modes en différens lieux du fyfteme, on
trouve en même tems les fons fondamentaux diftin-
gués du grave à l’aigu, & les deux femi-tons différemment
litués, relativement à chaque fon fondamental.
Mais outre ces modes, on en peut former plufieurs
autres, en prenant dans la même férié & fur le
même fon fondamental, différens fons pour les
cordes effentielles du.7no<&;par exemple, quand on
prend pour dominante la quinte du ion principal,
le mode eft authentique ; il eft plagal, li l’on choifit
la quarte , & ce font proprement deux modes différens
fur la même corde fondamentale. Or, comme
pour conftituer un mode agréable il faut, difenr les
Grecs, que la quarte ou la quinte foient juftes, ou
du-moins une des deux, il eft évident que l’on a
dans l’étendue de l’oCtave, cinq fondamentales fur
chacune defqûelles on peut établir un mode authentique,
& un plagal. Outre ces dix modes, on en
trouve encore deux , l’un authentique qui ne peut
fournir de plagal, parce que fa quarte fait le triton,
l’autre plagal, qui ne peut fournir d’authentique,
parce que fa quinte eft fauffe. C’eft fans doute
ainli qu’il faut entendre un paffage de Plutarque,
où la Mufique fe plaint que Phrynis l’a corrompue,
en voulant tirer de cinq cordes, ou plutôt de fept,
douze harmonies différentes. ' f ,
Voilà donc douze modes poflibles dans l’etendue
d’une oftave ou de deux tétracordes disjoints que
fi l’on vient à conjoindre les tétracordes « c eft - à-
dire à donner un bémol à la feptieme en retranchant
l’oCtave, ou fi l’on divife les tons entiers par
des intervalles chromatiques, pour y introduire de
nouveaux modes intermédiaires, ou fi, ayant feulement
égard aux différences du grave à 1 aigu, on
place d’autres modes à l’o&ave des précédens ; tout
cela fournira divers moyens de multiplier le nombre
des modes beaucoup au-delà de douze : &c ce
font là les feules maniérés félon lefquelles on peut
cxpliQucr les divers nombres de modes admis ou re^
jettés par les anciens en differens tems.^ ^
L’ancienne mufique ayant d’sbprd.Cte renfermée
M O D
dans les bornes étroites du tétracorde, dü pcrita-
corde, de l’hexacorde, de l’eptacorde , & de i’oâa-
corde, on n’y admit que trois modes , dont les fondamentales
étoient à un ton de diftance l’une de
l’autre. Le plus grave des trois s’appelloit le dorien ;
le phrygien tenoit le»milieu ; le plus aigu étoit le
lydien. En partageant chacun de ces tons en deux
intervalles, on fit place à deux autres modes, l’ionien
& l’éolien, dont le premier fut inféré entre le
dorien & le phrygien ; & le fécond entre le phrygien
& le lydien.
Dans la fuite, le fyftème s’étant étendu à l’aigti
& au grave, les Muficiens établirent de part &e
d’autres de nouveaux modes y qui tiroient leur dénomination
des cinq premiers, en y ajoutant la prépo-
fition hyper y fur, pour ceux d’enhaut; & la prépo-
fition hypo, fous, pour ceux d’enbas : ainfi le mode
lydien étoit fuivi de Yhyperdorien, de Yhyperionien,
de l’hyperphrigien , de Yhyperèolien, & de Y hyper lydien
en montant ; & après le mode dorien venoient
Yhypolydieny Yhypoéolieny Yhypophrygun y & Yhypo-
dorien, en defcendant. On trouve le dénombrement
de ces quinze modes dans Alypius, muficien grec :
voici leur ordre & leurs intervalles exprimés par
les noms des notes de notre mufique.
î . J i .Hyperlydien.
а. J i bémol . . . Hyperéolien.
• 5 Hyper-mixolydien.
. . . . . y Hyperphrygien.
r Hyperiaftien.
4. la bémol
•S-fil . .
б . fa dièfe
rayi
. . < Hypenonien,
iMMii*x o'lydien aigu.
r Mixolydien.
1 Hyperdorien.
Lydien.
f r Lydien grave.
7’ Ja ......................y Eolien.
9. mi bémol
t dièfe
Phrygie
rJaftien.
< Ionien.
LPhrygien grave.
< Dorien.
Z Hypomixolydien.
Hypolydien.
5 Hypolydien grave.
Wc HÊy poémolien.
Hypophrygien.
rHypoïaftien.
:I3. / ■ I .
■ Ç t . .
114. J i bémol . . . < Hypoïonien.
I Hypophrygien.
rHypodorien.
.35. la . . V . . < Commun.
1-Locrien.
. D e tous ces modes, Platon en rejettoit plufieurs
comme capables d’altérer les moeurs. Ariftoxene ,
au rapport d’Euclide, n’en admettoit que treize, fup-
primant les deux plus élevés , fa voir l’hyperéolien
& l’hyperlydien,
. Enfin Ptolomée les réduifoit à fep t , difant que
les modes n’étoient pas introduits dans le deffein de
varier les chants félon le grave & l’aigu, car il étoit
évident qu’on auroit pu les multiplier fort au-delà
du nombre de quinze, mais plutôt afin de faciliter
le paffage d’un mode à l’autre par des intervalles
confonnans & faciles à entonner. Il renfermoit donc
tous les modes dans l’efpace d’une oCtave, dont le
mode dorien faifoit comme le centre , de forte que
le mixolydien étoit une quarte au-deffus de lui , &
Vhypodorien une quarte au-deffous. Le phrygien une
quinte au-deffus de Yhypodarien , l’hypophrygien
une quarte au-deffous du phrygien , & le lydien une
quinte au-deffus de Yhypophrygien ; d’où il paroît
qu’à compter de l’hypôdorien qui eft le mode le plus
bas , il y avoit jufqu’à Yhypophrygien l’intervalle
M O D 597
d’un ton ; de Y hypophrygien au dorien un femi-ton ;
de ce dernier au phrygien un ton ; du phrygien au
lydien encore un ton , 6c du lydien au mixolydien
Un femi-ton ; ce qui fait l’étendue d’une feptieme
en cet ordre.
1 . f o l ;
Mixolydien;
2. fa dièfe
Lydien.
3. mi .
Phrygien.
4 * re •
Dorien.
5. ut dièfe
Hypolydien.
6. f j .
Hypophrygien.
7. là
Hypodorieri.
Ptolomée retranchoit donc tous les autres modes*
prétendant qu’on n’en pouvoit placer un plus grand
nombre dans le fyftème d’une oétave , toutes les
cordes qui la compofoient fe trouvant employées.
Ce font ces fept modes de Ptolomée q u i, en y joignant
Y hypomixolydien ajouté, dit-on , par l’Aretin,
font aujourd’hui les huit tons de notre plein-chant.
Voye{ T ons de l’Eglise:
Telle étoit la notion la plus Ordinaire qu’on aVoit
des tons ou modes dans l’ancienne mufique , entant
qii’on les regardoit comme ne différant entr’eux que
du grave à l’aigu ; mais ils avOient outre Cela d’au^
très différences qui les caraftérifoient encore plus
particulièrement. Elles fe tiroient du genre de poé-
fie qu’on mettoit en mufique , de l’efpece d’inftru-
ment qui devoit l’accompagner, du rhytme ou de la
cadence qu’on y obfervoit, de l’ufage où étoient
de certains chants parmi certaines nations ; & c’eft
de cette derniere circonftance que font venus originairement
les noms des modes principaux, tels que
le dorien , le phrygien , le lydien , Yionien & Y éolien.
Il y avoit encore dans la mufique greque d’autres
fortes de modes, qu’on auroit pu mieux appeller Jlyles
ou maniérés de compojition. Tels étoient le mode tragique
deftiné pour le théâtre, le mode nomique con-
lacré à Apollon, ôc le dithyrambique àBacchus, &c.
Voye[ Style & Mélopée.
Dans notre ancienne mufique, on appelloit aufli
modes par rapport à la mefure ou au tems certaines
maniérés de déterminer la valeur des notes longues
fur celle de la maxime , ou des brèves fur celle de
la longue ; & le mode pris en ce fens fe marquoit
après la clé d’abord par des cercles ou demi-cercles
ponâués ou fans points , fuivis des chiffres 2 ou 3
différemment combinés, à quoi on fubftitua enfuite
des lignes perpendiculaires , différentes, félon le
mode y en nombre & en longueur.
Il y avoit deux fortes de modes ; le majeur, qui fe
rapportoit à la maxime ; & le mineur, qui étoit pour
la longue : l’un & l’autre fe divifoit en parfait &
imparfait.
Le mode majeur parfait fe marquoit avec trois lignes
ou bâtons, qui rempliffoient chacun trois efpa-
ces de la portée, & trois autres qui n’en rempliffoient
que deux ; cela marquoit que la maxime valoit
trois longues. Foye%_ les PI. de Mujique.
Le mode majeur imparfait étoit marqué avec deux
lignes qui rempliffoient chacune trois efpaces , Ôç
deux autres qui n’en empliffoient que deux ; cela
marquoit que la maxime ne valoit que deux longues.
J^oye^ les PI.
Le mode mineur parfait étoit marqué par une ligne
qui traverfoit trois efpaces, & cela montroit que
la longue valoit trois brève«, r *ye{ les PI.
Le mode mineur imparfait étoit marqué par une
ligne qui ne traverfoit que deux efpaces , & la longue
n’y valoit que deux brèves. Voyè^ les Pl.
Tout cela n’eft plus en ufage depuis long-tems ;
mais il faut néceffairement entendre ces fignes pour
fa voir déchiffrer les anciennes mufiques, en quoi les