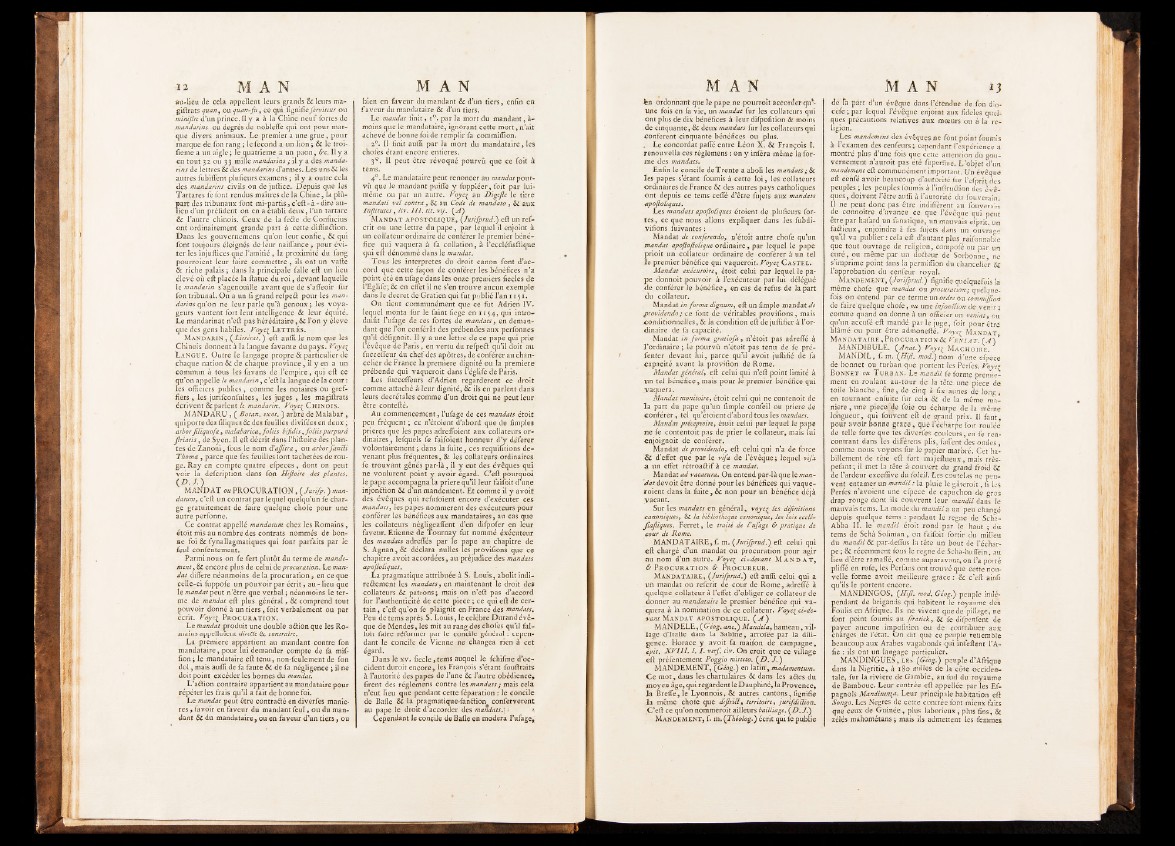
au-lieu de cela appellent leurs grands & leurs ma-
giftrats quan, ou quan-fu, ce qui lignifie ferviteur ou
minifire d’un prince. Il y a à la Chine neuf fortes de
mandarins ou degrés de nobleffe qui ont pour marque
divers animaux. Le premiers une grue, pour
marque de fon rang ; le fécond a un lion ; 6c le troi-
fieme a un aigle ; le quatrième a un paon, &c. Il y a
en tout 31 ou 3 3 mille mandarins ; il y a des mandarins
de lettres 6c des mandarins d’armes. Les uns 6c les
autres fubiffent plufieurs examens ; il y a outre cela
des mandarins civils ou de juftice. Depuis que les
Tartares fe font rendus maîtres de la Chine, la plupart
des tribunaux font mi-partis, c’eft-à-dire au-
lieu d’un préfident on en a établi deux, l’un tartare
& l’autre chinois. Ceux de la feâe de Confucius
ont ordinairement grande part à cette diftinâion.
Dans les gouvernement qu’on leur confie, 6c qui
font toujours éloignés de leur naiffançe, pour éviter
les injuftices que l’amitié, la proximité du fang
pourroient leur faire commettre, ils ont un vafte
& riche palais ; dans la principale falle eft un lieu
élevé où eft placée la ftatue du ro i, devant laquelle
le mandarin s’agenouille avant que de s’affeoir fur
fon tribunal. On a un fi grand refpeâ pour les mandarins
qu’on ne leur parle qu’à genoux ; les voyageurs
vantent fort leur intelligence & leur équité.
Le mandarinat n’eft pas héréditaire, 6c l’on y éleve
que des gens habiles. Voyez Let tré s.
Man d a rin , ( Littéral.) eft auffi le nom que les
Chinois donnent à la langue favante du pays. Voyez
L angue. Outre le langage propre & particulier de
chaque nation & de chaque province, il y en a un
commun à tous les favans de l’empire, qui eft ce
qu’on appelle le mandarin, c ’eft la langue de la cour :
les officiers publics, comme les notaires ou greffiers
, les jurifconfultes, les juges , les magiftrats
écrivent & parlent le mandarin. Voyez C hinois.
MANDARU, ( Botan. exot. ) arbre de Malabar ,
qui porte des filiques 6c des feuilles divifées en deux ;
arbor Jîliquofa , malabarica, foliis bifidis, foliispurpura
Jlriatis, de Syen. Il eft décrit dans l’hiftoire des plantes
de Zanoni, fous le nom üajjitra, ou arbor fancli
Thomce, parce que fes feuilles font tachetées de rouge.
Ray en compte quatre efpeces, dont on peut
voir la defeription dans fon Hifloire des plantes,
( D . J . )
M ANDAT ou PROCURATION, ( Jurifp. ) mm-
datunij c’eft un contrat par lequel quelqu’un fe charge
gratuitement de faire quelque chofe pour une
autre perfonne.
, Ce contrat appellé mandatum chez les Romains,
étoit mis au nombre des contrats nommés de bonne
foi 6c fynallagmatiques qui font parfaits par le
feul confentement.
Parmi nous on fe fert plutôt du terme de mandement,
§c encore plus de celui de procuration. Le mandat
différé néanmoins de la procuration, en ce que
celle-ci fuppofe un pouvoir par éerit, au - lieu que
le mandat peut n’être que verbal ; néanmoins le terme
de mandat eft plus général, 6c comprend tout
pouvoir donné à un tiers, foit verbalement ou par
écrit, Voyez Pro cu r a t io n .
Le mandat produit une double a&ion que les Romains
appelloient direHe 6c contraire.
La première appartient au mandant contre fon
mandataire, pour lui demander compte de fa mif-
fion; le mandataire eft tenu, non-feulement de fon
dol, mais àuffi de fa faute 6c de fa négligence ; il ne
doit point excéder les bornes du mandat.
L’aétion contraire appartient au mandataire pour
répéter les frais qu’il a fait de bonne foi.
Le mandat peut être contracté en diverfes manières
, favoir en faveur du mandant feul, ou du mandant
6c du mandataire, ou en faveur d’un tiers, ou
bien en faveur du mandant 6c d’un tiers, enfin en
faveur du mandataire 6c d’un tiers.
Le mandat finit, i° . par la mort du mandant, à-
moins que le mandataire, ignorant cette mort, n’ait
achevé de bonne foi de remplir fa commiffion.
j i° . Il finit auffi par la mort du mandataire, les
chofes étant encore entières.
yQ. Il peut être révoqué pourvu que ce foit à
tems.
40. Le mandataire peut renoncer au mandat pourvu
que le mandant puiffe y fuppléer, foit par lui*
même ou par un autre. Voyez au Digefie le titre
mandati vel contra , 6c au Code de mandato , 6c aux
Injlitufes, liv. III. tit. vij. (A)
Mandat a postolique, ( Jurifprud.) eft un ref-
crit ou une lettre du pape, par lequel il enjoint à
un collateur ordinaire de conférer le premier bénéfice
qui vaquera à fa collation, à l’eccléfiaftique
qui eft dénommé dans le mandat.
Tous les interprètes du droit canon font d’accord
que cette façon de conférer les bénéfices n’a
point été en ufage dans les onze premiers fiecles de
l’Eglife; 6c en effet il ne s’en trouve aucun exemple
dans le decret de Gratien qui fut publié l’an 1151.
On tient communément que ce fut Adrien IV.
lequel monta fur le faint fiege en 1154, qui intro-
duifit l’ufage de ces fortes de mandatsen demandant
que l’on conférât des prébendes aux perfonnes
qu’il défignoit. Il y a une lettre de ce pape qui prie
l’évêque de Paris, en vertu du refpeô qu’il doit au
fucceüeur du chef des apôtres, de conférer au chancelier
de France la première dignité ou la première
prébende qui vaqueroit dans l’églife de Paris.
Les fucceffeurs d’Adrien regardèrent ce droit
comme attaché à leur dignité, 6c ils en parlent dans
leurs décrétales comme d’un droit qui ne peut leur
être contefté.
Au commencement, l’ufage de ces mandats étoit
peu fréquent ; ce n’étoient d’abord que de fimples
prières que les papes adreffoient aux collateurs ordinaires
, lefqiiels fe faifoient honneur d’y déférer
volontairement ; dans la fuite, ces requifitions devenant
plus fréquentes, & les collateurs ordinaires
fe trouvant gênés par-là, il y eut des évêques qui
ne voulurent point y avoir égard. C’eft pourquoi
le pape accompagna la priere qu’il leur faifoit d’une
injonction 6c d’un mandement. Et comme il y avoit
des évêques qui refufoient encore d’exécuter ces
mandats, les papes nommèrent des exécuteurs pour
conférer les bénéfices aux mandataires, au cas que
les collateurs négligeaffent d’en difpofer en leur
faveur. Etienne de Tournay fut nommé éxécuteur
des mandats adreffés par le pape au chapitre de
S. Agnan, 6c déclara milles les provifions que ce
chapitre avoit accordées, au préjudice des mandats
apojloliques.
La pragmatique attribuée à S. Louis, abolit indirectement
les mandats, en maintenant le droit des
collateurs 6c patrôns; mais on n’eft pas d’accord
fur l’authenticité de cette piece ; ce qui eft de certain
, c’eft qu’on fe plaignit en France des mandats.
Peu de tems après S. Louis, le célébré Durand évêque
de Mendes, les mit au rang des chofes qu’il fal-
loit faire réformer par le concile général : cependant
le concile de Vienne ne changea rien à cet
égard.
Dans le xv. fiecle,tems auquel le fchifme d’occident
duroit encore, les François s’étant fouftraits
à l’autorité des papes de l’une 6c l’autre obédience,
firent des réglemens contre les mandats ; mais cela
n’eut lieu que pendant cette féparation : le concile
de Balle &c là pragmatique-fanâion conferverent
au pape le droit d’accorder des mandats.] a 1
Cependant le concile de Bafie en modéra l’ufage,
-fen ordonnant que îe pape ne pOurroit âccofdef qualifie
fois en fa vie, un mandat fur les collateurs qui
ont plus de dix bénéfices à leur difpofition & moins
de cinquante, 6c deux mandats fur les collateurs qui
confèrent cinquante bénéfices ou plus.
, Le concordat paffé entre Léon X. & François I.
renouvella ces réglemens : on y inféra même la forme
des mandats.
Enfin le concile de Trente a aboli lés mandats ; &
les papes s’étant fournis à cette lo i, les collateurs
ordinaires de France 6c des autres pays catholiques
ont depuis ce tems ceffé d’être fujets aux mandats
apojloliques.
Les mandats apofloliques étoient de plufieurs fortes,
ce que nous allons expliquer dans les fubdi-
vifions fuivantes :
Mandat de conferendo, n’étoit autre chofe qu’un
mandat apoftofiolique ordinaire, par lequel le pape
prioit un collateur ordinaire de conférer à un tel
le premier bénéfice qui vaqueroit. T'oyez C aste l .
Mandat exécutoire, étoit celui par lequel le pape
donnoit pouvoir à l’exécuteur par lui délégué
de conférer le bénéfice, en cas de refus de la part
du collateur.
Mandat in forma dignum, eft un fimple mandat de
providendo ; ce font de véritables provifions, mais
.conditionnelles, & la condition eft de juffifier à l’ordinaire
de fa capacité.
Mandat in forma gratiofa, n’étoit pas adreffé à
l ’ordinaire ; le pourvu n’étoit pas tenu de fe pré-
fenter devant lui, parce qu’il avoit juftifié de fa
capacité avant la provifion de Rome.
Mandat général, eft celui qui n’eft point limité à
un tel bénéfice, mais pour le premier bénéfice qui
.vaquera.
Mandat monitoire, étoit celui qui ne contenoit de
la part du pape qu’un fimple confeil ou priere de
conférer, tel qu’étoient d’abord tous les mandats.
Mandat préceptoire, étoit celui par lequel le pape
ne fe contentoit pas de prier le collateur, mais lui
enjoignoit de conférer.
Mandat de providendo, eft celui qui n’a de force
& d’effet que par le vifa de l’évêque; lequel vifi
a un effet rétroaâif à ce mandat.
Mandat ad vacatura. On entend par-Iàque le mandat
de voit être donné pour les bénéfices qui vaque-
roient dans la fuite, 6c non pour un bénéfice déjà
.vacant.
Sur les mandats en général, voyez les définitions
canoniques, 6c la bibliothèque canonique, Les Lois ecclé-
JîaJliques. Ferret, le traité de Vufage & pratique de
cour de Rome.
MANDATAIRE, f. m. (Jurifprud.) eft celui qui
eft chargé d’un mandat ou procuration pour agir
au nom d’un autre. Voyez ci-devant M a n d a t ,
& Pr o cu r a t io n & Procureur.
Mand a ta ire, ('Jurifprud.) eft auffi celui qui a
un mandat ou refçrit de cour de Rome, adreffé à
quelque collateur à l’effet d’obliger ce collateur de
donner au mandataire le premier bénéfice qui vaquera
à la nomination de ce collateur. Voyez ci-devant
Mandat apo sto l iq u e . ( A )
MANDELE, (Géog. anc.) Mandela, hameau, village
d’Italie dans la Sabine, arrofée par la diligence.
Horace y avoit fa maifon de campagne,
épit. X V II1. 1. 1. verf. civ. On croit que ce village
eft préfentement Poggio mirteto. (JD. J .)
MANDEMENT, (Géog.) en latin', madamentum.
C e mot, dans les chartulaires 6c dans les aCles du
moyen âge, qui regardent le Dauphiné, la Provence,
la Breffe, le Lyonnois, 6c autres cantons, fignifie
la même chofe que difiricl, territoire, jurifdiclion.
.C’eft ce qu’on nommeroit ailleurs bailliage. (D . J.)
Mandement, f. m. (Tkéolog.) écrit qui le publie
dé la part d\m évêque dans l’étendue de ion dio*
cèfe ; par lequel l’évêque enjoint aux fîdeles quel*
ques précautions relatives aux moeurs ou à la re-
ligion.
Les mandemtns des évêques ne font point fournis
à l’examen des eenfeurs ; cependant l’expérience A
montré plus d’une fois que cette attention du gouvernement
n’auroit pas été fuperflué. L ’objet d’un
mandement eft communément important. Un évêque
eft cenfé avoir beaucoup d’autorité fur l’efprit des
peuples ; les peuples fournis à l’inftruâion des evê-
ques, doivent l’être auffi à l’autorité du fouveraim
Il ne peut donc pas être indifférent au fouverain
de connoître d’avance ce que l’évêque qui peut
être par hafard un fanatique, un mauvais efprit, un
fa&ieux, enjoindra à fes fujets dans un ouvragé
qu’il va publier : cela eft d’autant plus raifonnablé
que. tout ouvrage de religion, compofé ou par un
curé, ou même par un dofleur de Sorbonne ne
s’imprime point làns la permiffion du chancelier 6c
l’approbation du cenfeur royal*
Mandement, ( Jurifprud.) fignifie quelquefois là
même chofe que mandat ou procuration; quelque*
fois on entend par ce terme un ordre ou commiffiort
de faire quelque chofe, ou une injonction de venir ;
comme quand on donne à un officier un veniàt, ou
qu’un accufé eft mandé par le juge, foit pour êtré
blâmé ou pour être admonefté. Vnye^ Mandat
Man d a t a ir e ,P ro cu r at io n 6c Re n iâ t . (A \ *
MANDIBULE. ( Anatf^oye^ Mâ ch o ire.
MANDIL, f. m. ( Hifl. mod.~) nom d’une efpécë
de bonnet ou turban que portent les Perfes'. Voyez
Bonnet ou T urban. Le mandil fe forme premie-
ment en roulant au-tour de la tête, une piece dé
toile blanche, fine, de cinq à fix aunes de long -,
en tournant enfuite fur cela 6c de la même maniéré,
une piece^e foie ou écharpe de la même
longueur, qui foitvent eft de grand prix. Il faut,
pour avoir bonne grâce, que l’écharpe foit roulée
de telle forte que les diverfes couleurs, en fe rencontrant
dans les différens plis, faffent des ondes ,
comme nous voyons fur le papier marbré. Cet ha-*-
billement de tête eft fort majeftueux, mais très-
pefant ; il met la tête à couvert du grand froid 6t
de l’ardeur exceffive du foleil. Les coutelas ne peuvent
entamer un mandil ; la pluie le gâteroit, fi les
Perfes n’a voient une efpece de capuchon de gros
drap rouge dont ils couvrent leur mandil dans le
.mauvais tems. La mode du mandil a un peu changé
depuis quelque tems : pendant le régné de Scha-
Abba II. le mandil étoit rond par le haut ;,du
tems de Schà Soliman, on faifoit fortir du milieu
du mandil 6c par-deffus la tête un bout de i’échar-
pe ; & récemment fous le régné de Scha-huffein, au
lieu d’être ramaffé, comme auparavant, on l’a porté
pliffé en rofe, les Perfans ont trouvé que cette nouvelle
forme avoit meilleure grâce : 6c c’eft ainfi
qu’ils le portent encore.
MANDINGOS, (Hifi. mod. Géog.) peuple indépendant
de brigands qui habitent le royaume des
Foulis en Afrique. Ils ne vivent que de pillage, ne
font point fournis au firatick, 6c fe difpenfent de
payer aucune impofition ou de contribuer aux
charges de l’état. On dit que ce peuple reffemble
beaucoup aux Arabes vagabonds qui infeftent l’A-
fie : ils ont un langage particulier.
MANDINGUES, les (Géog.) peuple d’Afrique
dans la Nigritie, à 180 milles de la côte occidentale,
fur la riviere de Gambie, au fud du royaume
de Bambouc. Leur contrée eft appellée par les Ef-
pagnols Mandinen{a. Leur principale habitation eft
Songo. Les Negres de cette contrée font mieux faits
que ceux de Guinée , plus laborieux, plus fins, &
zélés mahométans ; mais ils admettent les femmes