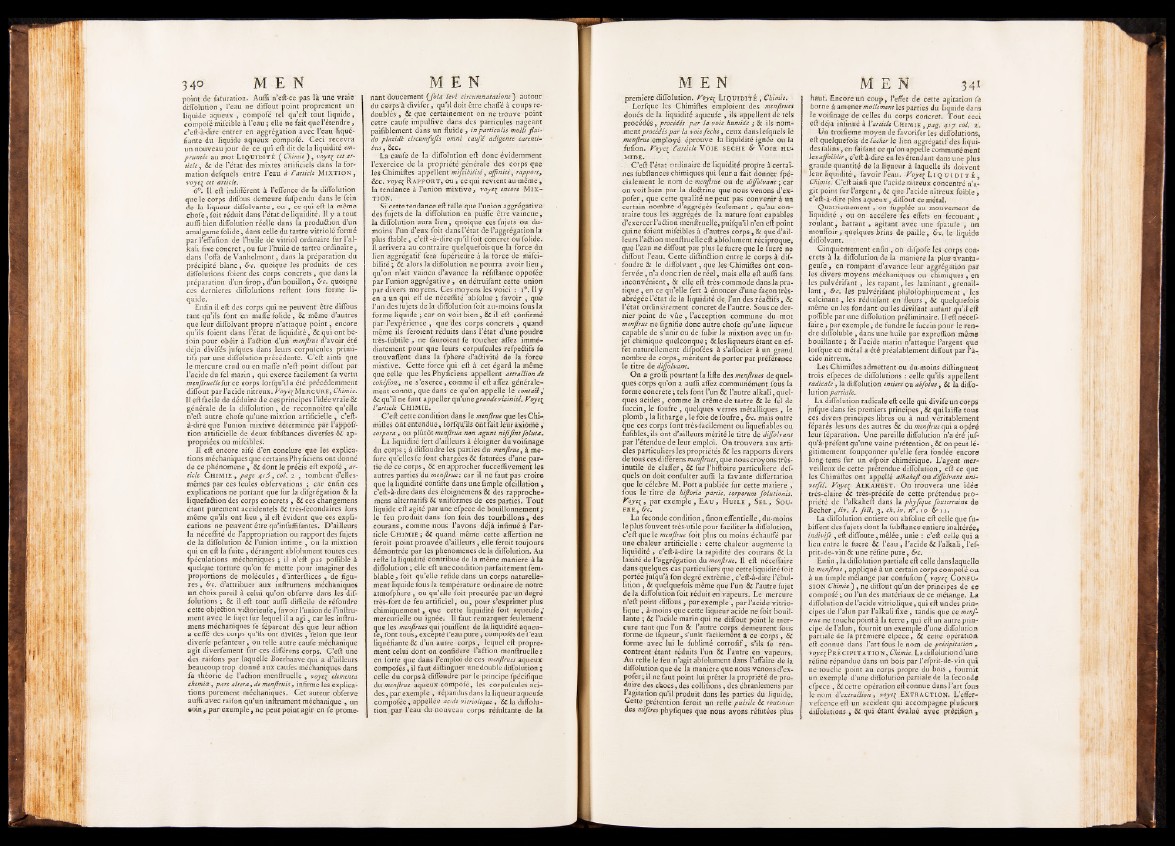
point de faturation. Aufli n’eft-ce pas là une vraie
diffolution, l’eau ne diffout point proprement un
liquide aqueux , compofé tel qu’eft tout liquide,
compofé mifcible à l’eau ; elle ne fait que l’étendre,
c’eft-à-dire entrer en aggrégation avec l’eau liquéfiante
du liquide aqueux compofé. Ceci recevra
un nouveau jour de ce qui eft dit de la liquidité empruntée
au mot Liq uid it é ( Chimie ) , voye^ cet ar*
ticle, & de l’état des mixtes artificiels dans la formation
defquels entre l’eau à Varticle Mix t ion ,
voye^ cet article.
6°. Il eft indifférent à l’effence de la diffolution
que le corps diffous demeure fufpendu dans le fein
de la liqueur dilfolvante, ou , ce qui eft la même
chofe, foit réduit dans l’état de liquidité. Il y a tout
auflibien diffolution réelle dans la produâion d’un
amalgame folide, dans celle du tartre vitriolé formé
par l’effufion de l’huile de vitriol ordinaire fur l’al-
kali fixe concret, ou fur l’huile de tartre ordinaire,
dans l’offa de Vanhelmont, dans la préparation du
précipité blanc, &c. quoique les produits de ces
diffolutions foient des corps concrets, que dans la
préparation d’un firop, d’un bouillon, &c. quoique
ces dernieres diffolutions reftent fous forme liquide.
Enfin il eft des corps qui ne peuvent être diffous
tant qu’ils font en maffe folide, 6c même d’autres
que leur diffolvant propre n’attaque point, encore
qu’ils foient dans l’état de liquidité, & qui ont be-
loin pour obéir à l’aâion d’un menflrue d’avoir été
déjà divifés jufques dans leurs corpufcules primitifs
par une diffolution précédente. C ’eft ainli que
le mercure crud ou en maffe n’eft point diffout par
l’acide du fel marin, qui exerce facilement fa vertu
menflruellt{\urce corps lorfqu’ila été précédemment
diffout par l’acide nitreux. VoyiezMercure, Chimie,
II eft facile de déduire de ces principes l’idée vraie 6c
générale de la diffolution, de reconnoître qu’elle
n’eft autre chofe qu’une mixtion artificielle , c’eft-
à-dire que l’union mixtive déterminée par l’appoft-
tion artificielle de deux fubftances diverfes & appropriées
ou mifcibles;
Il eft encore aifé d’en conclure que les explications
méchaniques que certains Phyficiens ont donné
de ce phénomène, & dont le précis eft expofé, article
C himie , page 4 16 , col. z , tombent d’elles-
mêmes par ces feules obfervations ; car enfin ces
explications ne portant que fur la difgrégation & la
liquefaâion des corps concrets , 6c ces changemens
étant purement accidentels & très-fecondaires lors
même qu’ils ont lieu j il eft évident que ces explications
ne peuvent être qu’infuffifantes. D ’ailleurs
la nécefiité de l’appropriation ou rapport des fujets
de la diffolution 6c l’union intime , ou la mixtion
qui en eft la fuite , dérangent àbfolument toutes ces 1
fpéculations méchaniques ; il n’eft pas pofiible à
quelque torture qu’on fe mette pour imaginer des
proportions de molécules, d’interftices , de figures
, &c. d’attribuer aux inftrumens méchaniques
un choix pareil à celui qu’on obferve dans les diffolutions
; & il eft tout aufli difficile de réfoudre
cette objeâion viâorieufe, favoir l’union de l’inftru-
ment avec le fujet fur lequel il a ag i, car les inftrumens
méchaniques fe féparent dès que leur aâion
a ceffé des corps qu’ils ont divifés , félon que leur
diverfe pefanteur, ou telle autre caufe méchanique
agit diverfement fur ces différens corps. C’eft une
des raifons par laquelle Boerhaave qui a d’ailleurs
beaucoup trop donné aux caufes méchaniques dans
fa théorie de l’aâion menftruelle , voye% elementa
chemia, pars altéra, de menjlruis, infirme les explications
purement méchaniques. Cet auteur obferve
aufli avec raifon qu’un inftrument méchanique , un
coin, par exemple, ne peut point agir en fe promenant
doucement (Jola levi circumnatatione ) autour
du corps à divifer, qu’il doit être chafie à coups redoublés
, & que certainement on ne trouve point
cette caufe impulfive dans des particules nageant
paifiblement dans un fluide , in particulis molli jlui-
do placidb circumfujîs omni caufâ adigente carenti-
bus , 6cc.
La caufe de la diffolution eft donc évidemment
l’exercice de la propriété générale des corps que
lesChimiftes appellent mifçibilité, affinité, rapport,
6cc. voyei Ra p po r t , oti, ce qui revient au même,
la tendance à l’union mixtive, voyeç encore Mix t
io n ; -
Si cette tendance eft telle que l’union aggrégative
des fujets de la diffolution en puiffe être vaincue ,
la diffolution aura lieu, quoique ces fujets ou du-
moins l’un d’eux foit dans l’état de l’aggrégation la
plus ftable, c’eft-à-dire qu’il foit concret ou folide.
Il arrivera au contraire quelquefois que la force du
lien aggrégatif fera fupérieüre à la torce de mifci-
bilité ; 6c alors la diffolution ne pourra avoir lieu ,
qu’on n’ait vaincu d’avance la réfiftance oppofée
par l’union aggrégative , en détruifant cette union
par divers moyens. Ces moyens les voici : i°. Il y
en a un qui eft de néceffité abfolue ; favoir , que
l ’un des fujets de la diffolution foit au-moins fous la
forme liquide ; car on voit bien, & il eft confirmé
par l’expérience , que ‘des corps concrets , quand
même ils feroient réduits dans l’état d’une poudre
très-fubtile , ne fauroient fe toucher affez immédiatement
pour que leurs corpufcules refpeâifs fe
trouvaffent dans la fphere d’aâivité de la force
mixtive. Cette force qui eft à cet égard la même
que celle que les Phyficiens appellent attraction de
cohéjîon, ne s’exerce, comme il eft affez généralement
connu, que dans ce qu’on appelle le contact y
6c qu’il ne faut appeller qu’une grande vifiinité, Voye^
l'article CH IM IE .
C ’eft cette condition dans le menjlrue que lesChimiftes
ont entendue, lorfqu’ils ont fait leur axiome ,
corpora, ou plûtôt menflriia non agunt nijijint foluta.
La liquidité fert d’ailleurs à éloigner du voifinage
du corps ; à diffoudre les parties du menjlrue, à me-
fure qu’elles fe font chargées 6c faturées d’une partie
de ce corps, 6c en approcher fucceflivement les
autres parties du menjlrue: car il ne faut pas croire
que la liquidité confifte dans une fimple ofcillation ,
c’eft-à-dire dans des éloignemens 6c des rapproche-
mens alternatifs 6c uniformes de ces parties. Tout
liquide eft agité par une efpece de bouillonnement ;
le feu produit dans fon fein des tourbillons, des
courans, comme nous l’avons déjà infinué à l’article
C h im ie ; & quand même cette affertion ne
feroit point prouvée d’ailleurs, elle feroit toujours
démontrée par les phenomenes de la diffolution. Au
refte la liquidité contribue de la même maniéré à la
diffolution ; elle eft une condition parfaitement fem-
blable, foit qu’elle refide dans un corps naturellement
liquide fous la température ordinaire de notre
atmofphere, ou qu’elle foit procurée par un degré
très-fort de feu artificiel, ou, pour s’exprimer plus
chimiquement, que cette liquidité foit aqueufe
mercurielle ou ignée. Il faut remarquer feulement^
que les menjlrues qui jouiffent de la liquidité aqueufe,.
font tous, excepté l’eâu pure, compofés de l ’eau
liquéfiante 6c d’un autre corps, lequel eft proprement
celui dont on confidere l’aâion menftruelle :
en forte que dans l’emploi de ces menflruts aqueux
compofés, il faut diftinguer une double diffolution ;
Celle du corps à diffoudre par le principe fpécifique
du menflrue aqueux compofé, les corpufcules acides,
par exemple , répandus dans la liqueur aqueufe
compofée, appellée acide vitriolique , 6c la diffolution.
par l’eau du nouveau corps réfultante de la
première diffolution. Voye^ Liq uid it é , Chimie.
Lorfque les Chimiftes emploient des menjlrues
doués de la liquidité aqueufe , ils appellent de tels
procédés, procédés par la voie humide ; & ils nomment
procédés par la voiefeche, ceux danslefqueis le
.menjlrue employé éprouve la liquidité ignée on la
fiifion. Koye[ l'article V oie SECHE & V oie hu*
.mi de. .
C ’eft l’état ordinaire de liquidité propre à certaines
fubftances chimiques qui leur a fait donner fpé-*
cialement le nom de menjlrue ou de dijfolvant ; car
on voit bien par la doârine que nous venons d’ex-
pofer, que cette qualité ne peut pas convenir à un
certain nombre d’aggrégés feulement, qu’au contraire
tous les aggregés de la nature font capables
d’exercerl’aâion menftruelle,puifqu’il n’en eft point
qui ne foient mifcibles à d’autres corps, & que d’ailleurs
l’aâion menftruelle eft àbfolument réciproque,
que l’eau ne diffout pas plus le fuçre que le lucre ne
diffout l’eau. Cette diftinâion entre le corps à diffoudre
& le diffolvant, que les Chimiftes ont con-
fervée, n’a donc rien de réel, mais elle eft aufli fans
inconvénient, & elle eft très-commode dans la pratique
, en ce qu’elle fert à énoncer d’une façon très-
abrégée l’état de la liquidité de, l’un des réaâifs, 6c
l ’état ordinairement concret de l’autre. Sous ce dernier
point de v u e , l’acception commune du mot
menjlrue ne fignifie donc autre chofe qu’une liqueur
capable de s’unir ou de fubir la mixtion avec un fujet
chimique quelconque ; & les liqueurs étant en effet
naturellement difpofées à s’affocier à un grand
nombre de corps, méritent de porter par préférence
le titre de dijfolvant.
On a grofli pourtant la lifte des menjlrues de quelques
corps qu’on a aufli affez communément fous la
forme concrète ; tels font l’un & l’autre alkali, quelques
acides, comme la crème de tartre & le fel de
fuccin, le foufre , quelques verres métalliques, le
plomb, la litharge, le foie de foufre, &c. mais outre
due ces corps font très-facilement ou liquéfiables ou
fufibles, ils ont d’ailleurs mérité le titre de dijfolvant
par l’étendue de leur emploi. On trouvera aux articles
particuliers les propriétés 6c les rapports divers
de tous ces différens menjlrues, que nous croyons très-
inutile de claffer, 6c fur l’hiftoire particulière defquels
on doit consulter aufli la favante differtation
que le célébré M. Pott a publiée fur cette matière ,
fous le titre de hijloria partie, corporum folutionis.
Voÿe{, par exemple, Ea u , Huile , Se l , Soufre^
La fécondé condition, finon effentielle, du-moins
le plus fouvent très-utile pour faciliter la diffolution,
c’eft que le menjlrue foit plus ou moins échauffé par
une chaleur artificielle : cette chaleur augmente la
liquidité , c’eft-à-dire la rapidité des courans & la
laxité de l ’aggrégation du menjlrue. Il eft néceffaire
dans quelques cas particuliers que cette liquidité foit
portée jufqu’à fon degré extrême, c’eft-à-dire l’ébullition
, & quelquefois même que l’un & l’autre fujet
de la diffolution foit réduit en vapeurs. Le mercure
n’eft point diffous , par exemple , par l’acide vitriô-
lique , à-moins que cette liqueur acide ne foit bouillante
; 6c l’acide marin qui ne diffout point le mercure
tant que l’un & l’autre corps demeurent fous
forme de liqueur, s’unit facilement à ce corps , 6c
forme avec lui le fublimé corrofif, s’ils fe rencontrent
étant réduits l’un 6c l’autre en vapeurs.
Au refte le feu n’agit àbfolument dans l’affaire de ia
diffolution que de la maniéré que nous venons d’ex-
pofer;il ne faut point lui prêter la propriété de produire
des chocs, des colliuons, des ébranlemens par
1 agitation qu’il produit dans les parties du liquide.
Cette prétention feroit un refte puérile 6c routinier-
des miferes phyfiques que nous ayons réfutées plus
haut. Encore un coup, l’effet de cétté agitation fé
borne à amener mollement les parties du liquide dans
le voifinage de celles du corps concret. Tout éeci
eft déjà infinué à Yarticle C himie ,j>ag. 41 y col. z-.
Un troifieme moyen de favorifer les diffolutions,
eft quelquefois de lâcher le lien aggrégatif des liquides
falins, en fâifant ce qu’on appelle communément
iesaffioiblir, c-<ik h-àirQ en les étendant dans une plus
grande quantité de la liqueur à laquelle ils doivent
leur liquidité, favoir l’eau. V oye^ L i q u i d i t é ,
Chimie. C ’eft ainfi que l’acide nitreux concentré n’a*
git point fur l’argent, 6c qüed’acide nitreux foible >
c’eft-à-dire plus aqueux, diffout ce métaL
Quatrièmement, on fupplée au mouvement de
liquidité > ou on accéléré les effets en fecouant ,
roulant, battant , agitant avec une fp'atule , un
mouffoir, quelques brins de paille , &c. le liquidé
diffolvant......
Cinquièmement enfin , on difpofe ieS corps côrl*
crets à la diffolution de la maniéré la plué-tfvanta-
geufe , en rompant d’avande leur aggrégatidn paf
les divers moyens méchaniques où chimiques, en
les pulvérifant , les rapant, les laminant, grenail*
Iant, &c. les pulvérifant philofophiquement , les
calcinant, les réduifant en fleurs, 6c quelquefois
même en les fondant ou ïes divifant autant qu’il eft
polfible par une diffolution préliminaire. II eft né'cef»
faire, par exemple ; de fondre le fuccin pour le rendre
diffoluble , dans une huile par expreflion même
bouillante ; & l’acide marin n’attaque l’argent que
lorfque ce métal a été préalablement diffout par l’à-
cide nitreux.
Les Chimiftes admettent ou du-moins diftinguent
trois efpeces de diffolutions : celle qu’ils appellent
radicale, là diffolution entière ou abfolue, & la diffolution
partiale.
La diffolution radicale eft celle qui divife un corps
jufque dans fes premiers principes, & quilaiffe tous
ces divers principes libres ou à nud véritablement
féparés les uns des autres & du menflrue qui a opéré
leur féparation. Une pareille diffolution n’a été juf-
qu’à-préfent qu’une vaine prétention, & on peut légitimement
foupçonner qu’elle fera fondée encore
long-tems fur un efpoir chimérique. L’agent mer*
veilleux'de cette prétendue diffolution, eft ce que
les Chimiftes ont appellé alkahefi ou dijfolvant uni*
verfel. Voyeç Alkahest. On trouvera une idée
très-claire & très-précile de cette prétendue propriété
de l’alkaheft dans, la phyfique fouterraint de
Becher,' liv. 1. fecl. 3 . ch. iv. n°. 10 & 11.
La diffolution entière ou abfolue eft celle que fü-
biffent des fujets dont la fubftance entière inaltérée,
indivife , eft diffoute, mêlée, unie : c’eft celle qui a
lieu entre le fucre 6c l’eau, l ’acide 6c l’alkali, l’ef-
prit-de-vin & une réfine pure, &c.
Enfin, la diffolution partiale eft celle dans laquelle
le menflrue , appliqué à un certain corps compofé ou
à un fimple mélange par confufion ( voyeç C onfusion
Chimie ) , ne diffout qu’un des principes de «e
compofé ; ou l’un des matériaux de ce mélange. La
diffolution de l’acide vitriolique, qui eft un des principes
de l ’alun par l’alkali fixe , tandis que-ce menf*
true ne touche point à la terre, qui eft un autre principe
de l’alun, fournit un exemple d’une diffolution
partiale de la première efpece, 6c cette opération
eft connue dans l’art fous le nom de précipitation ,
voye[ Pr é c ip it a t io n , Chimie. La diffolution d’uno
réfine répandue dans un bois par l’efprit-de-vin qui
ne touche point au corps propre du bois , fournit
un exemple d’une diffolution partiale de la féconde
efpece , & cette opération eft connue dans l ’art fous
le nom d'extraction, voye[ Ex tr a c t io n . L’effer-
vefcence eft un accident qui accompagne plufieurl
diffolutions , 6c qui étant évalué ayec précifion,