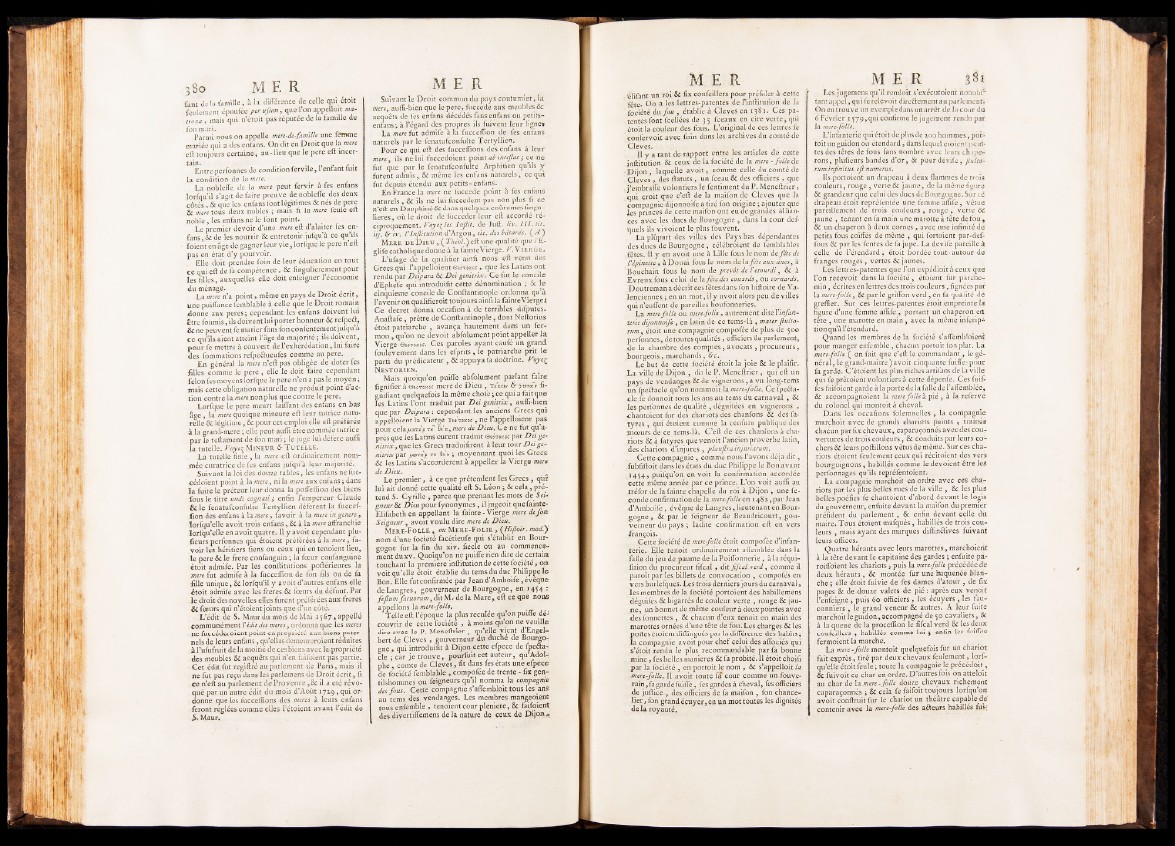
fant de la, famille, à la différence de celle qui étoit
feulement époufée per ufum, que l’on appellent
trôna , mais qui n’étoit pas réputée de la famille de
. fon mari. • . c
Parmi nous on appelle mere-de-famtlle une femme
mariée qui «1 des entans. On dit en Droit que la mere
eft toujours certaine, au-lieu que le pere eft incer-
Entre perfonnes de condition fervile, 1 enfant fuit
la condition de la mere.
La nobleffe de la mere peut fervir à fes enfans
lorfqu’il s’agit de faire preuve de nobleffe des deux
côtés, & que les enfans font légitimes & nés de pere
& mere tous deux nobles ; mais fi la mere feule eft
noble, les enfans ne le font point.
Le premier devoir d’une mere eft d alaiter fes en-
fans, 8c de les nourrir & entretenir jufqu’à ce qu’ils
foient en âge de gagner leur v ie , lorfque le pere n eft
pas en état d’y pourvoir.
Elle doit prendre foin de leur éducation en tout
ce qui eft de fa compétence, & fingulierement pour
les filles, auxquelles elle doit enfeigner l’économie
du ménage. . | .
La mere n’a point, même en pays de Droit écrit,
une puiffance femblable à celle que le Droit romain
donne aux peres; cependant les enfans doivent lui
être fournis, ils doivent lui porter honneur 8c refpett,
& ne peuvent fe marier fans fon contentement jufqu’à
ce qu’ils aient atteint l’âge de majorité ; ils doivent,
pour fe mettre à couvert de l’exhérédation, lui faire
des fommations refpeûueufes comme au pere.
En général la mere n’eft pas obligée de doter fes
filles comme le père, elle le doit faire cependant
félon fes moyens lorfque le pere n’en a pas le moyen ;
mais cette obligation naturelle ne produit point d’action
contre la mere non plus que contre le pere.
Lorfque le pere meurt laiffant des enfans en bas
âg e , la mere quoique mineure eft leur tutrice naturelle
8c légitime, & pour cet emploi elle eft préférée
à la grand-mere ; elle peut aufli être nommée tutrice
par le teftament de fon mari ; le juge lui déféré aufli
la tutelle. V o y e ^ Mineur & Tutelle.
La tutelle finie , la mere eft ordinairement, nommée
curatrice de fes enfans jufqu’à leur majorité.
Suivant la loi des douze tables, les enfans ne fuç-
cédoient point à la mere, ni la mere aux enfans ; dans
la fuite le préteur leur donna la poffeffion des biens
fous le titre unde cognati, enfin l’empereur Claude
& l e fenatufconfulte Tertyllien défèrent la fuccef-
fion des enfans à la mere , favoir à la mere in généré,
ïorfqu’elle avoit trois enfans, & à la mere affranchie
ïorfqu’elle en avoit quatre. Il y avoit cependant plu-
fieurs perfonnes qui étoient préférées à la mere, fa-
voir les héritiers fiens ou ceux qui en tenoient lieu,
le pere & le frere confanguin ; la foeur confanguine
étoit admife. Par les conftitutions poftérieures la
mere fut admife à la fucceflion de fon fils ou de fa
fille unique, 8c lorfqu’il y avoit d’autres enfans elle
ëtoit admife avec les freres 8c foeurs du défunt. Par
, le droit des novelles elles furent préférées aux freres
& foeurs qui n’étoient joints que d’un côté.
L ’édit de S. Maur du mois de Mai 1567, appelle
communément Y édit des meres, ordonna que les meres
ne fuccéderoient point en propriété aux biens paternels
de leurs enfans, qu’elles demeureroient réduites
à l’ufufruit de la moitié de cesbiens avec la propriété
des meubles 8c acquêts qui n’en faifoient pas partie.
Cet édit fut regiftré au parlement de Paris, mais il
ne fut pas reçu dans les parlemens de Droit écrit, fi
ce n’eft au parlement de Provence, & il a été révoqué
par un autre édit du mois d’Aout 1719, qui ordonne
que les fucceflions des meres à leurs enfans
feront réglées connue elles l’étoient avant l’édit de
JS. Maur.
Suivant le Droit commun du pays coutumier, là
mere, aufli-bien que le pere, fticcede aux meubles 8t
acquêts de fes enfans décédés fans enfans ou petits—
enfans; à l’égard des propres ils fuivent leur ligne»
La mere fut admife à la fucceflion de fes enfans
naturels par le fenatufconfulte Tertyllien.
Pour ce qui eft des fucceflions des enfans à leur
mere, ils ne lui fuccedoient point ab intejlai; ce ne
fut que par le fenatufconfulte Arphitien qu’ils y
furent admis, 8c même les enfans naturels, ce qui
fut depuis étendu aux petits-enfans.
En France la mere ne fuccede point à fes enfans
naturels , 8c ils ne lui fuccedent pas non plus fi ce
n’eft en Dauphiné 8c dans quelques coûtumes fingu-
lieres, où le droit de fucceder leur eft accordé réciproquement.
Voyelles Injiit. de Juft. liv. III. tic.
iij.& iv . Vlnflituiion d’A rgou, tit. des bâtards. (^4 )
Mere de D ieu , ( Théol.) eft une qualité que l’E-
glifecatholiquedonneà lafainteVierge. ^.Vierge.
L’ufage de la qualifier ainfi nous eft venu des
Grecs qui l’appelloient ©sotoxoç » que les Latins ont
rendu par Deipara 8c Dei genitrix. Ce fut le concile
d’Ephefe qui introduifit cette dénomination ; & le
cinquième concile de Conftantinople ordonna qu’à
l’avenir on qualifieroit toujours ainfi la fainteVierge*
Ce decret donna occafion à de terribles difputes.
Anaftafe , prêtre de Conftantinople, dont Neftorius
étoit patriarche , avança hautement dans un fer-:
mon , qu’on ne devoit abfolument point appeller la
Vierge ©ïotokoç. Ces paroles ayant caufé un grand
foulevement dans les efprits , le patriarche prit le
parti du prédicateur , 8c appuya fa doctrine. Voye^
Nestorien.
Mais quoiqu’on puiffe abfolument parlant faire
fignifier à ©*otokoç mere de Dieu , t/kuv & ytwctv lignifiant
quelquefois la même chofe ; ce qui a fait que
les Latins l’ont traduit par Dei genitrix, auflî-biere
que par Deipara : cependant les anciens Grecs qui
appelloient la Vierge Tto'roKoç , ne l’appelloienr pas
pour cela^uHTJt'p tb" Ota, mere de Dieu. Ce ne fut qu a-
près que les Latins eurent traduit ©ïotokoç par Dei genitrix,
que les Grecs traduifirent à leur tour Dei genitrix
par jUHTJt'p t» ôs'îj ; moyennant quoi les Grecs
& les Latins s’accordèrent à appeller la Vierge mere
de DieUv
Le premier, â ce que prétendent les Grecs , qüî
lui ait donné cette qualité eft S. Léon ; & cela, prétend
S. Cyrille , parce que prenant les mots de Seù*
gneur&c Dieu pour fynonymes, il jugeoit quefainte-
Elifabeth en appellant la fainte - Vierge mere de fort
Seigneur , avoit voulu dire mere de Dieu.
Mere-Folle , ou Mere-Folie , (Hifloir. mod.J
nom d’une fociété facetieufe qui s établit en Bourgogne
fur la fin du xiv, fiecle ou au commencement
du xv. Quoiqu’on ne puiffe rien dire de certain;
touchant la première inftitution de cette fociété, on
voit qu’elle étoit établie du tems du duc Philippe le
Bon. Elle fut confirmée par Jean d’Amboife,évêque
deLangres, gouverneur de Bourgogne, en 1454 :
fefium fatuorum, dit M. de la Mare, eft ce que nous
appelions la mere-folie. ,
Telle eft l’époque la plus reculée qu’on puiffe découvrir
de cette fociété , à moins qu’on ne veuille
dire avec le P. Meneftrier , qu’elle vient d’Engel-,
bert de C le v e s , gouverneur du duché de Bourgo-i
gne, qui introduifit à Dijon cette efpece de fpefta-
cle ; car je trouve, pourfuit cet auteur, qu’Adolphe
, comte de Cleves, fit dans fes états une efpece
de fociété femblable , compofée de trente - fix gentilshommes
ou feigneurs qu’il nomma la compagnie
des fous. Cette compagnie s’affembloit tous les ans
au tems des vendanges. Les membres marigeoienfi
tous enfemble , tenoient cour pleniere, & faifoient
des divertiffemens de la nature de ceux de Dijon $
élifànt un roi & fix confeillers pour préficter à cette
fête. On a les lettres-patentes de l’inftitution de la
fociété du fou , établie à Cleves en 1381. Ces patentes
font fcellées de 35 fceaux en cire verte, qiii
étoit la couleur des fous. L’original de ces lettres fe
confervoit avec foin dans les archives du comté de
Cleves. . .
Il y a tant de rapport entre les articles de cette
inftitution 8c ceux de la fociété de la mere -folle A?
Dijon , laquelle a vo it, comme celle du comté de
Cleves , des ftatuts , un fceau 8c des officiers , que
j ’embraffe volontiers le fentiment du P. Meneftrier,
qui croit que c’eft de la maifon de Cleves que la
compagnie dyonnoife a tiré fon origine ; ajoutez que
les princes de cette maifon ont eu de grandes alliances
avec les ducs de Bourgogne , dans la cour def-
Iquels ils vivaient le plus fouvent.
La plûpart des villes dés Pays bas dépendantes
des ducs de Bourgogne, célébroient de femblables
fêtes. Il y en avoit une à Lille fous le nom de fête de
Vèpintite, à Douai fous le nom de \z fête aux ânes, à
Bouchain fous le nom de prévôt de l'étourdi, 8c à
Evreuxfous celui de la fête des couards, ou cornards.
Doutreman a décrit ces fêtes dans fon hiftoire de V alenciennes
; en un mot, il y avoit alors peu de villes
qui n’euflent de pareilles boufonneries;
La mere-folie ou mere-folie, autrement dite Y infanterie
dijonnoife , en latin de- ce tems-Ià , mater flulto-
rum, étpit une compagnie compofée déplus de 500
perfonnes, de toutes qualités, officiers clu parlement,
,de la chambre des comptes, avocats , procureurs,
bourgeois, marchands, &c.
Le but de cette fociété étoit la joie & le plaifir.
La ville de Dijon , dit le P. Meneftrier ; qui eft un
pays de vendanges 8c de vignerons, a vu long-tem$
un fpe&acle qu’on nommoit la mere-folie. Cefpefta-
de.fe donnoit tous les ans au tems du carnaval , 8c
les perfonnes de qualité , déguifées en vignerons ',
chantoient fur des chariots des chanfons & des fa-
tyres , qui étoient comme la cenfure publique des
jmoeurs de ce tems-là. C ’eft de ces chanfons à chariots
8c à fatyres que venoit l’ancien proverbe latin,
des chariots d’injures , plaujlra injuriarum.
Cette compagnie , comme nous l’avons déjà d it ,
fubfiftoit dans les états du duc Philippe le Bon avant
1454, puifqu’on en voit la confirmation accordée
cette même année par ce prince. L’on voit aufli au
îréfor de la fainte chapelle du roi à Dijon , une fécondé
confirmation de la mere-folie en 1482,par Jean
d’Amboife, évêque de Langres, lieutenant en Bourgogne
, & parle feigneur de Beaudricourt, gouverneur
du pays ; ladite confirmation eft en vers
françois.
Cette fociété de mere-folie étoit compofée d’infanterie.
Elle tenoit ordinairement affemblée dans la
-falle du jeu de paume de la Poiffonnerie , à la réqui-
fition du procureur fifcal , dit fifcal.verd, comme il
paroît par les billets de convocation , compofés en
vers burlefques. Les trois derniers jours du carnaval,
les membres de la fociété portoient des habillemens
déguifés & bigarrés de couleur verte , rouge & jaune,
un bonnet de même couleur à deux pointes avec
des fonnettes , & chacun d’eux tenoit en main des
marottes ornées d’une tête de fou. Les charges & les
poftes étoient diftingués par la différence des habits ;
la compagnie avoit pour chef celui des affociés qui
s’étoit rendu le plus recommandable par fa bonne
inine, fes belles maniérés & fa probité. Il étoit choifi
.par la fociété , en portoit le nom , & s’appelloit la
mere-folie. Il avoit toute fa cour comme un fouve-
rain ,fa garde fujffe, fes gardes à cheval, fes officiers
de juftice , des officiers de fa maifon , fon chancelier
, fon grand écuyer, en un mot toutes les dignités
de la royauté.
Les jugemens qu’il rendoit s’exécutoient honobf"
tant appel, qui fe relevoit direétemenr au parlement.
On en trouve un exemple dans un arrêt de la cour du
6 Février 1579, qui confirme le jugement rendu par
la mcre-fôlle. ' ,
L’infanterie qui étoit de plus de 200 hommes, portoit
un guidon ou étendard, dans lequel étoient peintes
des têtes de fous fans nombre avec leurs chupe-
rons, plufieurs bandes d’o r , & pour dévife, fiulto-
rum infinitus ejl numerus.
Ils portoient un drapeau à deux flammes de trois
couleurs, rouge , verte & jaune, de la même figure
& grandeur que celui des ducs de Bourgogne. Sur ce
drapeau étoit repréfentée une femme aflife, vêtue
pareillement de trois couleurs , rouge , verte Ôc
jaune , tenant en fa main une marotte à tête de fou,
& un chaperon à deux cornes , avec une infinité dé
petits fous coiffés de même , qui fortoient par-def-
fous & par les fentes de fa jupe. La devife pareille à
celle de l’étendard; étoit bordée tout-autour de
.franges rouges , vertes & jaunes.
Les lettres-patentes que l’on expédioit à ceux qué
l’on recevpit dans la fociété ; étoient fur parchemin
, écrites en lettres des trois couleurs, lignées par
la mere-folie, 8c parle griffon verd, en fâ qualité dé
greffier. Sur ces lettres-patentes étoit empreinte là
figure d’une femme aflife , portant un chaperon eri
tête , une-marotte en main , avec la même inferip-
tion qu’à l’étendard.
Quand les membres de la fociété s’affembloient
pour manger enfemble , chacun portoit fon plat. Là
mere-folie ( on fait que c’eft le commandant, le général,
le grand-maître)avoit cinquante fuiffespour
fa garde; C ’étoient les plus riches artifans de la ville
qui fe prêtoient volontiers à cette dépenfe. Ces fuif-
fes faifoient garde à la porte de la falle del’affemblée,
8c accompagnoient la mere folle à pié , à la refervé
du colonel qui montoit à cheval.
Dans les occâfions folemnelles , la compagnie
marchoit avec de grands chariots peints , traînés
chacun par fix chevaux, caparaçonnés avec des couvertures
de trois couleurs, & conduits par leurs couchers
8c leurs poftillons vêtus de même. Sur ces chariots
étoient feulement ceux qui récitoient des vers
bourguignons, habillés comme le dévoient être leS
perfonnages qu’ils repréfentoieiit;
La compagnie marchoit en ordre avec ces chariots
par les plus belles rues de la ville , & les plus
belles poéfies fe charttoient d’abord devant le logis
du gouverneur, enfuite devant la maifon du premier
préfident du parlement, & enfin devant celle du
maire* Tous étoient mafqués, habillés de trois couleurs
, mais ayant des marques diftin&ives fuivant
ieurs offices.
Quatre hérauts avec leurs marottes, marchoierit
à ia tête devant le capitaine des gardes ; enfuite pà-
roiffoient les chariots, puis la mere-folie précédée de
deux hérauts , 8c montée fur une baquenéé blanche
; elle étoit fuivie de fes dames d’atoür , dé fix
pages & de douze valets de pié : après eux venoit
l’enfeigne ; puis 60 officiers , les écuyers , les fauconniers
, le grand veneùr & autres. A leur fuite
marchoit le guidon, accompagné de 50 cavaliers, &
à la queue de la procéflion le fifcal verd 8c les deux
confeillers , habillés comme lui ; enfin les fuiffes
fermoiént la marché. .
La mere - folle montoit quelquefois fur un chariot
fait exprès, tiré par deux chevaux feulement, lorsqu'elle
étoit feule ; toute la compagnie le précédoit,
& fuivoit ce char en ordre. D ’autres fois on atteloit
au char de la mere -folle douze chevaux richement
caparaçonnés ; 8c cela fe faifoit toujours lorfqu on
avoit conftruit fur le chariot un theatre capable dé
contenir avec la mere-folie des afteurs habillés fui«;