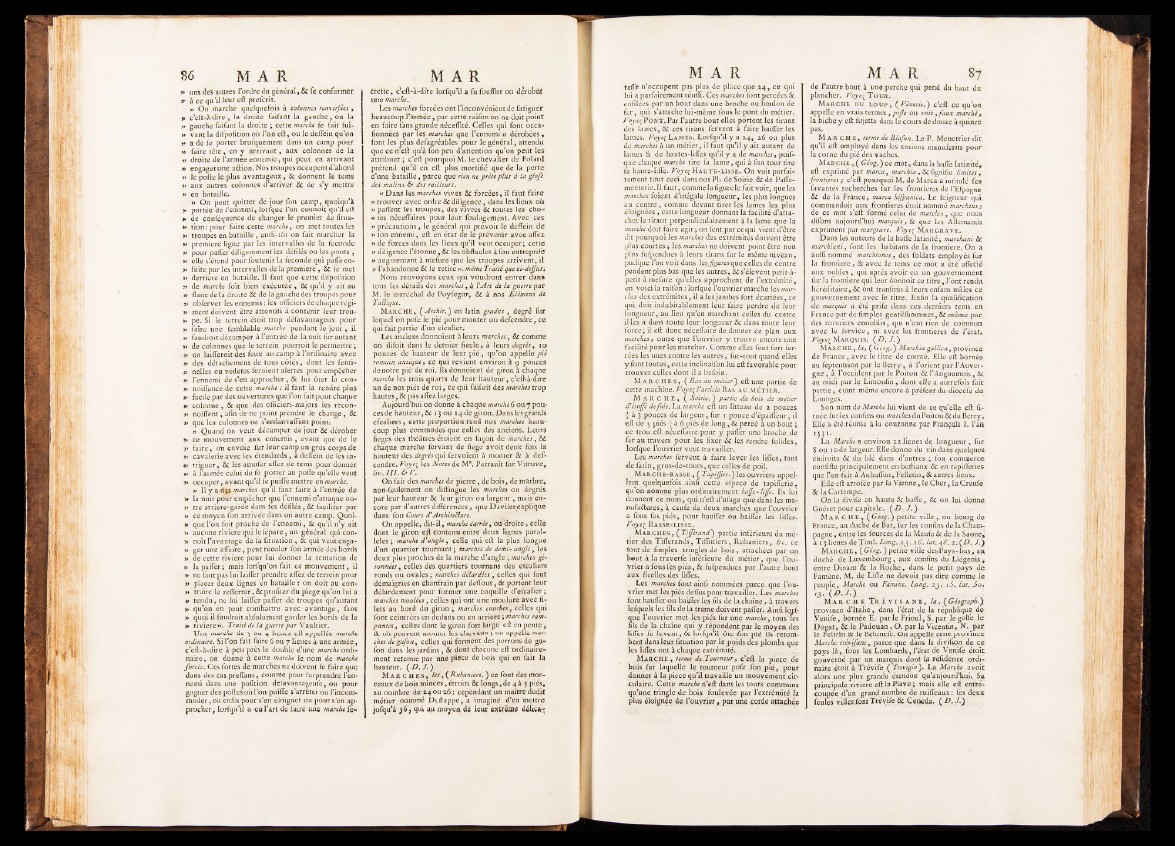
» uns des autres l’ordre du général, & fè cohformêf
» à ce qu’il leur eft prefcrit.
» On marche quelquefois à colonnes renverfées -,
» c’elt-à-dirc , la droite faifant la gauche, ou la
» gauche faifant la droite ; cette marche fe fait fui-
» vant la difpofition où l’on e ft, ou le deflein qu’on
» a de fe porter brufquement dans un camp pour
» faire tête, en y arrivant, aux colonnes de la
» droite de l’armée ennemie j qui peut en arrivant
» engagerune aâion. Nos troupes occupent d’abord
» le pofte le plus avantageux, & donnent le tems
» aux autres colonnes d’arriver & de s’y mettre
» en bataille.
» On peut quitter de jour fon camp* quoiqu’à
» portée de l’ennemi, lorfque l’on connoît qu’il eft
» de conféquence de changer le premier de fitua*
» tion : pour faire cette marche, on met toutes les
» troupes en bataille , anfli-tôt on fait marcher la
» première ligne par les intervalles de la fécondé
» pour paffer diligemment les défilés ou les ponts ,
» elle s’étend poùrfoutenir la fécondé qui paffeen-
» fuite par les intervalles de la première, 6c fe met
» derrière en bataille. Il faut que cette difpofition
» de marche foit bien exécutée , 6c qu’il y ait au
» flanc de la droite 6c de la gauche des troupes pour
» obferver les ennemis : les officiers de chaque régi-
» ment doivent être attentifs à contenir leur trou-
» pe. Si le terrein étoit trop défavantageux pour
» faire une femblable marche pendant Te jour, il
» faudroit décamper à l’entrée de la nuit fur autant
» de colonnes que le terrein pourroit le permettre ;
» on laifferoit des feux au camp à l ’ordinaire avec
» des détachemens de tous côtés, dont les fenti»
» nelles ou vedetes feroient alertes pour empêcher
» l’ennemi de s’en approcher, & lui ôter la con-
» noiffance de cette marche : il faut la rendre plus
» facile par des ouvertures que l’on fait pour chaque
» colonne, & que des officiers-majors les recon-
» noiffent, afin de ne point prendre le change, 6c
» que les colonnes ne s’embâfrraffent point.
» Quand on veut décamper de jour 6c dérober
»> ce mouvement aux ennemis, avant que de le
» faire, ôn envoie fur leur camp un gros corps de
» cavalerie avec les étendards, à deflein de les in-
»> trigüer, 6c les amufer aflez de tems pour donner
»> à Parmée celui de fe porter au pofte qu’elle veut
» occuper, avant qu’il fe puifle mettre en marche.
» Il y a dfcs marches qu’il faut faire à l’entrée de
w la nuit pour empêcher que l’ennemi n’attaque no-
» tre arriéré-garde dans fes défilés, 6c faciliter par
» ce moyen fon arrivée dans un autre camp. Quoi-
* que l’on foit proche de l ’ennemi, & qu’il n’y ait
» aucune rivicre qui lelépare, un général qui con*
>> noît l’avantage de fa fltuation, & qui veut enga-
v ger une affaire, peut reculer fon armée des bords
» de cette rivière pour lui donner la tentation de
» la paffer ; mais lorfqu’on fait ce mouvement, il
» ne faut pas lui laiffer prendre aflez de terrein pour
» placer deux lignes en bataille : oh doit au con-
>» traire le refferrer, 6c profiter du piege qu’on lui a
v tendu, ne lui laiffer paffer de troupes qu’autant
» qu’on en peut combattre avec avantage, fans
» quoi il faudroit abfolurtient garder les bords de la
h riviere». Traite de la guerre par Vaulticr.
Une marche de 3 ou 4 lieues eft appellée marche
ordinaire. Si l’on fait faire 6 ou 7 lieues à une armée,
c’eft-à-dire à peu près le double d’une marche ordinaire,
on donne à cette marche le nom de marche
forcée. Ces fortes de marches ne doivent fe faire que
dans des cas preffans, comme pour furprendre l’ennemi
dans une pofition defavantageufe, ou pour
gagner des poftes où l’on puifle s’arrêter ou l’incommoder
, ou enfin pour s’en éloigner ou pour s’en approcher,
lorfqu’il a eu l’art de faire une marche fe'*
èfèftè, c’eft-à-dire lorfqu’il a fu fouffler otl dérobé*
une marche.
Les marches forcées Ont l’inconvénient de fatiguer
beaucoup l’armée, par cette raifon on ne doit point
en faire fans grande néceflité. Celles qui font occa-
fionnées par les marches que l’ennemi a dérobées ,
font les plus defagréables pour le général, attendu
que ce n’eft qu’à fon peu d’attention qu’on peut les
attribuer ; c’eft pourquoi M. le chevalier de Folard
prétend qu’il en eft plus mortifié que de la perte
d’une bataille, parce que rien ne prête plus à la glofe
des malins & des railleurs.
« Dans les marches vives 6c forcées, il faut faire
t> trouver avec ordre & diligence, dans les lieux où
» païfent les troupes, des vivres & toutes les cho-»
» les néceffaires pour leur foulagement. Avec ces
» précautions, le générai qui prévoit le deflein de
» l'on ennemi, eft en état de le prévenir avec aflez
»de forces dans les lieux qü’il veut Occuper; cette
» diligence l’étonne, 6c les ôbftacles à fon ehtreprife
» augmentant à mefure que les troupes arrivent, il
» l’abandonne 6c 1e retire ». même Traité que zi-deffusi
Nous renvoyons ceux qui voudront entrer dan»
tous les détails des marches, à Y Art de la guerre par
M. le maréchal de Puyfegur, 6c à nos Elémens dt
Tacliqüè.
Marche, ( Àrchît.) en latin gtadüs , degré fur
lequel on pofe le pié pour monter ou defcendre, ce
qui fait partie d’un efcalier.
Les anciens donnoient à leurs marches, 6c comme
on difoit dans le dernier fieele, à leurs degrés, 10
pouces de hauteur de leur p ié , qu’on appelle pié
romain antique, Cé qui revient environ à o pouces
de notre pié de roi. Ils donnoient de giron à chaqne
marche les trois qtiarts de leur hauteur, c’eft-à-dire
un de nos piés de ro i, Ce qui fâifoit des marches trop
hautes, 6c pas aflez larges.
Aujourd’hui on donne à chaque marche 6 ou 7 pouces
de hauteur, 6c 13 ou 14 de giron. Dans les grands
efcaliers, cette proportion rend nos marches beau»
coup plus commodes que celles des anciens. Leurs
fieges des théâtres étoieht en façon de marches, 6c
chaque marche fervant de fiege avoit deux fois là
hauteur des degrés qui fervoient à monter & à def*
cendre. Voye^ les Notes de Me. Perrault fur V itruve,
liv. I I I . 6* V.
On fait des marchés de pief re, de bois, de marbre*
non-feulement on diftingue les marches ou degrés
par leur hauteur & leur giron ou largeur, mais encore
par d’autres différences, que Daviler explique
dans fon Cours d'Architecture.
On appelle, dit-il, marche carrée, ou droite, celle
dont le giron eft contenu entre deux lignes parallèles
; marche d'angle, celle qui eft la plus longue
d’un quartier tournant; marches de demi - angle, les
deux plus proches de la marche d’angle ; marches gi-
ronnées, celles des quartiers tournans des efcaliers
ronds ou ovales ; marches délardées , celles qui font
démaigries en chanfrain par deflous, & portent leur
délardement pour former une coquille d’efcalier;
marches moulées, celles qui ont une moulure avec filets
au bord du giron ; marches courbes, celles qui
font ceintrées en dedans ou en arriéré ; marches rampantes
, celles dont le giron fort large eft en pente *
& où peuverit monter les chevaux ; on appelle mar•
ches de gafon, celles qui forment des perrons de ga-
fon dans les jardins, & dont chacune eft Ordinairement
retenue par une piece de bois qui en fait là
hauteur. ( D . J. )
Ma r c h e s , lés, { Rubaniers. ) ce font des morceaux
de bois minces, étroits 6c longs, de 4 à ƒ piés,
au nombre de 24 ou 26 : cependant un maître dudit
métier nommé Dtftappe, a imaginé d’en mettre
jufqu’à 36; qui au moyeu de leur extrême délicateffe
n’occupent pas plus de place que 14 , ce qui
lui à parfaitement réufli. Ces marches font percées &
enfilées par un bout dans une broche ou boulon de
fer, qui s’attache lui-même fous le pont du métier.
Voyt{ Pont. Par l’autre bout elles portent les tirans
des lames, 6c ces tirans fervent à faire baiffer les
lames. Voye[ Lames. Lorfqu’il y a 24, 26 ou plus
de marches à un métier, il faut qu’il y ait autant de
lames & de hautes-liffes qu’il y a de marches, puif-
que chaque marche tire fa lame, qui à fon tour tire
fa haute-liffe. /^«{Haute-lisse. On voit parfaitement
tout ceci dans nos PL de Soirie & de Paffe-
menterie. Il faut, comme la figure le fait voir, que les
marches foient d’inégale longueur, les plus longues
au centre, comme devant tirer les lames les plus
éloignées, cette longueur donnant la facilité d’attacher
le tirant perpendiculairement à la lame que la
marche doit faire agir ; on fent par ce qui vient d’être
dit pourquoi les marches des extrémités doivent être
plus courtes ; les marches ne doivent point être non
plus fufpendues à leurs tirans furie même niveau,
puifque l’on voit dans les figures a ue celles du centre
pendent plus bas que les autres, 6c s’élèvent petit-à-
petit à mefure qu’elles approchent de l’extrémité,
en voici la raifon : lorfque l’ouvrier marche les marches
des extrémités, il a les jambes fort écartées, ce
qui doit indubitablement leur faire perdre de leur
longueur, au lieu qu’en marchant celles du centre
il les a dans toute leur longueur 6c dans toute leur
force; il eft donc néceflaire de donner ce plan aux
marches, outre que l’ouvrier y trouve encore une
facilité pour les marcher. Comme elles font fort ferrées
les unes contre les autres, fur-tout quand elles
y font toutes, cette inclinaifon lui eft favorable pour
trouver celles dont il a befoin.
M a r c h e s , ( Bas au métier') eft une partie de
cette machine. Voÿe^l'article Bas au m ét ier.
MARCHE , ( Soirie. ) partie du bois de métier
d'étoffe defoie. La marche eft un litteau de 2 pouces
i à 3 pouces de largeur, fur 1 pouce d’épaiffeur, il
eft de 5 piés - à 6 piés de long, 6c percé à un bout ;
ce trou eft néceflaire pour y paffer une broche de
fer au travers pour les fixer 6c les rendre folides.,
lorfque l’ouvrier veut travailler.
Les marches fervent à faire lever les lifles, tant
de fatin, gros-de-tours, que celles de poil.
Marche-basse , ( Tapiffier. ) les ouvriers appellent
quelquefois ainli cette efpece de tapiflerie,
qu’on nomme plus ordinairement baffe-liffe. Ils lui
donnent ce nom, qui n’eft d’ufage que dans les ma*
nufaftureSj à caufe de deux marches que l’ouvrier
a fous fes piés, pour haufler ou baifler les lifles.
Foyei Basse-lisse.
Ma r ch e s , ( Tifferand) partie inférieure du métier
des Tifferands, Tiflùtiers, Rubaniers, &c. ce
font de Amples tringles de bois, attachées par un
bout à la traverfe inférieure du métier, que l’ouvrier
a fous fes piés ,& fufpendues par l’autre bout
aux ficelles des lifles.
Les marches font ainfi nommées parce que l’ouvrier
met les piés deflùs pour travailler. Les marches
font haufler ou baifter les fils de la chaîne > à travers
lefquels les fils de la trame doivent pafler. Ainfi lqrf:
que l’ouvrier met lès piés fur une marche, tous Tes
nls de la chaîne qui y répondent par le moyen des
lifles fe lèvent, 6c lorfqu’il ôte fon pié ils retombent
dans leur fltuation par le poids des plombs que
les lifles ont à chaque extrémité. |
Ma r c h e , terme de.Tourneur, c’eft la piece de
bois fur laquelle le tourneur pofe fon pié, pour
donner à la piece qu’il travaille un mouvement" cirr
culaire. Cette marche ri’eft dans les tours communs
qu’une tringle de bois foulevée par l’extrémité la
plus éloignée de l’ouvrier, par une corde attachée
M
.de l’autre bout à une perche qui pend du haut du
plancher. Voyt{ T our.
Marche du loup, {Vénerie.) c’eft ce qu’on
appelle en vrais termes, pifie pu voie, faux marché,
la biche y eft fujette dans le cours de douze à quinze
pasa r c h e , terme de Blafon. Le P. Menetrier dit
qu’il eft employé dans les anciens manuferits pour
la corne du pié des vaches.
Marche , ( Géog. ) ce mot, dans la baffe latinité,
eft exprimé par marca, marchia, 6c lignifie limites,
frontières ; c’eft pourquoi M. de Marca a intitulé fes
favantes recherches fur Jes frontières de l’Efpagne
6c de la France, marca hifpanica. Le feigneur qui
commandoit aux frontières étoit nommé marcheus ;
de ce mot s’eft formé celui de marchés, que nous
difons aujourd’hui marquis, & que les Allemands
expriment par margrave. Voye{ Margrave.
Dans les auteurs de la baffe latinité; marchant 6c
marchiani, font les habitans de la frontière. On a
aufli nommé marchiones, des foldats employés fur
la frontière, & avec le tems ce mot a été affefté
aux nobles , qui après avoir eu un gouvernement
fur la frontière qui leur donnoit ce titre, l ’ont rendu
héréditaire, 6c ont tranfmis à leurs enfans mâles ce
gouvernement avec le titre. Enfin la qualification
de marquis a été prife dans ces derniers tems en
France par de Amples gentilfliommes, 6c même par
des roturiers ennoblis, qui n’ont rien de commun
avec le fervice, ni avec les frontières de l’état.
V o y e iMarquis. ( D . J . )
Marche , la, { Géog. ) Marchia gallica, province
de France, avec le titre de comté. Elle eft bornée
au feptentrion par le Berry , à l’orient par l’Auvergne
, à l’occident par le Poitou & l’Angoumois, 6c
au midi par le Limoufin, dont elle a autrefois fait
partie, étant même encore à préfent du diocèfe de
Limoges.
Son nom d e Marche lui vient de ce qu’elle eft fi-
tuée furies confins ou marches du Poitou 6c du Berry.
Elle a été réunie à la couronne par François I. l’an
BBB
La Marche s, environ 22 lieues de longueur , fur
8 ou 10 de largeur. Elle donne du vin dans quelques
endroits 6c du blé dans d’autres ; fon commerce
confifte principalement en beftiatix 6c en rapifferies
que l’on fait à Aubuffon, Felletin, & autres lieux.
Elle eft arrofée par la Vienne, le Cher, la Creufe
& laCartempe.
. On la divife en haute & baffe, 6c on lui donne
Guéret pour capitale. (D . J .)
M a r c h e , {Géog. ) petite ville , ou bourg de
France, au duché ,de Bar, fur les confins de la Champagne
, entre les fourçes de la Meufe 6c de la Saône*
à 13 lieues xle Tqql. Long. 2 3 .2G. lat. 48ix . {D. J.)
M a r c h e , {Géog. ) petite ville des Pays-bas , au
duché de Luxembourg, aux confins du Liégeois,
entre Dinant 6c la Roçhe, dans le petit pays de
Famène. M. de Lille ne devoit pas dire comme le
peuple, Marche ou Famine.,Long. 23. t5, lat. So.
13. {O . J .)
Marche Tr e v i s a n e , la , { Géograph.)
province d’Italie, dans l’état de la république, de
Venife, bornée E. parle Frioul,S. par le golfe le
Dogat, & le Padouan, O. par le Vicentin, N. par
le Feitrin & le Belunefe. On appelle cette province
Marche trévifane, parce que dans la divifion de ce
pays-là , fous les Lombards, l’état de Venife étoit
gouverné par un marquis dont la réfidence ordinaire,
,étoit à Trévife ( Trevigio). La Marche ayoït
alors une plus grande étendue qu’àùjourd’hui. Sa
principale riviere eft la Piave ; mais elle eft entré-
cqupée d’un grand nombre de ruiffeaux: fes deux
feuies villes font Trévife 6c Ceneda. ( D . J.)