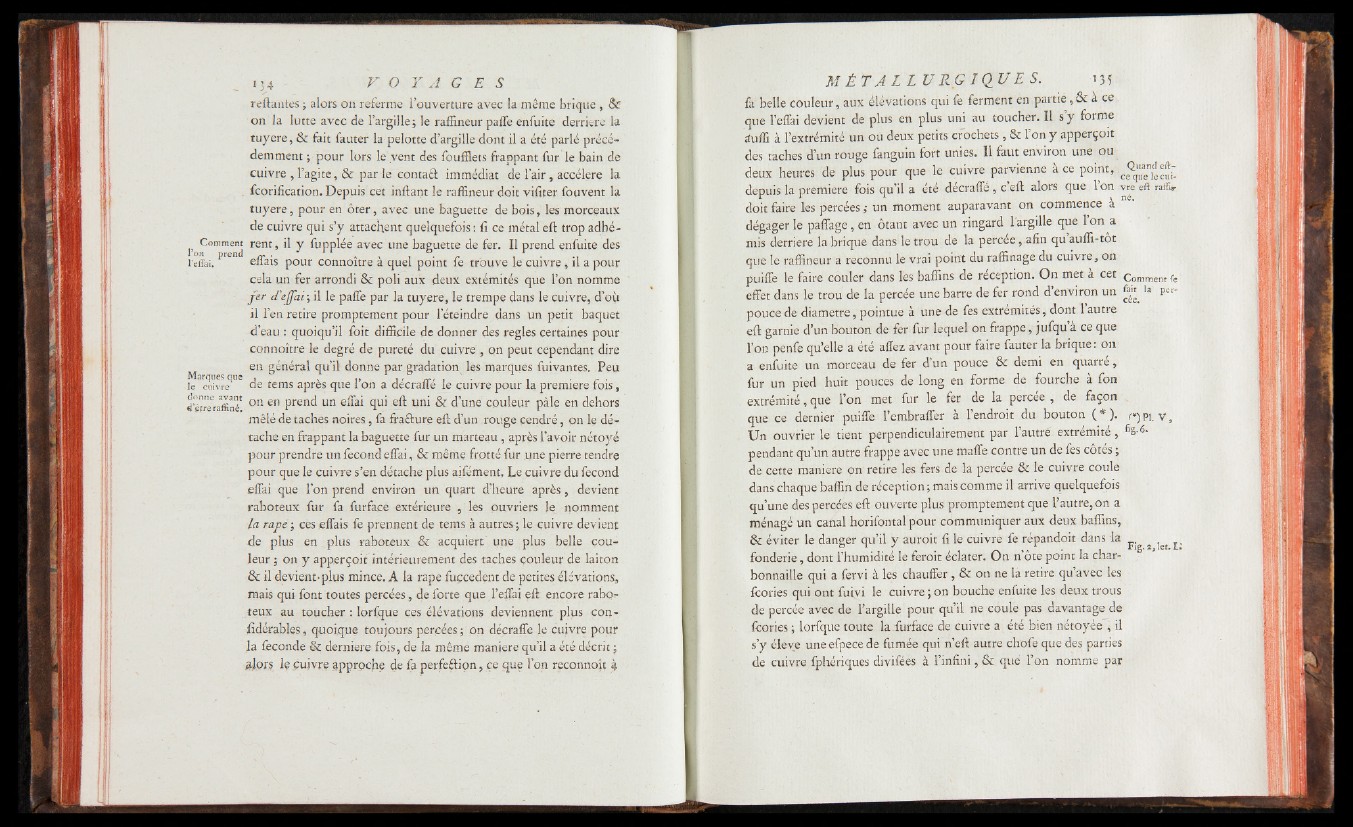
Comment
•l’on prend
l’effai.
Marques que
le cuivre
donne avant
d’être raffiné.
reliantes ; alors on referme l’ouverture avec la même brique, &
on la lutte avec de l’argille; le raffineur paffe enfuite derrière la
tuyere, & fait fauter la pelotte d’argille dont il a été parlé précédemment
; pour lors le vent des foufflets frappant fur le bain de
cuivre , l’agite ,& par le contait immédiat de l’a ir, accéléré la
fcorification. Depuis cet inftant le raffineur doit vifiter fouvent la
tuyere, pour en ôter, avec une baguette de bois, les morceaux
de cuivre qui s’y attachent quelquefois : fi ce métal eft trop adhérent
, il y fupplée avec une baguette de fer, fl prend enfuite des
effais pour connoître à quel point fe trouve le cuivre, il a pour
cela un fer arrondi & poli aux deux extémités que l’on nomme
fe r cl effai; il le paffe par la tuyere, le trempe dans le cuivre, d’où
il l’en retire promptement pour l’éteindre dans un petit baquet
d’eau : quoiqu’il foit difficile de donner des réglés certaines pour
connoître le degré de pureté du cuiyre , on peut cependant dire
en général qu’il donne par gradation les marques fuivantes. Peu
de teins après que l’on a décraffé le çuivre pour la première fois,
on en prend un effai qui efl: uni & d’une couleur pâle en dehors
mêlé de taches noires, fa fracture efl d’un rouge cendré, pn le détache
en frappant la baguette fur un marteau , après l’avoir nétoyé
pour prendre un fécond effai, & même frotté fur une pierre tendre
pour que le cuivre s’en détache plus aifément. Le cuivre du fécond
effai que l’on prend environ un quart d’heure après, devient
raboteux fur fa furface extérieure , les ouvriers le nomment
la râpe ; ces effais fe prennent de tems à autres ; le çuivre devient
de plus en plus raboteux & acquiert une plus belle couleur
; on y apperçoit intérieurement des taches çouleur de laiton
& il devient-plus mince. A la râpe fuçcedent de petites élévations,
mais qui font toutes percées, de forte que l’effai efl encore rabQr
teux au toucher : lorfque ces élévations deviennent plus con-
fidérables, quoique toujours percées; on décraffé le cuivre pour
la féconde & derniere fois, de la même maniéré qu’il a été décrit ;
alors le cuivre approche de fa perfection, ce que l’on reconnoît à
fa belle couleur, aux élévations qui fe ferment en partie, & a ce
que l’effai devient de plus en plus uni au toucher. 11 s y forme
Suffi à l’extrémité un ou deux petits crochets, & l’on y apperçoit
des taches d’un rouge fanguin fort unies. Il faut environ une ou
deux heures de plus pour que le cuivre parvienne a ce point,
depuis la première fois qu’il a été décraffé , c efl alors que 1 on
doit faire les percées ; un moment auparavant on commence à
dégager le paffage, en ôtant avec un ringard 1 argille que 1 on a
mis derrière la brique dans le trou de la percee, afin qu auffi-tôt
que le raffineur a reconnu le vrai point du raffinage du cuivre, on
puiffe le faire couler dans les baffins de réception. On met a cet
effet dans le trou de la percée une barre de fer rond d environ un
pouce de diamètre, pointue à une de fes extrémités, dont 1 autre
efl garnie d’un bouton de fer fur lequel on frappe, jufqu a ce que
l’on penfe qu’elle a été allez avant pour faire fauter la brique : on
a enfuite un morceau de fer d un pouce & demi en quarre,
fur un pied huit pouces de long en forme de fourche à fon
extrémité, que l’on met fur le fer de la percee , de façon
que ce dernier puiffe l’embraffer à l’endroit du bouton ( # ).
Un ouvrier le tient perpendiculairement par 1 autre extrémité,
pendant qu’un autre frappe avec une malle contre un de fes côtes ;
de cette maniéré on retire les fers de la percée & le cuivre coule
dans chaque baffin de réception ; mais comme il arrive quelquefois
qu’une des percées efl ouverte plus promptement que l’autre, on a
ménagé un canal horifontal pour communiquer aux deux baffins,
& éviter le danger qu’il y auroit fi le cuivre fe répandoit dans la
fonderie, dont l’humidité le feroit éclater. On n’ôte point la char-
bonnaille qui a fervi à les chauffer , & on ne là retire qu avec les
Icônes qui ont fuivi le cuivre ; on bouche enfuite les deux trous
de percée avec de l’argille pour qu’il ne coule pas davantage de
fcories ; lorfque toute la furface de cuivre a été bien nétoyée , il
s’y éleve une efpece de fumée qui n’eft autre chofe que des parties
de cuivre fphériques divifées à l’infini, & que l’on nomme par
Quand eft-
ce que le cuivre
eft raffiip
né.
Comment fs
fait la percée.
f*)Pl. V ,
fig.6.
Fig. a , let. 1.'