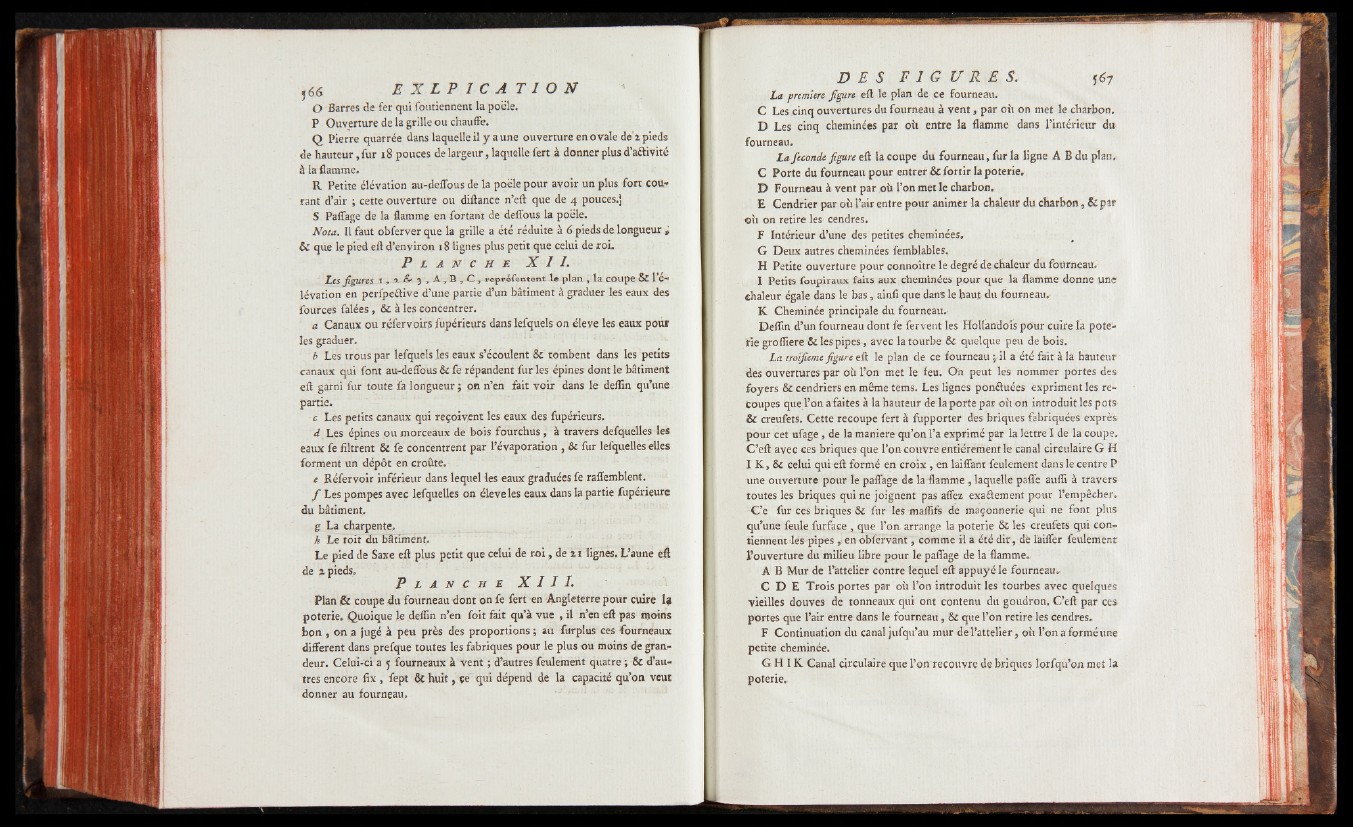
,6 6 E X L P I C A T I O N
O Barres de fer qui foutiennent la poêle.
P Ouverture de la grille ou chauffe.
Q Pierre quarrée dans laquelle il y a une ouverture en ovale de'z pieds
de hauteur ,fur 18 pouces de largeur, laquelle fert à donner plus d’a&ivité
à la flamme.
R Petite élévation au-deffous de la poêle pour avoir un plus, fort courant
d’air ; cette ouverture ou diftance n’eft que de 4 pouces.)
S Paffage de la flamme en fortant de deffous la poêle.
N o ta . Il faut obferver que la grille a été réduite à 6 pieds de longueur »
8c que le pied eft d’environ 18 lignes plus petit que celui de roi.
P l a n c h e XI I .
L ts figures 1 , i ^ 3 , 't . B , C , i-opréfentGnt ts plan , la coupe 8c l’e-
lévation en perfpeûive d’une partie d’un bâtiment à graduer les eaux des
fources fâlées, & à les concentrer.
a Canaux ou réfervoirs fupérieurs danslefquels on éleve les eaux pour
les graduer.
b Les trous par lefquels les eaux s’écoulent 8c tombent dans les petits
canaux qui font au-deffous 8t fe répandent fur les épines dont le bâtiment
eft garni fur toute fa longueur j on n’en fait voir dans le deflin qu’une
partie.
c Les petits canaux qui reçoivent les eaux des fupérieurs.
d Les épines ou morceaux de bois fourchus| à travers defquelles les
eaux fe filtrent 6c fe concentrent par l’évaporation , & fur lefquelles elles
forment un dépôt en croûte.
e Réfervoir inférieur dans lequel les eaux graduées fe raffemblent.
ƒ Les pompes avec lefquelles on éleve les eaux dans la partie fupérieure
du bâtiment.
g La charpente.
h Le toit du bâtiment.
Le pied de Saxe eft plus petit que celui de roi, de f? lignes,. L’aune eft
de x pieds.
P l a n c h e XI I I .
Plan & coupe du fourneau dont on fe fert en Angleterre pour cuire 1?
poterie. Quoique le deflin n’en foit fait qu’à vue , il n’en eft pas moins
bon , on a jugé à peu près dès proportions ; au furplus ces fourneaux
different dans prefque toutes les fabriques pour le plus ou moins de grandeur.
Celui-ci a 5 fourneaux à vent ; d’autres feulement quatre*, 8c d’autres
encore fix , fept 8c huit, ce qui dépend de la capacité qu’on veut
donner au fourneau.
L a première figure eft le plan de ce fourneau.
C Les cinq ouvertures du fourneau à vent, par oit on met le charbon.
D Les cinq cheminées par oit entre la flamme dans l’intérieur du
fourneau.
L a fécon d é fig u re eft la coupe du fourneau, fur la ligne A B du plan.
C Porte du fourneau pour entrer 8c fortir la poterie.
D Fourneau à vent par oit l’on met le charbon.
E Cendrier par où l’ait entre pour animer la chaleur du charbon, 8c par
où on retire les cendres.
F Intérieur d’une des petites cheminées.
G Deux autres cheminées femblables,
H Petite ouverture pour connoître le degré de chaleur du fourneau.
I Petits foupiraux faits aux cheminées pour que la flamme donne une
chaleur égale dans le bas, ainfi que dans le haut du fourneau.
K Cheminée principale du fourneau.
Deflin d’un fourneau dont fe fervent les Hollandois pour cuire la poterie
grotliere Si les pipes, avec la tourbe 8c quelque peu de bois.
L a troifieme fig u re eft le plan de ce fourneau ;-il a été fait à la hauteur
des ouvertures par oit l’on met le feu. On peut les nommer portes des
foyers 8c cendriers en même tems. Les lignes ponéluées expriment les recoupes
que l’on afaites à la hauteur de la porte par oit on introduit les pots
& creufets. Cette recoupe fert à fiipporter des briques fabriquées exprès
pour cet ufage, de la maniéré qu’on l’a exprimé par la lettre I de la coupe.
C’eft avec ces briques que l’on couvre entièrement le canal circulaire G H
I K , 6c celui qui eft formé en croix , en laiffant feulement dans le centre P
une ouverture pour le paffage de la flamme , laquelle paffe aufli à travers
toutes les briques qui ne joignent pas affez exaûement pour l’empêcher.
C’e fur ces briques 8c fur les maflifs de maçonnerie qui ne font plus
qu’une feule furface , que l’on arrange la poterie 8c les creufets qui contiennent
les pipes , en obfervant, comme il a été dir, de l'aiffer feulement
l’ouverture du milieu libre pour le paffage de la flamme.
A B Mur de l’àttelier contre lequel eft appuyé le fourneau.
C D E Trois portes par où l’on introduit les tourbes avec quelques
vieilles douves de tonneaux qui ont contenu du goudron. C’eft par ces
portes que l’air entre dans le fourneau, 8c que l’on retire les cendres.
F Continuation du canal jufqu’au mur del’attelier, où l’on a formé une
petite cheminée.
G H IK Canal circulaire que l’on recouvre de briques lorfqù’on met la
poterie.