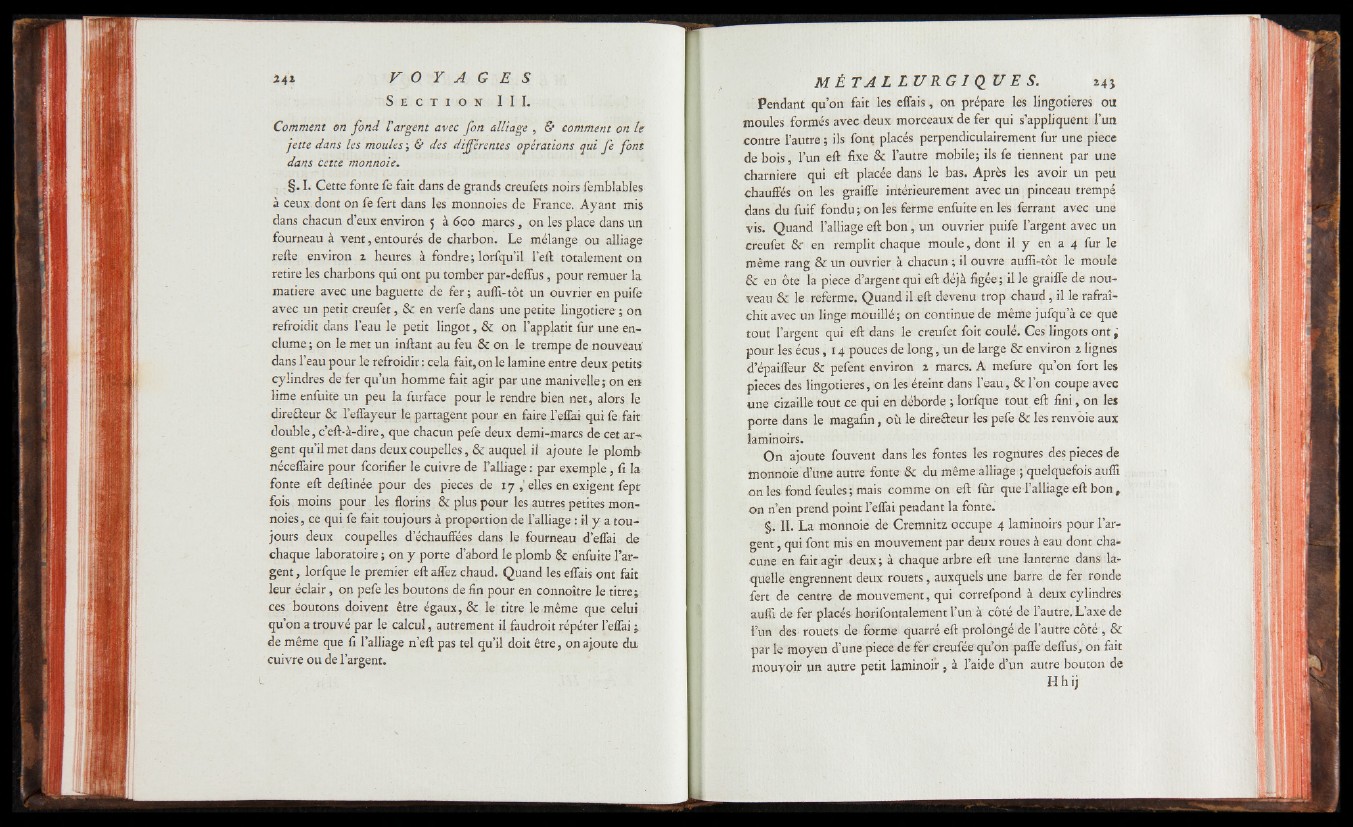
* 4* V O Y A G E S
S e c t i o n I I I .
Comment on fond l'argent avec fon alliage , & comment on le
jette dans les moules ; & des differentes opérations qui f e font
dans cette monnoie.
§ . I. Cette fonte Ce fait dans de grands creufets noirs femblables
à ceux, dont on fe fert dans les monnoies de France. Ayant mis
dans chacun d’eux environ 5 à 600 marcs on les place dans un
fourneau à vent, entourés de charbon. Le mélange ou alliage
refte environ 2 heures à fondre; lorfqu’il l’eft totalement on
retire les charbons qui ont pu tomber par-deffus, pour remuer la
matière avec une baguette de fer ; auffi-tôt un ouvrier en puife
avec un petit creufet, & en verfe dans une petite lingotiere ; on
refroidit dans l’eau le petit lingot, & on l’applatit fur une enclume
; on le met un inftant au feu & on le trempe de nouveau
dans l’eau pour le refroidir : cela fait, on le lamine entre deux petits
cylindres de fer qu’un homme fait agir par une manivelle; on en
lime enfuite un peu la furface pour le rendre bien net, alors le
direâeur & l’effayeur te partagent pour en faire l’effai qui fe fait
double, c’eft-à-dire, que chacun pefe deux demi-marcs de cet argent
qu’il met dans deux coupelles, & auquel il ajoute le plomb
néceffaire pour fcorifier le cuivre de l’alliage : par exemple, fi la
fonte eft defiinée pour des pièces de 1 7 ,' elles en exigent fept
fois moins pour les florins & plus pour les autres petites monnoies,
ce qui fe fait toujours à proportion de l’alliage : il y a toujours
deux coupelles d’échauffées dans le fourneau d’effai de
chaque laboratoire ; on y porte d’abord le plomb & enfuite l’argent
, lorfque le premier eft affez chaud. Quand les effais ont fait
leur éclair, on pefe les boutons de fin pour en connoître Je titre;
ces boutons doivent être égaux, & le titre le même que celui
qu’on a trouvé par le calcul, autrement il faudroit répéter l’effai ;
de même que fi l’alliage n’eft pas tel qu’il doit être, on ajoute du
cuivre ou de l’argent.
M É T A L L U R G I Q U E S . 24J
Pendant qu’on fait les effais , on prépare les lingotieres ou
moules formés avec deux morceaux de fer qui s’appliquent l’un
contre l’autre ; ils font placés perpendiculairement fur une piece
de bois, l’un eft fixe & l’autre mobile; ils fe tiennent par une
charnière qui eft placée dans le bas. Après les avoir un peu
chauffés on les graiffe intérieurement avec un pinceau trempé
dans du fuif fondu; on les ferme enfuite en les ferrant avec une
vis. Quand l’alliage eft bon, un ouvrier puife l’argent avec un
creufet & en remplit chaque moule, dont il y en a 4 fur le
même rang & un ouvrier à chacun ; il ouvre auffi-tôt le moule
& en ôte la piece d’argent qui eft déjà figée; il le graiffe de nouveau
& le referme. Quand il eft devenu trop chaud, il le rafraîchit
avec un linge mouillé ; on continue de même jufqu’à ce que
tout l’argent qui eft dans le creufet foit coulé. Ces lingots ont,
pour les écus, 14 pouces de long, un de large & environ 2 lignes
d’épaiffeur & pefent environ 2 marcs. A mefure qu’on fort les
pièces des lingotieres, on les éteint dans l’eau, & l ’on coupe avec
une cizaille tout ce qui en déborde ; lorfque tout eft fini, on le*
porte dans le magafin, où le directeur les pefe & les renvoie aux
laminoirs.
On ajoute fouvent dans les fontes les rognures des pièces de
monnoie d’une autre fonte & du même alliage ; quelquefois auffi
on les fond feules; mais comme on eft fûr que l’alliage eft bon,
on n’en prend point l’effai pendant la fonte.
§. II. La monnoie de Cremnitz occupe 4 laminoirs pour l ’argent
, qui font mis en mouvement par deux roues à eau dont chacune
en fait agir deux ; à chaque arbre eft une lanterne dans laquelle
engrennent deux rouets, auxquels une barre de fer ronde
fert de centre de mouvement, qui correfpond à deux cylindres
auffi de fer placés horifontalement l’un à côté de l’autre. L’axe de
l’un des rouets de forme quarré eft prolongé de l’autre côté , &
par le moyen d’une piece de fer creufée qu’on paffe deffus, on fait
mouyoir un autre petit laminoir, à l’aide d’un autre bouton de
H hij