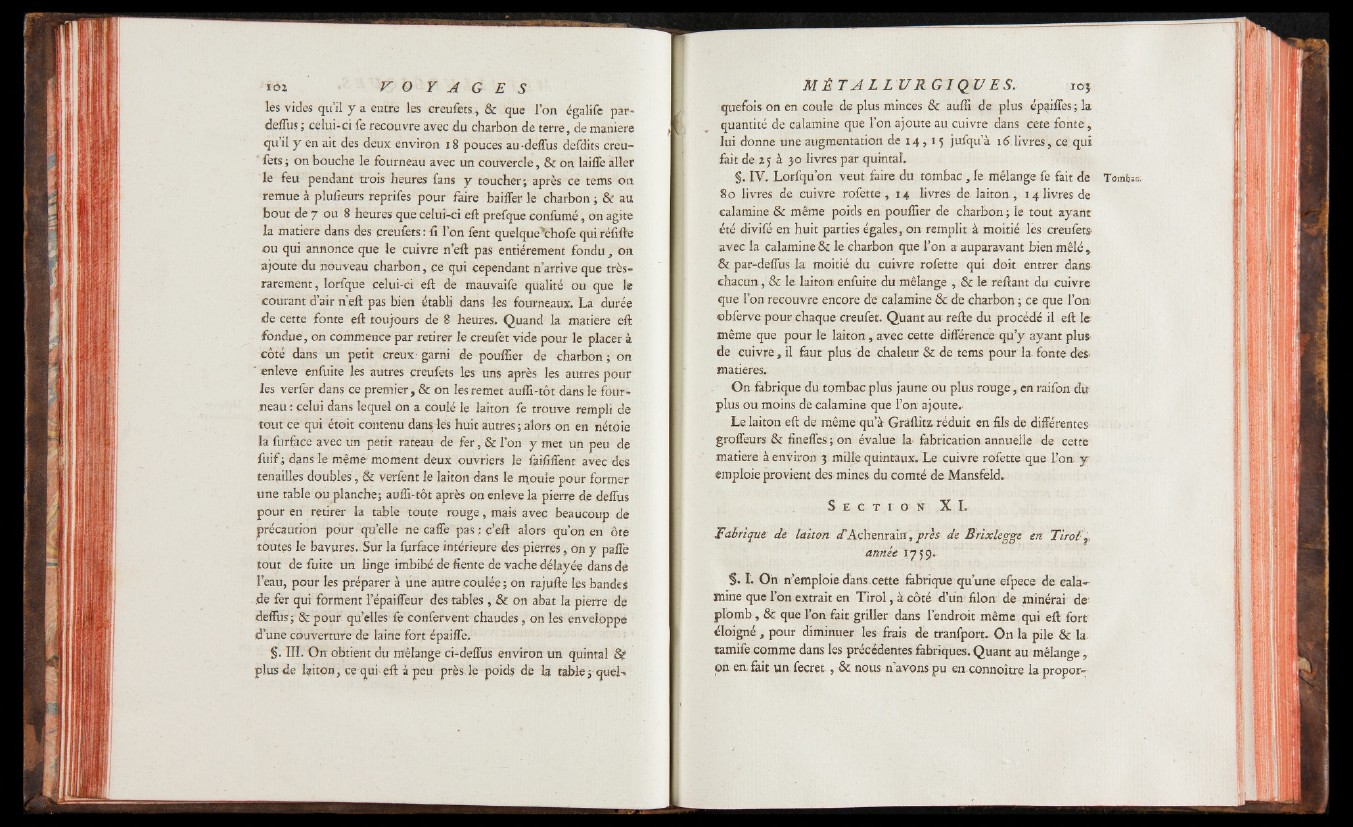
les vides qu’il y a entre les creufets, & que l ’on égalife par-
deffus ; celui-ci fe recouvre avec du charbon de terre, de maniéré
qu il y en ait des deux environ 18 pouces au -deffus defdits creu-
' fets ; on bouche le fourneau avec un couvercle, & on laiflè aller
le feu pendant trois heures fans y toucher; après ce tems on
remue à plufieurs reprifes pour faire bailler le charbon ; & au
bout de 7 ou 8 heures que celui-ci eft prefque confirmé, on agite
la matière dans des creufets : fi l’on fent quelque'chofe qui réfifte
ou qui annonce que le cuivre n’eft pas entièrement fondu, on
ajoute du nouveau charbon, ce qui cependant n’arrive que très-
rarement , lorfque celui-ci eft de mauvaife qualité ou que le
courant d air n eft pas bien établi dans les fourneaux. La durée
de cette fonte eft toujours de 8 heures. Quand la matière eft
fondue, on commence par retirer le creufet vide pour le placer à
côté dans un petit creux- garni de poufiïer de charbon ; on
‘ enleve enfuite les autres creufets les uns après les autres pour
les verfer dans ce premier, & on les remet auffi-tôt dans le fourneau
: celui dans lequel on a coulé le laiton fe trouve rempli de
tout çe qui étoit contenu dansles huit autres; alors on en nétoie
la furfaçe avec un petit rateau de fe r , 8c l’on y met un peu de
fuif ; dans le même moment deux ouvriers le faififfent avec des
tenailles doubles, & verfent le laiton dans le moule pour former
une table ou planche; auffi-tôt après on enleve la pierre de deffus
pour en retirer la table toute rouge, mais avec beaucoup de
précaution pour qu’elle ne caffe p a s ç ’eû alors qu’on en ôte
toutes le bavures. Sur la furface intérieure des pierres , on y paffe
tout de fuite un linge imbibé de fiente de vache délayée dans de
l ’eau, pour les préparer à une autre coulée ; on rajufte les bandes
de fer qui forment l’épaiffeur des tables , &c on abat la pierre de
deffus;- 8c pour qu’elles fe confervent chaudes, on les enveloppe
d’une couverture de laine fort épaiffe,
§. III. On obtient du mélange ci-deffus environ un quintal 8ê
plus de laiton, ce qui çft à peu près le poids de la table; quel-.
quefois on en coule de plus minces & auffi de plus épaiffes ; la
quantité de calamine que l’on ajoute au cuivre dans cete fonte,
lui donne une augmentation de 14, 15 jufqu’à 16. livres, ce qui
fait de 25 à 30 livres par quintal.
§. IY. Lorfqu’on veut faire du tombac, le mélange fe fait de
80 livres de cuivre rofette, 14 livres de laiton , 14 livres de
calamine & même poids en pouffier de charbon ; le tout ayant
été divifé en huit parties égales,.on remplit à moitié les creufets
avec la calamine & le charbon que l’on a auparavant bien mêlé ,
& par-deffus la: moitié du cuivre rofette qui doit entrer dans
chacun, & le laiton enfuite du mélange , & le reliant du cuivre
que Ion recouvre encore de calamine & de charbon ; ce que l’on
©bferve pour chaque creufet. Quant au refte du procédé il eft le
même que pour le laiton-, avec cette différence qu’y ayant plus
de cuivre, il faut plus de chaleur & de tems pour la- fonte des
matières..
On fabrique du tombac plus jaune ou plus rouge, en raifon du
plus ou moins de calamine que l’on ajoute..
Le laiton eft de même qu’à Graffiti réduit en fils de différentes'
groffeurs & fineffes ; on évalue la- fabrication annuelle de cette
matière à environ 3 mille quintaux. Le cuivre rofette que l’on, y
emploie provient des mines du comté de Mansfeld.
S E C T I O N X I.
Fabrique de laiton ^Achenrain, près de Brixtegge en Tirol r.
année 1759.
§. L On n’emplbie dans .cette fabrique qu’une efpece de cala--
mine que l’on extrait en Tirol, à côté d’un filon de minérai de:
plomb, & que l’on fait griller dans l’endroit même qui eft fort
éloigné , pour diminuer les frais de tranfport. On la pile & la.
tamife comme dans les précédentes fabriques. Quant au mélange,
on ea fait un fecret., & nous n’avons pu en connoître la propor-
Tombac.