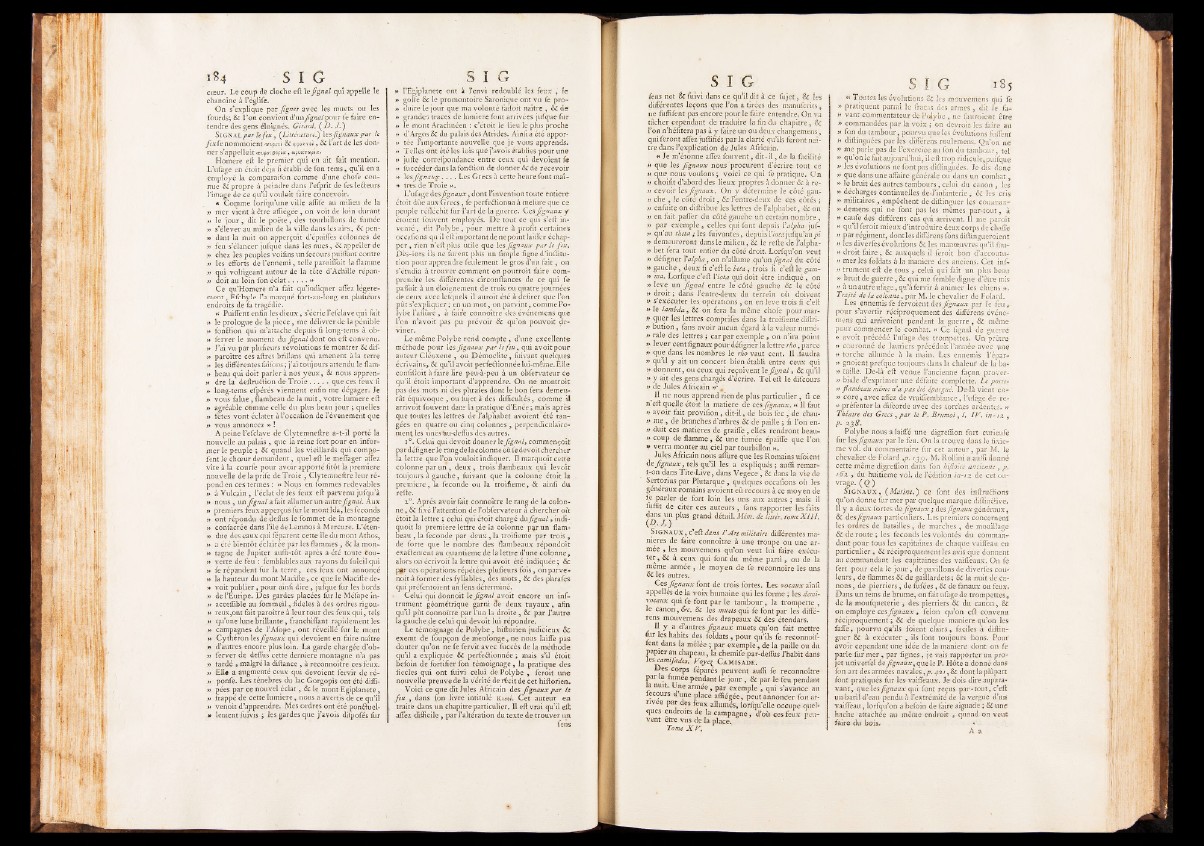
coeur. Le coup de cloche eft le fignal qui appelle le
chanoine à l’églife.
On s’explique par fignes avec les muets ou les
fourds; & l ’on convient d’unfignal^oxxr le faire entendre
des gens éloignés. Girard. ( D . J. ) S I G N A L p a r l e f e u , (.L it té ra tu r e .) lesf i g n a u x p a r le
f e u fe nommoient <avpmi & apoxrot, & l’art de les donner
s’appelloit <wvp<rc<pop)ct, topuKTufid.
Homere eft le premier qui en ait fait mention.
L’ufage en étoit déjà fi établi de fon tems, qu’il en a
employé la comparaifon comme d’une chofe connue
& propre à peindre dans l’efprit de fes leâeurs
l’image de ce qu’il voulait faire concevoir.
« Comme lorfqu’ilne ville aflife au milieu de la
» mer vient à être afliégée , on voit de loin durant
» le jou r, dit le poëte, des tourbillons-de fumée
» s’élever au milieu de la ville dans les airs, & pen-
» dant la nuit on apperçoit d’épaiffes colonnes de
» feu s’élancer jufque dans les nues, & appeller de
» chez les peuples voifins un fecours puiffant contre
» les efforts de l’ennemi, telle paroiffoit la flamme
» qui voltigeant autour de la tête d’Achille répan-
» doit au loin fon é c la t..........»
Ce qu’Homere n’a fait qu’indiquer affez légèrement
, Efchyle l’a marqué fort-au-iong en plufiéurs
endroits de fa tragédie.
« Puiffent enfin les dieux, s’écrie l’efclave qui fait
» le prologue de la piece, me délivrer de la pénible
» fonction qui m’attache depuis fi long-tems à ob-
» ferver le moment du fignal dont on eft convenu.
» J’ai vu par plufieufs révolutions fe montrer & dif-
» paroître ces aftres brillans qui amènent à la terre
» les différentes faifons ; j’ai toujours attendu le flam-
» beau qui doit parler à nos yeux, & nous appren-
» dre la deftruéiion de T ro ie ..........que ces feux fi
» long-tems efpérés viennent enfin me dégager. Je
» vous falue, flambeau de la nuit, votre lumière eft
» agréable comme celle du plus beau jour ; quelles
» fêtes vont éclater à l’occafion de l’évenement que
» vous annoncez » !
A peine l’efclave de Clytemneftre a-t-il porté la
nouvelle au palais , que la reine fort pour en informer
le peuple ; & quand les vieillards qui comp,o-
fent le choeur demandent, quel eft le meffager affez
vite à la courfe pour avoir apporté fitôt la première
nouvelle de la prife de Troie ? Clytemneftre leur répond
en ces termes : « Nous en i’ommes redevables
» à Vulcain, l’éclat de fes feux eft parvenu jufqu’à
» nous , fignal a fait allumer un autrefignal. Aux
» premiers feux apperçus fur le mont Ida, les féconds
» ont répondu de deffus le fommet de la montagne
» confacrée dans l’îie deLemnos à Mercure. L’éten-
» due des eaux qui féparent cette île du mont Athos,
» a été bientôt éclairée par les flammes , & la mon-
» tagne de Jupiter aufli-tôt après a- été toute tou-
» verte de feu : femblables aux rayons du foleil qui
» fe répandent fur la terre, ces feux ont annoncé
» la hauteur du mont Macifte, ce que le Macifte de-
» voit-publier, pour ainfi dire, jufque fur les bords
» de l’Euripe. Des gardes placées fur le Méfape in-
» acceflible au fommeil, fideles à des ordres rigou-
» reux,ont fait paroître à leur tour des feux qui, tels
» qu’une lune brillante, franchiffant rapidement les
» campagnes de l’Afope, ont réveillé fur le mont
» Cythéron lesfignaux qui dévoient en faire naître
» d’autres encore plus loin. La garde chargée d’ob-
» ferver de deffus cette dernieré montagne n’a pas
» tardé , malgré la diftance , à reconnoître ces feux.
» Eli« a augmenté ceux qui dévoient fervir de ré-
» ponfe. Les ténèbres du lac Gorgopis ont été diffi-
» pées par ce nouvel éclat, & le mont Egiplanete,
» frappé de cette lumière, nous a avertis de ce qu’il
» venoit d’apprendre. Mes ordres ont été ponâuel-
» lement fuivis ; les gardes que j’avois difpofés fur
» l’Egiplanete ont à l’envi redoublé les feux , le
» golfe & le promontoire Saronique ont vu fe pro-
» duire le jour que ma volonté faifoit naître , & de
» grandes traces de lumière font arrivées jufque fur
» le mont Arachnéen : c’étoit le lieu le plus proche
» d’Argos& du palais des Atrides. Ainfi a été appor-
» tée l’importante nouvelle que je vous apprends.
» T elles ont été les lois que j’avois établies pour une
» jufte correfpondance entre ceux qui dévoient fe
» fiiccéder dans la fonction de donner & d e recevoir
» les fignauy. . . . Les Grecs à cette heure font maî-
•» très de Troie ».
L’ufage des fignaux, dont l’invention toute entière
étoit due aux G recs, fe perfectionna à melure que ce
peuple réfléchit fur l’art de la guerre; Ces fignaux y
étoient fouvent employés. De tout ce qui s’eft inventé
, dit Polybe, pour mettre à profit certaines
occafions qu'il eft important de ne point laiffer échapp
e r , rien n’eft plus utile que les fignaux par le feu.
Dès-lors ils ne furent pliis un fimple ligne d’inftitu-
tion pour apprendre feulement le gros d’un fait, on
s’étudia à trouver comment on pourroit faire comprendre
les différentes circonftances de ce qui fe
pafl'oit à un éloignement de trois ou quatre journées
de ceux avec lelquels il auroit été à defirer que l’on
pût s’expliquer ; en un mot, on parvint ; comme Polybe
l’allure , à faire connoître des événemens que
l’on n’avoit pas pu prévoir & qu’on pouvoit deviner.
Le même Polybè rend compte, d’une excellente
méthode pour les fignaux par le feu , qui avoit pour
auteur Cléoxene , ou Démociite, fuivant quelques
écrivains, & qu’il avoit perfectionnée lui-même. Elle
confiftoit à faire lire peu-à-peu à un obfervateur ce
qu’il étoit important d’apprendre. On ne montroit
pas des mots ni des phral'es dont le bon fens demeurât
équivoque , ou lu jet à des difficultés, comme il
arrivoit fouvent dans la pratique d’Enée ; mais après
que toutes les lettres de l’alphabet avoient été rangées
en quatre ou cinq colonnes , perpendiculairement
les unesfcu-deffus des autres.
i° . Celui qui devoit- donner le fignal, commençoit
pardéfigner le rang de la colonne oii le de voit chercher
la lettre que l’on vouloit indiquer. Il marquoit cette
colonne par un , deux, trois flambeaux qui levoit
toujours à gauche, fuivant que la colonne étoit la
première, la fécondé ou la troifieme, & ainfi du
refte.
2°. Après avoir fait connoître le rang de la colonne
, & fixé l’attention de l’obfervateur à, chercher oii
étoit la lettre ; celui qui étoit chargé dufignal, indi-
quoit la première lettre de la colonne p$r un flambeau
, la fécondé par deux, la troifieme par trois ,
de forte que le nombre des flambeaux répondoit
exactement au quantieme de la lettre d’une colonne,
alors on écrivoitla lettre qui avoit été indiquée; &
p^r ces opérations répétées plufiéurs fois, on pafve-
noit à former des fyllables, des mots, & des phrafes
qui préfentoient un fens déterminé..
• Celui qui donnoit le fignal avoit encore un infl-
trument géométrique garni ae deux tuyaux, afin
qu’il pût connoître par l’un la droite, & par l’autre
la gauche.de celui qui devoit lui répondre.
Le témoignage de Polybe, hiftorien judicieux &
exemt de foupçon de menfonge, ne nous laiffe pas
douter qu’on ne fe fervît avec fuccès de la méthode
qu’il a expliquée & perfectionnée ; mais s’il étoit
befoin de fortifier fon témoignage , la pratique des
fiecles qui ont fuivi celui de Polybe , feroit une
nouvelle 'preuve de la vérité de récit de cet hiftorien.
Voici ce que dit Jules Africain des fignaux par le
feu , dans fon livre intitulé K tnt: Cet auteur en
traité dans un chapitre particulier. Il eft vrai qu’il eft
affez difficile, par l’altération du texte de trouver un
fens
fens net & fuivi dans ce qu’il dit à Ce fujet , &c les
différentes leçons que l’on a tirées des manuferits,
ne fuffifent pas encore pour le faire entendre. On va
tâcher cependant de traduire la fin du chapitre, 6c
l’on n’héfitera pas à y faire un ou deux changemens,
qui feront affez juftinés parla clarté qu’ils feront naître
dans l’explication de Jules Africain.
« Je m’étonne affez fouvent, d it- il, de la facilité
*> que les fignaux nous" procurent d’écrire tout ce
» que nous voulons ; voici ce qui fe pratique. On
i> choifit d’abord des lieux propres à donner Sc à re-
» ce voir les fignaux. On y détermine le côté gau-
» che , le côté droit, & l’entre-deux de ces côtés ;
» enfuite on diftribue les lettres de l’alphabet, & on
>> en fait paffer du côté gauche un certain nombre,
» par exemple , celles qui font depuis Valpha juf-
» qu’au thêta; les fuivantes, depuisr/otajufqu’aupi
» demeureront dans le milieu, & le refte de l’alphar
» bet fera tout entier du côté droit. Lorfqu’on veut
>> défigner 11 alpha, on n’allume qu’un fignal du côté
*> gauche, deux fi c’eft le beta,- trois fi c’eft le gam-
» ma. Lorfque c’eft l’iota qui doit être indiqué , on
>> levé un fignal entre le côté gauche & le côté
» droit ; dans l’entre-deux du terrein oit doivent
» s’exécuter les. opérations , on en leve trois fi c’eft
» le lambda, & on fera la même chofe pour mar-
# qtier les lettres comprifes dans la troifieme diftri-
» bution, fans avoir aucun égard à la valeur numé-
» raie des lettres ; car par exemple , on n’ira point
». lever cent fignaux pour défigner la lettre rko , parce
» que dans les nombres le rho vaut cent; Il .faudra
» qu’il y ait un concert bien établi entre ceux qui
» donnent, ou ceux qui reçoivent le fignal, & qu’il
» y ait des gens chargés d’écrire. T el eft le difeours
» de Jules Africain »’ «
Il ne nous apprend rien de plus particulier , fi ce
n’eft quelle étoit la matière de ces fignaux. « Il faut
» avoir fait provifion, dit-il, dé bois fec j de chau-
» me , de branches d’arbres & de paille ; fi l’on en-
» duit ces matières de graiffe , elles rendront beau-
» coup de flamme, & une fumée épaiffe que l ’on
» verra monter aivciel par tourbillon ».
Jules. Africain nous allure que les Romains ufoient
f e fignaux, tels qu’il les a expliqués ; aulfi remar-
t-on dans Tite-Live, dans Vegece, & dans la vie de
S.ertorius par Plutarque , quelques occafions oii les
generaux romains avoient eû recours à ce moyen de
le parler de fort loin Les uns aux autres ; mais il
fuffit de citer ces auteurs, fans rapporter les faits
dans un plus grand detail. Mém. de littér. tomeXHI. l r a |
Sign aux , c’eft dans VArt militaire différentes ma4
nieres de faire connoître à une troupe ou une armée
, les mouvemens qu’on veut lui faire exécu-
te r , &c à ceux qui font du même parti, ou de la
meme armee, le moyen de fe reconnoîre les uns
& les autres.
appelles de la voix humaine qui les forme ; les demi
vocaux qui fe- font par le tambour, la trompette
le canon, &c. & les muets qui fe font par les difFé
tens mouvemens des drapeaux & des étendars.
Il y a d’autres fignaux muets qu’on fait mettr<
Cur les habits des, foldats, pour qu’ils fe reconnoif
fent dans la mêlée ; par exemple, de la paille ou di
papier au chapeau, la chemife par-deffus l’habit dan.
les camifades. Voyei Camisade.
Des corps féparés peuvent aufli fe reconnoîtn
par la fiimee pendant le jour , & par le feu pendan
la nuit. Une armée, par exemple , qui s’avance ai
leepurs d’une place afliégée, peut annoncer fon ar
nvee par des feux allumés, lorfqu’elle occupe quel
ques endroits de la campagne , d’oû ces feux peuvent
etrevusdelapla.ee.
Tome X V~.
'« Toutes les évolutions & les moiivëniens qui fe
» pratiquent parmi le fracas des armes , cîit l e . fa-i
>> vant commentateur dé Polybe , ne fauroient être
>> commandées par la voix ; on devroit les faire au
» fon du tambour, pourvu que les évolutions fuffent
h diftinguées par les différens roulemens. Qu’on ne
>> me parle pas de l’exercice aii fon du tambour, tel
» qu’on le fait aujourd’hui, il eft trop ridicule, puifqué
» les évolutions ne font pas diftinguées* Je dis donc
» que dans une affaire générale ou dans un combat,
» le bruit des autres tambours , celui du canon , les
» décharges continuelles deJ’infanterie, Ôç les cris
» militaires , empêchent de diftinguer les comman*
» demens qui ne font pas les mêmes par-tout, à
» caufe des différens cas qui arrivent. II me paroît
» qu’il feroit mieiix d’introduire deux Corps de chaffé
» par régiment, dont les différens fonsdiftingueroient
» les diverfes évolutions & les, manoeuvres qu’il fau-
» droit faire * ôc auxquels il feroit bon d’accoutu-
» mer les foldats à la maniéré des anciens. Cet inf-
» trument eft de tous -, celui qui fait un plus beau
» bruit de guerre, & qui me femble digne d’être mis
» à un autre ufage, qu’à fervir à animer les chiens ».
Traité de la colonne, par M. le chevalier de Folard.
Les ennemis fe fervoient. des fignaux par le feu,
pour s’avertir réciproquement des différens événemens
qui arrivoient pendant la guerre, & même
pour Commencer le combat. « Ce fignal de guerre
» avoit précédé l’ufage des trompettes. Un. prêtre
» couronné de lauriers précédoit l’armée avec une
» torche allumée à la main. Les ennemis l’épar-*
» gnoient prefque toujours dans la chaleur de la ba-
» taille. De-là eft venue l’ancienne façon prover-
» biale d’exprimer une défaite complette. Lé porte-
» flambeau même n'a pas été épargné. De-là vient en-*
» core, avec affez de vraiffembiance, l’ufage de re-
« préfenter la difeorde avec des torches ardentes. »
Théâtre des Grecs , par le Pi Brumoi, L IV. in -12 j
p. 238.
Polybe nous a Iaiffé une digrefîion fort cuneufe
fur lesfignaux par le feu. On la troiive dans le fixi.e-
me vol. du commentaire fur cet auteur, par M. le
chevalier de Folard ,/>. / je». M; Rollinia.aüfïidonné
cette même digrefiion dans fon hifioife ancienne , p.
> 62 y du huitième vol; de l’édition in-12 de cet oih
vrage/(<2)
Sig n a u x , ÇMarine.') ce font des inftruélionS
qu’on donne fur mer par quelque marque diftin£Hve>
Il y a deux fortes de fignaux ; des fignaux généraux,
6c des fignaux particuliers. Les premiers concernent
les ordres de batailles , de marches , de mouillage
& de route ; les féconds les volontés du commandant
pour tous les capitaines de chaque vaiffeâu en
particulier, & réciproquement les avis que donnent
au commandant les capitaines des vaiffeauJL On fè
fert pour cela le jour, de pavillons de diverfes couleurs,
de flammes & de gaillardets ; & la nuit de caj
nons, de pierriers, de fufées , & de fanaux ou feux*
Dans un tems de brume, on fait ufage de trompettes^
de la moufqueterie -, des pierriers & du canon, 6c
on employé ces fignaux, félon qu’on eft convenu
réciproquement ; & de quelque manière qu’on les
faffe, pourvu qu’ils foient clairs, faciles à diftinguer
& à exécuter , ils font toujours bons. Pour
avoir cependant une idée de la manière dont on fe
parle fur mer , par lignes, je vais rapporter un projet
univerfel de fignaux, que le P. Hôte adonnédans
fon art des armees navales ,p. 421, & dont la plupart
font pratiqués fur les vaiffeaux. Je dois dire auparavant,
que les fignaux qui font reçus par-tout, c’eft
un-baril d’eau- pendu, àd’extrémité de la vergue d’un
vaiffeau, lorfqu’on a befoin de faire aiguade ; & une
hache attachée au même endroit quand on veut
faire-du bois*
À a