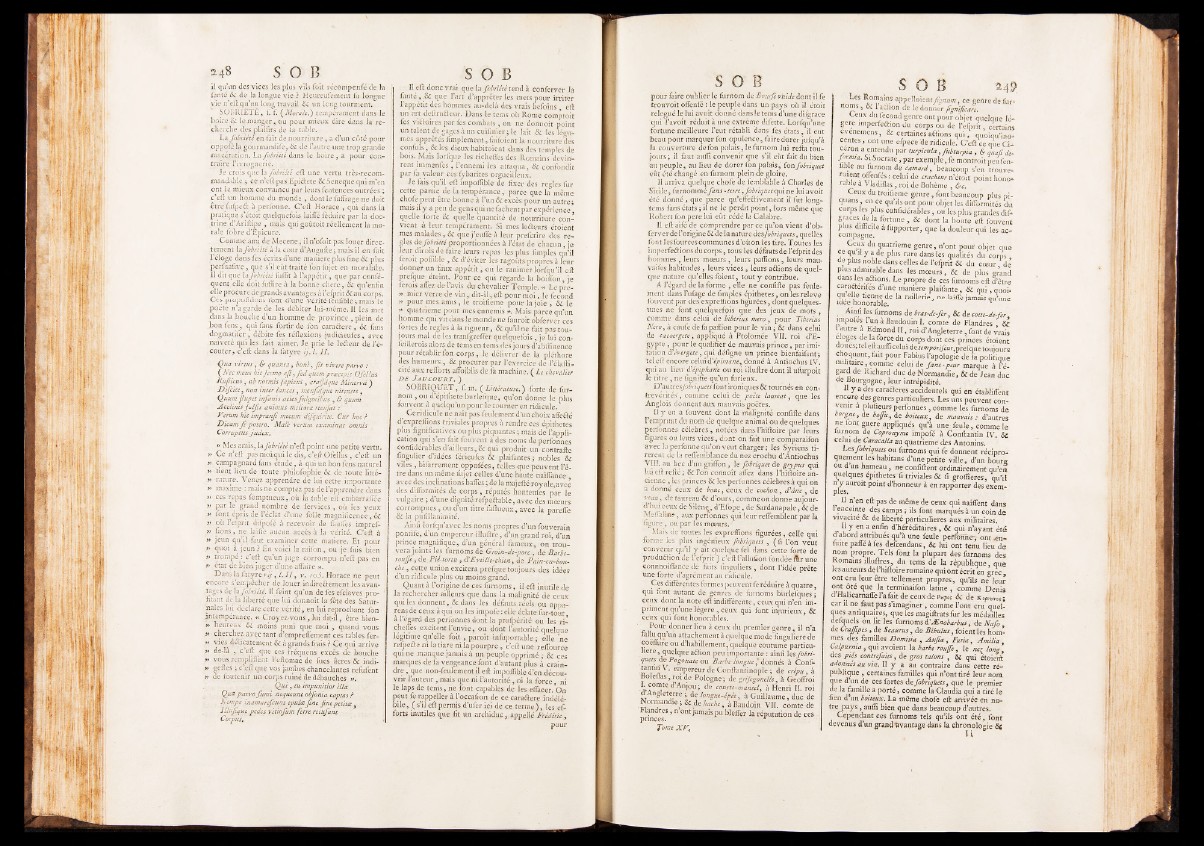
^48 S O B
il qu’un des vices les plus vils foit rccompenfé de la
fanté &c de la longue vie i Hcureufement la longue
vie n’eft qu’un long travail & un long tourment.
SOBRIÉTÉ, fi f. ( Morale.) tempérament dans le
boire &c le manger, ou pour mieux dire dans la recherche
des plaifirs de la table.
La fobriétè en fait de nourriture , a d’un côté pour
oppofe la gôurmandife, & de l’autre une trop grande
macération. La fobriétè dans le boire , a pour contraire
l’ivrognerie. ; v.
Je crois que la fobriétè eft une vertu très-recommandable.;
ce n’ eft pas' Epi&ete &Seneque qui m’en
ont le mieuxxonvaincu par leurs fentences outrées ;
c’eft un homme du monde , dont le fuffrage ne doit
êtrefiffpeû à perl'onne. C ’eft Horace , qui dans la
pratique s’étôit quelquefois laifle féduire par la doctrine
d’Ariftipe , mais qui goûtoit réellement la morale
fobre d’Epicure.
Comme ami de Mecene, il n’ofoit pas louer directement
la fobriétè à la cour d’Augufte; mais il en fait
l’éloge dans fes écrits d’une maniéré plus fine & plus
perfuafive, que s’il eût traité fon fujet en moralifte.
Il dit qué la fobriétè fuffit à l’appétit ;, que par confé-
quent elle doitfufïire à la bonne chere, & qu’enfin
elle procure de grands avantages à l’efprit & au corps.
Cés propofitions font d’une vérité fenfible ; mais le
poète n’a garde de les débiter lui-même. Il les met
.dans la bouche d’un homme de province., plein de
.bon fens, qui fans fortir de fon caradere , & fans
dogmatifcr, débite fes réflexions judicieufes, avec
naïveté qui les fait aimer. Je prie le le&eur de l’écouter
, c’eft dans la fatyre ij. I. II.
Qua virais, & quanta, boni, f ît vivere parvo :
( Nec meus hicJerrno e(t,fed qutm præcepit Ofellus
Rufîicus, ab normis fâpiens , craffâque Minervâ )
D i f ci te, non inter lances, menfafque nitentts ,
Qtium fiupet infinis aciesfulgoribus , & quum
Acclinis falfîs animus meliora rècufat r
Vîrurn hic impranfî mecum difquirite. Cur hoc ?
Dicarn f î potero. Malh verum examinât omnis
Corruptüsjudex.
« Mes amis, la fobriétè n’ eft point une petite vertu.
» Ce n’eft pas moi*qui le dis, c’eft Ofellus, c’eft un
» campagnard fans etude, à qui un bon fens naturel
» tient lieu.de toute philofophie Sc de toute litté-
» rature. Venez apprendre de lui cette importante
» maxime : mais ne comptez pas de l’apprendre dans
» ces repas fomptueux, oii la table eft embarraffée
» par le grand nombre de fervices , où les yeux
» font épris de l’éclat d’une folle magnificence, &
» oii l’ efprit difpofé à recevoir de fauffes impref-
» fions, ne laifle aucun accès à la vérité. C’efl à
« jeun qu’il faut examiner cette matière. Et pour -
>> quoi a jeun ? En voici la raifon, ou je fuis bien
» trompé : c’eft qu’un juge corrompu n’ eft pas en j
» état-de bien juger d’une affaire ».
Dans la fatyre v i j,/. / / , v. ioj. Horace ne peut
encore s’empêcher de louer indire&ement les avantages
de la fobnéiè. Il feint qu’un de fes efclaves pro- '
fitant de la liberté que lui donnoit la fête des Saturnales
lui déclare cette vérité , en lui reprochant fon
.intempérance. « Croyez-vous, lui dit-il, être bien-
» heureux & moins puni que moi , quand vous
» cherchez ayec tant d’empreflement ces tables fer-
» vies délicatement & à grands frais ? Ce qui arrive
» de-là , ç ’éft .que ces fréquens excès de bouche
» vous.remplifient l’eftomac de fucs âcres & indi-
» geftes ; c’ eft que vos jambes chancelantes refufent
» de foutenir un,corps ruiné de débauches ».
Qui , tu impunitior ilia
Qfice parvo fumi nequeunt obfonia captas ?
Jf anpe inamarefcunt epulce fine fine petita ,
Illifique pedes yitiofum ferre recufant
Corpus, ,
S O B
Il eft donc vrai que la fobriétè tend à confervér la
fanté, & que l’art d’apprêfer les mets pour irriter
^ l'appétit des hommes au-delà des vrais befoins , eft
un art defiruôeur. Dans le tems oii Rome comptoit
les vi&oires par fes combats , on ne donnoit point
un talent de gages à un cuifinier ; le lait & les légumes
apprêtés Amplement, faifoient la nourriture des
confuls, & les dieux habitaient dans des temples de
bois. Mais lorfque les richefles des Romains devinrent
immenfes , l’ennemi les attaqua, & confondit
par fa valeur ces fybarites orgueilleux.
Je fais qu’il eft impoflible de fixer des réglés fur
cette partie de la tempérance, parce que la même
chofe peut être bonne à l’un & excès pour un autre;
mais il y a peu de gens qui ne fâchent par expérience,
quelle forte & quelle quantité de nourriture convient
à leur tempérament. Si mes le&eurs étoient
mes malades , & que j’euffe à leur prefcrire des réglés
d fobriétè proportionnées à l’état de chacun, je
leur dirois de faire leurs repas les plus fimples qu’il
feroit pofîïble, & d’éviter les ragoûts propres à leur
donner un faux appétit', ou le ranimer lorfqu’il eft
prefique éteint. Pour ce qui regarde la boiffon, je
ferois affez de l’avis du chevalier Temple. « Le pre-
» mier verre de vin, dit-il, eft pour m oi, le fécond
» pour mes amis, le troifieme pour la joie , & le
» quatrième pour mes ennemis ». Mais parce qu’un
homme qui v it dans le monde ne fauroit obferver ces
fortes de réglés à la rigueur , & qu’il ne fait pas toujours
mal de les tranfgreffer quelquefois , je lui con-
feiilerois alors de tems en tems des jours d’abftinence
pour rétablir fon corps, le délivrer de la pléthore
des^ humeurs , & procurer par l’exercice de l’élafti-
cité aux refforts affoiblis de fa machine. ( L e ch e v a lie r
D E JJU C O U R T , f . ..
SOBRIQUET, f. m. ( Littérature. ) forte de fur-
nom ,ou d’épithete burlefque, qu’on donne le plus
fouvent a quelqu’un pour le tourner en ridicule.
. Ce ridicule ne naît pas feulement d’un choix affefté
d expreflîons triviales propres à rendre ces épithetes
plus fignificatives ou plus piquantes ; mais de l’application
qui s’en fait fouvent à des noms de perfonnes
confidérables d’ailleurs, & qui produit un contrafte
fingulier d’idées férieufes & plaifantes ; nobles &
viles, bifarrement oppofées, telles que peuvent l’être
dans, un même fujet celles d’une haute naiffance
avec des inclinations baffes ; de la majefté royale,avec
des difformités de corps, réputés honteufes par le
vulgaire ; d’une dignité refpeâable, avec des moeurs
corrompues, ou d’un titre faftueux, avec la pareffe
. & la püfillanimité.
Ainfi lorfqu’avec les noms propres d’un' fouverain
pontife, d’un empereur illuflre, d’un grand roi, d’un
prince magnifique, d’un général fameux, on trouvera
joints les furnOms de Groin-de-^porc , de Barbe-
roujfe , de. Pié-tortu , d’Eveille-chien, de Pain-en-bou-
che , cette union excitera prefque toujours des idées
d’un ridicule plus ou moins grand.
Quant à l’origine de ces furnoms, il eft inutile de
la rechercher ailleurs que dans la. malignité de ceux
qui les donnent, & dans les défauts réels: ou appareils
de cëux à qui on les impofe : elle éclate fur-tout
à l’égard des perfonnes dont la profpérité ou les ri-
chçffes excitent l’envie, ou dont l’autorité quelque
légitime qu’elle foit , paroît infuportable; elle ne
refpefte ni la tiare ni la pourpre , c’efl une reffource
qui ne manque jamais à un peuple opprimé ; & ces
marques de fa vengeance font d’autant plus à craindre
, que non-feulement il eft impoflible d’en découvrir
l’auteur ,;mais que ni l’autorité:, ni la force ni
le laps de tems, ne font capables de les effacer. On
peut fe rappeller à l’occafion de ce caraftere indélébile
, ( s’il eft permis d’ufer ici de ce terme ) , les efforts
inutiles que fit un archiduc,.appelle Frédéric,
pour
S O B p'ôur faire oublier le furnom de Bourfe v'uide dont fl fe
trouvoit offenfé : le peuple dans Un pays où il étoit
relégué le lui avoit donné dans le tems d’une difgrace
qui l’avoit réduit à une extrême difette. Lorfqu’une
fortune meilleure l’eut rétabli dans fes états, il eut
beau pour marquer fon opulence, faire dorer jufqu’à
la couverture de fon palais, le furnom lui refta toiu-
jours; il faut aufli convenir que s’il eût fait du bien
‘au peuple j au lieu de dorer fon palais,- fon fobriquet
eût été changé en furnom plein de gloire.
Il arriva quelque chofe de.femblable à Charles de
Sicile, furnomme,/à/M -terre, fobriquet qui ne lui avoit
été donné, que parce qu’effeftivement il fut long-
tems fans états ; il ne le perdit point, lors même que
Robert fon pere lui eût cédé la Calabre*
Il eft aifé de comprendre par ce qu’on, vient d’ob-
ferver de l’origine & de la nature desfobriquets, quelles
font lesfources communes d’oîion les tire. Toutes les
imperfeélions du corps, tous les défauts de l’éfprit des
hommes , leurs moeurs , leurs pallions, leurs mau-
Vaifes habitudes > leurs vice s, leurs aâions de quelque
nature qu’ elles foient, tout y contribue.
A l’égard de la forme , elle ne confifte pas feulement
dans l’ufage de fimples épithètes, on les releve
fouvent par des expreflîons figurées, dont quelques-
unes ne font quelquefois que des jeux de mots ,
comme dans celui de biberius mero, pour Tiberius
Nero, à caufe de fa paflïon pour le vin ; & dans celui
de cacoergete, appliqué à Ptolomée VIL roi d’Egypte
, pour le qualifier de mauvais prince, par imitation
d’c’vergete, qui défigne un prince bienfaifant ;
tel eft encore celui déépimane, donné à Antiochus IV.
qui au lieu' üépipharie ou roi illuftre dont il uflirpoit
le titre , ne lignifie qu’un furieux.
D’autresfobriquets font ironiques & tournés en contrevérités'
, comme celui de poète lauréat, que les
Anglois donnent aux mauvais poètes.
Il y en a fouvent dont là malignité confifte dans
l’emprunt du nom de quelque animal ou de quelques
perfonnes célébrés , notées dans l’hiftoire par leurs '
figures où leurs vices, dont on fait une comparaifon
avec la perfonne qu’on veut charger ; les Syriens tirèrent
de la reffemblance du nez crochu d’Antiochus
VIII. au bec d’un griffon, le fobriquet de grypus qui
lui eft refté ; & l’on connoît affez dans l ’hiftoire ancienne
, les princes & les perfonnes célébrés à qui on
a donné ceux de bouc, ceux de cochon, d'âne , de
y tau, de taureau & d’ours, comme on donne aujourd’hui
ceux de Silene, d’Efope, de Sardanapale, & de
Meflaline, aux perlonnes qui leur reflemblent par la
figure, ou par les moeurs.r'
Mais de toutes les expreflîons figurées, celle qui
forme les plus ingénieux fobriquets , ( f i l’on veut
convenir qu’il y ait quelque fel dans, cette forte de
production de l’efprit ) c ’eft l’allufion fondée ffer une
çonnnoiffance de faits finguliers , dont l’idée prête
une forte d’agrément au ridicule.
Ces différentes formes peuvent fe réduire à quatre,
qui font autant de genres de furnoms bûrlefques ;
ceux dont la note eft indifférente, ceux qui n’en im-
priment qu’une légère , ceux qui font injurieux, &
ceux qui font honorables.
Pour donner lieu à c.eux du premier genre, il n’a
fallu qu un attachement à quelque mode finguliere de
coeffure ou d’habillement, quelque coutume particir-
liere, quelque aftion peu importante : ainfi les fobriquets
de Pogonate ou Barbe-longue ,* donnés à Conf**
tantinV. empereur de Conftantinople ; de crépu à
Boieflas roi de Pologne; de grifigonelle, à Geoffroi
.j, ^on}te d Anjou ; de courte-mante f à Henri II. roi
d Angleterre ; de longue-épée, à Guillaume, duc de
g o rm a n d r e s& d eW « , i,Baudoin VII. comte de
rlandres, n ont jamais pu bleffer la réputation de ces
princes. r
Tome X V t
S O B * 4$
Les Romains appelaientftgnunï, de écrire de fur*
noms, & 1 action de le donnerfîgnificare*
Ceux du fécond genre ont pour objet quelque lé*
gere imperfeéhon du corps ou de l’efprit certains
evénemens, & certaines aérions q ui, quoiqu’ino*
centes, ont une efpece de ridicule. C’eft ce que Ci-
ceron a entendu par turpicula ,fubturpia, & quafi de-
Socrate > par exemple, fe montroit peu fen*
îiDle au furnom de camard, beaucoup s’en trouve»
m m M m \ celui de cracheur n’étoit point hono»
râble à Vladiflas, roi de Bohème , &ci
Ceux du troifieme genre, font beaucoup plus pi-
quans, en ce qu’ils ont pour objet les difformités du
corps les plus cohfidérables , ou les plus grandes dif*
grâces de la fortune , & dont la honte eft fouvent
plus difficile à fupporter, que la douleur qui les accompagne.
Ceux du quatrième genre, n’ont pour objet que
ce qu il y a de plus rare dans les qualités du corps ,
de plus noble dans celles de l’efprit & du coeur, de
plus admirable dans les moeurs, & de plus grand
d 3 n S o n s * Pr(?Pre ces fiirnoms eft d’être
caratterifes d’une maniéré plaifante, & q u i, quoi*
qu e e tienne de la raillerie, ne laifle jamais qu’une
idee honorable.
Ainfi les furnoms de bras-de-fer, & àecotte^de-fer.
impofes 1 un à Baudouin I. comte de Flandres àc
l autrer à Edmond I I, roi d’Angleterre, font de vrais
eloges de la forcedii Corps dont ces princes étoient
doues; tel eft aufli celui de temporifeur,prefque toujours
choquant, fait pour Fabius l’apologie de fa politique
B *ta]re ? comme celui de fans - peur marque à l’égard
de Richard duc de Normandie, & d e Jean due
de Bourgogne, leur intrépidité.
Il y a des caracieres accidentels qui en établiffent
encore des genres particuliers. Les uns peuvent convenir
à plufieurs perfonnes , comme les furnoms de
orgne y de bojfu., de boiteux, de mauvais : d’autres
ne font guere appliqués qu’à une feule, comme le
lurnom de Copronyme impofé à Conftantin IV. &
celui de Caracalla au quatrième des Antonins.
Les fobriquets ou furnoms qui fe donnent réciproquement
les habitans d’une petite ville, d’un bourg
ou d un hameau, ne confiftent ordinairement qu’en
quelques épithetes fi triviales & fi groflîeres, qu’il
n y auroit point d’honneur à en rapporter des exem*
pies-.
Il n’en eft pas de même de ceux qui naiffent dans
1 enceinte des camps ; ils font marqués à un coin de
vivacité & de liberté particulières aux militaires.
Il y en a enfin d’héréditaires , & qui n’ayant été
d abord attribués qu’à une feule peffoRne^ ont „en-
fuite paffé à fes delcendans, & lui ont tenu lieu de
nom propre. Tels font la plupart des furnoms des
Romains illuftres, du tems de la république, que
les auteurs de l’hiftoire romaine qui ont écrit en grec
ont cru leur être tellement propres, qu’ils ne leur
ont ôté que la terminaifon latine , comme Denis
d’Halicarnaffe l’a fait de ceux de Peçoe & de k opvuroç ;
car il ne faut pas s’imaginer, comme l’ont cru quelques
antiquaires, que les magiftrats fur les médailles
defquels on lit les furnoms à’Ænobarbus, de Nafo,
de Craffîpes , de Scaurus, de Bibulus, foient les hom*
mes des familles Domina , A x fia, Furia, Amilia
Calpurnia, qui avoient la barbe touffe, le ne{ long\
des pies contrefaits, de gros talons , & qui étoient
adonnés au vin. Il y a au contraire dans cette république
, certaines familles qui n’ont tiré leur non!
que dun de ces fortes de fobriqüets, que le premier
de la famille a porté, comme la Claudia qui a tiré le
lien d un boiteux. La même chofe eft arrivée en no-
tre pa ys, aufli bien que dans beaucoup d’autres.
Cependant ces furnoms tels qu’ils ont é té, font
devenus d’un grand Avantage dans la chronologie &
I i