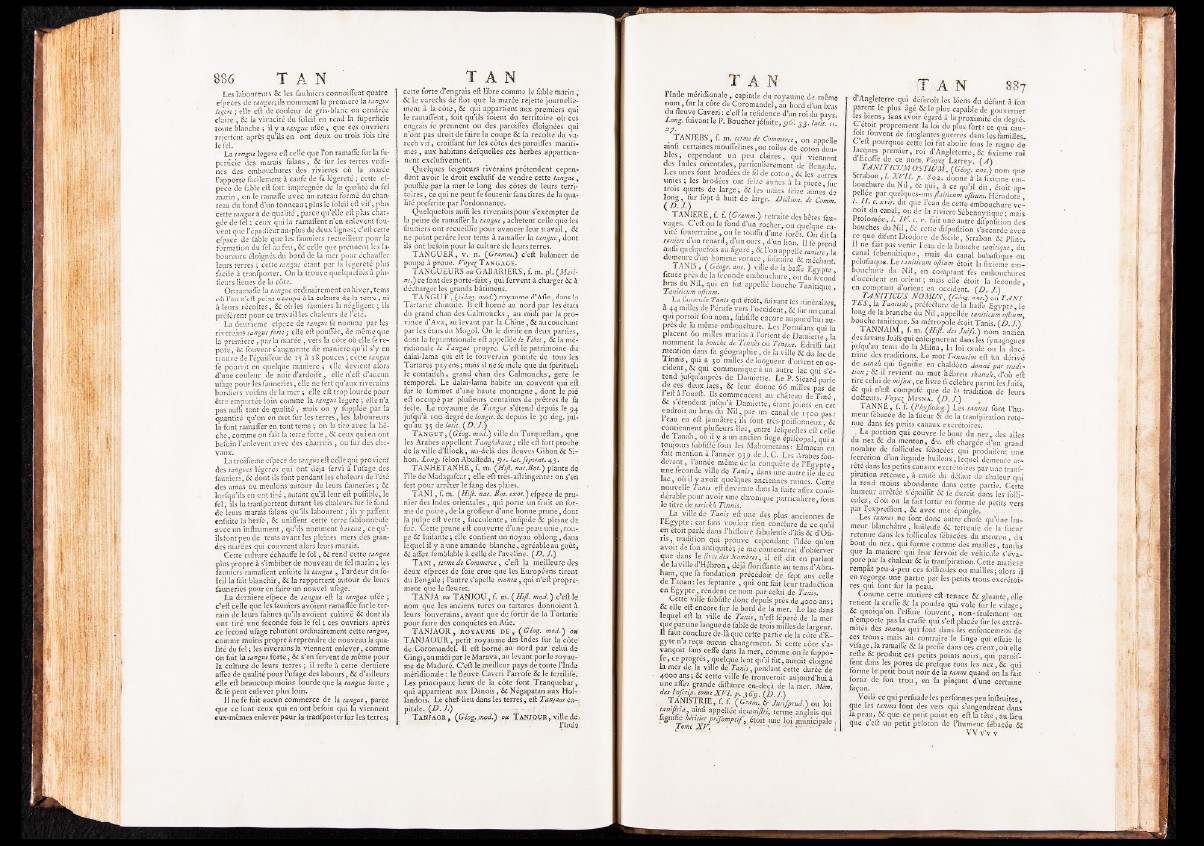
Les laboureurs & les faulniers connoiffent quatre
efpeces de tangue-,ils nomment lapremiere la tangue
legcre ; elle eft de couleur de gris-blanc ou cendrée
claire , & la vivacité du foleil en rend la fuperficie
toute blanche ; il y a tangue ufée , que ces ouvriers
rejettent après qu’ils en ont deux ou trois fois tire
le fel.
La tangue legere eft celle que l’on ramafle fur la fuperficie
des marais falans, & fur les terres voifi-
nes des embouchures d.es rivières oii la marée
l’apporte facilement à caufe de fa légèreté ; cette el-
pece de fable eft fort imprégnée de la qualité du fel
marin , on le ramafle avec un rateau formé du chanteau
du fond d’un tonneau ; plus le foleil eft v i f , plus
cette tangue a de qualité, parce qu’elle eft plus chargée
de fel ; ceux qui la ramaflent n’en enlevent fou-
vent que l’épaiffeur au-plus de deux lignes ; c’eft cette
efpace de fable que les faumiers recueillent pour la
formation du fel au feu, & celle que prennent les laboureurs
éloignés du bord de la mer pour échauffer
leurs terres ; cette tangue étant par fa légèreté plus
facile à tranfporter. On la trouve quelquefois à plu-
fieurs lieues de la côte.
On ramafle la tangue ordinairement en hiver, tems
où l’on n’eft point occupé à la culture de la'terre, ni à leurs récoltes, & oh les fauniers la négligent ; ils
préfèrent pour ce travail les chaleurs de l’été.
La deuxieme efpece de tangue fe nomme par les
riverains tangue forte ; elle eft pouffée, de même que
la première , par la marée , vers la côte où elle fe re-
pofe, & fouvent s’augmente de maniéré qu’il s’y en
trouve de l’épaiffeur de 1 5 à 18 pouces ; cette tangue
fe pourrit en quelque maniéré ; elle devient alors
d’une couleur de noir d’ardoife, elle n’eft d’aucun
ufage pour les fauneries, elle ne fert qu’aux riverains
bordiers voifins de la mer ; elle eft trop lourde pour
être emportée loin comme la tangue legere ; elle n’a
pas aufli tant de qualité, mais on y fupplée par la
quantité qu’on en met fur les terres, les laboureurs
la font ramafler en tout tems ; on la tire avec la bêche,
comme on fait la terre forte, & ceux qui en ont
befoin l’enlevent avec des charrois , ou fur des chevaux.
La troifieme efpece de tangue eft celle qui provient
des tangues légères qui ont déjà fervi à l’ufage des
fauniers, & dont ils font pendant les chaleurs de i’été
des amas ou meulons autour de leurs fauneries ; &
lorfqu’iis en ont tiré , autant qu’il leur eft pofîible, le
fe l, ils la tranfportent durant les chaleurs fur le fond
de leurs marais falans qu’ils labourent ; ils y paffent
enfuite la herfe, & unifient cette terre fablonnêufe
avec un infiniment, qu’ils nomment haveau, ce qu’-
ilsfont peu de tems avant les pleines mers_ des grandes
marées qui couvrent alors leurs marais.
Cette culture échauffe le f o l , & rend cette tangue
plus propre à s’imbiber de nouveau du fel marin ; les
fauniers ramaflent enfuite la tangue , l’ardeur du foleil
la fait blanchir, & la rapportent autour dé leurs
fauneries pour en fairé un nouvel ufage.
La derniere efpece de tangue eft la tangue ufee ;
c’eft eèlle que les fauniers avoient ramaffée furie terrain
de leurs falines qu’ils avoient cultivé & dont ils
ont tiré unè fécondé fois le fel ; ces ouvriers après
£e fécond ufage rebutent ordinairement cette tangue,
comme moins propre à reprendre de nouveau la qualité
du fel ; les riverains la viennent enlever, comme
on fait la tangue forte, & s’en fervent de même pour
la culture de leurs terres ; il refte à cette derniere
affez de qualité pour l’ufage des labours, & d’ailleurs
elle eft beaucoup moins lourde que la tangue forte ,
& fe peut enlever plus loin.
Il ne fe fait aucun commerce de la tangue, parce
que ce font ceux qui en ont befoin qui la viennent
eux-mêmes enlever pour la tranfporter fur les terres;
cette forte d’engrais eft libre comme le fable marin
& le varechs de flot que la marée rejette journellement
à la côte, & qui appartient aux premiers qui
le ramaflent, foit qu’ils foient du territoire où ces
engrais fe prennent ou des paroiffes éloignées qui
n’ont pas droit de faire la coupe & la récolté du varech
v i f , croiffant fur les côtes des paroiffes maritimes
, aux habitans defquelles ces herbes appartiennent
exclufivement.
Quelques feigneurs riverains prétendent cependant
avoir le droit exclufif de vendre çette tangue,
pouffée par la mer le long des côtes de leurs territoires
, ce qui ne peut fe foutenir fans titres de la qualité
preferite par l’ordonnance.
Quelquefois aufli les riverains pour s’exempter de
la peine de ramafler la tangue, achètent celle que les
fauniers ont recueillie pour avancer leur travail, &
ne point perdre leur tems à ramafler la tangue, dont
ils ont befoin pour la culturè de leurs terres.
TANGUER, v . _n. (Gramm.) c’eft balancer de
poupe à proue. Voye%_ T an g ag e.
TANGUEURS ou GABARIERS , f. m. pl. [Marine.')
ce font des porte-faix, qui fervent à charger & à
décharger les grands bâtimens.
T A N G U T , ( Géog. mod.) royaume d’Afie, dans la
Tartarie chinoile. Il eft borné au nord par les états
du grand chan des Calmoucks , au midi par la province
d’Ava, au levant par la Chine, & au couchant
par les états du.Mogol. On le divife en deux parties,
dont la feptentrionale eft appellée le Tibet, & la méridionale
le Tangue propre. C’eft le patrimoine du
dalaï-lama qui eft le fouverain pontife de tous les
Tartares payens ; mais il ne fe mêle que du fpirituel:
le contailch, grand chan des Calmoucks, gere le
temporel. Le dalaï-lama habite un couvent qui eft
fiir le fommet d’une haute montagne , dont le pié
eft occupé par plufieurs centaines- de prêtres de fa
feéte. Le royaume de Tangue s’étend depuis le 94
jufqu’à 100 degré de longi't. & depuis le 30 deg. juf-
qu’au 35 de latit. [D :J .) .
T àngu t , [Géog. mod.) ville du Turqueftan, que
les Arabes appellent Tanghïkunt; elle eft fort proche
de la ville d’Illock, au-delà des fleuves Gihon & Si-
hori. Long, félon Abulfeda, g 1. lat.feptent. 4g.
TANHÉTANHÉ, 1. m. [Hijl. nat.Bot.) plante de.
l’île de Madagafcar ; elle eft très-aftringente : on s’en
fert pour arrêter le fang des plaies.
T A N I , f. m. [Hifl. nat. Bot. exot.) efpece de prunier
des Indes orientales , qui porte un fruit en for-,
me de poire, de la groffeur d’une bonne prune, dont
là pulpe eft verte, fucculente, infipide & pleine de
fuc. Cette prune eft couverte d’une peau unie, rouge
& luifante ; elle contient un noyau oblong, dans
lequel il y a une amande blanche, agréable au goût,
& aflez lemblable à celle de l’aveline. [D . J.)
T A NI, terme de Commerce , c’eft la meilleure des
deux efpeces de foie crue que les Européens tirent-
du Bengale ; l’autre s’apelle monta, qui n’eft propre-,
ment que le fleuret.
TAN JA ou TANJOU, f. m. {Hijl. mod.) c’eft le
nom que les anciens, turcs ou tartares donnoient à
leurs îouverains, avant que de fdrtir de la Tartarie
pour faire des conquêtes en Afie/ • -
TANJAOR, royaume d e , [Géog. mod.) ou
TANJAOUR, petit royaume des Indes fur la côte?
de Coromandel. Il eft borné~au nord par celui dé
Gingi, au midi par le Marava, au levant par le royau-’
me de Maduré. Ç’eft le meilleur pays de toute l’Inde
méridionale : le fleuv.e Caveri l’arrofe & le fertilife.
Les principaux lieux de la côte font Tranquebar,
qui appartient aux Danois, & Négapatan aux Hol-;
landois. Le chef-lieu dans les terres, eft Tanjaor ca-i
pitale.,‘[D . J.)
T an jao r , [Géog. mod.) ou T anj.o u r , ville dé»
' l’Inde
ï’Iricle méridionale, capitale du royaume de même
nom, far la côte de Coromandel, au bord d’un bras
du fleuve Caveri : c’cll la rèfidence d’un roi du pays.
Long, fuwantle P. Boucher jéfeite,3 éT. 3 3 .Utit.
* 7 -
. TANJEB.S , f. m. terme de Commercé, on appelle
ninfi certaines-mouffelinesypittoiles.de coton doubles,
cependant un peu claires, qui viennent
des Indes Orientales, particulièrement de Bengale.-
Les unes font brodées de fil de coton, & les entres
unies; lés brodées ont fei/e'âur.cs à la nicce -fur
trois quarts de large; &-leÿ in ie s feize aunes de
à huit de large. Diction, de Comme
TANIERE, f. f. (Gramm.) retraite dés,bêtes fau-
vages. C ’eft où lé fond d’un rocher, ou quelque cal;
vite fouterraine ,,ou le touffu d’une forêt. On dit la
tanière d’un renard, d’un ours, d’un.lion. 11 fe prend
aufli quelquefois au figuré, & l'on appelle taniere ,1a
demeure d un homme vorace., folitaire & méchant.
TAMÇ , (Geogr. OTg&ÜaklfeKbpflh Eoypte l
fituee près de la fécondé embouchure, ou dûlecond
bras du Nil, qui en fut appelle bquche Tanitique “
Taniticum oflium. * 9
La fameufe Tanis qui étoit, fuivant les itinéraires
à 44 milles de Pérufe vers l’occident, & fur un canal
qui portoit fonnom, fubfifte encore aujourd’hui auprès
de la même embouchure. Les Portulans qui la
placent 60 milles marins à l’orient de Damiette la
nomment la bouche de Tennis ou Ténexc. Edriffi fait
mention dans fa géographie, de la ville & du lac de .
Tmnis, qui a 30 milles de longueur d’orient en occident
, & qui communique à un autre lac qui s’étend
jufqu’auprès de Damiette. Le P. Sicard parle
de ces deux lacs, & leur donne 66 milles pas de
le ft M’oueft. Ils commencent au château deTiné
& s etendent jufqu’à Damiette, étant joints en cet
endroit au bras du N il, par un canal.de 1500 pas :
l’eau en eft .jaunâtre; ils font très-poiffonneux &
contiennent plufieurs îles, entre lelquelles eft celïe
de Tanah, où il y a un ancien fiege épifcopal, qui a
toujours fubfifté fous les Mahométans: Elmacin en
fait mention à l’année 939 de J, C. Les Arabes fon:
derent, Tannee même de la conquête de l’Egypte
une fécondé ville de Tanis, dans une autre île de ce
la c , où il y avoit quelques anciennes ruines. Cette
nouvelle Tanis eft devenue dans la-fuite affez confi-
dérable pour, ayoir une chronique particulière fous
le titre de tarickh Tihnis. ' ’ '
„_^a ville de Tanis eft une des plus, anciennes, de
1Egyp;e : bar fans vouloir rien conclure de ce qu’il
en etoit parlé, dans l’hiftoire fabuleufe d’Ifis & d’Ofi-
r is , tradition qui prouve 'cependant l’idée qu’on
avoit de fon antiquité; je me contenterai d’obferver
que dans le livre des Nombres, i f eft .dit en parlant
de la ville d’Hébron , déjà floriffante au tems d’Abraham,
que fa fondation précédoit de fept ans celle
de Tzoan: les feptante , qui ont fait leur traduction
en E gypte, rendent ce nom par celui de Tanis. '
Cette ville fubfifte donc depuis près de 4000 ans ;
& elle eft encore fur le bord de la mer. Le lac dans
lequel eft la ville de Tanis,, n’eft féparé de la mer
que par une langue de fable de trois milles de largeur.
Il faut conclure de-làque cette partie de la côte d’E-
gyte n’a reçu aucun changement. Si cette côte s’a-
vançoit fans cefle dans Ta mer, eomme.on l e fuppo- '
l e , ce progrès » quelque lent qu’il fut, auroît éloigné
la mer de la ville de , pendant cette durée de
4oo°ans ; & cette ville fe trouveroit aujourd’hui à ’
une aflez grande diftançe en-deçà de la mer. Mém.
des Infcrip. tome XVI. p . ïÇ q \ [D.J.')
■ Tf NISTRIE> 1 f- (Çram.& TÙrifprud.) ou loi
tamftna, ainfi appellée àetanifiriy terme .anglois qui !
ligmfte hernie^ préfomptif , étoit une loi municipale .
Tome ' 1
cPAngleterre -qui déferoit les biens du défunt à fon
parent le plus âgé & le plus capable de gouverner
les biens;; fans avoir égard à la proximité du degré.
C étoit proprement la Ipi du plus fort; ce qui eau.
loit foulent fanglantes guerres dans lesàmilles.
L eft pourquoi cette loi futabqlie fous le régné de
- P,remier>,roi d-Angleterre, & fixieme roi
d Ecofle de ce nom, fCeve! Larrey. (A\
e OSTIUM, (Géog. anc.) nom que
Stfabon , l. X r l I . p. go z . donne à la fixieme em-
bouqhure du N il, & à ce qufil dit, étoit ap-
pellee -par quelques.uns jlaiticum oflium. Hérodote ,
l. II. c. xvy. dit que l’eau de cette embouchure ve-»
noit du canal, ou de la riviere Sébennytique; mais
Ptolomee , l. IV. c. v. fait une autre difpofition des
bouches du N il, & cette difpofition s’accorde avec
ce que difent D iodore de Sicile, Strabon & Pline*
Il ne rair pas venir l’eau de la bouche tanitique, du
canal febenmtique, mais du canal bubaftique ou
pelufiaque. Le taniticum oflium étoit la fixieme embouchure
du N il, en comptant fés embouchures
d occident en orient ; mais-elle étoit la fécondé,
en comptant d’orient en occident. (D . J.)
TANITICUS NO MUS, [Géog. anc.) oui TANI*
T E S , la Tanitide-, préfe&ure de la baffe Egypte, le
long de la branche du N il, appellée taniticum oflium,
bouche tanitique. Sa métropole étoit Tanis. (D. J.)
TANNAIM, f. m. (jffifl. des Juifs.) nom ancien
des favans Juifs qui enfeignerent dans les fynagogues
jufqu’au tems de la Mifna, la loi orale ou la doctrine
des traditions. Le mot Tannaïm eft tin dérivé
de tanah qui lignifie en chaldéen donné par tradi-
tion ; & if revient au mot hébreu shanah, d’où eft
tiré celui de mifna, ce livre fi célébré parini les Juifs,
& qui n’eft compofé que de la1 tradition de leurs
dofteurs. Voye^ Mi SNA. [D .J .)
TANNE, f. f. [Phyflolog.) Les tannes font l’humeur
fébacée de la fueur & de la tranfpiration rete-
nu£ dans fes petits canaux excrétoires*
. La portion qui couvre le bout du nez, des aîles
du nez & .du menton, &c. eft chargée d’un grand
nombre de follicules fébacées qui produifent une
fecretion d’un liquide huileux, lequel demeure arrête
dans les petits canaux excrétoires par une tranfpiration
retenue, à. caufe du’ défaut de chaleur qui
-la rend-1 moins abondante dans cette partie. Cette
humeur arrêtée s’épaiflit & fe durcit dans les folli-
cples, d ou ôn la fait fortir en -forme de petits vers
pair 1,’expreflioq., ;& avec une épingle*.
-L es tannes ne.font donc autre chofe qu’une humeur
blanchâtre, huileufe & terreufe de la fueur
retenue dans les follicules fébacées du menton, du
bout du nez , qui forme comme des mailles, tandis
que -la matière qui leur fer voit de véhicule s’évapore
par la chaleur & la tranfpiration. Cette matière
remplit peu-à-peu ces follicules ou mailles; alors il
en regorge une partie, par les petits trous excrétoires
qui font fur la peau.
Comme cette matière eft tenace & gluante, elle
retient la crafle & la poudre qui vole fur le vifage;
& quoiqu on leffuie fouvent, non-feulement on
n’emporte pas la craffe qui, s’eft placée fur les extrémités
des tannes g\\y font dans les enfoncemens <le
ces,trous; mais au contraire le linge qui effuie le
vifage, la ramaffe & la preffe dans ces creux, où elle
refte & produit ces petits points noirs, qui paroif*
fent dans les pores de prefque tous les nez, & qui
forrne le petit bout noir de la tanne quand on la mit
fortir de fon trou, en la pinçant d’une certaine
façon.
Voilà ce qui perfuiade les perfonnespeu inftruites
qiie les tannes font des vers qui s’engendrent dans
la Peau» & que ce petit point en eft la tête , au-lieu
qùé c’eft un petit'ptlôtoh 'de Thumeur fébacée ,&
V V y'y v