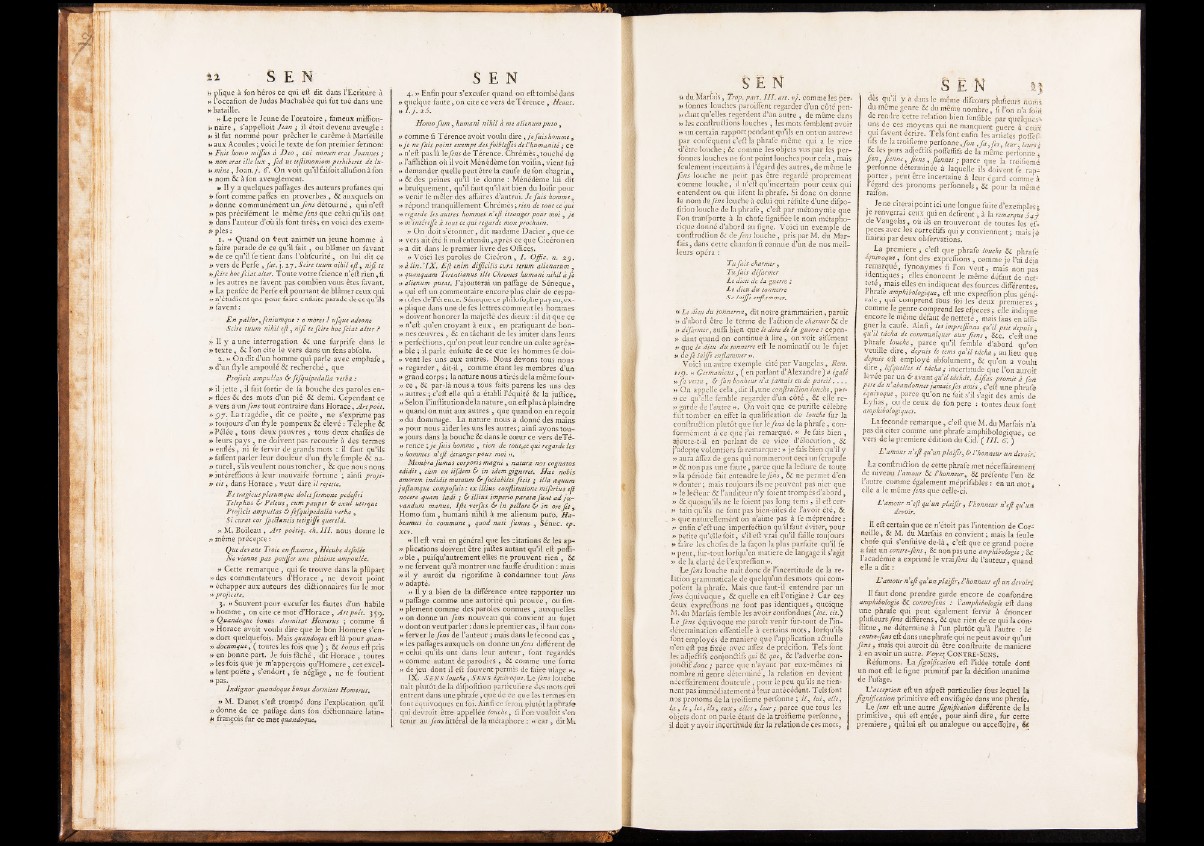
;> plique à fon héros ce qui èll dit dans l’Ecriture à
» l’occafion de Judas Machabée qui fiit tué dans une
»> bataille.
» Le pere le Jeune de l’oratoire , fameux miffion-
naire , s’appelloit Jean ; il étoit devenu aveugle :
h il fut nommé pour prêcher le carême à Marfeille
>> aux Acoules ; voici le texte de fon premier fermon:
» Fuit homo mijfus à Deo , cùi nomeh erat Joannes ;
» non erat ille lux , fed ut teflimoniom perhïberet de lu-
fi mine, Joan.y. <f. Ori voit qu’il faifoitallufiôn à fon
» nom & à fon aveuglement.
» Il y a quelques paffages des auteurs profanes qui
» font comme paffés en proverbes , & auxquels on
>> donne communément un fens détourné, qui n’eft
» pas précifément le même fens que celui qu’ils ont
i> dans l’auteur d’où ils font tirés; en voici des exem-
fi pies :
i . » Quand on ^eut animer un jeune homme à
faire parade de ce qu’il f a it , ou blâmer un favant
» de ce qu’il fe tient dans l’obicurité, on lui dit ce
fi vers de Perfe , fat. j. %y. S cire tuum nihil efl, nifi te
fifcire hoc fciat alter. Toute votre fcience n’eft rien, li
» les autres ne favent pas combien vous êtes favant.
La penfée de Perfe eft pourtant de blâmer ceux qui
fi n’étudient qne pour faire enfuite parade de ce qu’ils
» favent :
En pàllor ,ftniumqae : o mores ! ufque adeone
Scire tuum nihil e jl, niji le fcire hoc fciat alter ?
>> Il y a une interrogation & .une furprife dans le
>» texte, & l’on cite le vers dans un fens abfolu. '
i . » On dit d’un homme qui parle avec emphafe,
» d’un ftyle ampoulé & recherché, que
Projicit ampullas & fefquipedalia verba :
» il jette , il fait fortir de fa bouche des paroles en-
» fiées 8c des mots d’un pié 8c demi. Cependant ce
fi vers a un Jens tout contraire dans Horace, Artpoet.
» cyy. La tragédie, dit ce poëte, ne s’exprime pas
» toujours d’un ftyle pompeux & élevé : Télephe &
» Pélée , tous deux pauvres , tous deux chaffés de
» leurs pa ys, ne doivent pas recourir à des termes
fi enflés, ni fe fervir de grands mots : il faut qu’ils
» faffent parler leur douleur d’un ftyle fimple 8c na-
» turel, s’ils veulent nous toucher, & que nous nous
» intéreffions à leur mauvaife fortune ; ainfi proji-
» c it, dans Horace, veut dire il rejette.
Et tragicusplerumque doletfermone pedeflri
Telephus & Peleus, cum pauper & exul uterque
Projicit ampullas & fefquipedalia verba ,
Si curât cor fpeclantis tetigiffe querelâ.
» M. Boileau , Art poétiq. ch. III. nous donne le
» même précepte :
Que devant Troie en flamme , Hécube defoléc
Ne vienne pas poujjer une plainte ampoulée.
» Cette remarque , qui fe trouve dans la plupart
»des commentateurs d’Horace , ne devoit point
» échapper aux auteurs des dictionnaires fur le mot
» projicere. .
3. » Souvent pour excufer les foutes d’un habile
>> homme, on cite ce mot d’Horace, Artpoét. 3 59.
fi Quandoque bonus dormitat Homerus ; comme li
» Horace avoit voulu dire que le bon Homère s’en-
fi dort quelquefois. Mais quandoque eft là pour quan-
fi documque, ( toutes les fois que ) ; 8c bonus eft pris
» en bonne part. Je fuis fâché, dit Horace , toutes
» les fois que je m’apperçois qu’Homere, cet excel-
» lent poëte , s’endort, 1e néglige , ne fe foutient
fi pas«
lndignor quandoque bonus dormitat Homerus.
» M. Danet s’eft trompé dans l’explication qu’il
fi donne de ce paffage. dans fon dictionnaire latin-.
* françois fur ce mot quandoque.
4. » Enfin pour s’excufer quand on eft tombé dans
» quelque faute, on cite ce vers deTérence , Heaut.
» I . j . 2.5.
Homo fum , humani nihil a me alienum puto,
» comme li Térence avoit voulu dire , je fuis homme ,
» je ne fuis point exempt des foibleffes de l'humanité ; ce
» n’eft pas là le fens de Térence. Chrêmes, touché de
» l’àffliCtion où il voit Ménédème fon voifin, vient lui
» demander quelle peut être là caule de fon chagrin ,
» 8c des peines qu’il fe donne : Ménédème lui dit
» brufquement, qu’il faut qu’ilait bien du loilir pour
» venir fe mêler des affaires d’autrui. Je fuis homme,
» répond tranquillement Chrêmes; rien de tout ce qui
» regarde les autres hommes n'ef étranger pour moi , je
» m'intérejfe à tout ce qui regarde mon prochain.
» On doit s’étonner, dit madame D ac ier, que ce
» vers ait été fi mal entendu,après ce que Cicéron en
» a dit dans le premier livre des Offices.
» V oici les paroles de Cicéron, I . O {fie. n. 2$.
» a Un. 'IX. Efl enim dijjîcilis cura rerum alienarum ,
fi quanquam Terentianus ille Chremes humani nihil à fe
» alienum putat. J’ajouterai un paffage de Séneque,
» qui eft un commentaire encore plus clair de cespa-
» rôles deTérence. Séneque ce philofophe payen, ex-
» plique dans une de fes lettres comment les nommes
» doivent honorer la majefté des dieux : il dit que ce
» n’eft qu’en croyant à eu x , en pratiquant de bon-
» nés oeuvres, & en tâchant de les imiter dans leurs
» perfections, q.u*on peut leur rendre un culte agréa-
» ble ; il parle enfuite de ce que les hommes fe doi-
» vent les uns aux autres. Nous devons tous nous
» regarder, dit-il, comme étant les membres d’un
» grand corps ; la nature nous a tirés de la même four-
» ce , & par-là nous a tous faits païens les uns des
» autres ; c’eft elle qui a établi l’équité & la juftice.
Selon l’inftitution de la nature, on eft plus à plaindre
» quand on nuit aux autres , que quand on en reçoit
» du dommage. La nature nous a donné des mains
» pour nous aider les uns les autres; ainfi ayons tou-
>* jours dans la bouche 8c dans le coeur ce vers deTé-
» rence ; je fuis homme , rien de loutre qui regarde les
fi hommes ri efl étranger pour moi ». •
Membra fumus corporis magni , natura nos cognatos
tdidit, cian ex iifdem 6* in idem gigneret. Hcec nobis
amorem indidit mutuum & fociabiles fteit ; ilia cequum
jujlumque compofuit- : ex illius conftitutione miferius efl
nocere quam lezdi ; & illius imperio par ata finit ad ju -
vandum manus. Ijle verfus 6* in peclore & in orejit,
Homo fum , humani nihil à me alienum puto. Ha-
beamus in commune , quod nati fumus , Sénec. ep.
xcv.
« Il eft vrai en général que les citations & les ap-
» plications doivent être juftes autant qu’il eft poffi-
»ble , puifqu’autrement elles ne prouvent rien , &
» ne fervent qu’à montrer une fauffe érudition : mais
» il y aurôit du rigorifme à condamner tout fens
» adapté.
» Il y a bien de la différence entre rapporter un
» paffage comme une autorité qui prouve, ou fim-
» plement comme des paroles connues , auxquelles
» on donne un fens nouveau qui convient au fujet
» dont on veut parler : dans le premier cas, il fout con*
» ferver le fens de l’auteur ; mais dans le fécond cas ,
» les paffages auxquels on donne un fens différent de
» celui qu’ils ont dans leur auteur, font regardés
» comme autant de parodies , & comme une forte
» de jeu dont il eft fouvent permis de foire ufoge ».
IX. S en s louche, S en s équivoque. Le fens louche
naît plutôt de là difpofition particulière des mots qui
entrent dans une phrafe, que de ce que les termes en
font équivoques en foi. Ainfi ce ieroit plutpt la phrafe
qui devroit être appellée louche, fi l’on vouloit s’en
tenir, au fens littéral de la métaphore : « c a r , ditM;
S E N
ÿ> du Mariais, Trop. part. III. art. vj. comme lès per-
» fonnes louches paroiffent regarder d’un côté pen-
>> dant qu’elles regerdent d’un autre , de même dans
fi lés conftruétions louches , les mots femblent avoir
» un certain rapport pendant qu’ils en ont un autre»:
par confequent c’eft la phrafe même qui a le vice
d’être louche ; & comme les objets vus par les per-
fonnes louches ne font point louches pour ce la, mais
feulertient incertains à l’égard des autres, de même le
fens louche ne petit pas être regardé proprement
comme louche, il n’eft qu'incertain pour ceux qui
entendent ou qui lifent la phrafe. Si donc on donne
le nom de Jens louche à celui qui réfulte d’une difpofition
louche de la phrafe, c’eft par métonymie que
l’on tranfporte à la chofe fignifiée le nom métaphorique
donné d’abord aufigne. Voici un exemple de
- conftruétion & de fens louche, pris par M. du Mar-
fais, dans cette chanfon fi connue d’un de nos meilleurs
opéra :
Tu fais charmer ,
Tu fais défarmer
Le dieu de la guerre :
Le dieu du tonnerre
Se laijfe enflammer.
<< Le dieu du ïohncrrre9 dit notre grammairien, paroît
fi d’abord être le terme de l’aétion de charmer & de
yy défarmer, auffi bien que le dieu de la guerre : cepen-
» dant quand on continue à lire , on voit aifément
fi que Le dieu du tonnerre eft le nominatif ou le fujet
» deyè laijfe enflammer ».
Voici un autre exemple cité par Vaugelas , Rem.
UC). « Germanicus, ( en parlant d’Alexandre) à égalé
fi fa vertu , & fon bonheur ri! a jamais eu de pareil. . . .
fi On appelle cela , dit il,une conflruclion louche, par-
» ce qu’elle femble regarder d’un côté , & elle re- ;
» garde de l’autre ». On voit que ce purifte célébré
fait tomber en effet la qualification de louche fur la
conftruétion plutôt que fur le fens de la phrafe, conformément
à ce que j’ai remarqué. « Je,fois bien ,
ajoute-t-il en parlant de ce vice d’élocutiôn, &
j’adopte volontiers fa remarque : » je fais bien qu’il y
>> aura àffez de gens qui nommeront ceci unfcrupule
n & non pas une foute, parce que la leéture de toute
» la période fait entendre le fens, & ne permet d’en
fi douter ; mais toujours ils ne peuvent pas nier que
fi le leéteur & l’auditeur n’y foient trompés d’abord,
» & quoiqu’ils ne le foient pas long tems, il eft cer-
» tain qu’ils ne font pas bien-aifes de l’avoir été, &
fi que naturellemént on n’aime pas à fe méprendre :
» enfin c’ eft une imperfeétion qu’il faut éviter, pour
» petite qu’elle foit, s’il eft vrai qu’il faille toujours
» faire les chofes-de la façon la plus parfaite qu’il fe
» peut, fur-tout lorfqu’en matière de langage il s’agit
fi de la clarté de l’expreffion ».
Le fens louche naît donc de l’incertitude de la relation
grammaticale de quelqu’un des mots qui com-
pofent la phrafe. Mais que faut-il entendre par un
fens équivoque, & quelle en eft l’origine } Car ces
deux expreflions ne font pas identiques, quoique
M. du Marfais femble les avoir confondues (foc. cit.)
Le fens équivoque me paroît venir fur-tout de l’indétermination
effentielle à certains mots, lorfqu’ils
font employés de maniéré que l’application aétuelle
n’en eft pas fixée avec affez de precifion. Tels font '
les adjeétifs conjonétifs qui & que, & l’adverbe con-
jonéfif donc ; parce que n’ayant par eux-mêmes ni
nombre ni genre déterminé, la relation en devient
néceffairement douteufe , pour le peu qu’ils ne tiennent
pas immédiatement à leur antécédent. Tels font
nos pronoms de la troifieme perfonne ; i l, lui, elle,
la , le , les,ils, eux, elles, leur; parce que tous les
objets dont on parle étant de la troifieme perfonne,
il doit y avoir incertitude fur la relation de ces mots,
S Ë N
dès qu’il y a dans le même difcoiifs pïufieurs noms
du meme genre & du même nombre, fi l’on n’a foin
de rendre cette relation bien fenfible par quelques-
uns de ces moyens qui ne manquent guère à ceüï
qui lavent eènre. Tels font enfin les articles p oM -
iils.de la troifieme perfonne,fôn .fa , fes. leur, Imrsi
les purs adjeftifi poffeffi& de la même perfonne i
fan fienàe, f ia i ; , funnes; parce que la troifiemé
perfonne déterminée à laquelle ils doivent fe rap-
porter, peut être incertaine à leur égard comme à
l’egard des pronoms perfonnels, & pour la même
raifon.
.. Je në citerai point ici une longue fuite d’exemples ;
je renverrai ceux qui en défirent, à la remarque 5qy
de Vaugelas, où ils en trouveront de toutes les ef-
pe ces avec les correétifs qui y conviennent; mais }é
finirai par deux obfervations.
, première , c’eft que phrafe louche & phrafë
équivoque, font des expreflions, comme je l’ai déjà
remarqué, fynon^mes fi l’on veut, mais non pas
identiques ; elles énoncent le même défaut de net-
tete, mais elles en indiquent des fources différentes.
Phrafe amphibologique, eft une expreffion plus générale
, qui comprend fous foi les deux premières i
comme le genre comprend les efpeces ; elle indique
encore le même défaut de nettete , mais fans en affi-
gner k caufe. Ainfi, les imprefjions qu'il prit depuis ,
qu'il tâcha de communiquer aux jiens, & c . c’eft une
phrafe louche, parce qu’il femble d’abord qu’on
veuille dire, depuis le tems qu’il tâcha, au lieu que
depuis eft employé abfolument, & qu’on a voulii
dire , lefquelles il tâcha ; incertitude que l’on auroit
le vee par un & avant qu'il tâchât. Lifîas promît à fort
pere de n'abandonner jamaisfes amis , c’eft une phrafe
équivoque, parce qu’on ne fait s’il s’agit des amis dé
Lyfias,. ou de ceux de fon pere : toutes deux font
amphibologiques.
La fécondé remarque, c’eft que M. du Marfais n’â
pas dû citer comme uné phrafe amphibologique, cé
vers de la première édition du Cid. ( III. S .)
L'amour n efl qu'un plaifîr, & 1'honneur un devoiri
La conftru&ion de cette phrafe met néceffairement
de niveau l'amour & l'honneur, 8c préfente l’un &
l’autre comme également méprifables : en un mot,
elle a le même fins que celle-ci.
L'amour n'e(l qu'un plaifit, Fkonneur n’e f qu'un
devoir.
Il eft certain que ce n’étoit pas l’intention de Corneille
, & M. du Marfais en convient ; mais la feule
chofe qui s’enfuive de-là, c’eft que ce grand poëte
a fait un contre-fens, 8c non pas une amphibologie ; &
l’académie a exprimé le vraifens de l’auteur, quand
elle a dit :
L'amour n'ef quun plaifir, l'honneur efl un devoiri
II fout donc prendre garde encore de confondre
amphibologie 8c contre-fens : l’amphibologie eft dans
une phrafe qui peut également fervir à énoncer
pïufieurs fens différens, & que rien de ce qui la côn-
ftitue, ne détermine à l’un plutôt qu’à l’autre : lë
contre-fens eft dans une phrafe qui ne peut avoir qu’uri
fens i mais qui auroit dû être conftruite de maniéré
à en avoir un autre; Voye[ C ontre-Sens;
Réfumons. La Jignification eft l’idée totale dont
un mot eft le ligne primitif par la décifion unanimé
de l’ufage«
U acception eft un afpeâ particulier foiis lequel là
Jignification primitive eft envifagée dans une phrafei
Le Jens eft une autre Jignification différente de là
primitive, qui eft entée, pour ainfi dire, fur cetté
première, qui lui eft ou analogue ouacceffoire, êé