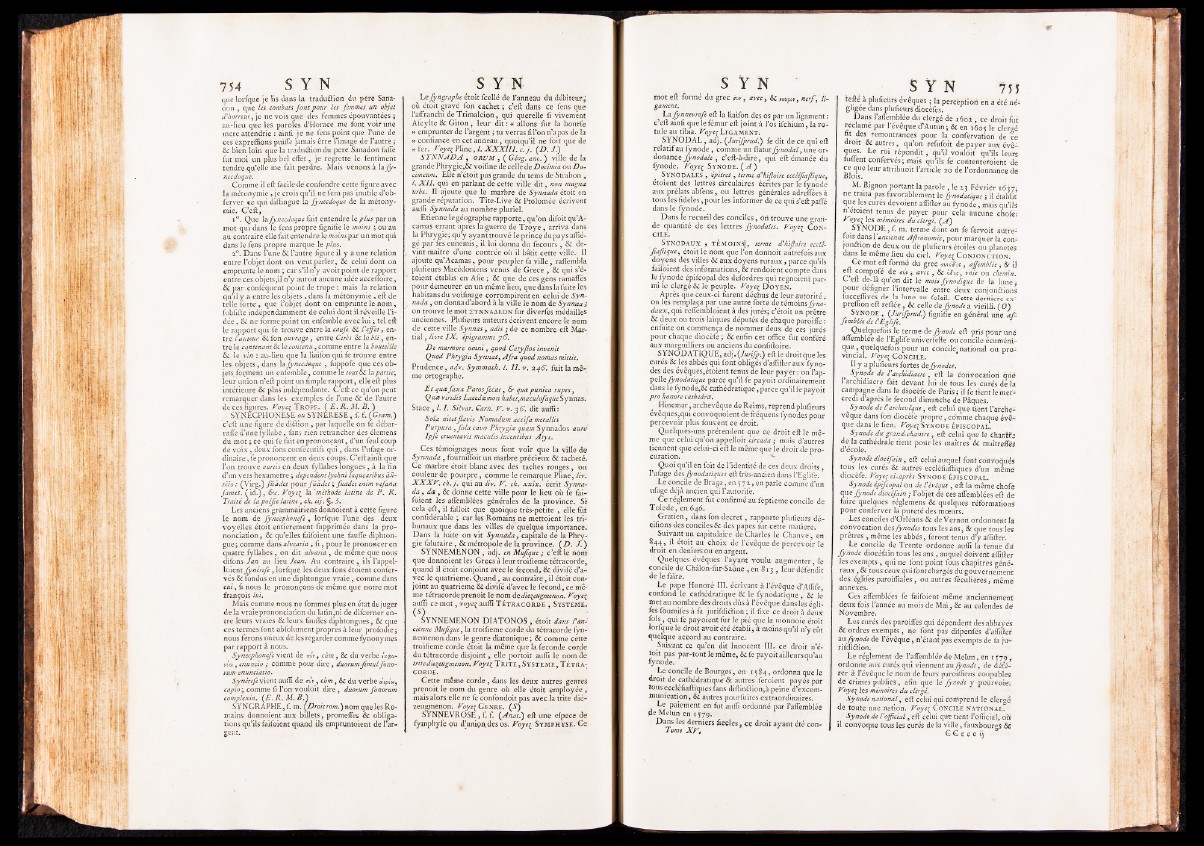
7 5 4 S Y N que lorfque je lis dans la traduôion du pere Sana-
don , que les combats font pour les femmes un objet
d’horreur, je ne vois que des femmes épouvantées ;
au-lieu que les paroles d’Horace me font voir une
inere attendrie : ainfi je ne fens point que l’une de
ces expreffions puiffe jamais erre l’image de l’autre ;
& bien loin que la traduâion du pere Sanadon faffe
fur moi un plus bel effet , je regrette le fentiment
tendre qu’elle me fait perdre. Mais venons à la fy necdoque.
Comme il eft facile de confondre cette figure avec
la métonymie, je crois qu’il ne lera pas inutile d’ob-
ferver ee qui diflingue la fynecdoque de la métonymie.
C’eft,
i° . Que la fynecdoque fait entendre le plus par un
mot qui dans le fens propre fignifie le moins ; ou au
au contraire elle fait entendre le moins par un mot qui
dans le fens propre marque le plus.
2°. Dans l’une & l’autre figure il y a une relation
entre l’objet dont on veut parler, & celui dont on
emprunte le nom ; car s’il n’y avoit point de rapport
entre ces objets,il n’y auroit aucune idée acceffoire,
& par conféquent point de trope : mais la relation
qu’il y a entre les objets , dans la métonymie, eft de
telle forte , que l’objet dont on emprunte le nom,
fubfifte indépendamment de celui dont il réveille l’idée
, & ne forme point un enfemble avec lui ; tel eft
le rapport qui fe trouve entre la caufe & Veffet, en-
tref £ auteur & fon ouvrage , entre Cerès &1 eblé, entre
le, contenant & le contenu , comme entre la bouteille
&C le vin : au-lieu que la liaifon qui fe trouve entre
les., objets, dans la fynecdoque , fuppofe que ces objets
forment un enfemble, comme le tout6c \z partie;
leur union n’eft point un fimple rapport, elle eft plus
intérieure & plus indépendante. C ’eft ce qu’on peut
remarquer dans les exemples de l’une & de l’autre
de ces figures. Voyei T r o p e . £ E. R. M, B. )
SYNECPHONESE ou SYNÉRESE, f. f. {Gram.)
c’eft une figure de di&ion , par laquelle on fe débar-
rafl'e d’une lyllabe, fans rien retrancher des élemens
du mot ; ce qui fe fait en prononçant, d’un feul coup
de v o ix , deux fons confécutifs qui, dans l’ufage ordinaire
, fe prononcent en deux coups. C ’eft ainfi que
l’on trouve aureis en deux fyllabes longues, à la fin
d’un vers hexametre ; dépendent lychni laquearibus au-
rets : (Virg.) Juàdet pour fuâdet ; fuadet enim vejana
famés, ( id .) , &c. Voye[ la 'méthode latine de P . R.
Traite de la poéjîe latine, ch. iij. § . 5.
Les anciens grammairiens donnoient à cette figure
le nom de fynecpkonefe , lorfque l’une des deux
voyelles étoit entièrement fupprimée dans la prononciation
, & qu’elles faifoient une fauffe diphtongue;
comme dans alvearia, f i , pour le prononcer en
quatre fyllabes, on dit alvaria , de même que nous
difons J an au lieu Jean. Au contraire , ils l’appel-
loient fynérefe , lorfque les deux fons étoient confer-
vés & fondus en une diphtongue vraie, comme dans
cui, fi nous le prononçons de même.que notre mot
françois lui.
Mais comme nous ne fommes plus en état de juger
delà vraieprononciationdu latin,ni de difcerner entre
leurs vraies & leurs fauffes diphtongues, & que
ces termes font abfolument propres à leur profodie;
nous ferons mieux de les regarder comme fynonymes
par rapport à nous.
Synecphonefe vient de avv, cum, & du verbe iy.ipu-
yîcà, enuncio ; comme pour dire, duorum Jimul fono-
lurn enunciatio.
Synérefe vient aufîi de <rov, cum, & du verbe dipla,
capio ; comme fi l’on vouloit dire, duorum fonorum
complexio. {E. R . M. B .)
SYNGRAPHE,f. m. {Droitrom.)nom que lesRomains
donnoient aux billets, promeffes & obligations
qu’ils faifoient quand ils empruntoient de l’argent.
S Y N- Le Jyngraphe étoit fcellé de l’anneau du débiteur
où étoit gravé fon cachet ; c?eft dans ce fens que
l’affranchi deTrimalcion, qui querelle fi vivement
Afcylte & G iton, leur dit : « allons fur la bourfe
» emprunter de l’argent ; tu verras fi l’on n’a pas de la
» confiance en cet anneau ^quoiqu’il ne foit que de
» fer. f'oyei Pline, /. X X X I I I . c .j. (Z>. J.)
SYN N AD A , o r u m , ( Géog. anc.) ville de la
grande Phrygie,& voifine de celle de Docimia ou Do-
cimeum. Elle n’étoit pas grande du tems de Strabon ,
l. X I I . qui en parlant de cette ville dit, non magna
urbs. Il ajoute que le marbre de Synnada étoit en
grande réputation. Tite-Live & Ptolomée écrivent
aufîi Synnada au nombre pluriel.
Etienne le géographe rapporte, qu’on difoit qu’A-
camas errant après la guerre de T r o y e , arriva dans
la Phrygie; qu’y ayant trouvé le prince du pays affié-
gé par fes ennemis, il lui donna du fecours , & devint
maître d’une contrée où il bâtit cette ville. Il
ajoute qu’Acamas, pour peupler fa ville, raffembla
plufieurs Macédoniens venus de Grece , & qui s’é-
toient établis en Afie ; & que de ces gens ramaffés
pour demeurer en un même lieu, que dans la fuite les
habitans du voifmage corrompirent en celui de Synnada
, on donna d’abord à la v ille le nom de Synnaa ;
on trouve le mot stn naae&n fur diverfes médailles
anciennes. Plufieurs auteurs écrivent encore le nom
de cette ville Synnas , adis ; de ce nombre eft Martial
, livre IX . épigranime y 6.
De marmot e omni, quod Caryjlos invenit
Quod Phrygia Synnas, Afra quod nomas mittit.
Prudence, adv. Symmach. I. II. v. 2 4 (T. fuit la même
ortographe.
E t qua fa x a Parosfecat, & qua punica rilpes,
Qua viridis Lacedcemon habetynaculofaque Synnas.
Stace , /. I. Silvar. Garn. V. v. g (T. dit aufîi :
Sola nitetflavis Nomadum accifa metallis
Purpura, fola cavo Phrygia quarn Synnados aurû
Ipfe cruentavit maculis lucentibus Atys. "
Ces témoignages nous font voir que la ville de
Synnada, fourniffoit un marbre précieux & tacheté.
Ce marbre étoit blanc avec des taches rouges, ou
couleur de pourpre, comme le remarque Pline, liv.
X X X V , ch.j. qui au liv. V. ch. xxix. écrit Synnada
, dat., & donne cette ville pour le lieu où fe faifoient
les affemblées générales de la province. Si
cela eft, il falloit que quoique très-petite , elle fut
confidérable ; car les Romains né mettoient les tribunaux
que dans les villes de quelque importance.
Dans la fuite on vit Synnada, capitale de la Phrygie
falutaire, & métropole de la province. {D . J . )
SYNNEMENON , adj. en Mujîque ; c ’eft le nom
que donnoient les Grecs à leur troifieme tétracorde,
quand il étoit conjoint avec le fécond, & divifé d’avec
le quatrième. Quand, au contraire, il étoit conjoint
au quatrième & divifé d’avec le fécond, ce même
tétracorde prenoit le nom de die^eugmenon. Voyeç
aufîi ce m ot, voyez aufîi T é t r a c o r d e , S y s t è m e .
(51)
SYNNEMENON DIATONOS , étoit dans Cancienne
Mujîque, la troifieme corde du tétracorde fyn-
nemenon dans le genre diatonique ; & comine cette
troifieme corde étoit la même que la fécondé corde
du tétracorde disjoint, elle portoit aufîi le nom 3e
tritedieçeugmenon. Voye^ T R IT E , S Y S T EM E , T É t RA-
CORD-e .
Cette même corde, dans les deux autres genres
prenoit le nom du genre où elle étoit employée ,
mais alors elle ne fe confondoit pas avec.la trite dié-
zeugmenon. Voye^ G e n r e . (S)
SYNNEVROSE, f. f. (Anat.) eft une efpece de
fyinphyfe ou d’union des os. Voye^.Symphy se. Ce
■ r
S Y N mot eft formé du grec <Sw-, avec , ôC.yevpop, nerf j ligament.
Yzfynnevrofe eft îa liaifon des os par un ligament :
c’eft ainfi que le fémur eft joint à l’os ifchium, la rotule
au tibia. Voye{ Ligament;
SYN O D Â L , adj. {Jurifprud.) fe dit de ce qui eft
relatif au fynode, comme un ftatut fynodaf une or-
donance fynodale , c’ eft-à-dire, qui eft émanée du
fynode; Voye^ Synode. ( A )
SYNODALES , 1épurés , terme dihiJloirc eccléfiaf ique,
étoient des lettres circulaires écrites par le fynode
aux prélats abfens, ou lettres générales adreffées à
tous les fideles, pour les informer de ce qui s’eft paffé
dans le fynode.
Dans le recueil des conciles, dri trouvé une gratifie
quantité de Ces lettres fynodales. Voye^ C oncile.
Syn odaux > têmoins|, terme dkijloirè eccU-
Jîaftique, étoit le nom que l’on donnoit autrefois aux
doyens des villes & aux doyens ruraux, parce qu’ils
faifoient des informations, & rendoient compte dans
le fynode épifcopal des defordres qui regnoient parmi
le cierge & le peuple. Voyeç D o yen .
. Après que ceux-ci furent déchus de leur autorité f
on les remplaça par une autre forte de témoins fyno-
daux, qui reffembloient à des jurés; c’étoit un prêtre
& deux ou trois laïques députés de chaque paroiffe :
enfuite on commença de nommer deux de ces jurés
pour chaque diocèfe ; & enfin cet office fut conféré
aux marguilliers ou anciens du confiftoire.
SYNODATIQUE, adj* {Jurijpi) eft le droit que les
curés & les abbés qui font obligés d’affifteraux fyno-
des des évêquesyétoient tenus de leur payer : on l’ap-
pelltfynodatique parce qu’il fe payoit ordinairement
dans le fynode,& cathédratique, parce qu’il fe payoit
pro honore cathedra,
Hincmar, archevêque de Reims, reprend plufieurs
évêques,qui convoquoient de fréquens fynodes pour
percevoir plus fouverit ee droit*
Quelques-uns prétendent que ee droit eft le même
que celui qu’on appelloit circada ; mais d’autres
tiennent que celui-ci eft le même que le droit de procuration.
Quoi qu’il en foit de l ’identité de ces deux droits f
l’ufage des fynodatiques eft très-ancien dans l’Eglife.
Le concile de Braga, en 572, en parle comme d’iin
ufage déjà ancien qiii l’autorife.
Ce réglement fut confirmé au feptiettie concile de
iTolede, en 646.
Gratien, dans fon decret, rapporte plufieurs décrions
des conciles & des papes fur cette matière.
Suivant un capitulaire de Charles le Chauve, en
844 , il etoit au choix de l’évêque de percevoir le
droit en deniers ou en argent*
Quelques évêques l’ayant voulu augmenter, le
concile de Châlon-fur-Saône ,en 813 , leur défendit
de le faire*
Le pape Honoré III. écrivant à l’évêque d’Affife
confond le cathédratique & le fynodatique , & lé
met au nombre des droits dûs à l’évêque dans les éd ifies
fôumifes à fa jurifdiéfion ; il fixe ce droit à deux
fols, qui fe payoient fur le pié que la monnoie étoit
lorfque le droit avoit été établi, à moins qu’il n’y eût
quelque accord au contraire.
Suivant ce qu’en dit Innocent III. ce droit n’é-
foit pas par-tout le même, & fe payoit ailleurs qu’au
fynode.
Le concile de Bourges, en 1584, ordonna que le
droit de cathédratique' & autres feroient payes par
tous eccléfiaftiques lans diftinâion,à peine d’excom-
Jnumcatiort, & autres pourfuites extraordinaires.
Le paiement en fut auffi ordonné par l’aflemblée
fie Melun en 1579'.
Dans les derniers fiecles, ce droit ayant été con-
Tome XV*
S Y N 755
ièftea plufieurs evêquëS ; la percèptioii én a été négligée
dans plufieurs diocèfes;
Dans l’âflèmblée du clergé de r ô o i , ce droit fut
réclamé par l’évêque d’Autun; & en t(Î65 ie clergé
fit des remontrances pour la cônfervatioh de cé
droit & autres qü’on refufoit de payer aux évê-
qiies. Le roi répondit, qu’il voulôit qii’ils- leurs
fullent conferves ; mais qu’ils fe contenteroient dè
ce que leur attribuoit l’article 26 de l’ordonnance dé
Blois.
» , 7 ;-- ---- , I l WLdUllL
que les cures dévoient affiftër au fynode, mais qu’ils
n’etoient tenus de payer pour cela aucune choféi
Voye^ les mémoires du clergé. {A)
SYNODE, f. m. terme dont ort fe fervoit autrefois
dans 1 ancienne AJlrohômi’e, poiir marquer la conjonction
de deux ou dé plüfietirs étoiles ou planètes
dans le meme lieu du ciel. Voye^ C onjonction;
Cë mot eft formé du grec cW<Tcç ; affaiblie ; & Ü
eft eompqfe de <rov ; avec , & IS'oç, voie Ou chemin.
C eft de-là qu’on dit le mois fynodique de la lune ;
pour defigner l’intervalle entre deux conjonâionS
fucceffivés de là lune au foleil; Cette derniere ex-
prelîion eft reftee, & celle dé fynode a vieilli. {O)
Synode , {Jurifprud.) fignifie en général Une af-
femblèe de CEglife.
Quelquefois le terme de fynode eft pris pour une
aflemblée de l’Eglife univerfeHe oü concile écuméni-
que, quelquefois pour urt concile^ national oü provincial.
Voye[ Concile.
Il y a plufieurs fortes de fynodes.
Synode de l'archidiacre, eft la convocation quë
l’archidiacre fait devant lui de tous les curés dé la
campagne dans le diocèfe de Paris ; il fe tient le mercredi
d’après le fécond dimanche de Pâques.
Synode de l'archevêque, eft celui qile tient l’ârcîlè-
veque dans fon diocèfe propre, comme chaque évê^
que dans le fien. V7ye[ Synode épiscopal.
Synode du grand-chantre , eft celui que le chanîfe
de la cathédrale tient pour les maîtres & maîtreffés
d’école*
Synode diocèfaih, eft celui auquel font convoqués
tous les curés & autres eccléfiaftiques d’un meme
diocèfe* Vûye^ci-aprïs Synode ÉPISCOPAL.
Synode épifcopal ou de C évêque , eft la même chofé
que fynode diôcéfain ; l’objet de Ces affemblées eft dé
faire quelques réglemens & quelques réformationS
pour conferver la pureté des moeurs*
Les conciles d’Orléans & de Vernon ordonnent la
convocation Aes jynodes toits les ans, & que tous les
prêtres , même les abbés, feront tenus d’y affiftër.
Le concile de Trente ordonné auffi la tenue dit
fynode dio’céfain tous les ans, auquel doivent affiftër
les exempts , qui ne font point fous chapitres généraux
, & tous ceux qui font chargés du gouvernement
des églifes paroiffiales, ou autres féculiefes,- même
annexes.
Ces affemblées fe faifoient même anciennement
deux fois l’année au mois de Mai, & au calendes dé
Novembre*
Les Curés des paroiffes qui dépendent des abbayes
& ordres exempts, ne font pas difpenfés d’affifter
au fynode de l’évêque, n’étant pas exempts de fa jm-
rifdiéfion*
Le réglement de l’affemblée dè Melun, en 1579,=
ordonne aux Curés qui viennent au fynode, de déférer
à l’évêque le nom de leurs paroiffiens coupables
dé crimes publics, afin que le fynode y pourvoie.
Voye^les mémoires du clergé.
Synode national, eft celui qui comprend le clergé'
de toute une nation. Voyt{ C oncile nat ion al.
Synode de l'official, eft celui que tient Pôfficia‘1, oÙ
il convoque tous les curés de la ville, fauxbourgs Sé
G G c e e ij •