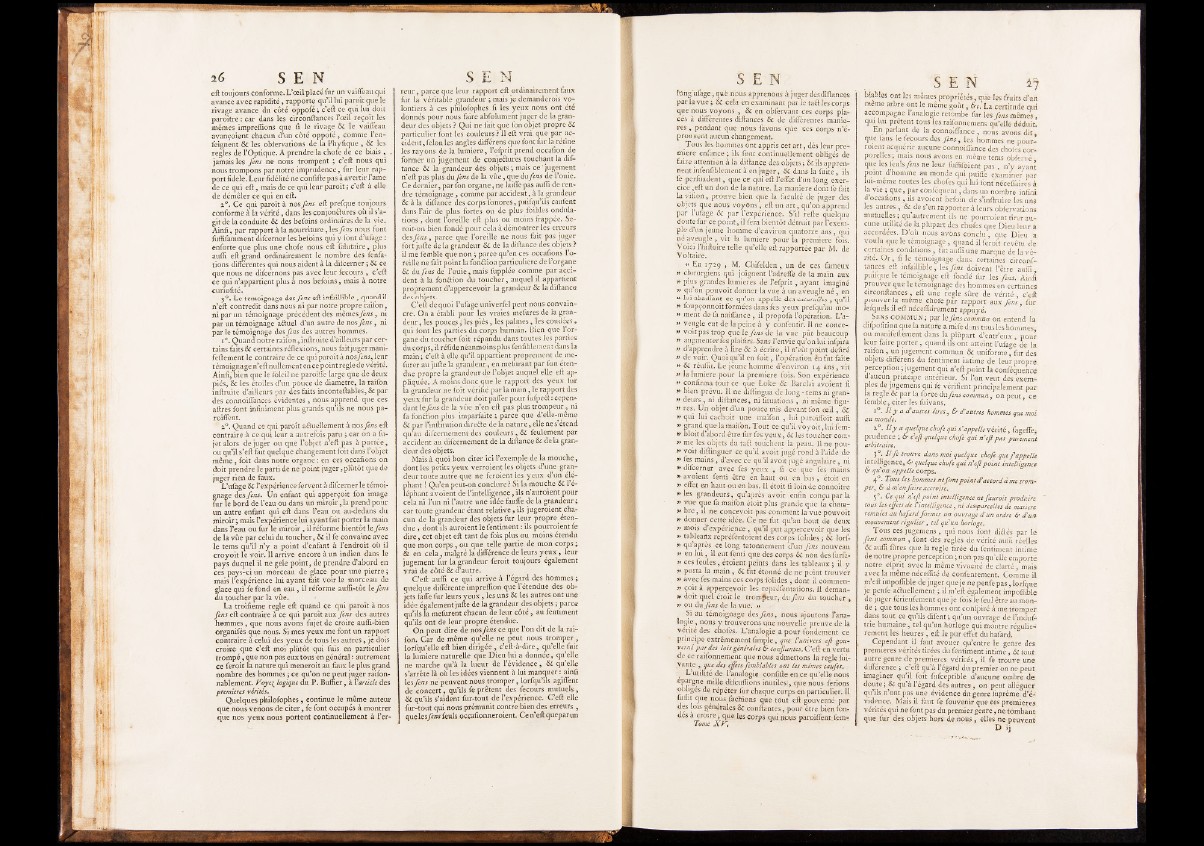
eft toujours conforme. L’oeil placé fur un vaifleau qui
avance avec rapidité, rapporte qu’il lui paroît que le
rivage avance du côté oppofé ; c’eft ce qui luÿ doit
paroître : car dans les circonftances l’oeil reçoit les
mêmes impreflions que li le rivage & le vaifleau
avançoient chacun d’un côté oppofe, comme l’en-
l'eignent & les obiervations de la Phyfique , & les
réglés de l’Optique. A prendre la choie de ce biais , ,
jamais les fens ne nous trompent ; c’elt nous qui
nous trompons par notre imprudence, fur leur rapport
fidele. Leur fidélité ne confifte pas à avertir l’ame
de ce qui e ft , mais de ce qui leur paroît ; c’eft à elle
de démêler ce qui en eft.
2°. Ce qui paroît à nos fens eft prefque toujours
conforme à la vérité, dans les conjonctures oii il s’agit
de la conduite & des befoins ordinaires de la vie.
Ainfi, par rapport à la nourriture, les fens nous font
fuffifamment difcerner les befoins qui y font d’ufage :
enforte que plus une chofe nous eft falutaire, plus
aufli eft grand ordinairement le nombre des fenfa-
tions différentes qui nous aident à la difcerner ; & ce
que nous ne difcernons pas avec leur fecours , c ’eft
ce qui n’appartient plus à nos befoins, mais à notre
curiofité.
3°. Le témoignage des fens eft infaillible, quand il
n’eft contredit dans nous ni par notre propre raifon,
ni par un témoignage précédent des mêmes fens, ni
par un témoignage aCtuel d’un autre de nos fens, ni
par le témoignage des fens des autres hommes.
i° . Quand notre raifon, inftruite d’ailleurs par certains
faits & certaines réflexions, nous fait juger manir
feftement le contraire de ce qui paroît à no s fens, leur
témoignage n’eft nullement en ce point réglé de vérité.
Ainfi, bien que le foleil ne paroifie large que de deux
piés, & les étoiles d’un pouce de diamètre, la raifon
inftruite d’ailleurs par des faits inconteftables, & par
des connoiffances évidentes , nous apprend que ces
aftres font infiniment plus grands qu’ils ne nous pa-
roiffent.
* 2°. Quand ce qui paroît actuellement à nos fens eft
contraire à ce qui leur a autrefois paru ;.car on a fu-
jet alors de juger ou que l’objet n’eft pas à portée,
ou qu’il s’eft fait quelque changement foit dans l’objet
même, foit dans notre organe : en ces ocçafions on
doit prendre le parti de ne point juger , plutôt que de
juger rien de faux.
L’ufage & l’ expérience fervent à difcerner le témoignage
des fens. Un enfant qui apperçoit fon image
Fur le bord de l’eau ou dans un m iroir, la prend pour
un autre enfant qui eft dans l’ eau ou au-dedans du
miroir ; mais l’expérience lui ayant fait porter la main
dans l’eau ou fur le miroir, il réforme bientôt le fens
de la vûe par celui du toucher, & il fe convainc avec
le tems qu’il n’y a point d’enfant à l’endroit oîi il
croyoit le voir. Il arrive encore à un indien dans le
pays duquel il ne gele point, de prendre d’abord en
ces pays-ci un morceau de glace pour une pierre ;
mais l’expérience lui ayant fait voir le morceau de
glace qui fe fond en eau, il réforme aufli-tôt le fens
du toucher par la vûe.
La troifieme réglé eft quand çe qui paroît à nos
fens eft contraire à ce qui paroît aux fens des autres
hommes, que nous avons fujet de croire aufli-bien
organifés que nous. Si mes yeux me font un rapport
contraire à celui des yeux de tous les autres, je dois
croire que c’eft moi plutôt qui fuis en particulier
trompé, que non pas eux tous en général : autrement
ce feroit la nature qui meneroit au faux le plus grand
nombre des hommes ;c e qu’on ne peut juger raifon-
nablement. Voye{ logique du P. Buffier, à Xarticle des
premières ventes.
Quelques philofophes, continue le même auteur
que nous venons de citer, fe font occupés à montrer
que nos yeux nous portent continuellement à l’erreur
, parce que leur rapport eft ordinairement faux
fur la véritable grandeur ; mais je demanderais volontiers
à ces philofophes fi les yeux nous ont été
donnés pour nous faire abfolument juger de la grandeur
des objets ? Qui ne fait que fon objet propre &C
particulier font les couleurs ? Il eft vrai que par accident
, félon les angles différens que font lur la rétine
les rayons de la lumière, l’efprit prend occafion de
former un jugement de conjectures touchant la distance
& la grandeur des objets ; mais c e ’ jugement
n’eft pas plus du fens de la vû e, que du fens de l’ouie.
Ce dernier, par fon organe, ne laiffe pas aufli de rendre
témoignage, comme par accident, à la grandeur
& à la diftance des corps fonores, pwifqu’ils caufent
dans l’air de plus fortes ou de plus- foibles ondulations
, dont l’oreille eft plus ou moins frappée. Se-
roit-on bien fondé pour cela à démontrer les erreurs
des fens, parce que l’oreille ne nous fait pas juger
fort jufte de la grandeur & de la diftance des objets ?
il me femble que non ; parce qu’en ces occafions l’oreille
ne fait point la fonction particulière de l’organe
& du fens de l’ouie, mais fupplée comme par accident
à la fonction du toucher, auquel il appartient
proprement d’appercevoir la grandeur & la diftance
des objets.
C ’eft de quoi l’ufage univerfel peut nous convaincre.
On a établi pour les vraies mefures de la grandeur
, les pouces ,* les piés, les palmes, les coudées,
qui font les parties du corps humain. Bien que l’organe
du toucher foit répandu dans toutes les parties
du corps, il réfide néanmoins plus fenfiblement dans la
main; c’eft à elle qu’il appartient proprement de me-
furer au jufte la grandeur, en melurant par fon étendue
propre la grandeur de l’objet auquel elle eft appliquée.
A moins donc que le rapport des yeux fur
la grandeur ne foit vérifié par la main, le rapport des
yeux fur la grandeur doit paffer pour fufpeCt: cependant
le fens de la vûe n’en eft pas plus trompeur, ni
fa fonction plus imparfaite ; parce que d’elle-même
& par l’inftitution direCte de la nature, elle ne s’étend
qu’au difcernement des couleurs, &; feulement par
accident au difcernement de la diftance &c delà grandeur
des objets.
Mais à quoi, bon citer ici l’exemple de la mouche,
dont les petits yeux verroient les objets d’une grandeur
toute autre que ne feroient les yeux d’un éléphant
! Qu’en peut-on conclure? Si la mouche & l’éléphant
avoient de l’intelligence, ils n’auroient pour
cela ni l’un ni l’autre une idée fauffe de la grandeur ;
car toute grandeur étant relative, ils jugeroient chacun
de la grandeur des objets fur leur propre étendue
, dont ils auroient le fentiment : ils pourroient fe
dire, cet objet eft tant de fois plus ou moins étendu
que mon corps , ou que telle partie de mon corps ;
& en cela, malgré la différence de leurs y e u x , leur
jugement fur la grandeur feroit toujours egalement
yrai de côté & d’autre.
C’eft aufli ce qui arrive à l’égard des hommes ;
quelque différente impreflion que l’étendue des objets
faffe fur leurs y e u x , les.uns & les autres ont une
idée également jufte de la grandeur des objets ; parce
qu’ils la mefurent chacun de leur côté, au fentiment
qu’ils ont de leur propre étendue.
On peut dire de nos fens ce que l’on dit de la raifon.
Car de même qu’elle ne peut nous tromper ,
lorsqu’elle eft bien dirigée, c’eft-à-dire, qu’elle fuit
la lumière naturelle que Dieu lui a donnée, qu’elle
ne marche qu’à la lueur de l’évidence, &: qu’elle
s’arrête là ou les idées viennent à lui manquer : ainfi
les fens ne peuvent nous tromper, lorfqu’ils agiffent
de concert, qu’ils fe prêtent des fecours mutuels,
& qu’ils s’aident fur-tout de l’expérience. C’eft elle
fur-tout qui nous prémunit contre bien des erreurs ,
queles/àwfeuls occafionneroient. Cen’eftqueparun
tong'ufage ; què nous apprenons à juger dèsdiftances
par la vue ; & cela en examinant par le tad les corps
que nous voyons , & en obfervant ces corps placés
à différentes diftances & de différentes manières.,
pendant que nous favons que ces corps n’éprouvent
aucun changement.
Tous les hommes ont appris cet a rt, dès leur première
enfance ; ils font continuellement obligés de
faire attention à la diftance des objets ; & ils apprennent
infenfiblement à en juger, & dans la fuite, ils
fe perfuadent, que ce qui eft l’effet d’un long exercice
,eft un don de la nature. La maniéré dont fe fait
lavifion, prouve bien que la faculté de juger des
objets que nous voyons , eft un art, qu’on apprend
par l’ufage & par l’expérience. S’il refte quelque
doutefur ce point, il fera bientôt détruit par l’exemple
d’un jeune homme d’environ quatorze ans, qui
né aveugle , vit la lumière pour la première fois.
Voici l’hiftoire telle qu’elle eft rapportée par M. de
Voltaire.
« En 1729 , M. Chifelden, un de ces fameux
» chirurgiens qui joignent l’adrefle de la main aux
» plus grandes lumières de l’efprit, ayant imaginé
» qu’on pouvoir donner la vue à un aveugle n é , en
» lui abaiflant ce qu’on appelle des cataractes , qu’il
» foupçonnoit formées dans fes yeux prefqu’au mo-
y> ment de fa naiflance , il propofa l’opération. L’a-
» veugle eut de la peine à y confentir. Il ne conce-
» voit pas trop que le fens de la vue pût- beaucoup
» augmenter les plaifirs. Sans l’envie qu’on lui infpira
» d’apprendre à lire & à écrire, il n’eût point defiré
» de voir. Quoiqu’il en fo it , l’opération en fut faite
» & réuftit. Le jeune homme d’environ 14 ans, vit
y* la lumière pour la première fois. Son expérience
» confirma tour çe que Loke & Bardai avoient fi
» bien prévu. Il ne diftingua de long - tems ni gran-
» deurs , ni diftances, ni fituations , ni même figu-
» res. Un objet d’un pouce mis devant fon oe i l , &
» qui lui cachoit une inaifon , lui paroifloit aufli
» grand que la maifon. Tout ce qu’il v oyoit, lui fem-
» bloit d’abord être fur fes yeux, & les toucher corr.-
» me les objets du taû touchent la- peau. Il ne pou-
» voit diftinguer ce qu’il avoit jugé rond à l’aide de
» fes mains, d’avec ce qu’il avoit jugé angulaire, ni
» difcerner avec fes yeux , fi ce que fes mains
» avoient fenti être en haut ou en bas, étoit en
» effet en haut ou en bas. Il étoit fi loin de connoître
» les grandeurs, qu’après avoir enfin conçu par la
» vue que fa maifon étoit plus grande que fa charn-
» bre, il ne concevoir pas comment la vue po.uvoit
» donner cette idée. Ce ne fut qu’au bout de deux
» mois d’expérience, qu’il put appercevoir que les
» tableaux repréfèntoient des corps foliées ; & lorf-
» qu apres ce long tâtonnement d’un fens nouveau
» en lu i, il eut fenti que des corps & non des furfa*
» ces feules, étoient peints dans les tableaux ; il y
» porta la main , & fut étonné de ne point trouver
» avec fes mains ces corps folides , dont il çomrnen-
» çoit à appercevoir les. repréfentations. Il demari-
» doit quel étoit le trompeur, du fens du toucher *
» ou du fens de la vue. » Kg
Si au témoignage des fens, nous ajoutons l’âna-
l°gie > nous, y trouverons une nouvelle preuve de la
vérité des chofes. L’analogie a pour fondement ce
principe extrêmement fimple, que, Ç univers e f gouverne
par des lois générales & confiantes. C ’eft en vertu
de ce raifonnement que nous admettons la réglé Suivante
, que des effets femblab,les ont les mêmes caufts.
L’iutilité de l’analogie confifte en ce qu’elle nous
-épargné mille difcuflïons inutiles* , que nous ferions
obligés de répéter fur chaque corps en particulier. Il
iufnt que nous fâchions que tout eft gouverné par
des lois générales & confiantes., -pour être bien fonr
des à croire j que lés corps qui.uous paroiffent fem-r
Tome X V i
biables ont les mêmes propriétés, que les fruits d’un
meme arbre ont le même goût, &c. La certitude qui
accompagne l’analogie retombe fur les fins mêmes ,
qui 1m prêtent tous ies raifonnemens qu’elle déduit,
En parlant de la connoilfance , nous avons dit,
que fans le fecours des f in s , les hommes ne pourraient
acquérir auainejconnoilfance des chofes cori
pqrelfqs ; mais nous avons en même tems obfervé •
que ies i"«\!s/t/« ne leur fuffifoient pas , n’y ayant
point d’homme au monde qui puifle examiner par
lui-même toutes les chofes qui lui font néceflaires à
fe vie i <pe . par eonfequent;, dans un nombre infini
d’oçfflûons , lis avoient befoin de s’inftruire les uns
les autres, & de s’en rapporter à leurs obfervations
mutuelles ; qu autrement ils ne pourroient tirer aucune
utilité de là plupart des chofes que Dieu leur a »
accordées D ou nous avons conclu , que Dieu a
voulu que le témoignage , quand il feroit revêtu de
certaines conditions , fut aufli une marque de la vé-i
îite. O r , fi lë témoignage dans certaines cireor.f-
tances eft infaillible, les fins doivent l’être aufli ,
puifque le témoignage eft fondé fur les fins. Ainfi
prouver que le témoignage des hommesen certaines
dirconftances , eft une réglé sûre de vente , c eft
prouver la même choie par rapport aux f in s , fur
iefquels il eft néc.eflairement appuyé.
S !:. N S lié) M M c N J par le fins cami/sttn on entend là
dïfpafiïipA queia natuie a rnife dans tous les hdmmes;
ou manifellement dans ia plupart d’entr’eux , pour
leur faire porter, quand ils oni atteint l’üiage de la
raifon, un jugement commun & uniforme, fur des
objets différens du fentiment intime de leur propre
perception ; jugementiqui n’eft point la conféquencë
d’aucun .principe antérieur. Si l’on veut des exemc
plesde jugement qui fe vérifient principalement par
ia r é g lé e par la force du fins commun, on peut, ce
femble, citer les fuivans.
i°. IL y a d autres êtres, & d'autres hommes que moi
au monde.
20. Il y a quelque chofe qui s'appelle vérité, fagefle*
prudence J 6* cejl quelque chofe qui n'eflpas purement,
arbitraire.
30. I l fe trouve dans moi quelque chofe que ƒ 'appelle
intelligence, & quelque chofe qui n'efl point intelligence
& qu'on appelle corps.
40. Tous les kommes nèfont point d'accord à me tromper,
& a m'en faire accroire.
- 50* qUL n e f point intelligence ne fauroit produire
tous les effets de l'intelligence, ni de&parcelles de matière
remuées au hafard former un ouvrage d'un ordre & d'un
mouvement régulier , tel qu'un horloge.
Tous ces jugemens , qui nous font difiés par le
fens commun , font des réglés de vérité aufli réelles
& aufli fûres que la réglé tirée du fentiment intime
de notre propre perception ; non pas qu’elle emporté
notre efprit avec la même vivacité de clarté, mais
avec la même néceflité de confentement. Comme il
m’ eft impoflible déjuger que je ne penfe pas, lorfqite
je penfe actuellement ; il m’efi également impoflible
de juger férieufement que jé fois le feul être au monde
; que tous les hommes ont confpiré à me tromper
dans tout ce qu’ils difent ; qu’un ouvrage de l’induf-
trie humaine, tel qu’un horloge qui montre régulièrement
les heures , efi le pur effet du hafard.
Cependant il faut avouer qu’entre le gefire des
premières vérités tirées du fentiment intime ,• & tout
autre genre de premières vérités,- il fe trouve une
différence ;• c’ eft qu’à l’égard du premier on ne peut
imaginer qu’il foit fufceptible d’aucune ombre de
doute ; & qu’à l’égard des autres , on peut alléguef
qu’ils n’ont pas une évidence dit genre fuprème d’évidence.
Mais il faut fe fouvenir que ées premières
vérités qui ne font pas du premier genre, ne tombant
que fur des objets hors de nous* elles ne peuvent
d ij