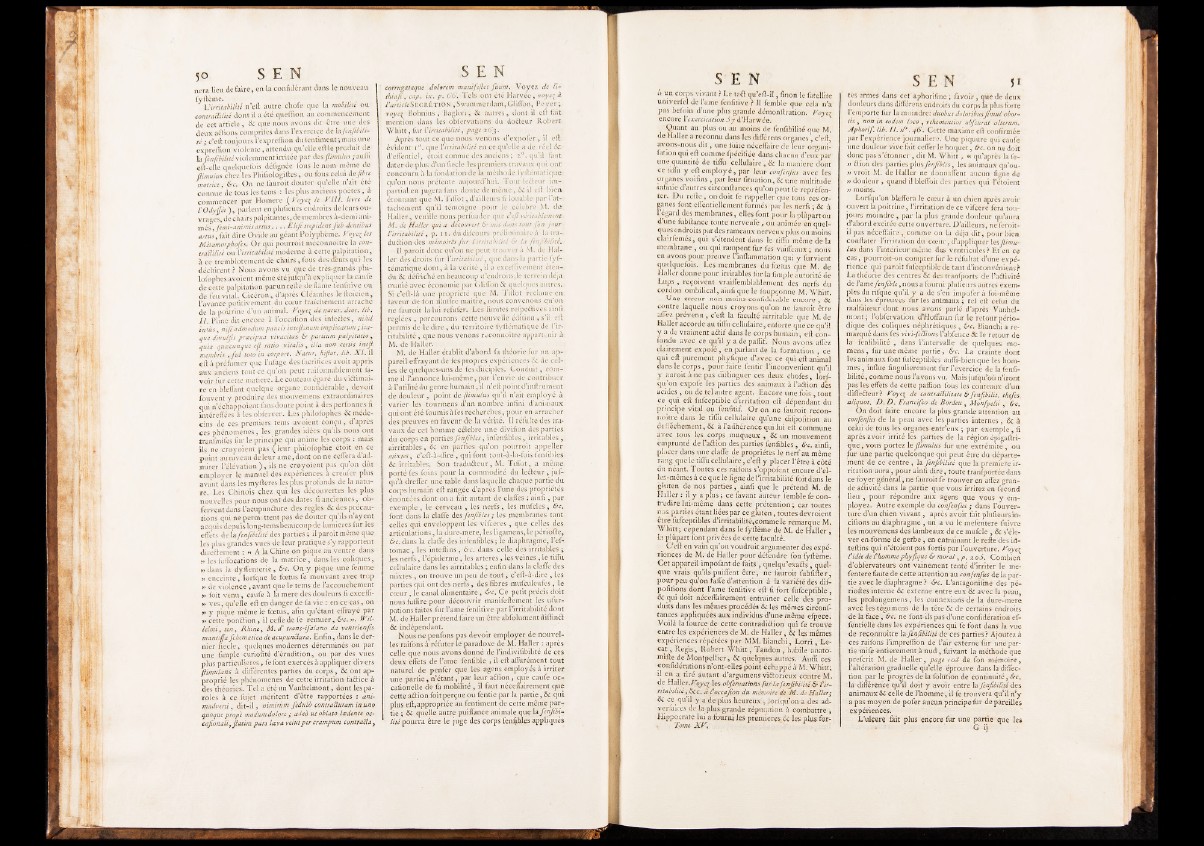
Il
50 S E N
nera Heu de faire, en la confidérant dans le nouveau
fyftème.
L'irritabilité n’eft autre chofe que la mobilité ou
contractilité dont il a été queftion au commencement
de cet article, 6c que nous avons dit être une des
deux avions, compril'es dans l’exercice de lafenfibili-
té • c’eft toujours l’expreflion du fentiment ; mais une
expreflion violente, attendu qu’elle eft le produit de
la fenfibilité violemment irritée par des /limulus ; aufU
eft-elle quelquefois défignée fous le nom même de
(limulus chez les Phifiologiftes, ou fous celui^de fibre
motrice, &c. On ne fauroit douter qu’elle n’ait été
connue de tous les tems : les plus anciens poètes, à
commencer par Homere ( Voyt[ le VIII. livre de
lOdyjJét'), parlent en plufteurs endroits de leurs ouvrages,
de chairs palpitantes, de membres à-demi mp
més, femi-animis artus. . ..E lif i trépident fub dentibus
anus, fait dire Ovide au géant Polyphénie. Voy&i les
Mécamorphofes. Or qui pourroit méconnoître la contractilité
ou l’irritabilité moderne à cette palpitation,
à ce tremblotement de chairs , fous des dents qui les
déchirent ? Nous avons vu que de très-grands philosophes
avoient même étéjufqu’à expliquer la caufe
de cette palpitation par un refte deflame ienfitive ou
de feu vital. Cicéron, d’après Cléanthes le ftoïcien,
l’avance pofitivenient du coeur fraîchement arraché
de la poitrine d’un animal. Voye{ de natur. deor. lib.
JI. Pline dit encore à l’occafxon des infe&es, nihil
intus, ni fi admodum paucis intejhnum irnplicatum ; ica-
que divuljis proecipua vivacitas & parùum palpitatio ,
quia qucecunque efl ratio vita/is, ilia non certis inejl■
membres ,fcd toto in corpore. Natur. hijlor. lib. X L 11
eft à préfumer que l’ufage des iacrifices avoit appris
aux anciens tout ce qu’on peut raifonnablement lavoir
fur cette matière. Le couteau égaré du vi&imai-
re en bleffant quelque organe conliderable, devoit
fouvent y produire des mouvemens extraordinaires
qui n’échappoient fans doute point à des perlonnes fi
intéreffées à les obferver. Les philofophes 6c médecins
de ces premiers tems avoient conçu, d’apres
ces phénomènes, les grandes idées qu’ils nous ont
tranfmifes fur le principe qui anime les corps : mais
ils ne croyoxent pas ( leur philofophie etoit en ce
point au niveau de leur ame,dont on ne ceffera d’admirer
l’élévation ) , ils ne croyoient pas qu’on dût
employer le manuel des expériences à creufer plus
avant dans les myfteres les plus profonds de la nature.
Les Chinois chez qui les découvertes les plus
nouvelles pour nous ont des dates fi anciennes, ob-
fervent dans l’acupun&ure des réglés 6c des précautions
qui ne permettent pas de douter qu ils n ayent
acquis depuis long-tems beaucoup de lumières fur les
effets de fenfibilité des parties ; ilparoîtmême que
les plus grandes vues de leur pratique s’y rapportent
directement : « A la Chine on pique au ventre dans
» lesfufFocations de la matrice, dans les coliques,
» dans la dyffenterie, &c. On y pique une femme
» enceinte, lorfque le foetus fe mouvant avec trop
» de violence, avant que le tems de l’accouchement
» l'oit venu, caufe à la mere des douleurs fi excelïi-
» v e s, qu’elle eft en danger de la vie : en ce cas, on
» y pique même le foetus, afin qu’étant effraye par
» cette ponttion, il ceffe de fe remuer, &c. ». Wil-
lélniï ten, Rhine, M. d'trans-ifalano da ventrienfis
mantiffa fchematica de acupunclura. Enfin, dans le dernier
fiecle, quelques modernes déterminés ou par
line fimple curiofité d’érudition, ou par des vues
plus particulières, fe font exercés à appliquer divers
flimulans à différentes parties du corps, 6c ont approprié
les phénomènes de cette irritation fa&ice à
des théories. Tel a été un Vanhelmont, dont les paroles
à ce fujet méritent d’être rapportées : ani-
madverti dit-il, niminim fedulb contracluram in uno
quoqiu propè modumdolore ; adeb ut oblato Icedcnte oc-
cajionaliyjlatim pars lava velutper crampum contracta,
S E N
corrttgataque dolortm manifeflet fuurn. Voyez de li-
thiaji, cap. ix. p. 66. -Tels ont été Harvéc, voyeç à
/W/ic/eSECRÉTiON ,S\vammerdam,Gli(fon, Peyer;-
voyez Bohnius , Baglivi, & autres, dont il eft fait
mention dans les oblervations du doèteur Robert
Whitt, fur l'irritabilité, page 2 63.
Après tout ce que nous venons d’expofer , il eft.
évident i° . que Y irritabilité en ce qu’elle a de réel 6c
d’eflènticl, etoit connue des anciens ; z°. qu’il faut
dater de plus d’un fiecle les premiers travaux qui ont
concouru il la fondation de la méthode fyftématique
qu’on nous prélente aujourd’hui. Tout leéteur impartial
en jugera fans doute de même, 6c il eft bien
étonnant que M.Tilfot, d’ailleurs li louable par Pat-•
tachement qu’il témoigne pour le célébré M. de.
Haller, veuille nous perluader que c’cjlvéritablement
M. de Haller qui a découvert 6* mis dan« tout fon jour
l'irritabilité, p. 11. dii difcours préliminaire A la traduction
des mémoires fur l irritabilité & la fenfibilité.
Il paroit donc qu’on ne peut trouver à M. de Haller
des droits fur l’irritabilité, que dans la partie fyf-,
tématique dont, à la vérité, il a excefliveihent éten-,
du 6c défriché en beaucoup cl’endroits,le terrein déjà
manié avec économie par Glilfon & quelques autres..
Si c’eft-là une propriété que M. Tiffot reclame en.
faveur de-fon illuftre maître, nous convenons qu’on
ne fauroit la lui refufer. Les limites refpe£tives ainfi.
réglées , parcourons cette nouvelle édition , s’il eft
permis de le dire , du territoire fyftématique de l’irritabilité
, que nous venons rcconnoître appartenir à
M. de Haller.
M. de Haller établit d’abord fa théorie fur un appareil
effrayant de les propres expériences 6c de celles
de quelques-uns de les difciples. Conduit, comme
il l’annonce lui-même, par l'envie de contribuer
à l'utilité du genre humain, il n’eft point d’inftrument
de douleur, point de (limulus qu’il n’ait employé à
varier les tourmens d’un nombre infini d'animaux
qui ont été fournis à les recherches, pour en arracher
des preuves en faveur de la vérité. Il réfulte des travaux
de cet homme célébré une divilion des parties
du corps en parties fenjibles, infenfibles, irritables ,
aïrritables, 6c en parties qu’on pourroit appeller
mixtes, c’eft-à-dire , qui font tout-à-la-fois fenfibles
6c irritables. Son traducteur, M. Tiflot, a même,
porté fes foins pour la commodité du leCteur , juf-
qu’à drelfer une table dans laquelle chaque partie du
corps humain eft rangée d’après l’une des propriétés
énoncées dont on a fait autant de dalfes ; ainfi , par
exemple , le cerveau , les nerfs , les, mufcles , 6c.
font dans la clalfe des fenjibles ; les ^membranes tant
celles qui enveloppent les vifeeres , que celles des
articulations, la dure-mere, les ligamens, le périofte,
&c. dans la claffe des infenfibles ; le diaphragme, l ’ef-
tomac, les inteftins, &c. dans celle des irritables ;
les nerfs, l’épiderme, les arteres, les veines , le tiffu
cellulaire dans les aïrritables ; enfin dans la claffe des
mixtes , on trouve un peu de tou t, c’ eft-à-dire , les
parties qui ont des nerfs , des fibres mufculeufes , le
coeur , le canal alimentaire, &c. Ce petit précis doit
nous fuffire pour découvrir manifeftement les ufur-
pations faites furl’ame fenfitive par l’irritabilité dont
M. de Haller prétend faire un être abfolument diftinCt
6c indépendant.
Nous ne penfons pas devoir employer de nouvelles
raifons à réfuter le paradoxe de M. Haller : après
celle que nous avons donné de l’indivifibilite de ces
deux effets de l’aroe fenfible , il eft affurément tout
naturel de penfer que les agens employés à irriter
une partie, n’étant, par leur aCtion, que caufe oc-
cafionelle de fa mobilité , il faut néceffairement que
cette aCtion foit perçue ou fentie par la partie, 6c qui
plus eft,appropriée au fentiment de cette même partie
; 6c quelle autre puiffance animale que la fenjîbi-
• lité pourra être le juge des corps fenfjbles appliqués
p i
S E N
îV un corps vivant ? Le taCt qu’eft-il, fînon le fatellîte
univerfel de l’ame fenfitive ? II femble que cela n’a
pas befoin d’une plus grande démonftration. Voyez
encore Vexercitation 5j d’Harwée.
Quant au plus ou au moins de fenfibilité que M.
de Haller a reconnu dans les différens organes, c’eft,
avons-nous d it , une fuite néceffaire de leur organi-
fation qui eft comme fpécifiée dans chacun d’eux par
une quantité de tiffu cellulaire, 6c la maniéré dont
ce tiffu y eft employé, par leur confenfUs avec les
organes voifins , par leur fituation, 6c une multitude
•infinie d’autres circonftances qu’on peut fe repréfen-
ter. Du refte , on doit fe rappeller que tous ces organes
font effentiellement formés par les nerfs ; 6c à
1 égai d des membranes, elles font pour la plupart ou
d’une fubftance toute nerveufe, ou animée en quelques
endroits par des rameaux nerveux plus ou moins
clairfemés, qui setendent dans le tiffu même de la
membrane , ou qui rampent fur fes vaiffeaux ; nous
en avons pour preuve l’inflammation qui y furvient
quelquefois. Les membranes du foetus que M. de
Haller donne pour irritables fur la fimple autorité de
Lups , reçoivent vraiffemblablement des nerfs du
cordon ombilical, ainfi que le foupçonne M. 'Vt'hitt.
Une erreur non moins confiderable encore, &
contre laquelle nous croyons qu’on ne fauroit être
affez prévenu , c’eft la faculté aïrritable que M. de
Haller accorde au tiffu cellulaire, enforte que ce qu’il
y a de vraiment aéfif dans le corps humain, eft confondu
avec ce qu’il y a de paflïf. Nous avons affez
clairement expofé, en parlant de la formation , ce
qui eft purement phyfique d’avec ce qui eft animal
dans le corps, pour faire fentir l ’inconvenient qu’il
y auroit à ne pas diftinguer ces deux chofes, lorf-
qu’on expofe les parties des animaux à l’aéfion des
acides , ou de tel autre agent. Encore une fois , tout
ce qui eft fufceptible d’irritation eft dépendant du
principe vital ou fenfitif. Or on ne fauroit recon-
noître dans le tiffu cellulaire qu’une difpofition au
deftechement, 6c à l’adhérence qui lui eft commune
avec tous les corps muqueux , 6c un mouvement
emprunté de l’aélion des parties fenfibles, &c. ainfi
placer dans une claffe de propriétés le nerf au même
rang que le tiffu cellulaire, c’eft y placer l’être à côté
du néant. Toutes ces raifons s ’oppofent encore d’elles
mêmes à ce que le figne de l’irritabilité foit dans le
gluten de nos parties, ainfi que le prétend M. de
Haller : il y a plus ; ce favant auteur femble fe contredire
lui-même dans cette prétention ; car toutes
nos parties étant liées par ce gluten, toutes devroient
êtrefufceptibles d’irritabilité,comme le remarque M.
Whitt; cependant dans le fyftème de M. de Haller
la plupart font privées de cette faculté.
■ C’eft en vain qu’on voudroit argumenter des expériences
de M. de Haller pour détendre fon fyftème.
Cet appareil impofant de faits , quelqu’exatts, quelque
vrais qu’ilsjpuiflent être, ne fauroit fubfifter,
pour peu qu’on faffe d’attention à la variété des dif-
pofitions dont l’ame fenfitive eft fi fort fufceptible ,
& qui doit néceffairement entrainer celle des produits
dans les mêmes procédés & les mêmes circonftances
appliquées aux individus d’une même efpeee.
Voilà lafource de cette contradiftion qui fq trouve
entre les expériences de M. de Haller, 6c Iqs mêmes
expériences répétées par MM. Bianchi, Lo r r i, Le-
c a t , Regis, Robert Whitt, Tandon , habile anato-
mifte de Montpellier, & quelques autre?. Auffî ces
confidérations n’ont-elles point échappé à M. Whitt;
il en a tiré autant d’argumens viftorieux contre M.
de Haller, Voyeç les obfervathns fur-la fenfibilité & tirritabilité
, 6cc. à l'occafion du mémoire de M. de Haller;
6c ce qu’il y a de plus heureux, iorfqu’on a des: acl-
verfaires de la plus grande réputation à combattre ,
Hippocrate lui a fourni les premières 6c les plus for-
. Tome XV\
S E N 5t
tes armes dans cet- aphorifmc ; favôir, que de deux
douleurs dans différens endroits du corps la plus forte
l’emporte fur la moindre: duobus doloribusfimul obor-
tts, non in codent loco , vehementior bbfcurât alterum,
Aphorif lib. //. n°. 46. Cette maxime eft confirmée
par l'expérience journalière. Une piquure qui caufe
une douleur vive fait cefler le hoquet, 6c. on ne doit
donc pas s’étonner , dit M. Whitt, « qu’après la fe-
» ftion des parties plus fenfibles, les animaux qu’ou-
» vroit M. de Haller ne donnaffent aucun figne de
» douleur , quand il bleffoit des parties qui l’etoient
» moins.
Lorfqu’on bluffera le coeur à un chien après avoir
ouvert la poitrine, l’irritation de ce vifeere fera toujours
moindre , par la plus grande douleur qu’aura
d’abord excitée cette ouverture. D’ailleurs, ne feroit-
il pas néceffaire, comme on la déjà dit, pour bien
conftater l’irritation du coeur, d’appliquer lesJlimu-
lus dans l’intérieur même dus ventricules ? Et en ce
cas, pourroit-on compter fur le réfultat d’une expérience
qui paroît fufceptible de tant d’inconvéniens?
La théorie des centres 6c des tranfports de l’aéfivité
de l’ame fenfible, nous a fourni plufteurs autres exemples
du rifque qu’il y a de s’en impofer à foi-même
dans les épreuves fur les animaux ; tel eft celui du
malfaiteur dont nous avons parlé d’après Vanhelmont
; l’obfervation d’Hoffman fur le retour périodique
des coliques néphrétiques , &c. Bianchi a remarqué
dans fes vivi-fections l’abfence Sc le retour de
la fenfibiUté , dans l’intervalle de quelques mo*
mens , fur une même partie, &c. La crainte dont
les animaux font fufceptibles auffi-bien que les hommes
, influç fingulierement fur l’exercice de la fenfibilité,
comme nous l’avons vu. Mais jufqu’où n’iront
pas les effets de cette paflion fous les couteaux d’un
diffetteur? Voye^ de coniraclilitaie & ftnfibilit. thefes,
aliquot. D . D . Francifco de Bordeu , Monfpelii , &c.
On doit faire encore la plus grande attention au
confenfus de la peau avec les parties internes , 6c à
celui de tous les organes entr’eux ; par exemple , ft
après avoir irrité les parties de la région épigaftri-
que, vous portez le ftimulus fur une extrémité, ou
fur une partie quelconque qui peut être du département
de ce centre , la fenfibilité que la première irritation
aura , pour ainfi dire, toute tranfportée dans
ce foyer général, ne fauroit fe trouver en affez grande
adivité dans la partie que vous irritez en fécond
lieu , pour répondre aux agens que vous y employez.
Autre exemple du confenfus ; dans l’ouverture
d’un chien vivant, après avoir fait plufteurs in-
cifions au diaphragme , on a vu le mefentere fuivre
les mouvemens des lambeaux de ce mufcle , 6c s’élever
en.forme de gerbe , en entraînant le refte des id-
teftins qui n’étoient pas fortis par l’ouverture. Voye^
l'idée de Chommephyfique 6* moral, p. 20S. Combien
d’obfervateurs ont vainement tenté d’irriter le mefentere
faute de cette attention au confenfus de la partie
avec le diaphragme ? &c. L’antagonifme des pé-
rioftes interne 6c externe entre eux 6c avec la peau,
les prolongemens, les connexions de la dure-mere
avec les tégumens de la tête & de certains endroits
de la face, 6c. ne font-ils pas d’une confidération ef-
féntiéllè dans les expériences qui fe font dans la vue
de recQnnoître hfen/ibilité de 'ces parties? Ajoutez à
ccs raifons l’impreffion de l’air externe fur une partie
mife entièrement: à nud , fuivant la méthode que
prêtent M. de Haller, page 108 de fon mémoire,
l’altération graduelle qu’elle éprouve dans la détection
par le progrès de la folütion de continuité, 6c.
Tà différence qu’il doit y avoir entre h, fenfibilité des
animaux & celle de l’homme, il fe trouvera qu’il n’y
a-pas moyen de pofer aucun principe fur de pareilles
- expériences.
L ’ulcere fait plus encore fur une partie que les
G if