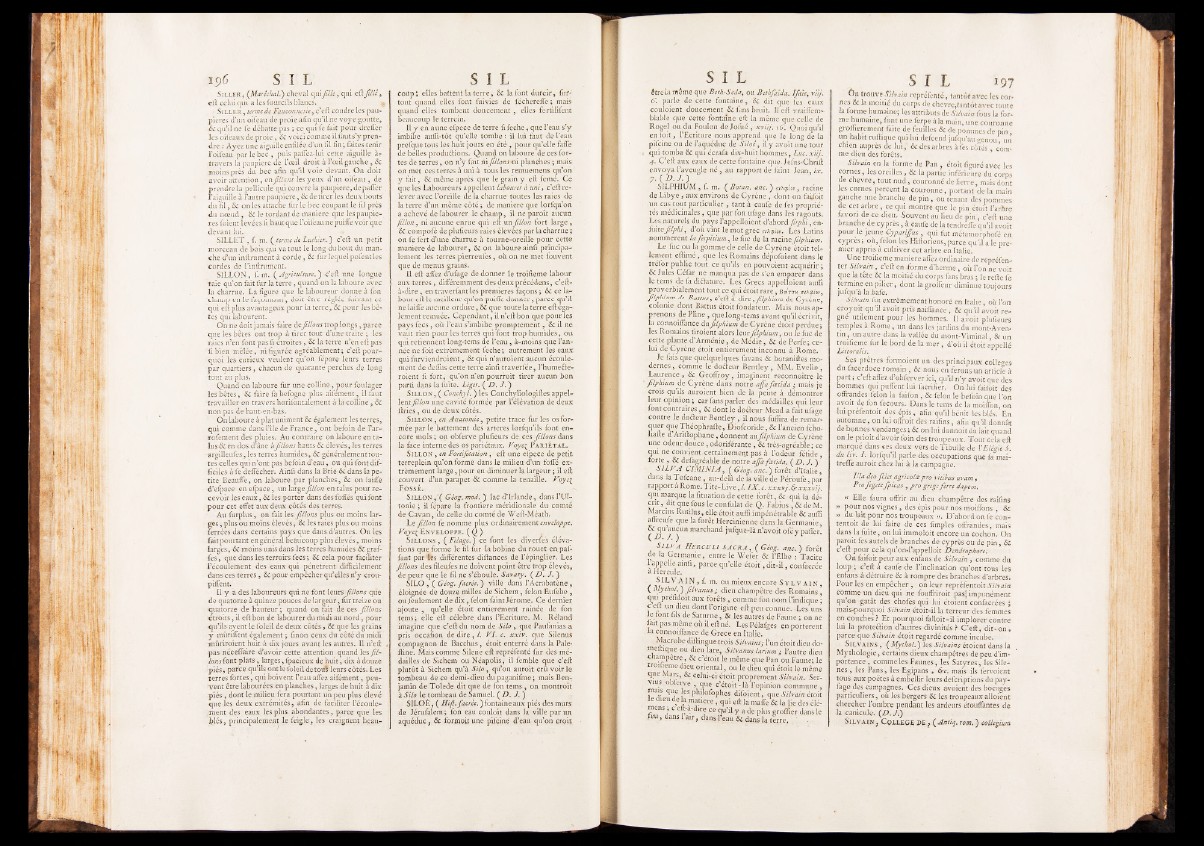
Siller , ('Maréchal.) cheval quifille , qui eft ,
eft celui qui a les fourcils blancs.
h SiLLER, terme de Fauconnerie, c’eft coudre les paupières
d’un oifeau de proie afin qu’il ne voye goutte,
& qu’il ne le débatte pas ; ce qui lé fait pour dreflèr
les oifeaux de proie, &c voici comme il faut s’y prendre
: Ayez une aiguille enfilée d’un fil fin; faites tenir
l’oifeau par le bec , puis paffez-lui cette aiguille àr
travers la paupière de l’oeil droit à l’oeil gauche , &c
moins près du bec afin qu’il voie devant. On doit
avoir attention, en filiant les yeux d’un oifeau , de
prendre la pellicule qui couvre la paupière, de paffer
l ’aiguille à l’autre paupière, & de tirer les deux bouts
du f il, & on les attache fur le bec coupant le fil près
du noeud , & le tordant de maniéré que les paupières
foient levées fi haut que l’oifeau ne puiflé voir que
devant lui.
SILLET , f. m. ( terme de Luthier. ) c’eft un petit
morceau de bois qui va tout le long du bout du manche
d’un infiniment à corde, & fur lequel pofentles
cordes de l’inftrument.
SILLON, f. m. (Agriculture.) c’eft une longue
raie qu’on fait fur la terre, quand on la laboure avec
la charrue. La figure que le laboureur donne à fon
champ en le façonnant, doit être réglée fuivant ce
qui eft plus avantageux pour la terre, & pour les bêtes
qui labourent.
On ne doit jamais faire defilons trop longs, parce
que les bêtes ont trop à tirer tout d’une traite ; les
raies n’en font pas fi étroites, & la terre n’en efi pas
fi bien mêlée, ni figurée agréablement ; c’eft pourquoi
les curieux veulent qu’on fépare leurs terres
par quartiers, chacun de quarante perches de long
"tout au plus.
Quand on laboure fur une colline, pour foulager
les bêtes, & faire fa befogne plus aifément, il faut
■ travailler en travers horilontalement à la colline , &
non pas de haut-en-bas.
On laboure à plat uniment & également les terres,
qui comme dans l’île de France, ont befoin de l’ar-
rofement des pluies. Au contraire on laboure en talus
& en dos d’âne à filon s hauts & élevés, les terres
•argilleufes, les terres humides, & généralement toutes
celles qui n’ont pas befoin d’eaii, ou qui font difficiles
à fe deffécher. Ainfi dans la Brie & dans la petite
Beauffe, on laboure par planches, & on laiflè
d’efpace en efpace, un large f ilo n en talus pour recevoir
les eaux, & les porter dans des foffés qui font
pour cet effet aux deux côtés des terres.
Au furplus, on fait les filions plus ou moins larges
, plus ou moins élevés, & les raies plus ou moins
ferrées dans certains pays que dans d’autres. On les
fait pourtant en général beaucoup plus élevés, moins
larges, & moins unis dans les terres humides & graf-
fe s , que dans les terroirs fecs; & cela pour faciliter
l ’écoulement des eaux qui pénètrent difficilement
dans ces terres, & pour empêcher qu’ elles n’y crou-
piffent.
Il y a des laboureurs qui ne font leurs filions que
de quatorze à quinze pouces de largeur, fur treize ou
quatorze de hauteur ; quand on fait de ces filions
étroits, il eft bon de labourer du midi au nord, pour
qu’ils ayent le foleil de deux côtés, & que les grains
y muriffent également ; finon ceux du côté du midi
mûriroient huit à dix jours avant les autres. Il n’eft
pas néceffaire d’avoir cette attention quand les filions
font ■ plats, larges, fpacieux de huit, dix à douze
-’pies, parce qu’ils ont le foleil de tou? leurs côtés. Les
terres fortes, qui boivent l’eau affez aifément, peuvent
être labourées en planches, larges de huit à dix
piés , dont le milieu fera pourtant un peu plus élevé
que les deux extrémités, afin de faciliter l’écoule-
. ment des eaux les plus abondantes, parce que les
blés, principalement le feigle, les craignent b,eaucoup
; elles battent la terre, & la font durcir, fur-
tout quand elles font fuivies de féchereffe ; mais
quand elles tombent doucement, elles fertilifent
beaucoup le terrein.
Il y en aune efpece de terre fi feche, que l’eau s’y
imbibe auffi-tôt qu’elle tombe : il lui faut de l’eau
prefquetous les huit jours en é té , pour qu’elle faffe
de belles produirions. Quand on laboure de ces fortes
de terres, on n’y fait ni filions-ni planches ; mais
on met ces terres à uni à tous les remuemens qu’or»
y fait, & même après que le grain y eft feme. Ce
que les Laboureurs appellent labourer à uni, c’eft relever
avec l’oreille de la charrue toutes les raies de
la terre d’un même côté ; de maniéré que lorfqu’on
a achevé de labourer le champ, il ne paroît aucun
filo n , ni aucune enrue qui eft un filo n fort large ,
& compofé de plufieurs raies élevees par la charrue ;
on fe fert d’une charrue à tourne-oreille pour cette
maniéré de labourer, &c on laboure ainfi principalement
les terres pierreufes, où on ne met fouvent
que de menus grains.
Il eft affez d’ufage de donner le troifieme labour
aux terres, différemment des deux précédens, c’ eft-
à-dire, en trav.erfant les'premières façons ; & ce labour
eft le meilleur qu’on puiffe donner, parce qu’il
ne laifle aucune ordure, & que toute la terre eft egalement
remuée. Cependant, il n’eft bon que pour les
pays fecs, où l’eau s’imbibe promptement, & il ne
vaut rien pour les terres qui font trop humides, ou
qui retiennent long-tems de l’eau, à-moins que l’année
ne foit extrêmement feche ; autrement les eaux
qui furviendroient, & qui n’auroient aucun écoulement
de deffus cette terre ainfi traverfée, l’humefte-
roient fi fort, qu’on n’en pourroit. tirer aucun bon
parti dans la fuite. Liger. ( D . J.')
Sil lon , ( Conchyl. ) les Conchyliologiftes appellent
filon une cavité formée par l’élévation de deux
ftries, ou de deux côtés.
Sillon , en Anatomie, petite trace fur les os formée
par le battement des arteres lorfqu’ils font encore
mois ; on obferve plufieurs de ces filions dans
la face interne des os pariétaux. Voye£ Pa r ié t al .
Sillon , en Fortification, • eft une efpece de petit
terreplein qu’on forme dans le milieu d’un foffé extrêmement
large, pour en diminuer la largeur ; il eft
couvert d’un parapet & comme la tenaille. Voyc{
F o s s é .
Sil lo n , ‘( Géog.mod. ) lac d’Irlande, dansl’Ul-
tonie ; il fépare la frontière méridionale du comté
de Cavan, de celle du comté de Weft-Méath.
Le fillon fe nomme plus ordinairement enveloppe.
Voye{ Enveloppe. ( Q )
Sil l o n s , ( Filage. ) ce font les divçrfes élévations
que forme le fil fur la bobine du rouet en paf-
fant par Les différentes diftances de l’épinglier. Les
filions des fileufes ne doivent point être trop élevés,
de peur que le fil ne s’éboule. Savary. ( 2?. J . )
SILO , ( Géog. facrée. ) ville dans l’Acrabatène ,
éloignée de douze milles de Sichem, félon Eufebe ,
où feulement de dix, félon faint Jérome. Ce dernier
ajoute , qu’elle étoit entièrement ruinée de fon
tems; elle eft célébré dans l’Ecriture. M. Réland
imagine que c’eft du nom de Silo , que Paufanias a
pris occaüon de dire, l. VI. c. xxiv. que Silenus
compagnon de Bacchus, étoit enterré dans la Pale-
ftine. Mais comme Silene eft repréfenté fur des médailles
de Sichem ou' Néapolis, il femble que c’eft
plutôt à Sichem qu’à Silo, qu’on auroit cru voir le
tombeau de ce demi-dieu dupaganifme; mais Ben?
jamin de Tolede dit que de fon tems , on montroit
à Silo le tombeau de Samuel. ('2?. 2. )
SILOÉ, ( Hi(l. facrée. ) fontaine aux piés des murs
de Jérufalem ; fon eau couloit dans la ville par un
aquéduc, & formoit une pifeiné d’eau qu’on croit
être la même que Beth-Seda, ou Betlifaîda. Tfaïe, vïi) .
G. parle de cette fontaine, &ç dit que fes eaux
couloient doucement & fans bruit. Il eft vraiffem--
blable que cette fontaine eft la même que celle de
Rogel ou du Foulon de Jofué , xviij. iG. Quoiqu’il
en foit, l’Ecriture nous apprend que le long de la
pifeine ou de I’aquéduc de Siloé, il y avoit une tour
, .qui tomba & qui écrafa dix-huit hommes, Luc. xiij.
4. C ’eft aux eaux de cette fontaine que. Jefus-Chrift
envoya l’aveugle n é , au rapport de faint Jean ix.
7 , ( / > . / . )
SILPHIUM , f. m. ( Botan. anc. ) oiXtpîov, racine
de L ibye , aux environs de Cyrène , dont on faifoit
un cas tout particulier , tant à caufe de fes propriétés
médicinales, que par fon ufage dans les ragoûts.
Les naturels du pays l’appellôient d’abord (irphi, en-
fuite ƒ//>/« , d’où vint le mot grec <nx<piov. Les Latins
nommèrent la ferpitium, lefuc de la racine filphium.
Le fuc ou la gomme de celle de Cyrène étoit tellement
eftimé, que les Romains dépofoient dans le
trefor public tout ce qu’ils en pouvoient acquérir ;
& Jules Céfar ne manqua pas de s’en emparer dans
le tems de fa di&ature. Les Grecs appelloient auffi
proverbialement tout ce qui étoit rare, bÙttv nxfiov,
filphium de Battus, c’eft-à-dire , filphium de Cyrène,
colonie dont Battus étoit fondateur. Mais nous apprenons
de Pline , que long-tems avant qu’il écrivit,
la connoiffance du filphium de Cyrène étoit perdue;
les Romains tiroient alors leurfilphium, ou le fuc de
cette plante d’Arménie, de Meclie, & de Perfe; celui
de Cyrène étoit entièrement inconnu à Rome.
Je fais que quelquelques favans & botaniûes modernes
, comme le do&eur Bentley, MM. Evelin ,
Laurence, & Geoffroy, imaginent reconnoître le
' filphium de Cyrène dans notre affa foetida ; mais je
crois qu’ils auroient bien de la peine à démontrer
leur opinion ; car fans parler des médailles qui leur
font contraires, & dont le doûeur Mead a fait ufage
contre le do&eur Bentley, il nous fuffira de remarquer
que Théophrafte, Diofcoride, & l’ancien feho-
liafte a Ariftophane, donnent aufilphium de Cyrène
une odeur douce, odoriférante , & très-agréable; ce
qui ne convient - certainement pas à l’odeur fétide ,
forte , & defagréable de notre affa fattida. ( D . J . )
S ILV A CI MI N IA , ( Géog. anc.') forêt d’Italie,
dans la Tofcane , au-delà de la ville de Péroufe, par
. rapport à Rome. Tite-Live, l. IX. c. xxxvj. & xxxvij.
qui marque la fituation de cette forêt, & qui la décrit
, dit que fous le confulat de Q. Fabius , & de M.
Marcius Rutilus, elle étoit auffi impénétrable & auffi
affreufe que la forêt Hercinienne dans la Germanie,
Q u ’aucun marchand jufque-là n’avoit ofé y paffer.
Si l v a He r c u l i s a c r a , (Géog. anc.) forêt
de la Germanie, entre le Wefer & l’Elbe : Tacite
l’appelle ainfi, parce qu’elle é to it, dit-il, confacrée
a Hercule.
S I L V A IN , f. m. ou mieux encore S y l v a i n ,
( Mythol. ) filvanus ; dieu champêtre des Romains ,
qui prefidoit aux forêts, comme fon nom l’indique ;
c ’eft un dieu dont l’origine eft peu connue. Les uns
le font fils de Saturne, & les autres de Faune ; on ne
Jait pas meme ou il eft né. Les Pélafges en portèrent
la connoiffance de Grece en Italie.
Macrobe diftingue trois Silvains; l’un étoit dieu do-
meihque ou dieu lare, Silvanus Urium ; l’autre dieu
champêtre, & c’étoit le même que Pan ou Faune; le
101 *®me,dieu oriental, ou le dieu qui étoit le même
que Mars, & celui-ci étoit proprement Silvain. Ser-
vins oblerve , que c’étoit-là l’opinion commune ,
mais que les philofophes difoient, que Silvain étoit
le dieu de la matière, qui eft la maffe & la lie des élé-
mens, c e -a-dire ce qu’il y a de plus groflier dans le
Jeu, dans 1 air, dans l’eau & dans la terre. '
On trouve Silvain repréfenté, tantôt avec les cor-
nés & la moitié du corps de chevre,tantôt avec toute
la forme humaine; les attributs de Silvain fous la forme
humaine, font une.ferpe à la main, une couronne
groffierement faite de feuilles & de pommes de pin
un habit ruftique qui lui defeend jufqu’au genou, un
chien auprès de lui, 6c des arbres à fes côtés com*
me dieu des forêts.
Silvain en la forme de Pan , étoit figuré avec les
cornes, les oreilles, & la partie inférieure du corps
de chevre, tout nud, couronné de lierre, mais dont
les cornes percent la couronne, portant de la main
gauche une branche de pin, ou tenant des pommes
de cet arbre, ce qui montre que le pin étoit l’arbre
favori de ce dieu. Souvent au lieu de pin, c’eft une
branche de cyprès, à caufe de la tendreffe qu’il avoit
pour le jeune CypariJJus , qui fut métamorphofé en
cyprès ; où, félon les Hiftoriens, parce qu’il a le pre*
mier appris à cultiver cet arbre en Italie.
Une troifieme maniéré affez ordinaire de rèpréfen-
ter Silvain, c’eft en forme d’herme , où l’on ne voit
que la tête & la moitié du corps fans bras ; le refte fe
termine en pilier, dont la groffeur diminue toujours
jufqu’à la bafe.
Silvain fut extrêmement honoré en Italie, où l’on
cfqyoit qu’il avoit pris naiffance, & qu’il avoit régné
utilement pour les hommes. Il avoit plufieurs
temples à Rome, un dans les jardins du mont-Aven*
tin, un autre dans la vallee du mont-Viminal, & un
troifieme fur le bord de la mer , d’où il étoit appellé
Littoralis,
Ses prêtres formoient un des principaux colleges
du faeerdoce romain , & nous en ferons un article à
part ; c eft affez d’obferver ici, qu’il.n’y avoit que des
hommes qui puffent lui facrifier. On lui faifoit des
offrandes félon la faifon , & félon le befoin que l ’on
avoit de fon fecours. Dans le tems de la moiffon, on
lui préfentoit des épis, afin qu’il bénît les blés. En
automne, on lui offroit des raiiins, afin qu’il donnât
de bonnes vendanges ; & on lui donnoit du lait quand
on le prioit d’avoir foin des troupeaux. Tout cela eft
marqué dans ces deux vers de Tibulle de Y Elégie 5.
du liv. I. lorfqu’il parle des occupations que fa maî-
treffe auroit chez lui à la campagne5^ ï# d f«^ii
Ilia deo feiet agricole pro vitibus uvam,
Profegetefpicas , pro grege ferre dapem.
« Elle faura offrir au dieu champêtre des raifins
» pour nos vignes, des épis pour nos moiffons , &
» du lait pour nos troupeaux ». D abord on fe con-
tentoit de lui faire de ces fimples offrandes, mais
dans la fuite, on lui immoloit encore un cochon. On
paroit fes autels de branches de cyprès ou de pin, &
c’eft pour cela qu’on-l’appelloit Dendropkore.
On faifoit peur aux enfans de Silvain, comme du
loup ; c’eft à caufe de l’inclination qu’ont tous les
enfans à détruire & à rompre des branches d’arbres.
Pour les en empêcher, . on leur repréfentoit Silvain
comme un dieu qui ne fouffriroit pas^ impunément
qu’on gâtât des choies qui lui étoient confacrées ;
mais-pourquoi Silvain étoit-il la terreur des femmes
.en couches ? Et pourquoi falloit-il implorer contre
lui la prote&ion d’autres divinités ? C’eft, dit-on,
parce que Silvain étoit regardé comme incube.
Silvains , (Mythol. ) les Silvains étoient dans la
Mythologie, certains dieux champêtres de peu d’importance
, comme les Faunes,, les Satyres , les Silènes
, les Pans, les Egipans , &c. mais ils fervoient
tous aux poètes à embellir leurs deferiptions du pay-
fage des campagnes. Ces dieux avoient des bocages
particuliers, où les bergers & les troupeaux alloient
chercher l’ombre pendant les ardeurs étouffantes cle
la canicule. (D . J.)
S i l v a i n ? C o l l e g e d e ^ ( Antiq. rom,') collegium