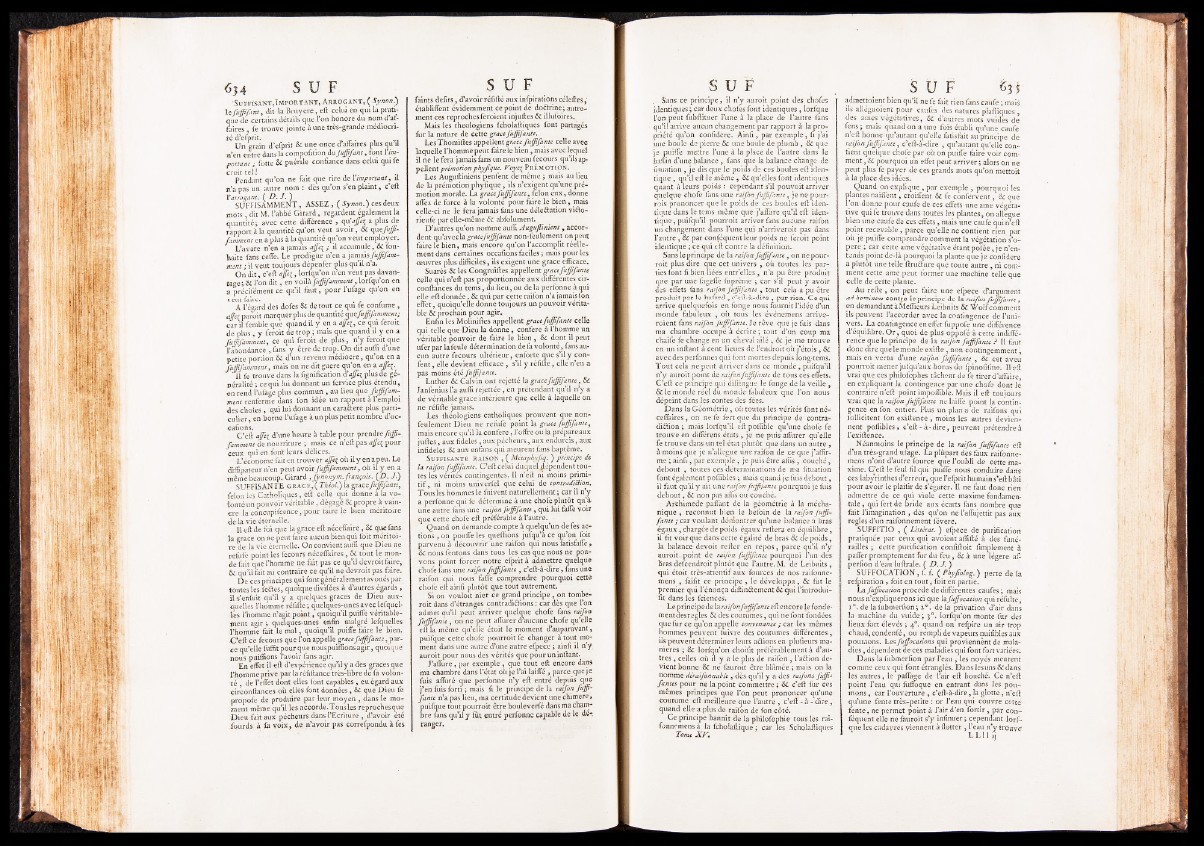
<534 S ü F
'S u f f i s a n t , I m p o r t a n t , A r r o g a n t , { Synonÿ ;
Itfuffîfant, dit la Bruyere, eft celui en qui la prati- ■
que de certains détails que l’on honore du nom d’affaires
, fe trouve jointe à une très-grande médiocrité
d’efprit.
Un grain d’efprit & une once d affaires plus qu il
n’en entre dans la compofition du Juffifant, font 1 important
; fotte 6c puérile confiance dans celui qui fe
croit teU ..
Pendant qu’on ne fait que rire de 1 important, il
n’a pas un autre nom > des qu on s en plaint, c eft
Varrogant. ( / ? . / . )
SUFFISAMMENT, ASSEZ, ( Synon.) ces deux
mots , dit M. l’abbé Girard, regardent également la
quantité; avec cette différence , qu’<#{ a plus de
rapport à la quantité qu’on veut avoir, 6c quefuffi-
Jammeni en a plus à la quantité qu’on veut employer.
L’avare n’en a jamais affie^ ; il accumule, 6c fou-
haite fans ceffe. Le prodigue n’en a jamaisfuffifam-
ment ; il veut toujours dépenfer plus qu’il n’a.
On dit, c’eft a(fe{ , lorfqu’on n’en veut pas davantage;
& l’on d it ,' en voilà fuffifamment, lorfqu’on en
a précisément ce qu’il faut, pour l’ufage qu’on en
veut faire.
A l’égard des dofes 6c de tout ce qui fe confume ,
affei paroit marquer plus de quantité quefuffifamment;
car il-femble que quand il y en a affe^ ce qui feroit
de plus , y feroit de trop ; mais que quand il y en a
(uffifammenty ce qui feroit de plus, n’y feroit que
l’abondance , fans y être de trop; On dit aufli d’une
petite portion 6c d’un revenu médiocre, qu’on en a
fuffifamment, mais on ne dit guere qu’on en a affie^
Il fe trouve dans la fignification Gaffa plus de généralité
; ce qui lui donnant un fervice plus étendu,
en rend l’ufage plus commun , au lieu que fuffifam-
ment renferme dans fon idée un rapport à l’emploi
des chofes , qui lui donnant un cara&ere plus particulier,
en borne l’ufage à un plus petit nombre d’oc-
cafions.
C ’eft ajfei d’une heure à table pour prendrefuffi-
famment de nourriture ; -mais ce n’eft pas affii pour
ceux qui en 'font leurs delices.
L’économe fait en trouver affie{ oîi il y en a peu. Le
diflïpateur n’en peut avoir /uffifamment, où il y en a
même beaucoup. Girard ,fynonym.françois. (D . J.)
SUFFISANTE g r â c e , ( Tkéol.) la gracefuffifante,
félon les Catholiques, eft celle qui donne à la volonté
un pouvoir véritable, dégagé 6c propre à vaincre
la concupifcence, pour faire le bien méritoire
de la vie éternelle. .
Il eft de foi que la grâce eft néceffaire, 6c que fans
la grâce on ne peut faire aucun bien qui foit méritoire
de la vie éternelle. On convient aufli que Dieu ne
refufe point les fecours néceffaires, 6c tout le monde
fait que l’homme ne fait pas ce qu’il devroit faire,
& qu’il fait au contraire ce qu’U ne devroit pas faire.
De ces principes qui font généralement avoués par
toutes les lèéles, quoique divifées à d’autres égards ,
il s’ enfuit qu’il y a quelques grâces de Dieu auxquelles
l’homme réfifte ; quelques-unes avec lefquel-
les l’homme n’agit point, quoiqu’il puiffe véritablement
agir ; quelques-unes enfui malgré lefquelles
l’homme fait le mal, quoiqu’il puiffe faire le bien.
C ’eft ce fecours que l’on appelle grâce fuffifante, parce
qu’ elle fuflit pour que nouspuiflions agir, quoique
nous publions l’avoir fans agir.
En effet il eft d’expérience qu’il y a des grâces que
l’homme prive par la réfiftance très-libre de fa volonté
de l’effet dont elles font capables , eu égard aux
circonftances où elles font données, 6c que Dieu fe
propofe de produire par leur moyen , dans le moment
même qu’il les accorde. Tous les reprochesque
Dieu fait aux pécheurs dans l’Ecriture , d’avoir été
Lourds à fa vo ix , de n’avoir pas çorrefpondu à fes
S U F
faints defirs, d’avoir réfifté aux infpirations céleftes,'
établiffent évidemment ce point de doétrine; autrement
ces reproches feroient injuftes 6c illufoires.
Mais les théologiens lcholaftiques font partagés
fur la nature de cette grâce fuffifante.
LesThomiftes appellent grâce fuffifante celle avec
laquelle l’hommépeut faire le bien, mais avec lequel
il ne le fera jamais fans un nouveau fecours qu’ils appellent
prémotionphyfique. V oye^ PRÉMOTION.
Les Auguftiniens penfent de même ; mais au lieu
de la prémotion phyfique, ils n’exigent qu’une prémotion
morale. La grâce fuffifante, félon eux, donne
affez de force à la volonté pour foire le bien, mais
celle-ci ne le fera jamais fans une délégation vifto-
rieufe par elle-même & abfolument.
D’autres qu’on nomme aufli Auguftiniens , accordent
qu’avec la gracefuffifànte non-feulement on peut
faire le bien, mais encore qu’on l’accomplit réellement
dans certaines occafions faciles ; mais pour les
oeuvres plus difficiles, ils exigent une grâce efficace.
Suarès 6c les Congruiftes appellent grâce fuffifante
celle qui n’eft pas proportionnée aux différentes circonftances
du tems, du lieu, ou de la perfonne à qui
elle eft donnée, 6c qui par cette raifon n’a jamais fon
effet, quoiqu’elle donne toujours un pouvoir véritable
& prochain pour agir.
Enfin les Moliniftes appellent grâce fuffifante celle
qui telle que Dieu la donne, conféré à l’homme un
véritable pouvoir de faire le bien , 6c dont il peut
ufer par la feule détermination de fa volonté, fans aucun
autre fecours ultérieur, enforte que s’il y con-
fent, elle devient efficace, s’il y réfifte, elle n’en a
pas moins été fuffifante.
Luther 6c Calvin ont rejetté la grâce fuffifante, &
Janfenius l’a aufli rejettée, en prétendant qu’il n’y a
de véritable grâce intérieure que celle à laquelle on
ne réfifte jamais.
Les théologiens catholiques prouvent que non-
feulement Dieu ne refufe point la grâce fuffifante,
mais encore qu’il la conféré, l’offre ou la prépare aux
juftes, aux fideles, aux pécheurs, aux endurcis, aux
infidèles 6c aux enfans qui .meurent fans baptême.
S u f f i s a n t e r a i s o n , ( Métaphyftq. ) principe de
la raifon fuffifante. C’ eft celui duquel dépendent toutes
les vérités contingentes. Il n’eft ni moins primit
i f , ni moins univerfel que celui de contradiction,
Tous les hommes le fui vent naturellement ; car il n’y
a perfonne qui lé détermine à une chofe plutôt qu’à,
une autre fans une raifon fuffifante, qui lui faffe voir
que cette chofe eft préférable à l’autre. •
Quand on demande compte à quelqu’un de fes actions
, on pouffe les queftions jufqu’à ce qu’on foit
parvenu à découvrir une raifon qui noüs fatisfoffe,
6c nous fentons dans tous les cas que nous ne pouvons
point forcer notre efprit à admettre quelque
chofe fans une raifon fuffifante , c’eft-à-dire, lans une
raifon qui nous faffe comprendre pourquoi cette
chofe eft ainfi plutôt que tout autrement.
Si on vouloit nier ce grand principe, on tombe-
roit dans d’étranges contradiétions : car dès que l’on
admet qu’il peut arriver quelque chofe fans raifon
fuffifante, on ne peut affurer d’aucune chofe qu’elle
eft la même qu’elle étoit le moment d’auparavant,
puifque cette chofe pourroitfe changer à tout moment
dans une autre d’une autre efpece ; ainfi il n’y
auroit pour nous des vérités que pouruninftant.
J’affure, par exemple , que tout eft encore dans
ma chambre dans l’état où je l’ai laiffé , parce que je
fuis affuré que perfonne n’y eft entré depuis que
j’en fuis forti ; mais fi le principe de la raifon fuffifante
n’a pas lieu, ma certitude devient une chimere,
puifque tout pourroit être bouleverfé dans ma chambre
lans qu’il y fût entré perfonne capable de le de*,
ranger»
S U F Sans ce principe j il n’y auroit point des chofes
identiques ; car deux choies font identiques , lorfque
l’on peut fubftituer l’une à la place de l ’autre fans
qu’il arrive aucun changement par rapport à la propriété
qu’on confidere. Ainfi, par exemple, fi j’ai
une boule de pierre 6c une boule de plomb, 6c que
jè puiffe mettre l’une à la place de l’autre dans le
baflin d’une balance , fans que la balance change de
fiîuation , je dis que le poids de ces boules eft identique
, qu’il eft le même , 6c qu’elles font identiques
quant à leurs poids : cependant s’il pouvoit arriver
quelque chofe fans une raifon fuffifante, je ne pour-
rois prononcer que le poids de ces boules eft identique
dans le tems même que j’affure qu’il eft identique,
puifqu’il pourroit arriver fans aucune raifon
un changement dans l’une qui n’arriveroit pas dans
l’autre, 6c par conféquent leur poids ne feroit point
identique ; ce qui eft contre la définition.
Sans le principe de la raifon fuffifante, on ne pourroit
plus dire que cet univers , oii toutes les parties
lont fi bien liées entr’elles , n’a pu être produit
que par une fageffe fuprème ; car s’il peut y avoir
des effets fans raifon fuffifante., tout cela a pu être
produit par le hafard, c’eft-à-dire , par rien. Ce qui
arrive quelquefois en fonge nous fournit l’idée d’un
inonde fabuleux , où tous les événemens arrive-
roient fans raifon fuffifante. Je rêve que je fuis dans
ma chambre occupé à écrire ; tout d’un coup ma
chaife fe change en un cheval ailé , & je me trouve
en un inftant à cent lieues de l’endroit où j’étois, 6c
avec des perfonnes qui font mortes depuis long-tems.
Tout cela ne peut arriver dans ce monde, puifqu’il
n’y auroit point de raifon fuffifante de tous ces effets*
C ’eft ce principe qui diftingue le fonge de la veille ,
& le monde réel du monde fabuleux que l’on nous
dépeint dans les contes des fées.
Dans la Géométrie, où toutes les vérités font néceffaires
, on ne fe fert que du principe de contradiction
; mais lorfqu’il eft poflible qu’une chofe fe
trouve en différens états, je ne puis affurer qu’elle
fe trouve dans un tel état plutôt que dans un autre ,
à moins que je n’allegue une raifon de ce que j’affirme
; ainfi , par exemple, je puis être affis, couché,
debout , toutes ces déterminations de ma fituation
font également poffibles ; mais quand je fuis debout,
il fout qu’il y ait une raifon fuffifante pourquoi je fuis
debout, 6c non pas affis ou couché.
ArChimede paffant de la géométrie à la mécha-
nique , reconnut bien le befoin de la raifon fuffifante
; car voulant démontrer qu’une balance à bras
égaux, chargée de poids égaux reliera en équilibre,
il fit voir que dans cette égalité de bras 6c de poids,
la balance devoit refter en repos, parce qu’il n’y
auroit. point de raifon fuffifante pourquoi l’un des
bras defeendroit plutôt que l’autre. M. de Leibnits ,
qui étoit très-attentif aux fources de nos raifonne-
mens , faifit ce principe, le développa, & fut le
premier qui l’énonça diftinâement 6c qui l’introdui-
fit dans les fciences.
Le principe de la raifon fuffifante eft encore le fondement
desregles &des coutumes, qui ne font fondées
que fur ce qu’on appelle convenance ; car les mêmes
hommes peuvent liiivre des coutumes différentes,
ils peuvent déterminer leurs aélions en plufieurs maniérés
; 6c lorfqu’on choifit préférablement à d’autres
, celles où il y a le plus de raifon, l ’aétion devient
bonne & ne fauroit être blâmée ; mais on la
nomme déraifonnable , dès qu’il y a des raifons fuffi*
famés pour ne la point commettre ; 6c c’eft fur ces
memes principes que l’on peut prononcer qu’une
Coutume eft meilleure que l’autre , c’eft - à - dire ,
quand elle a plus de raifon de fon côté.
Ce principe bannit de la philofophie tous les rai-
fonnemens à la fçhoîaftique ; car les Scholaftiques
Tome X Ki
S U F 635
admettoient bien qu’il ne fe fait rien fans caüfe ; mais
ils alleguoient pour caufes des natures plaftiques ,
des âmes végétatives, ôc d’autres mots vuides de
fens ; mais quand on a une fois établi qu’une caufe
n’eft bonne qu’autant qu’elle fatisfait au principe de
raifon fuffifante, c’eft-à-dire , qu’autant qu’elle contient
quelque chofe par où on puiffe faire voir comment
, 6c pourquoi un effet peut arriver ; alors on ne
peut plus fe payer de ces grands mots qu’on mettait
à la place des idées.
Quand on explique , par exemple , pourquoi les
plantes naiffent, croiffent 6c fe çonférvent, 6c oué
l ’on donne pour caufe de ces effets une ame végétative
qui fe trouve dans toutes les plantes, on allégué
bien une caufe de ces effets , mais une caufe qui n’eft
point recevable, parce qu’elle ne contient rien par
où je puiffe comprendre comment la végétation s’opère
; car cette ame végétative étant pofée, je n’entends
point de-là pourquoi la plante que je confidere
a plutôt une telle ftruéture que toute autre , ni comment
cette ame peut former une machine telle que
celle de cette plante.
Au refte, on peut faire une efpece d’argument
ad hominem contre le principe de la raifon fuffifante ,
en demandant à Meilleurs Leibnits & W olf comment
ils peuvent l’accorder avec la contingence de l’univers.
La contingence en effet fuppofe une différence
d’équilibre.Or, quoi de plus oppofé à cette indifférence
que le principe de la raifon fuffifante ? Il fout
donc dire que le monde exifte , non contingemment,
mais en vertu d’une raifon fuffifante , 6c cet aveu
pourroit mener jufqu’aux bords du fpinofifme. Il eft
vrai que ces philofophes tâchent de fe tirer d’affaire,
en expliquant la contingence par une chofe dont le
contraire n’eft point impoffible. Mais il eft toujours
vrai que la raifon fuffifante ne laiffe point la contingence
en fon entier. Plus un plan a de raifons qui
lbllicitent fon exiftence , moins les autres deviennent
poffibles, e’e f t-à -d ire , peuvent prétendre à
l’exiftence.
Néanmoins le principe de la raifon fuffifante eft
d’un très-grand ulàge. La plupart des faux raifonne-
mens n’ont d’autre fource que l ’oubli de cette maxime.
G’eft le feul fil qui puiffe nous conduire dans
ces labyrinthes d’erreur, que l’efprit humain s’eft bâti
pour avoir le plaifir de s’égarer. Il ne faut donc rien
admettre de ce qui viole cette maxime fondamentale
, qui fert de bride aux écarts fans nombre que
foit l’imagination, dès qu’on ne l’affujettit pas aux
réglés d’un raifonnement févere.
SUFFITIO , ( Littérat. ) efpece de purification
pratiquée par ceux qui avoient affilié à des funérailles
; cette purification confiftoit Amplement à
paffer promptement fur du feu , 6c à une légère afo
perfion d’eau luftrale. ( D . J. )
SUFFOCATION, f. f. ( Phyfiolog. ) perte de la
refpiration, foit en tout, foit en partie.
La fuffiocation procédé de différentes caufes ; mais
nous n’expliquerons ici que la fuffiocation qui réfulte,'
i° . de la lubmerfion; z 0. de la privation d’air dans
la machine du vuide; 3 °i lorfqu’on monte fur des
lieux fort élevés ; 40. quand on refpire un air trop*
chaud, condenfé, ou rempli de vapeurs nuifîbles aux
poumons. Les fuffiocations qui proviennent de maladies
, dépendent de ces maladies qui font fort variées.
Dans la fubmerfion par l’eau , les noyés meurent
comme ceux qui font étranglés. Dans les uns & dans
les autres, le paffage de l’air eft bouché. Ce n’eft
point l’ eau qui fuftoque en entrant dans les poumons
, car l’ouverture , c’eft-à-dire, la glotte, n’eft
qu’une fente très-petite : or l’eau qui couvre cette
fente, ne permet point à l’air d’en fortir, par conféquent
elle ne fauroit s’y infinuer ; cependant lorfque
les cadavres viennent à flotter , l’ eau n’y trouvé
L L 11 ij