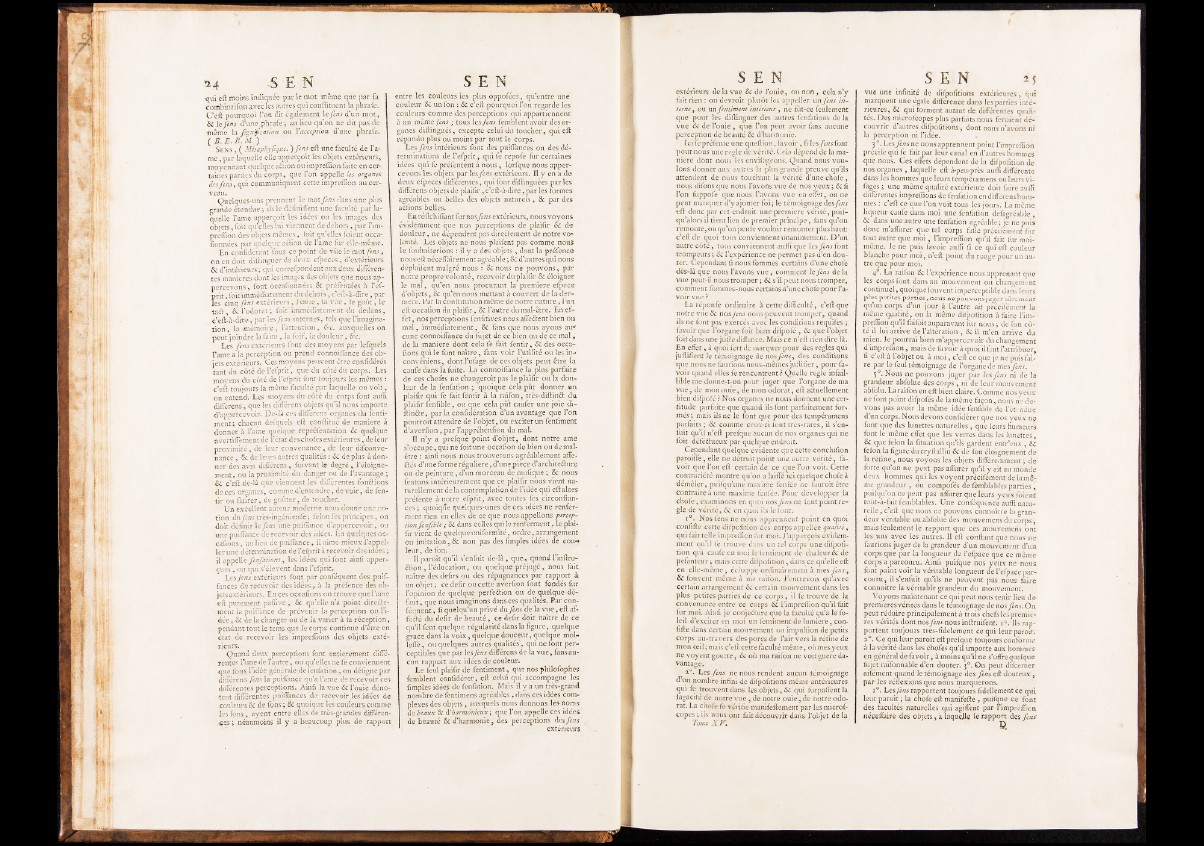
'qui eft moins indiquée par le mot même que par fa
combinaifcm avec les autres quiconftituent la phrafe.
eft pourquoi l’on dit également le fens d’un mot,
le fens d’une phrafe ; au lieu qu’on ne dit pas de
même la f.gn'fcation ou Xacception d’une phrafe.
( B . E. R. M. )
Sens , ( Mètaphyfique. ) fens eft une faculté de l’aine
P?Q
, par laquelle elle apperçoit les objets extérieurs,
moyennant quelque aétion ouimprefîion faite en certaines
parties du corps , que Pon appelle Les organes
des fens, qui communiquent cette impreffion au cerveau.
Quelques-uns prennent le mot fens dans une plus
grande étendue ; ils le définiffent une faculté par laquelle
Famé apperçoit les idées on les images des
objets, foit qu’elles lui viennent de dehors, par l’im-
preflion des objets mêmes, foit qu’elles foient occa-
fionnées par quelque action de Pâme fur elle-même.
En confidérant fous ce point de vue le mot fens,
on en doit diftinguer de deux efpeces, d’extérieurs
& d’intérieurs ; qui correfpondent aux deux différentes
maniérés dont les images des objets que nous ap-
percevons, font occalionnées & préfentées à Fef-
p rit, foit immédiatement du dehors, c’eft-à-dire, par
les cinq fens extérieurs, Fouie, la vu e , le goût, le
ta& , & l’odorat; foit"immédiatement du dedans,
c’eft-à-dire, par les fens internes, tels que l’imagination
, la mémoire, l’attention, &c. auxquelles on
peut joindre la faim , la foif, la douleur, &c.
Les fens extérieurs font des moyens par lefquels
l’ame a la perception ou prend connoiffance des objets
extérieurs. Ces moyens peuvent être confidérés
tant du côté de l’efprit, que du côté du corps. Les
moyens du côté de Pefprit font toujours les mêmes :
c’eft toujours la même faculté par laquelle on v o it ,
on entend. Les moyens du côté du corps font auffi
différens, que les diffère ns objets qu’il nous importe
d’appercevoir. De-là ces différens organes du fenti-
ment; chacun defquels eft conftitué de maniéré à
donner à Famé quelque repréfentation & quelque
avertiffement de l’état des chofes extérieures, de leur
proximité, de leur convenance, de leur difconve-
nance & de leurs autres qualités : & de plus à donner
des avis différens, fuivant le degré,d ’éloignement,
ou la proximité du danger ou de l’avantage ;
& c’eft de-là que viennent les différentes fondions
de ces organes, comme d’entendre, de vo ir , de fentir.
ou „flairer, de goûter, de toucher.
Un excellent auteur moderne nous donne une notion
du fens très-ingénieufe; félon fes principes, on
doit définir le fens une puiffance d’appercevoir, ou
une puiffance de recevoir des idées. En quelques oc-
çafions, au lieu de puiffance, il aime mieux l’appel-
ler une détermination de Pefprit à recevoir des idées ;
il appelle fenfations, les idées qui font ainfi apper-
çues 9 ou qui s’élèvent dans Pefprit.
Les fens extérieurs font par conféquent des puif-
fances de recevoir des idées, à la préfence des objets
extérieurs. En ces occafions on trouve que l’ame
eft purement paflive, & qu’elle n’a point direéte-
ment la puiffance de prévenir la perception ou l’idée
, & de la changer ou de la varier à la réception,
pendant tout le tems que le corps continue d’être en
état de recevoir les imprefîions des objets extérieurs.
Quand deux perceptions font entièrement différentes
l’une de l’autre, ou qu’ elles ne fe conviennent
que fous l’idée générale de fenfation, on défigne par
différens fens la puiffance qu’a Famé de recevoir ces
différentes perceptions. Ainft la vue & Fouie dénotent
différentes puiffances de recevoir les idées de
couleurs & de foos ; & quoique les couleurs comme
les fons, ayent entre elles de très-grandes différences
; néanmoins il y a beaucoup plus de rapport
entre les couleurs les plus oppofées, qu’entre une
couleur &c unfon : & c’eft pourquoi Pon regarde les
couleurs comme des perceptions qui appartiennent
à un même fens ; tous les fens femblent avoir des organes
diftingués, excepté celui du toucher, qui eft •
répandu plus ou moins par tout le corps.
Les fens intérieurs font des puiffances ou des déterminations
de Pefprit, qui fe repofe fur certaines
idées qui fe préfentent à nous, lorfque nous appér-
cevons les objets par l’es fens extérieurs. Il y en a de
deux efpeces différentes, qui font diftinguées par les
différens objets de plaifir, c’eft-à-dire, par les formes
agréables ou belles des objets naturels, & par des
aérions belles.
En réflchiffant fur nos fens extérieurs, nous voyons
évidemment que nos perceptions de plaifir &c de
douleur, ne dépendent pas dire&ement de notre vo*
lonté. Les objets ne nous plaifcnt pas comme nous
le fouhaiterions : il y a des objets , dont la préfence
nous eft néceffairement agréable ; Sc d’autres qui nous
déplaifent malgré nous : & nous ne pouvons, par
notre propre volonté, recevoir du plaifir ôc éloigner
le mal, qu’en nous procurant la première efpece
d’objets, &: qu’en nous mettant à couvert de la-dernière.
Par la conftitution même de notre nature, l’un
eft occafion du plaifir, & l’autre du mal-être. En effet
, nos perceptions fenfitives nous affe&ent bien ou,-
mal, immédiatement, & fans que nous ayons au»»
cune connoiffance du fujet de ce bien ou de ce mal,
de la maniéré dont cela fe fait fentir, Sc des occa-
fiôns qui le font naître, fans voir l’utilité ou les in-*
convéniens, dontl’ufage de ces objets peut être la
caufe dans la fuite. La connoiffance la plus parfaite
de ces chofes ne changeroit pas le plaifir ou la douleur
de la fenfation ; quoique cela pût donner un
plaifir qui fe fait fentir à la raifon, très-diftinâ du
plaifir fenfible, ou que cela pût caufer une joie di-
ftinâe, parla confidération d’un avantage que l’on
pourroit attendre de l’objet, ou exciter un fentiment
d’averfion, par l’appréhenfion du mal.
Il n’y a prefquc point d’objet, dont notre ame
s’occupe, qui ne foit une occafion de bien ou de malêtre
: ainfi nous nous trouverons agréablement affichés
d’une forme régulière, d’unepiece d’archite&ure
ou de peinture, d’un morceau de mufique ; & nous
fentons intérieurement que ce plaifir nous vient naturellement
de la contemplation de l’idée qui eft alors
préfente à notre efprit, avec toutes fes circonftan-
ces ; quoique quelques-unes de ces idées ne renferment
rien en elles de ce que nous appelions perception
fenfible ; & dans celles qui le renferment, le plai»
fir vient de quelque uniformité, ordre, arrangement
ou imitation, & non pas des fimples idées de cou-*
leur, defon.
Il paroît qu’il s’enfuit de-là , que, quand l’inftru-
£rion, l’éducation, ou quelque préjugé, nous fait
naître des defirs ou des répugnances par rapport à
un objet; ce defir ou cette averfion font fondés fur
l’opinion de quelque pcrfeérion ou de quelque défaut
, que nous imaginons dans ces qualités. Par conféquent
, fi quelqu’un privé du fens de la vue, eft af-
feàé du defir de beauté, ce defir doit naître de ce
qu’il fent quelque régularité dans la figure, quelque
grâce dans la v o ix , quelque douceur, quelque mol-
leffe, ou quelques autres qualités, qui ne font perceptibles
que par les fens différens de la vue, fans aucun
rapport aux idées de couleur.
Le feul plaifir de fentiment, que nos philofophes
femblent confidérer, eft celui qui accompagne les
fimples idées de fenfation. Mais il y a un très-grand
nombre de fentimens agréables, dans ces idées complexes
des objets, auxquels nous donnons les-noms
de beaux & d'harmonieux; que Pon appelle ces idées
de beauté & d’harmonie, des perceptions des fens
extérieurs
extérieurs de la vue & dé l’oniè, ou nûft, cela n’y
fait rien : on devroit plutôt les appeller un fens interne,
ou un fentiment intérieur, ne fut-ce feulement
que pour les diftinguer des autres fenfations de la
vue & de Fouie , que l’on peut avoir fans aucune
perception de beauté & d’harmonie,
Ici fe préfente une queftion, favoir, fi les fens font
pour nous une réglé de vérit é. Cela dépend de la maniéré
dont nous les envifageons. Quand nous voulons
donner aux autres la plus grande preuve qu’ils
attendent de nous touchant la vérité d’une chofe,
nous difons que nous l’avons vue de nos yeux; & f i
l’on fuppofe que nous Pavons vue en effet, on ne
peut manquer d’y ajouter foi; le témoignage desfens
eft donc par cet endroit une première vérité, puif-
qu’alors il tient lieu de premier principe, fans qu’on
remonte, ou qu’on penie vouloir remonter plus haut:
c’eft de quoi tous conviennent unanimement. D ’un
autre côté, tous conviennent auffi que les fens font
trompeurs ; & l’expérience ne permet pas d’en douter.
Cependant fi nous fommes certains d’une chofe
dès-là que nous l’avons vu e , comment le fens de la
vue peut-il nous tromper ; & s’il peut nous tromper,
comment fommes-nous certains d’une chofe pour Favoir
vue ?
La réponfe ordinaire à cette difficulté, c’ eft que
•notre vue & nos Jens nous peuvent tromper, quand
ils ne font pas exercés avec les conditions requifes ;•
favoir que l’organe foit bien difpofé , & que l’objet
foit dans une julle diftance. Mais cc n’eft rien dire là.
En effet, à quoi fert de marquer pour des réglés qui
juftifient le témoignage de nos fens, des conditions
■ que nous ne faurions nous-mêmes juftifier, pour favoir
quand elles fe rencontrent ? Quelle réglé infaillible
me donne-t-on pour juger que l’organe de ma
vue , de mon ouïe, de mon odorat, eft actuellement
bien difpofé r Nos organes ne nous donnent une certitude
parfaite que quand ils font parfaitement for»
mes; mais ils ne le font que pour des tempéramens
parfaits; & comme ceux-ci font très-rares, il s’en-
luit qu’il n’eft prefque àucun de nos organes qui ne
foit défectueux par quelque endroit.
Cependant quelque évidente que cette conclufion
paroiffe, elle ne détruit point une autre vérité, favoir
que l’on eft certain de ce que l’on voit. Cette
contrariété montre qu’on a laiflè ici quelque chofe à
démêler, puifqu’une maxime fenfée ne fauroitêtre
contraire à une maxime fenfée. Pour développer la
chofe, examinons en quoi nos fens ne font point réglé
de vérité, & en quoi ils le font.
i° . Nos fens ne nous apprennent point en quoi
confifte cette difpofition des corps appellée qualité,
qui fait telle impreffion fur moi. J’apperçois évidemment
qu’il fe trouve dans un tel corps une difpofition
qui caufe en moi le fentiment de chaleur & de
pefanteur ; mais cette difpofition, dans ce .qu’elle eft
en elle-même, échappe ordinairement à mes fens,
& fouvent même à ma raifon. J’entrevois qu’avec
•certain arrangement &: certain mouvement dans les
plus petites parties de ce corps, il fe trouve de la
convenance entre ce corps &c Fimpreffion qu’il fait
fur moi. Ainfi je conjecture que la faculté qu’a le fo-
leil d’exciter en moi un fentiment de lumière, con-
fifte dans certain mouvement ou impulfion de petits
corps au-travers des pores de Pair vers la rétine de
mon oeil; mais c’eft cettefaculté même, où mes yeux
ne voyent goutte, &c oîi ma raifon ne voitguere davantage.
i° . Les fens ne nous rendent aucun témoignage
d un nombre infini de difpofitions même antérieures
qui fe trouvent dans les objets, & qui furpaflènt la
îagacite de notre vue , de notre ouïe, de notre odorat.
La chofe fe vérifie manifeftement par les microf-
copes ; ils nous ont fait découvrir dans l’objet de la
Tome X F .
Vue U né infinité de difpofitiohs extérieures, qui
marquent une égale différence dans les parties intérieures,
& qui forment autant de différentes quali-
tés. Des microfcopes plus parfaits nous feroient découvrir
d’autres difpofitions -, dont nous n’avons ni
la perception ni l’idée.
30. Les fens ne nous apprennent point Fimpreffion
précife qui fe fait par leur canal ert d’autres hommes
que nous. Ces effets dépendent de la difpofition de
nos organes , laquelle eft à-peu-près auffi différente
dans les hommes que leurs teinperamens ou leurs vi-
fages ; une même qualité extérieure doit fàife auffi
différentes impreffions de fenfation en différens hommes
: c eft ce que l’on voit tous les jours. La-même
liqueur caufe dans moi une fenfation defagréable ,
& dans une autre une fenfation agréable; je ne puis
donc m’affurer que tel corps faffe précifément fur
tout autre que moi, Fimpreffion qu’il fait fur moi-
même. Je ne puis favoir auffi fi ce qui eft couleur
blanche pour m oi, n’eft point du ronge pour un autre
que pour moi.
4°. La raifon & l’expérience nous apprenant que
les corps font dans un mouvement ou changement
continuel, quoique fouvent imperceptible dans leurs
plus petites parties, nous ne pouvons juger sûrement
qu’un corps d’un jour à l’autre ait précifément la
meme qualité, ou la même difpofition à faire l’im-
preffion qu’il faifoit auparavant fur nous ; de fon côté
il lui arrive de l’alteration , & il m’en arrive du
mien. Je pourrai bien m’appercevoir du changement
d’impreffion, mais de favoir à quoi il faut l’attribuer,
fi c’eft à l’objet ou à moi, c’eft ce que je ne puis faire
par le feul témoignage de l’organe de mes fens.
50. Nous ne pouvons juger par les fens ni de la
grandeur abfolue des corps , ni de leur mouvement
abfolu. La raifon en eft bien claire. Comme nos yeux
ne font point difpofés de la même façon, nous ne devons
pas avoir .la même idée fenfible de l’étendue
d un corps. Nous devons confidérer que nos yeiix ne
font que des lunettes naturelles, que leurs humeurs
font le même effet que les verres dans les lunettes,
&: que félon la fituation qu’ils gardent entr’eux , &
félon la figureducryftallin & de fon éloignement de
la retine, nous voyons les objets différemment ; de
forte qu’on ne peut pas affurer qu’il y ait au monde
deux hommes qui les voyent précifément de la même
grandeur , ou compofés de femblables parties
puifqu’on ne peut pas affurer que leurs yeux foiént
tout-a-fait femblables. Une conféquence auffi naturelle,
c’eft que nous né pouvons connoître la grandeur
véritable ou abfolue des mouvemens du corps,
mais feulement le rapport que ces mouvemens ont
les. uns avec les autres. Il eft confiant que nous ne
faurions juger de la grandeur d’un mouvement d’un
corps que par la longueur de l’efpace que ce même
corps a parcouru. Ainfi puifque nos yeux ne nous
font point voir la véritable longueur de l’efpace parcouru,
il s’enfuit qu’ils ne peuvent pas nous faire
connoitre la véritable grandeur du mouvement.
Voyons maintenant ce cjui peut nous tenir lieù de
premières vérités dans le témoignage de no s fens. On
peut réduire principalement à trois chefs les premières
vérités dont nos fens nous inftruifent. 1 V ils rapportent
toujours très-fidelement ce qui leur paroît.
z°. Ce qui leur paroit eft prefque toujours conforme
à la vérité dans les chofes qu’il importe aux hommes
en général de favoir, à moins qu’il ne s’offre quelque
fujet raifonnable d’en douter. 30. On peut difcerner
aifément quand le témoignage des fens eft douteux,
par les réflexions que nous marquerons.
i°. Les fens rapportent toujours fidellementce qui
leur paroît ; la chofe eft manifefte, puifque ce font
des facultés naturelles qui agiffent par Fimpreffion
néceffaire des objets, à laquelle le rapport des fens