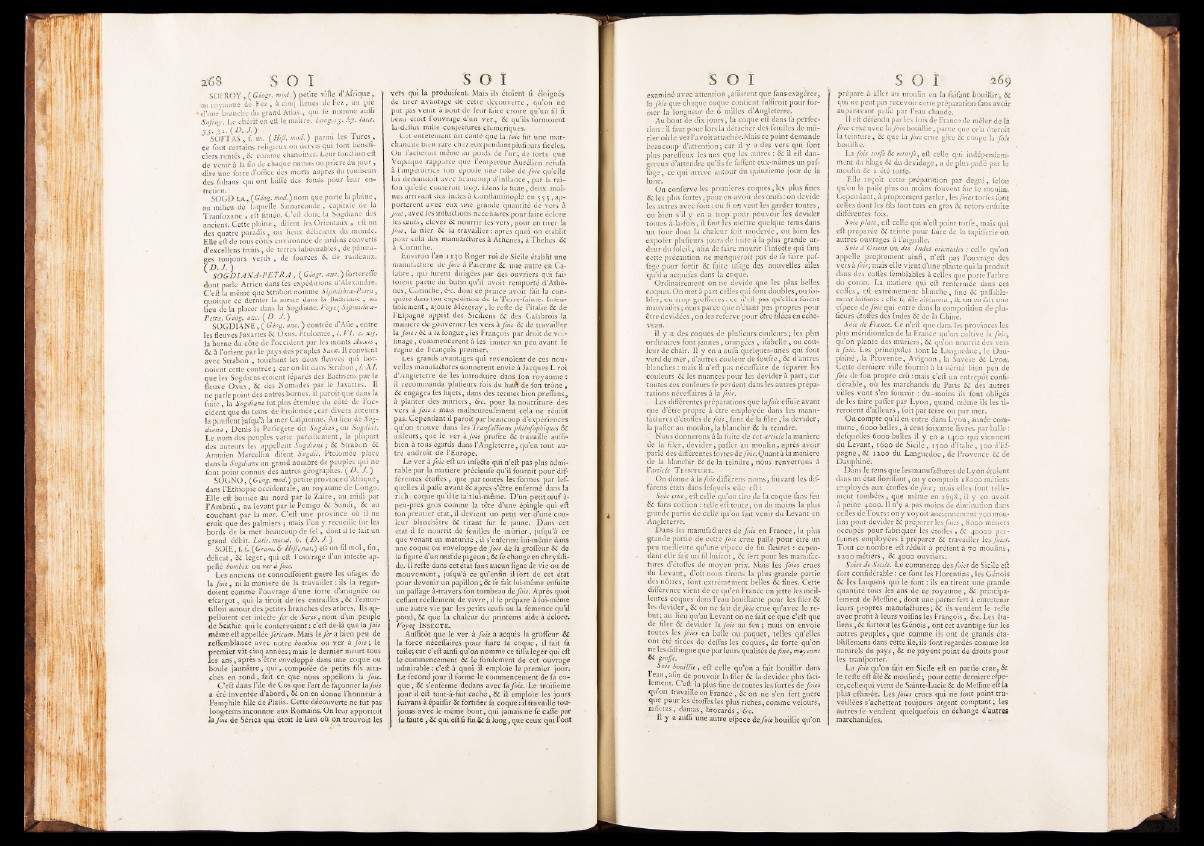
SOFROY, ( Gèogr. mod..) petite ville d'Afrique ,
au royaume de F e z , à cinq lieues de Fez, au pié
-d’une branche du grand Atlas , qui le nomme auffi ■
Sofroy. Le chérif en eft le maître. Long. 13.6.7. laut.
33. 22. {D . J .)
SOFT A S , 1'. m. (Hifh mod.) parmi les Turc s,
•ce font certains religieux ou dervis qui font benéfi-
•ciers rentés , 6c comme chanoines. Leur fonction elt
de venir à la fin de chaque namas ou priere du jourg
•dire une forte d’office des morts auprès du tombeau
des fultans qui ont laiffé des fonds pour leur en-
tretiem-
SOGD la , {Géog. mod.) nom que porte la plaine,
^u milieu de laquelle Samarcande , capitale de la
Tranfoxane , eft fituée* C ’eft donc la Sogdiane des
anciens. Cette plaine, dil'ent les Orientaux , eft un
des quatre paradis, ou lieux délicieux du monde.
Elle eft dç tous côtés environnée de jardins couverts
d’excellens fruits, de terres labourables, de pâturages
toujours verds , de fources 6c de ruilleaux.
SO G ^ IJN A -P E T R A , (Giogr. anc.) fortereffe
dont parle Arrien dans fes expéditions d’Alexandre.
C ’eft la même que Strabon nomme Sijimïthm-Pura,
quoique ce dernier la mette dans la Ba&riane , au
lieu de la placer dans la Sogdiane. Foye{ Siji/niihioe-
Petra. Géog. anc. ( D. J. )
SOGDIANE, ( Géog. anc. ) contrée d’Afie , entre
les fleuves Jaxartes 6c Oxus. Ptolomée , 1. F l. c. xij.
la borne du côté de l’eecident par les monts Auxts ,
6c à l’orient par le pays des peuples S acte. Il convient
avec Strabon , touchant les deux fleuves qui bot*
noient cette contrée ; car on lit dans Strabon, L. A /,
que les Sogdiens étoient lepares des Bactriens par le
fleuve Oxus, & des Nomades par Je Jaxartes. Il
ne parle point des autres bornes. Il paroît que dans la
fuite, la Sogdiane fut plus étendue du côté de l’occident
que du tems de Btolomee ; car divers auteurs
la pouffent jufqu’à la mer Cafpienne. Au lieu de Sog-
dïana , Denis le Periegete dit Sugdias, ou Sogdias.
Le nom des peuples varie pareillement, la plupart
•des auteurs les appellent Sogdiani ; 6c Strabon 6c
Ammien Marcellin difent Sogdii. Ptolomée place
dans la Sogdiane un grand nombre de peuples qui ne
font point connus des autres géographes. ( D. J. )
SOGNO, {Géog. mod.) petite province d’Afrique,
dans l’Ethiopie occidentale, au royaume de Congo.
Elle eft bornée au nord par le Zaïre, au midi par
l’Ambrifi, au levant par le Pemgo 6c Sundi, 6c au
couchant par la mer. C’eft une province ou il ne
•croît que des palmiers ; mais l’on y recueille fur les
bords de la mer beaucoup de fe l, dont il le fait un
grand débit. Latit. mérid. 6. {D .J . )
SOIE, f. f. {Gram. & Hijhnat.) eft un fil mol, fin,
délicat, 6c leger, qui eft l ’ouvrage d’un infedte ap-
pellé bombix ou ver à foie.
Les anciens ne connoifloient guere les ufages de
la foie, ni la maniéré de la travailler : ils la regar-
doient comme l’ouvrage d’une forte d’araignée ou
efeargot, qui la tiroit de les entrailles , 6c i’entor-
tilloit autour des petites branches des arbres. Ils ap-
pelioient cet infeôe J'er de Seres, nom d’un peuple
de Scithie qui le conlervoient : c’eft de-là que la foie
même eft appellée fericum. Mais le fer a bien peu de
reffemblance avec notre bombix ou ver à Joie ; le
premier v it cinq années ;mais le dernier meurt tous
les ans , après s’être enveloppé dans une coque ou
boule jaunâtre, q ui, compolèe de petits fils attachés
en rond, fait ce que nous appelions la foie.
C ’eft dans l’île de Cos .que l’art de façonner la J’oie
a été inventée d’abord, 6c on en donne l’honneur à
Pamphile fille de Platis. Cette découverte ne fut pas
long-tems inconnue aux Romains. On leur apportoit
la foie de Sérica qui étoit le lieu où on trouvoit les
vêts qui la produifent-, Mais ils étoient fi éloignés
de tirer avantage de cette découverte, qu’on né
put pas venir à bout de leur faire croire qu’un fil fi
beau étoit l’ouvrage d’un v e r , 6c qu’ils formoient
là-deflus mille coujeüures chimériques.
Cet entêtement fut cauie que la /oie fut une marchandée
bien rare chez eux pendant plufieurs fiecles*
On i’achetoit même au poids de l’or; de forte que
Vopiique rapporte que l’empereur Aurélien refufa
à l’impératrice Ion époufte une robe de.foie qu’elle
lui demandoit avec beaucoup d’inftance, par la rai-
fon qu’eile couteroit trop. Dans la fuite, deux moines
arrivant des Indes à Conftantinople en 555, apportèrent
avec eux une grande quantité de vers à
joie, avec les inltuttions néceffaires pour faire éclore
les oeufs, élever 6c nourrir les vers, pour en tirer la
J'oie, la filer 6c la travailler : après quoi on établit
pour cela des manufadtures à Athènes, à Thebes 6c
à Corinthe.
Environ l’an 1130 Roger roi de Sicile établit une
manufadure de foie à Palerme 6c une autre en Calabre
, qui furent dirigées par des ouvriers qui fai-
loient partie du butin qu’il avoit remporté d’Athènes,
Corinthe, &c. dont ce prince avoit fait la con*
quête dans Ion expédition de la Terre-faintè. Infen-
fibiement, ajoute M ézeray, le refte de l’Italie 6c de
l’Elpagne apprit des Siciliens 6c des Calabrois la
maniéré de gouverner les vers kfoie 6c de travailler
la foie : 6c à la longue, les François par droit de vol*
finage, commencèrent à les imiter un peu avant le
régné de François premier;
Les grands avantages qui revenoient dé ces nou*
velles manufadtures donnèrent envié à Jacques I. roi
d’Angleterre de les introduire dans fon royaume :
il recommanda plufieurs fois du haift de fon trône ,
6c engagea fes fujets, dans des termes bien preflans,
à planter des mûriers, 6-c* pour la nourriture des
vers à Joie : mais malheureufement cela ne réuflit
pas. Cependant il paroît par beaucoup d’expériences
qu’on trouve dans les Tranfactions philofophiques 6>C
ailleurs, que le ver à Joie profite & travaille auffi*
bien à tous égards dans l’Angleterre, qu’en tout autre
endroit de l’Europe.
Le ver à foie eft un infedte qui n’eft pas plus admirable
par la matière précieufe qu’il fournit pour différentes
étoffes , que par toutes les formes par lef-
quelles il paffe avant 6c après s’être enfermé dans la
rie h . coque qu’il fe fait lui-même. D’un petit oeuf à-
peu-près gros comme la tête d’une épingle qui eft
Ion premier état, il devient un petit ver d’une couleur
blanchâtre 6c tirant fur le jaune. Dans cet
état il fe nourrit de feuilles de mûrier, .jufqu’à ce
que venant en maturité, il s’enferme lui-même dans
une coque ou enveloppe de Joie de la groffeur 6c de
la figure d’un oeufde pigeon ; 6c fe change en chryfali-
1 de. Il refte dans cet état fans aucun figne de vie ou de
mouvement, jufqu’à ce qu’enfin il fort de cet état
pour devenir un papillon ; 6c fe fait lui-même enfuite
un paffage à-travers fon tombeau de foie. Après cpioi
ceffant réellement de vivre, il fe prépare à loi-meme
une autre vie par les petits oeufs ou la femence qu’il
pond, & que la chaleur du printems aide à éclore*
Foyci Insecte.
Auffitôt que le ver à foie a acquis la groffeur &
la force néceffaires. pour faire fa coque, il fait fa
toile; car c’eft ainfi qu’on nomme ce tiffu leger qui eft
le commencement & le fondement de cet ouvrage
admirable : c’eft à quoi il emploie le premier jour*
Le fécond jour il forme le commencement de fa coque,
6c s’enferme dedans avec fa Joie. Le troifieme
jour il eft tout-à-fait caché, 6c il emploie les jours
fuivans à épaiffir & fortifier fa coque : il travaille toujours
avec le même bout, qui jamais ne fe caffe par
fa faute, 6c qui eft fi fin 6c û long, que ceux qui l’ont
examiné avec attention, affluent que fans exâgéfér,
la foie que chaque coque contient fuffiroit pour former
la longueur de 6 milles d’Angleterre.
Au bout de dix jours, la coque eft dans fa perfection
: il faut pour lors la détacher des feuilles de mûrier
où le verravoit'attaehée.Mais ce point demande
beaucoup d’attention; car il y a- des vers qui font
plus pareffeux les uns que les autres : 6c il eft dangereux
d’attendre qu’ils fe fafltent eux-inemes un paffage,
ce qui arrive autour du quinzième jour de la
lune.
' On eonférveles premières coques, les plus fines
6c les plus fortes, pour en avoir des oeufs : on dévidé
les autres avec foin : ou fi on veut les garder toutes,
ou bien s’il y en a trop pour pouvoirTes dévider
toutes à-la-fois, il faut les mettre quelque tems dans
lin four dont la chaleur foit modérée, oü bien les
expofer plufieurs jours dé fuite à la plus grande ardeur
du foleil, afin de faire mourir l’infeéte qui fans
cette précaution ne manqueroit pas de fe faire paffage
pour fortir 6c faire ufage des nouvelles aîles
qu’il a acquifes dans la coque.
Ordinairement on ne dévidé que les plus belles
coques. On met à part celles qui font doubles, ou foi-
bles, ou trop groffieres : ce n’eft pas qu’elles foient
mauvaifes ; mais parce que n’étant pas propres pour
être dévidées, on les relérve pour etre filées en écheveau.
Il y a des coques de plufieurs couleurs; les plus
ordinaires font jaunes, orangées , ifabelle, ou couleur
de chair. Il y en a auffi quelques-unes qui font
verd de mer, d’autres couleur dè foufre, & d’autres
blanches : mais il n’eft pas néçeflàire de féparer les
couleurs 6c les nuances pour les devider à part ; car
toutes ces couleurs fe perdent dans les autres préparations
néceffaires à la foie.
Les différentes préparations que la foie effuie avant
que d’être propre à être employée dans les manufactures
d’étoffes de foie, font de la filer, la devider,
la paffer au moulin, la blanchir 6c la teindre*
Nous donnerons à la fuite de cet article la maniéré
de la filer, devider, paffer au moulin, après avoir
parlé des différentes fortes de foie. Quant à la maniéré
de la blanchir 6c de la teindre, nous renverrons à
l’article TEINTURE,
On donne à la foie différens noms, fuivant les dif-
férens états dans lefquels elle eft:
Soie crue, eft celle qu’on tire de là coque fans feu
6c fans coûion : telle eft toute, ou du moins la plus
grande partie de celle qu’on fait venir du Levant en
Angleterre.
Dans les manufadures de foie en France, la plus
grande partie de cette foie crue paffe pour être un
peu meilleure qu’une efpece de fin fleuret : cependant
elle fait un fil luifant, 6c fert pour les manufactures
d’étoffes de moyen prix. Mais les foies crues
du Levant, d’où nous tirons la plus grande partie
des nôtres, font extrêmement belles 6c fines. Cette
différence vient de ce qu’en France on jette les meilleures
coques dans l’eau bouillante pour les filer 6c
les devider, 6c on ne fait ae foie crue qu’avec le rer
but; au lieu qu’au Levant on ne fait ce que e’eft que
de filer 6c devider la Joie au feu ; mais on envoie
toutes les foies en balle ou paquet, telles qu’elles
ont été tirées de deffus les coques, de forte qu’on
jùe les diftingue que par leurs qualités de fine, moyenne
Soie bouillie > eft celle qu’ori a fait bouillir dans
1 eau, afiij de pouvoir la filer 6c la devider plus facilement.
C’eft la plus fine de toutes les fortes de foies
qu on travaille en France , 6c on ne s’en fert guere
que pour les étoffes les plus riches , comme velours,
taffetas, damas, brocarjds , &c.
U y a auffi une autre efpece de/ôïe bouillie qu’on
prépare à aller au moulin en la faifant bouillir-, 6c
qui ne peut pas recevoir cette préparation fans avoir
auparavant paffé par l’eau chaude.
U eft défendu par les lois de France de mêler de là
foie crueuvec 1a,foie bouillie, parce que cela ôteroit
la teinture, 6c que la foie crue gâte 6c coupe la foie
bouillie.
La foie totfe 6c retorfe, eft celle qui indépendamment
du filage 6c du devidage, a de plus paffé par le
moulin 6c a été torfe. .
Elle reçoit cette préparation par deg'ré, félon
qu’on la paflè plus ou moins fouvent fur le moulin.
Cependant, à proprement parler, les foies torfes font
celles dont les fils font tors en gros 6c retors enfuite
différentes fois.
Soie plate, eft celle qui n’eft point torfe, mais qui
eft préparée 6c teinte pour faire de la tapifferie où
autres ouvrages à l’aiguille.
Soie d’Orient' ou des Indes drieritales : celle qu’on
appelle proprement ainfi, n’eft pas l’ouvrage des
vers kfoie; mais elle vient d’une plante qui la produit
dans des eoffes femblables à celles que porte l’arbre
du çoton. La. matière qui eft renfermée dans ces
eoffes, eft extrêmement blanche, fine 6c paisiblement
luifame : elle fe file ailément, 6c on en fait une
efpece de foie qui entre dans la compofitioij de plufieurs
étoffés des Indes 6c de la Chine.
Soie de France. Ce n’eft que dans les provinces lés
plus méridionales de la France qu’on cultive la foiey
qu’on plante des mûriers, 6c qu’on nourrit des vers
à foie. Les principales font le Languedoc, le Dau-
phiné, la Provence, Avignon, la Savoie 6c Lyon;.
Cette derniere ville fournit à la vérité bien peu dé
foie de fon propre crû : mais c’eft un entrepôt co,nfi-
dérablé, où les marchands de Paris 6c des autres
villes vpnt s’en fournir : du-moins ils font obligés
de les faire paffer par Lyon , quand même ils les ti-
reroient d’ailleurs , foit par terre ou par mer.
On compte qu’il en entre dans Lyon, année commune,
6000 balles, à cent foixante livrés par halle :
defquelles 6000. balles il y en a 1400 qui viennent
du Levant, 1600 de Sicile, 1500 d’Italie, 300 d’Ef-
pagne, 6c 1200 du Languedoc, de Provence 6c de
Dauphiné*
Dans le tems que lesmanufa<ftures de Lyon étoient
dans un état floriffant, on y comptoit 18000 métiers
employés aux étoffes de foie; mais elles font tellement
tombées, que même en 1698, il y en avoit
à peine 4000. Il n’y a pas moins de diminution dans
celles deTours: on y voyoit anciennement 700 moulins
pour devider 6c préparer les foies , 8000 métiers
occupés pour fabriquer les étoffes > 6c 40000 per-
fonnes employées à préparer 6c travailler les foies.
Tout ce nombre eft réduit à préfent à 70 moulins;
1200 métiers, 6c 4000 ouvriers.
Soies de Sicile. Le commerce des foies de Sicile eft
fort confidérable : ce font les Florentins, les Génois
& les Luqiiois qui le font : ils en tirent une grande
quantité tous les ans de ce royaume, 6c principalement
de Meffine, dont une partie fert à entretenir
leurs propres manufaflures ; 6c ils vendent le refte
avec profit à leurs voifins les François, &c. Les Italiens
, 6c furtout les Génois, ont cet avantage fur les
autres peuples, que comme ils ont de grands éta-
bliffemens dans cétte île, ils font regardés comme les
naturels du pays, & ne payent point de droits pour
les tranfporter.
La foie qu’on fait en Sicile eft en partie crue, &
le refte eft filé & mouliné; pour cette derniere efpece,
eellequi vient de Sainte-Lucie 6c de Meffine eft la
plus eftimée. Les foies crues qui ne font point travaillées
s’achettent toujours argent comptant ; les
autres fe vendent quelquefois en échange d’autres
marçhandifeSi