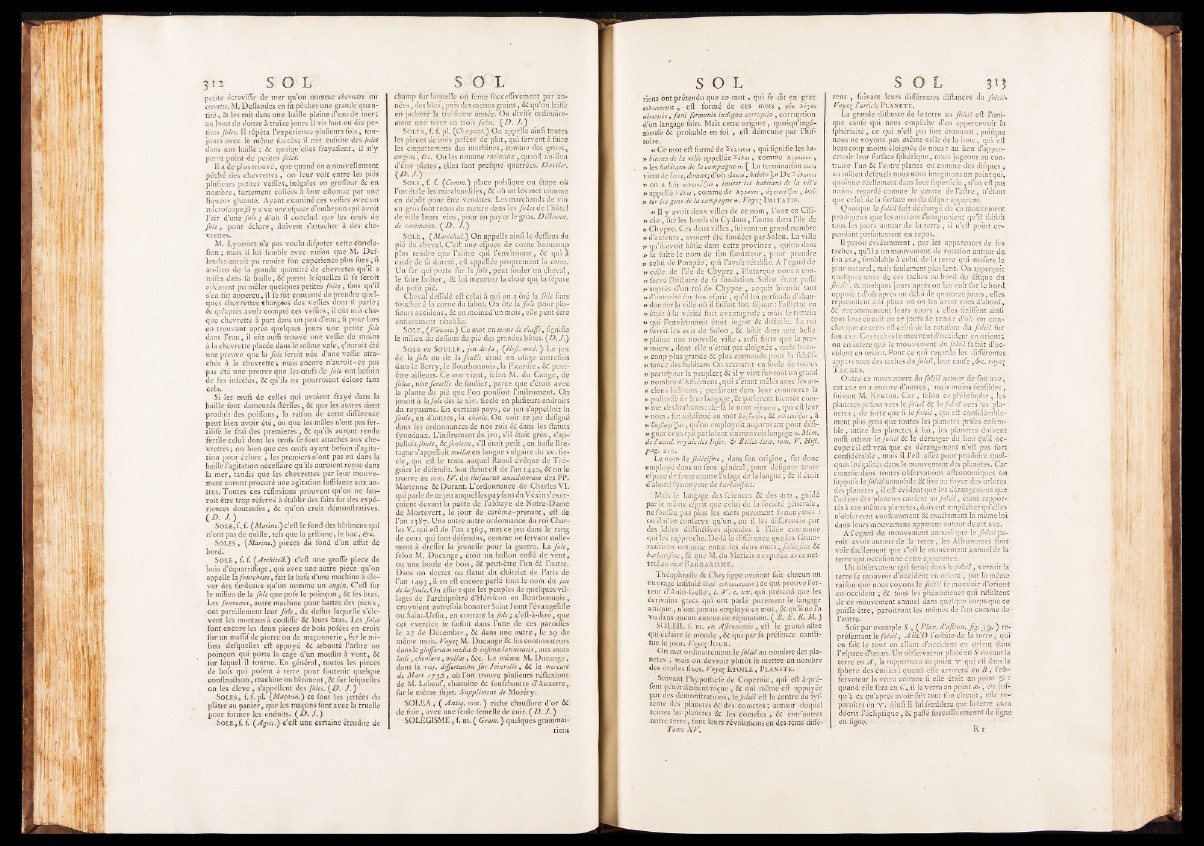
petite écreviffe de mer qu’oft nomme chevrette ou
, crevette. M. Deflandes en fit pêcher une grande quantité
, & les mit dans une baille pleine d’eau de mer ;
au bout de douze à treize jours il vit huit ©u dix petites
foies. Il répéta l’expérience plufieurs fois, toujours
avec le même fuceès; il mit enfuite des joies
dans uns baillé ; & quoiqu’elles frayaflènt, il n’y
parut point de petites foies.
11 a de plus trouvé, que quand on a nouvellement
pêché des chevrettes , on leur voit entre les pies
plufieurs petites veffies, inégales en groffeur & en
nombre, fortement collées à leur eftomac par une
liqueur gluante. Ayant examiné ces veffies avec un
microfcope,il y a vu une éfpece d’embryon qui avoit
l ’air d’une joie • d’oh il cortclud que les oeufs de
fo ie , pour éclore, doivent s’attacher à des chevrettes.
M. Lyonhet n’a pas voulu difputer cette éonclu-
fion ; mais il lui fernble avec raifon que M. Deflandes
aurait pu rendre fon expérience plus fure, fi
an-lieu de la grande quantité de ehevretes qu’il a
mifes dans fa baille, & parmi lefquelles il fe feroit
aifément pu mêler quelques petites foies, fans qu’il
s ’en fût apperçu, il fe fût contenté de prendre quelques
chevrettes chargées des veffies dont il parle ;
&c qu’après avoir compté ces veffies, il eût mis chaque
chevrette à part dans un peu d’eau; fi pour lors
en trouvant après quelques jours une petite foie
dans l’eau T il eût auffi trouvé une veffie de moins
à la chevrette placée dans le même vafe, c’aurait été
une preuve que la foie feroit née d’une veffie attachée
à la .chevrette ; mais encore n’aurait-ce pas
pas été une preuve que les-oeufs de foie ont béfoin
de fes infeûes, & qu’ils ne pOurroient éclore fans
cela.
Si les oeufs de celles qui avoient frayé dans la
baille font demeurés ftériles, & que les autres aient
produit des poiffons, la raifon de cette différence
peut bien avoir été, Ou que les mâles n’ont pas fer-
tilifé le frai des premières , & qu’ils auront rendu
fertile celui dont les oeufs fe font attachés aux chevrettes
; ou bien que ces oeufs ayant befoin d’agitation
pour éclore , les premiers n’ont pas eu dans la
baille l’agitation néceffaire qu’ils auroient reçue dans
la mer, tandis que les chevrettes par leur mouvement
auront procuré une agitation fuffifante aux autres.
Toutes ces réflexions prouvent qu’on ne fau-
roit être trop réfervé à établir des faits fur des expériences
doutenfes, & qu’on croit démonftratives.
(;Z>. J. j
SoLE,f.;f. (Marine.) c’eft le fond des bâtimens qui
n’ont pas de ouille, tels que la gribane, le bac, &c.
Soles , (Marine.) pièces du fond d’un affût de
bord.
Sole , f. f. (.Architecl.) c’eft une greffe pieee de
bois d’équarriffage, qui avec une autre piece qu’on
appelle la fourchette, fait la bafe d’une machin e à élever
des fardeaux qu’on nomme un engin. C ’eft fur
le milieu de la foie que pofe le poinçon, & fes bras.
Les Jbnneetes, autre machine pour battre des pieux,
ont pareillement leur fo ie , de defius laquelle s’élèvent
les montans à cottliffe & leurs bras. Les foies
font encore les deux pièces de bois pofées en croix
fur un maffif de pierre ou de maçonnerie, fur le milieu
defquelles eft appuyé & arbouté l’arbre ou
poinçon qui porte la-cage d’un moulin à vent, &
fur lequel il tourne. En général, toutes les pièces
de bois qui pofent à terre pour foutenir quelque
conftruôion, machine ou bâtiment, & fur lefquelles
on les éleve, s’appellent des foies. (D . J. )
Soles y f. f. pl. (Maçonn?) ce font les jettées du
plâtre au panier, que les maçons font avec la truelle
pour former les enduits. (Z>. J . j
S o l e , 1, f . ( A griç.) e ’e f t u n e c e r ta in e é ten d u e d e
chafnp fur laquelle on femé fucceffivement par années
, des blés, puis dès menus grains, & qu’on laiffé
en jachère la tfaifieme année. On divile ordinairement
une terré ën trois foies. (D . / .)
Soles, f. f. pl. (Charpent.)On appelle ainfi toutes
les pièces de bôis pofées' db plat, qui fervent à faire
les ëmpattèmens dès machines, comme des grues ,
engins, &c. On lès nomme racinaùx, quand au-lieu
d’êtrë plates, elles font prefque quarrées. Daviler.
(Z>. / .) ■ : • ; • ;
So l e , f. f. (Comm.) place publique ou etape oh
l’on étale les marchandifes, & oh on lés met comme
en dépôt pour être vendues. Les marchands de vin
en gros font tenus de mettre dans les foies de l’hôtel
de ville leurs vins-, pour en payer le gros. Diclionn.
de commerce. ( D. / .)
Sole , (Maréchal.') On appelle ainfi le deiTous du
pie du cheval. C ’eft une efpece de corne beaucoup
plus tendre que l’autrê qui l’environne, & qui à
caufe de fà dureté, eft appellée proprement la corne.
Un fer qui porte fur là foie, peut fouler un cheval,
le faire boiter, ôc lui meurtrir la chair qui la fépare
du petit pïé.
Cheval deffolé eft celui à qui on a Ôté la foie fans
toucher à la corne du fabot. On ôte la foie pour plufieurs
accidens, & en moins d’un mois, elle peut être
entièrement rétablie.
Sole, (vénerie?) Ce mot en terme de chaffe, lignifie
le milieu du deffous du pié des grandes bêtes. (D. J.)
Sole ou Soulle , jeu de la , (Hijl. mod. y Le jeu
de la foie ou de la foulle étoit en ufage autrefois
dans le Berry, le Bourbonnois, la Picardie, & peut-
être ailleurs. Ce mot vient, félon M. du Cange, de
folea, une femelle de foulier, parce que c’étoit avec
la plante du pié que l’on pouffoit l’inflrument. On
jouoit à la foie dès le xiv. fieele en plufieurs endroits
du royaume. En certains pays, ce jeu s’appelloit la
foule, en d’autres, la chéole. On voit ce jeu défigné
dans les ordonnances de nos rois & dans les ftatuts
fynodaux. L’inftrument du jeu, s’il étoit gros, s’appelloit
Joule, fkjbulette, s’il étoit p etit, en baffe Bretagne
s’appelloit mellat en langue vulgaire du xv. fieele,
qui eft le tems auquel Raoul évêque de Tré-
guier le défendit. Son ftatuteft de l’an 1440, & on le
trouve au tom. IV. du thejaurus anecdotorum des PP.
Martenne & Durant. L’ordonnance de Charles V I.
quiparle de ce jeu auquel les pay fans du Véxins’exer-
çoient devant la porte de l’abbaye de Notre-Dame
de Mortevert, le jour de carême-prenant, eft de
l’an 1387. Une autre autre ordonnance du roi Charles
V. qui eft de l’an 1369, met ce jeu dans le rang
de ceux qui font défendus, comme ne fervant nullement
à dreffer la jeuneffe pour la guerre. La foley
félon M. Ducange, étoit un ballon enflé de vent,
ou une boule de bois, & peut-être l’un & l’autre.
Dans un decret ou ftatut du châtelet de Paris de
l’an 1493 , il en eft encore parlé fous le nom du jeu
de lafoule. On aflure que les peuples de quelques villages
de l’archiprêtre d’Hérifcon en Bourbonnois,
croyoient autrefois honorer Saint Jeant l’évangelifte
ou Saint-Urfin, en courant la foie ; c’eft-à-dire, que
cet exercice fe faifoit dans l’une de ces paroiffes
le 2.7 de Décembre, & dans une autre , le 29 dir
même mois. Voyeç M. Ducange & fes continuateurs
dans leglojarium media & infima latinitatis, aux mots
Ludi, cheoUre, mellat, &c. Le même M. Ducange,
dans fa viij. dijfertadon fur Joinville, & le mercure
de Mars 173Ó, oh l’on, trouve plufieurs réflexions
de M. Leheuf, chanoine & foufehantre d’Auxerre,
fur le même fujet. Supplément de Moréry.
SOLEA , ( Antiq. tom. ) riche chauffure d’or &
de foie , avec une feule femelle de cuir. (D . J .)
SOLÉCISME, f, m. ( Gram. ) quelques grammairiens
riehs ont prétendu que Ce mot, qui fe dit en gfee
coXomo-pcç , eft formé de ces mots., <ro« Aoyou
tthrrpoç, fani fermonis indigna corruptio , corruption
d’un langage faim. Mais cette origine, quoiqu’ingé-
nieufe & probable en foi , eft démentie par l’nif-
toire.
« C e mot eft formé de xctxoi, qui lignifie les ha-
» bilans de la ville appellée TÔMi, comme AypoiKot ,
» les kabitans de la campagne ». [ La terminaifon omet
vient de or.uet domus; d’oh oIkuu , habito ].« De ^oXoikoi
» on a fait eoXoïni f iiv , imiter les habitan's de la vil'e
» appellé Z’oAo/ ; comme de Aypaxoi, aypcixi fytv, imi-
» ter les gens de la campagne ». Voye£ IMITATIF.
« Il y avoit deux villes de ce nom, l’une en Cili-
» cie fur les bords du Cydnus, l’autre dans l’île de
» Chypre. Ces deux villes ,fuivant un grand nombre
» d’auteurs, avoient été fondées par Solon. La ville
» qu’iUâvoit bâtie dans cette province , quitta dans
» la fuite le nom de fon fondateur, pour prendre
» celui de Pompée, qui l’avoit rétablie. A l’égard de
»celle de l’île de Chypre , Plutarque nous a çon-;
»• fervé l’hiftoire de fa fondation. Solon étant paffé
»•auprès d’un roi de Chypre , acquit bientôt tant
» d’autorité fur fon efprit, qu’il lui perfuada d'aband
o n n e r la ville oh il faifoit fon féjour : l’affiette en
» étoit à la vérité fort avantageüfe ; mais le t-errein
» qui l’envii'onnoit étoit ingrat & difficile. Le roi
» fuivit les avis de Solon , & bâtit dans une belle
» plaine une nouvelle ville , auffi forte que la pre-
» mière , dont elle n’étoit pas éloignée , mais beau-
» coup plus grande & plus commode pour la fubfif-
» tance des habitans On accourut en foule de toutes
» parts^our la peupler; ôc il y vint fur-tout un grand
» nombre d’Athéniens, qui s’ étant mêlés avec les an-
» ciens habitans , perdirent dans leur commerce la
» politefte de leur langage, & parlèrent bientôt com-
» me des barbares: de-là le nom coXoïxot, qui eft leur
» nom. fut fubftitué au mot /3 JpCapoe, & nXoïxi'^uv, à
» ÇapCttpt'Çuv, qu’on employoit auparavant pour défi-
»’gner ceux qui parloient un mauvais langage ». Mém.
de tacad. royale des Infer. & Belles-lettr. tom. V. Hifi.
p a g . 2 ià.
Le nom de folécifme, dans fon origine, fût donc
employé dans un fens général, pour défigner toute
efpece de faut.e contre l’ufage de la langue ; & il ctoit
d’abord fy nonyme de barbarijme.
' Mais le langage des fciences & des arts , guidé
par le même eiprit que celui de.la fociété générale,
ne fouffre- pas plus les mots purement fynonymes :
ou il n en conferve qu’u n , oh il les difFérencie par
des ,idées difiinélives ajoutées à l’idée commune
qui les rapproche. De-là là différence que les Grammairiens
ont.mife entre -les deux-.mots , folécifme &
ba.rba.nfne, & que M. du Mariais a expofée avec net-
teté,au wôz'B a r b a r i s m e / .
Théophrafte & Chryfippe avoient fait chacun un
ouvrage intiiulérkp? ^Aaixin^mv^ze qui prouve l’erreur
d’Aulu-Geik',./. tV. c. x x . qui prétend que les
écrivains grecs qui ont parlé purement le langage
attique, n’ont jamais employé ce mot, & qu’il ne l’a
vu dans- aucun auteur de réputation. ( B. E . R. M. )
SOLEIL f. m. en AJlranomie , eft .le grand aftre
qui éclaire le monde , & qui par fa préfence confti-
tue le jour. Voye^.. Jour.
On met ordinairement le foleil au nombre des pla-
ftetgs ; mais on devroit plutôt, le mettre au nombre
des étoiles fixes. Voye^ Étoile , Planete.
Suivant l’ hy.pothèfe de Cbpernic, qui eft à-pré-
fent généralement reçue , & qui même eft appuyée
par des démonftratiôns, \e Joleil e-ft le centre du fyf-
îèfne; dès planètes & r des1 comet.es ; autour duquel
toutes les planètes & lès' Cômeîes'i"& entr’autres
notre terre, .font leurs révolutions en des-tems diffé-
Tome X V %
refis , fluvant leurs différentes diftancêS du foleil*
Voye{ C article PLANETE.
La grande diftance de la terre au foleil eft l’unique
caufe qui nous empêche d’en appercevoir la
fphéricité , ce qui n’eft pas fort étonnant, puifque
nous ne voyons pas même celle de la lune, qui eft
beaucoup moins éloignée de nous : au lieu d’apper-
cevoir leur furface fphérique, nous jugeons au contraire
l’un & l’autre planes ou comme des difques ,
au milieu defquels nous nous imaginons un point qui,
quoique réellement dans leur fuperficie , n’en eft pas
moins regardé comme le centre de l’aftre, n’étant
que celui de la furface ou du difque apparent.
Quoique le foleil foit déchargé de ce mouvement
prodigieux que les anciens s’imaginoient qu’il feifoit
tous les jours autour de la terre, il n’eft point cependant
parfaitement en repos.
Il paroît évidemment, pat les apparences de fes
taches, qu’il a un mouvement de rotatibn autour de
..fon axe , femblable à celui de la terre qui mefure le
jour naturel, mais feulement plus lent. On apperçoit
quelques-unes de ces taches au bord du difque dit
foleil, & quelques jours après on les voit fur le bord
oppofé ; d’oh après un délai de quatorze jours, elles
reparoiffent à la place oh on les avoit vues d’abord,
& recommencent leurs cours ; elles Unifient ainfi
tout leur circuit en 27 jouïs de tems : d*ôh on conclut
que ce tems efi-celïii de la rotation du foleil fur
fon axe. Ces taches fe meuvent d’occident en orient;
on en infère que le mouvement du foleil fefait d’occident
en orient. Pour ce qui regarde les différentes
apparences des taches du foleil, leur caufe, &c. voyei
T aches.
Outre ce mouvement du foleil autour de fon axe,
cet axe en a encore d’autres, mais moins fenfibles ,
fuivant M. Newton. Car , félon ce philofophe , les
pianetes pefent vers le foleil & le foleil vers les planètes
; de forte que fi le fole il, qui eft confidérable-
ment plus gros que toutes les pianetes prifes enfem-
b le , attire les pianetes à lu i, les pianetes doivent
auffi attirer lé foleil 6c le déranger du lieu qu’il oc-
çupe ;' il eft vrai que ce dérangement n’eft pas fort
confidé'rable , mais il. l-’eft aflez pour produire quelques
inégalités dans le mouvement des pianetes. Car
comme dans toutes obfervations aftronomiques on
fuppofe 1 à foleil immobile & fixe au foyer des orbites
des pianetes , il eft évident que les dérangemens que
l’aftion des (planetes caufent au foleil, étant rapportés
à ces mêmes pianetes, doivent empêcher qu’elles
n?obfervént conftamment & exaftement la même loi
dans leurs mouvemens apparens autour de cet axe.
A l’égard du mouvement annuefque le foleil paroît
avoir autour de la terre , les AftronOmes font-
voir facilement que c’eft le mouvement annuel de la
terre qui bccafionne cette apparence.
Un obfervateur qui feroit dansle^feî/vverr'oit la
terre fe mouvoir d’oceident en orient, par la même
raifori-que nous voyons le foleil fe mouvoir d-orient
en occident ; & tous les phénomènes qui réfultent
de ce mouvement annuel dans quelque èorps-que ce
puifle être, paroîtront les mêmes de l’un comme de •
l’autre.
Soit par exemple S , ( Plan, d’aftron. fig. 3 j* ) fe-
préfentant le fole il, ABCD l’orbite de la terre j qui
en fait le tour en allant d’occident en orient dans
. l’ëfpace d’un an. Un obfervateùr placé en S voyant la
terre en A , la rapportera au point T qui eft dans la
fphere des étoiles : quand elle arrivera en:B-j Tob-r
fervateur la verra comme fi elle étoit au point <3
quand elle fera en C, il ia verra au point =ü , àc. juf-
qu’à ce qu’après avoir fait tout fon circuit,, elle re«"
paraîtra en y . Ainfi il lui femblera que la terre aura
décrit l’écliptique , ôc paie fuçceffivemennt de figne
en fi0gn e. - r» &