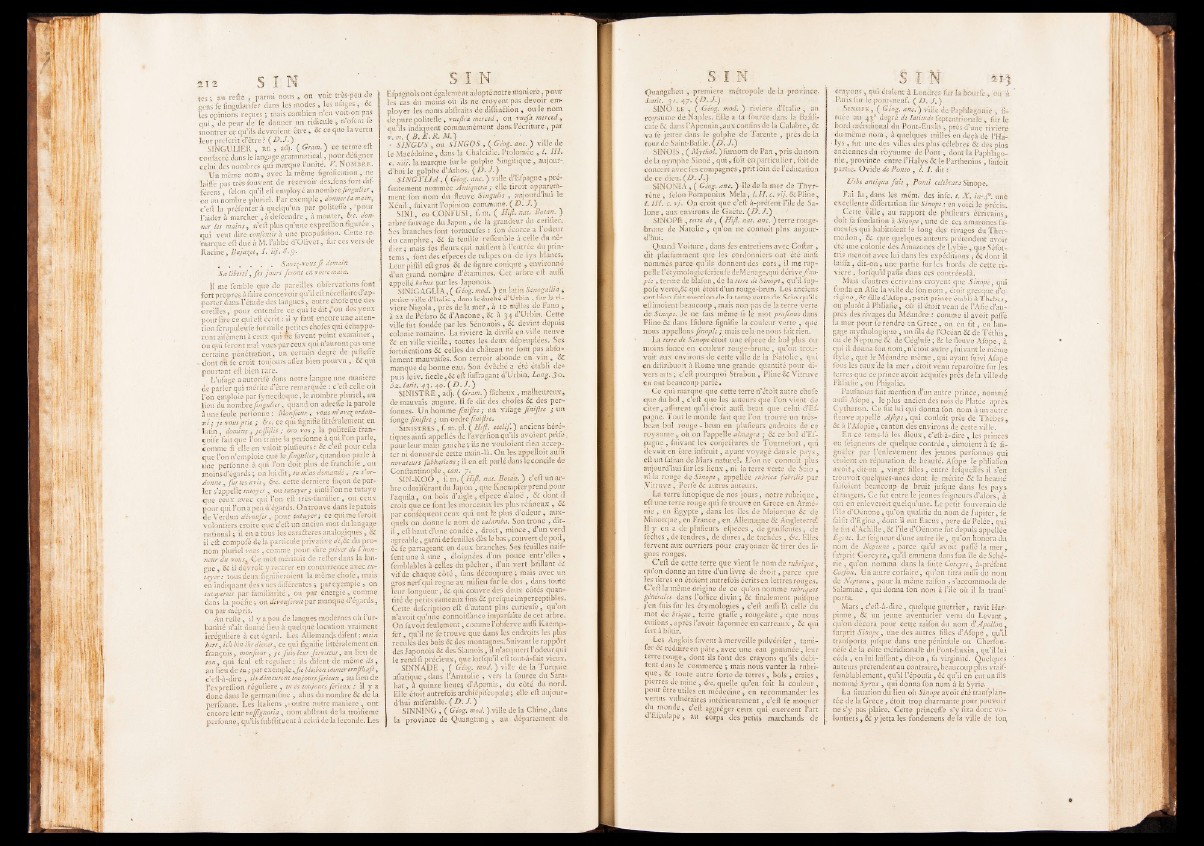
2 . 1 2 S I N
tes ; au refte , parmi nous , on voit très-peu de
gens fe fingularifer dans les modes , les ufages , Si
les opinions reçues ; mais combien n’en voit-on pas
qui, de peur de fe donner un ridicule -, nofentfe
montrer ce qu’ils devroient être, Si ce que la vertu
leur prefcrit d’être ? (Z)./. )
SINGULIER , RE , adj. ( Grant. ) ce terme eft
confacré dans le langage grammatical, pour déligner
celui des nombres qui marque l’unité. Vu Nombre.
Un même nom, avec la même lignification , ne
ïaifle pas très-fouvent de recevoir desjens fort dif-
féreiis, félon qu’il eft employé au nombre fingulitr,
ôu au nombre pluriel. Par exemple, donner la main,
c’eft la présenter à quelqu’un par politeffe , ‘pour
l’aider à marcher , à defcendre , à monter, &c. donner
les mains, n’eft plus qu’une expreflion figurée ,
qui veut dire confentir à une propofition. Cette remarque
eft duë à M. l’abbé d’O livet, fur ces vers de
Racine, Baja^et, I. iij. 8.$.
. . . . . . Saveç-vousfi demain
Sa liberté, jes jours feront en votre main.
Ï1 me femble que de pareilles obfervations font '
fort propres, à foire concevoir qu’il eft nécefiaire d’apporter
dans l’étude des langues ? autre chofe que des
oreilles, pour entendre ce qui fe dit * ou des yeux
pour lire ce qui eft écrit : il y fout encore une attention
fcrupuieufe fur mille petites chofes qui échapperont
aifément à ceux qui fie favent point examiner,
ou qui feront mal vues par ceux qui n’auront pas une
certaine pénétration, un certain degre de juftcffe
„ dont on fe croit toujours allez bien pourvu , Si qui
pourtant eft bien rare..
L’ufage a autorifé dans notre langue une maniéré
de parler qui mérite d’être remarquée : c’eft celle oii
l’on emploie par fyneedoque,le nombre pluriel, au
lieu du nombreJingulier, quand on adreffe la parole
à une feule perfonne : Monjjeur , vous n i ave£ ordonné;
je vous prie ; &c. ce qui fignifie littéralement en
latin , domine * jujfijlis ; oro vos ; la politeffe fran-
coife fait que l’on traite la perfonne à qui.l’on parle,
comme fi elle en valoit plufieurs : Si c eft pour cela
que l’on n’emploie que le Jingulier, quand on parle a
line perfonne à qui l’on doit plus de franchife , ou
moins d’égards ; on lui dit, tu nias demandé, je t ’ordonne
, fur ies avis -, &c. cette derniere façon de parler
s’appelle tutoyer , ou tutayer ; ainfi l’on ne tutaye
que ceux avec qui l’on eft très-familier, ou ceux
pour qui l’on a peu d’égards. On trouve dans le patois
de Verdun dévoujïr, pouf tutayer ; ce quimeferoit
volontiers croire que c’eft un ancien mot du langage
national ; il en a tous les caractères analogiques , S i
il eft compofé delà particule privative défie du pronom
pluriel vous , comme pour dire priver de l honneur
du vous. Ce mot méritoit de refter dans la langue
, Si il devroit y rentrer en concurrence avec tutayer:
tous deux fignifieroient la même chofe, mais
en indiquant des vues différentes ; f)ar exemple , on
tutayeroit par familiarité , ou par énergie, comme
dans la poéfie ; On dévouferoit par manque d’egards,
ou par mépris.
Au refte, il y a peu de langues modernes où l’urbanité
n’ait donné lieu à quelque locution vraiment
irrégulière à cet égard. Les Allemands difent : mein
herr, ichbinihr diener, ce qui fignifie littéralement en
françois, monfuur, je fuis leur ferviteur, au lieu de
ton, qui feul eft régulier : ils difent de même ils ,
au lieu de tu; par exemple ,fie bleiben immer ernjlhaft
c’eft-à-dire , ils démeurent toujours fèrieux, au lieu de
l’expreffion régulière , tu és toujours fèrieux : il y a
donc dans le germanifme , abus du nombre Si de la
perfonne. Les Italiens , • outre notre maniéré , ont
encore leur vofjignoria, nom abftrait de la troifieme
perfonne qu’ils fubftituent à celui de la fécondé. Les
f i
Efpagnols ont également adopté notre maniéré, p our
les cas du moins où ils ne croyent pas devoir employer
les noms abftraits de diftin&ion , ou le nom
de pure politeffe , vueflra merced, ou vuefa merced,
qu’ils indiquent communément dans l’écriture, par
■ v. m. ( B. E. R. M. )
• S INGUS , ou SINGQS , ( Géog. anc .j ville de
le Macédoine, dans la Chalcidie. Ptolomee , /. III-
c. xiij. la marque furie golphe Singitique , au jour-,
d’hui le golphe d’Athos. (L). / .) / •
S IN G Y L I A , ( Géog. anc.) ville d’Efpagne , pre-
fentement nommée Antiquera ; elle tiroit apparemment
fon nom du fleuve Singulis , aujourdhui le
X én il, fuivant l’opinion commune. (D . J.)
SINI, ou CONFUSI, f.m. ( Hiß. nat. Botan. )
arbré fauvage du Japon, de l'a grandeur au cenfieii.
Ses branches font tortueufes : fon écorce a l’odeur
du camphre , Si fa feuille reffemble à celle du néflier
; mais fes fleurs qui naiffent à l’entree du prin-
tems , font des efpeces de tulipes ou de lys blancs*
Leur piftil eft gros & de figure conique , environné
d’un grand nombre d’étamines. Cet arbre eft auffi
appellé kobus par les Japonois. ■
SINIGAGLIA, ( Géog. mod. ) en latin Senôgalliaÿ
petite ville d’Italie , dans le duché d’Urbin , fur la rivière
N igola, près de la m er, a i o milles de Fano *
à 2.2, de Péfaro Si. d’Ancone , Si à 34 d’ Urbin. Cetté
ville fut fondée par les Sénonois , Si devint depuis
colonie romaine. Lariviere la divife en v ille neuve
Si en ville vieille, toutes les deux dépeuplées. Ses
fortifications Si celles du château ne font pas abfo-
lument mauvaifes. Son terroir abonde en^ vin * Si
manque de bonne eau. Son eveche a ete établi depuis
leiv . fiecle, Si eft fuffragant d’Urbin. Long. 30,
5z . latit. 43. 40. (D . J. ) _ 1
SINISTRE, adj. ( Gram. ) fâcheiix , malheureux*
de mauvais augure. Il fe dit des chofes Si des per-
fonnes. Un homme ßnifire; un vifage finißre ; un
fonge ßnifire ; un ordr e finißre.
Sinistres , f. m. pl. ( Hiß. cccléf.) anciens hérétiques
ainfi appellés de l’averfion qu’ils avoient p rife.
pour leur main gauche ; iis ne vouloient rien accepter
ni donner de cette main-là. On les appelloit auffi
novateurs fabbatiens ; il en eft parlé dans le concile de
Conftantinople, can. 7 . £.
SIN-KOO , f. m. {Hiß. nat. Botan.) c’eft un arbre
odoriférant du Japon , que Kaempfer prend pour
l’aquila, ou bois d’aigle, efpece d’aloë , Si dont il
croit que ce font les morceaux les plus réfineux , Si
par conféquent ceux qui ont l'e plus d’odeur, auxquels
on donne le nom de calamba. Son tronc , dit-
il , eft haut d’une coudée , droit, mince, d’un verd
agréable, garni de feuilles dès le bas, couvert de poil,
Si fe partageant en deux branches. Ses feuilles naiffent
une à une , éloignées d’un pouce entr’elies ,
femblables à celles du pêcher, d’un vert brillant Si.
v if de chaque cô té , fans découpure ; mais avec un
gros nerf qui regne au milieu fur le dos , dans tourte
leur longueur, Si qui couvre des deux côtés quantité
de petits rameaux fins & prefque imperceptibles.
Cette defeription eft d’autant plus curieufe, qu’on
n’a voit qu’une connoiffance imparfaite de cet arbre.
On favoit feulement, comme l’obferve auffi Kaempfe
r , qu’il ne fe trouve que dans les endroits les plus
reculés des bois & des montagnes. Suivant le rappôrt
des Japonois Si des* Siamois, il n’acquiert l’odeur qui
le rend fi précieux, que lorfqu’il eft tout-à-fait vieux.
SINNADE , ( Géog. mod. j ville de, la Turquie
afiatique, dans l’Anatolie , vers la four ce du Sara-
b a t, à quinze lieue$ d’Apamis, du côté du nord.
Elle étoit autrefois archiépifcopale ; elle eft aujourd’hui
miférable. ( D . J. )
SINNING, ( Géog. mod. ).ville de la Chine, dans
I la province de Quangtung -, au . département de
S I N
Quartgcheù , première métropole delà province.
Latit. 31. 47. (A>. J.)
SINO le , ( Géog. mod. ) riviere d’Italie , au
-royaume de Naples. Elle a fa fource dans la, Bafili-
cate Si dans l’Apennin ,.aux confins de la Calabre, Si
va fe jetter dans le golphe de Tarente , près de la
tour de SaintBafile. (Z?. J .j
SINOIS , ( Mythol. ) furnom de Pan , pris du nom
de la nymphe Sinoë, qui, foit en particulier, foit de
concert avec fes compagnes, prit foin de-l’éducation
de ce dieu. (Z>. J.J
SINONIA , ( Géog. anc. ) île de la mer de Thyr-
rène , félon Pomponius Mêla, l. II. c. vij. Si Pline,
7. III. c. vj. On croit que c’eft à-préfent l’île de Sa-
lone , aux environs de Gaëte. (Z>. J .j .
SINOPE , terre de, ( Hijl. nat. anc. ) terre rouge-
brune de Natolie , qu’on ne connoît plus aujourd
’hui.
Quand V oiture, dans fes entretiens avec Coftar ,
dit plaifamment que- les cordonniers ont été ainfi
nommés parce qu’ils donnent des co rs, il me rappelle
l’étymologie férieufe deMénage,qui dérivefino-
.ple , terme de blafon, de la terre de Sinope, qu’il fup-
pofe verte,& qui étoit d’un rouge-brun. Les anciens
ont bien fait mention de la terre verte de Scio qu’ils
cftimoient beaucoup , mais non pas de la terre verte
de Sinope. Je ne fais même fi le mot prafinus dans
Pline Si dans Ifidore fignifie la couleur Verte , que
nous appelions finople; mais cela ne nous fait rien.
La terre de Sinope étoit une efpece de bol plus ou
moins foncé en couleur rouge-brune , qu’on trou-
Voit aux environs de cette v ille de la Natolie * qui
en diftribuoit à Rome une grande quantité pour divers
arts ; c’eft pourquoi Str-abon, Pline Si Vitruve
en ont beaucoup parlé.
Ce qui marque que cette terre n’étoit autre chofe
que du b o l, c’eft que les auteurs que l’on vient de
cite r , affinent qu’il étoit auffi beau que celui d’Efpagne.
Tout le monde fait que l’on trouvé un très-
beau bol rouge - brun en plufieurs endroits de ce
royaume , où on l’appelle almagra ; Si ce bol d’Efpagne
, fuivant les conje&ures de Tournefort, qui
devoit en être inftruit, ayant voyagé dans le pays,
eft un fofran de Mars naturel. L’on ne connoît plus
aujourd’hui furies lieux , ni la terre verte de Scio ,
ni la rouge de Sinope , appellée. rubrica fabrilis par
,Vitruve,. Perfe Si autres auteurs.
La terre finopique de nos jours, notre rubrique,
eft une terre rouge qui fe trouve en Grece en Arménie
, en Egyp te, dans les îles de Majorque Si de
Minorque, en France , en Allemagne Si Angleterre*
Il y en a de plufieurs efpeces , de graifîeufes * de
feches , de tendres, de dures , de tachées , &c. Elles
fervent aux ouvriers pour crayonner Si tirer des lignes
rouges.
C’eft de cette terre que vient le nom de rubrique,
qu’on donne au titre d’un livre de droit, parce que
les titres en étoient autrefois écrits en lettres rouges.
C ’eft la-même ôrigine de ce qu’on nomme rubriques
générales dans l’office divin ; Si finalement puifque
j’en fuis fur les étymologies , c’eft auffi là celle du
mot de brique, terre graffe , rougeâtre , que nous
cuifons, après l’avoir façonnée en carreaux, Si qui
lërt à bâtir.
Les Anglois favent à merveille pulvérifer , tami-
fer Si réduire en pâte, avec une eau gommée, leur
terre rouge, dont ils font des crayons qu’ils débi- '
tent dans le commerce ; mais nous vanter la rubrique
, Si toute autre forte de terres, bols , craies ,
pierres de mine , &c. quelle qu’en foit la couleur ,
pour etre utiles en médecine, en recommander les
vertus vulnéraires intérieurement, c’eft fe moquer
du monde, c’eft aggréger ceux qui exercent l’art
d Elculape, au corps des petits marchands de
S I N 213
crayons , qui étalent à Londres fur la bourfe * bu à
Paris fur le pont-neuf. ( D . J. )
Sinope , ( Géog. anc. j ville de Paphlagonie , fi-
tuée au 43e degré de latitude feptentrionaiè •, fur le
bord méridional du Pont-Euxin * près d’uné rivieré
du même nom , à quelques milles en deçà de l’Ha-
• lys , fut une des villes des plus célébrés Si dés plus
anciennes dit royaume dé Pont -, dont la Paphlagonie,
province entre l’Halys & leParthenius , faifoit
partie. Ovide de Porno , l. I. dit :
Urbs antiqua fu i t , Po/ni celïbrata Sinope.
J’ai lu , dans les méni. des infe. t. X . in-40. uné
excellente differtation fur Sinope : en voici le précis1.
' Cette ville;, au rapport de plufieurs écrivains,
doit fâ fondation à Sinope, une de ces amazones fa-
meufes qui habitoien'tle long des rivages duThér-
modon, Si que quelques auteurs prétendent avoir
été une colonie des Amazones de Lybie , que Séfof-
tris menoit avec lui dans fes expéditions * & dont il
laiffa, dit-on, une partie fur les bords de cette rivieré
, lorfqu’il paffa dans ces contrées-là.
Mais d’autres écrivains croyent que Sinope , ycx\x
fonda en Afie la ville de fon nom, étoit grecque d’origine
, Si fille d’Afope, petit prince établi à Thebës,
ou plutôt à Phliafie , où il étoit venu de l’Afie d’au- •
près des rivages du Méandre : comme il avoit paffé
la mer pour fe fendre en G rece, on en f it , én langage
mythologique , un fils dé l’Océan Si de Téthis,
ou de Neptune Si de Céglufe ; Si le fleuve Afope, à
qui il donna fon nom, n’etoit autre, fuivant le même
ftyle , que le^Méandre même, qui ayant fuivi Afopè
fous les eaux de la mer, étoit venu reparoître fur les
terres que ce prince avoit acquifes près delà ville de
Phliafie, ou Phigalie.
Paufanias fait mention d’un autre prince, nommé
auffi Afope, le plus ancien des rois de Platée après
Gytheron. Ce fut lui qui donna fon nom à un autre
fleuve appellé Afope, qui couloit près de Thèbes*
Si à l’Afopie , canton des environs de cette ville.
En ce tems-là les dieux, c’eft-à-dire , les princes
ou feigneurs de quelque contrée , aimoient à fe fi-
gnaier par l ’énlevement des jeunes perfonnes qui
etoient en réputation de beauté. Afope le phliafien
avoit,. dit-on , vingt filles * entre lesquelles il s’en
trouvôit quelques-unes dont le mérite Si la beauté
faifoient beaucoup de bruit jufque dans les pays
étrangers. Ce fut entre le jeunes feigneurs d’alors, à
qui en enleveroit quelqu’une. Le petit fouverain dé
l’île d’Oënone, qu’on qualifie du nom de Jupiter, fé
faifit d’Egine, dont il eut Eacus , pere de Pelée , qui
le fut d’Achille, Si l’île d’Oënone fut depuis appellée
Egine. Le feigneur d’une autre î le , qu’on honora du
nom de Neptune , parce qu’il avoit paffé la mer ,
firt-prit Gorcyre, qu’il emmena dans fon île deSché-
rie , qu’on nomma dans la fuite Corcyre, à-préfent
Corfou. Un autre corfaire, qu’on titra auffi du nom
de Neptune , pour la même raifon , s’accommoda de
Salamine , qui donna fon nom à l’île où il la tranf-
porta.
Mars , c’eft-à-dire, quelque guerrier, ravit Har-
pinne, Si un jeune aventurier venu du Levant *
qu’on décora pour cette raifon du nom d’Apollon,
lùrprit Sinope, Une des autres filles d’Afope , qu’il
tranfporta jufque dans une péninfule ou Cherfon-
nèfe de la côte méridionale du Pont-Euxin , qu’il lui
céda, en lui laiffant, dit-on 5 fa virginité. Quelques
auteurs prétendent au contraire, beaucoup plus vraif-
femblablement, qu’il Pépoufa , Si qu’il en eut un fils
nommé Syrus , qui donna fon nom à la Syrie.
La fituation du lieu où Sinope avoit été tranfplan-
tée de la G rece, étoit trop charmante pour pouvoir
ne s’y pas plaire. Cette priiiceffe s’y fixa donc v o lontiers
, Si y jetta les fondemens de la ville de fou