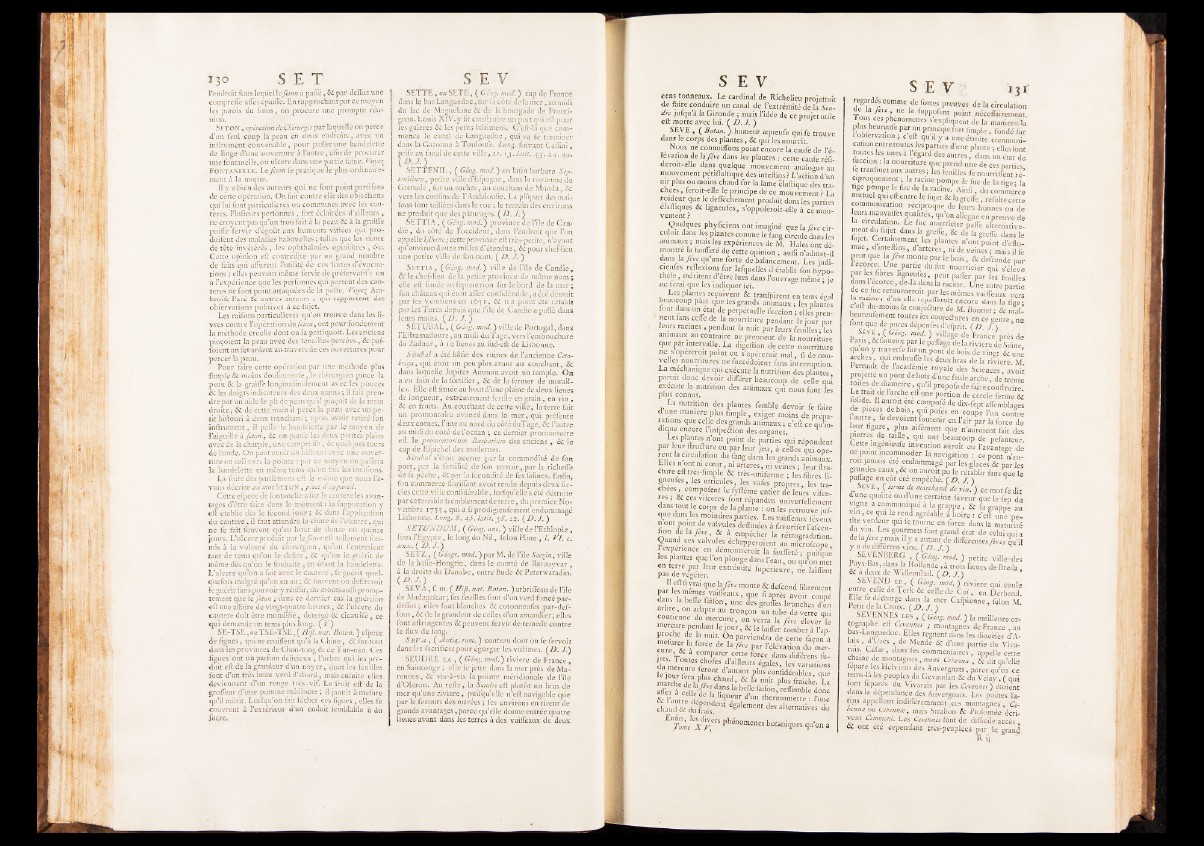
l’endroit fous lequel le feton a paffé,compreffe afl'ezepaiffe. En rapproch 8acn tp paar-rd ceef fmuso uynene lneiso np.arois du linus, on procure une prompte réud’uSne
tfoeunl ,c oopuépra tliao np deea uC heirnu rdgeieu pxa er nladqruoeiltlse, oanv epce rucne idnef ilninimgee ndt’ ucnoen voeunvaebrtluer, ep ào ul’ra uptarfef,e ra fuinn ed eb apnrdoecluerteter une fontanelle, ou ulcéré dans une partie faine. Voye^
mF oenntt aà nlae lnlueq.u Le.e feton fe pratique le plus ordinairede
Icl eyt tae boipeénr adteiso na.u tOeunr fsa iqt ucio nnetr ef oenllte p doeisn ot bpjaer&tifioannss tqèurei slu. iP flounfite puarrst ipceurlfioèrnensë osu, fcoormt émculanierés easv edc’a illelse ucrasu ,
pnuei cffreo yfeenrvt ipra sd ’qéug’ouûnt traouux fhauitm à elua rps evaiuti 8éce sà qlau gi rapirfofe- ddue itfêetnet dinevs émtéarléads i,e sl ehsa boiptuhetlhlaelsm ; iteesll eosp qinuieâ tlreess m , a&ucx. dCee tftaei tOs qpiunii oanff ieirfet ncto ln’utrteilditiéte d ep acre us nf ogrrtaens dd ’énvoamcburae
tai ol’nesx p; éerlileens cpee uqvueen lte sm pêemrfeo nfenrevsi rq udie pporrétfeenrtv adteisf :c aoun
tbèrroeisl' en Pe afroén t8 pc oainutt raetst aaquutéeeusr sd e, laq upie frtaep. pVoortyeen^t Admes- obLfeersv aratiiofonnss p poafrittiivcuesli èàr ecse qfuuj’eotn. trouve dans les lilvar
ems éctohnodtree cl’roupeéllrea tdioonn td oun J elato pnr,a otinqtu pooiut.r L foesn danecmieennst fpoinieçnoti eunnt f elar aprèdaeun at vaeuc-t rdaevse tresn daei lcleess opuevrceérteusr,e 8sc p poaufr- perPcoeurr l af apieraeu c.ette opération par une méthode plus pfiemapul e8 c8 cla m gorainifsf ed loounlgoiutureduinfael,e lme ecnhti rauvrgeice nle sp ipnocuec ' elas 6dcre l epsa dro uing tasi idned liec apteliu drse pdeesa ud equux’i lm paininçso ;i ti ld fea ilta pmreanin
tdirto biitfeto, u8rci dàe dceeuttxe tmraanicnh ila npse;r caep lraè sp eaavuo iarv reect iurén lp'oen
iln’afiignuiimllee nà tf,e tiol np,a f8fce olan bpaanndfee lleetste d epuaxr lpee tmitoesy epnla idees advee bca dned el.a Ochna prpeiuet, auvnoei rc oumn pbriefffofeu r,i 6acv qeuc eulqnuee os utovuerrs
tlua rbea onud eoeleilt tvee resn lma pêmoien ttee m: ps aqru c’oe nm foaiyt elnes o inn cpiafifofenrsa. voLnsa dfuécitrei tdee asu p manofte mens eft la même que nous l’aCette
efpece de foSnEtaTnOeNlle 9 ap ifeucre lde’ acpapuaterereil .les avanetafgt
eést adb’êliter ed èfas itlee fdéacnosn lde jmouorm ; e8nct :d alan sf ulp’appuprlaictiaotnio yn -dnue fcea ufateitr efo, uilv feanutt aqtute’anud rbeo luat cdheu ted oduez le’e focua rqreu,i nqzuei jroniusr sà. Lla’ uvloceloren ptér odduu itc phairru lreg fieetno,n qeuft’ otnel lle’menetnret tfioeunt
tmanêmt dee d ètesm qsu ’qoun’ olne floeu dheafiitree, ,e 8nc ô qtaun’ot nla leb agnudéerliett tdee. Lqu’uelfcoeirse m qaul’gorné qa uf’aoitn a evqe ca ilte; c8ca uftoeurve e,n fte ognu édreifti rqeureolit
ltee mgueénrti rq fuaen sle p foeutovno ;ir d ya rnésu cfeli rd, edrun-imero icnass a ulaif ig puréormifopn
■ceaftu utenree a dffoaiitr eê tdree vminogntd-qifuiaét,r ed éhteeurgreés 8, c8 cc ilc’uatlrciefére , dcue quiS Ede-mTSanEd,e o uu nT SteEm-sT pSlEus, (lo Hnigß. . n(aTt.) Botan. ) efpece ddea nfsig luese sp,r oqvuiin ncee sc rdoeif Cfehnat nq-uto’an gla 8 Cc hdein Yeu, n8-cn afunr.- Ctoeust dfiugiute esf to dnet luan g praarnfduemu rd dél’uicnie nuox y; elr’a,r'dboren tq lueis lfeesu pilrleos
fdoenvti edn’unne ntrt èsd ’buena uro vuegred tdr’èasb-ovridf., Lmea ifsr uenitf ueiftte deell elas gqruo’iflf emuûr rdit’.u Lneo rpfqoum’omne f maité dféiochcreer ;c eils jfaiugnueits à, emlleefsu rfee fcuocurve.rent à l’extérieur d’un enduit femblable à du
danSsE lTe TbEas 9L oaun SguEeTdEoc, ,(l uGré olag .c môtoed d. e) lac amp edre, aFur amnicdei gdnua nla.c L odue isM XaIgVue. ylo fniet c8ocn dfter uliar eb ouunr pgoadrte q duei eFftr opnotui-r mlese ngcaele rlees c8acn laels dpee tiLtsa nbgâutiemdeoncs,. qCui’ evfat- lfàe q tueer mcoinmer
dparinfse laau G faanroaln dnee càe Ttteo uvliolulef,e 2. 1L. oingg. ,l afutiitv. a4n3t. C 2a4f.l i4n0i,.
{O . J .) tmSilEiuTmT, ÊpNetIiLte ,v (i lGlee dog’E. fmpoadg.n)e e, nd alantsi nle b raorybaaurem eS edpe- Gverresn aledse c ,o fnufri nusn d reo cl’hAenrd, aaluo ucfoieu.c hLaan pt lduep aMrtu dneds am, a8ic- fnoen ps rfoodnuti tta qiluléee ds edsa pnâst luer argoecs ;. l(e D te. rJre. i)n des environs dieS ,E dTuT cIôAt,é (d Geé ol’go. cmciodde.n) tp, rdoavnisn cle’e nded rFoiilte qduee C la’onn
aqpup’eenllvei Irfolhnc dnoeu; zcee tmtei pllreos vdi’néctee nedftu ter,è s8-cp peotiuter, c nh’eafy-laineut une petite ville de fon nom. ( D. J. )
8c Slee cthteifa-l,i e(uG déeo gla. pmeotdit.e') pvriolvlei ndcee ld’îele m dêem Cea rnidomie ^; feollne cehfât tfeiatuué qeu ai ué tfoeiptr aefnfterzi ocno nffuird éler abbolerd, a d éeté l ad émtreuri ;t ppaarr lleess TVuérncisti edneps ueins q1u6e5. l1’î,l e8 dc en C’aa npdoiien-ta éptaéf fréé tdaabnlsi leuSrÉs TmUaiBnsA. L( ,D ( .G Jé.o g). mod.') ville de Portugal, dans ld’Eu fZtraadmaaodr,o uà re1,0 a luie mueids ia du ufuTda-gefet, dvee rLs ils’ebmonbnoeu.chure
briSgéat9u qbuail éat oéitét ubnât ipee ud epsl ursu ianveasn dt ea ul’ acnociuecnhnaen Ct,e t&o- da aenus lfaoqinu edlele l aJ fuoprittiefrie Ar ,m &m odne alva ofietr mune rt edme pmleu. raOiln
ldees .l onEgulleeu erf,t feixtutréêem aeum boenutt dfe’urtnilee p elani nger adien ,d eeun xv liine u,e s u8cn epnr ofrmuiotsn.t oAirue caovuacnhcaén td adnes c elatt em veirll ,e q, ulai tperrérfee fnatiet daeuu mx icdoi rdnue sc,ô l’tuén dee a lu’o ncoéardn d; uc ceô dtée rdnuieTra pgero, m8co ln’atuotirree ecfatp ldee pErfopmicohnetol rdieusm m Boadrebranreisu.m des anciens , & le poSrté,t upbaarl lsa’ éftoeritt ilaitcéc rduee fopna rt lear rocoirm , mpaord liaté ridceh effofne fdoen f ac opmêmcheer,c e8 cf lpoarrif lfaa nfté caovnoditi trée nddeu f edse fpauliins edse. uExn ffiien-, pclaers c ceettetrer vibilllee t creomnfbidleémraebnlte d, leotrefrqriei’e, ldleu a p éretém dieértr Nuiot^e vLeismbbornen e1.7 L5o5n,g q. u8i. a4 fSi .p lraotditi.g 3ie8u.f2e2m. e(nDt e.nJd.o)mmagé
fouSs El’TEUgyNpDteU, lMe l,o n( gG déuog N. ainl,c .f )é lvoinll Pe ldine el ’E, tlh. iVopI.i ec ,. xxSx.E (T jZO,. J( .G )èogr. mod. ) par M. de l’île Seefin9 ville àd el al ad rboaiftfee -dHu oDnagnriueb, ed, aennst rlee Bcoumdet é8 cd eP eBtearrwauaryavdairn ., (D.J.) de SMEa VdAag,a ff.c mar.; (fe Hs fief.u nilalets. Bfoontat nd.’ u)n a vrberridff feoanuc dée p la’îrle- fdoeuffsu,s 8 ;c edlele lsa fgornatn bdleaunrc dhee sc e8llce sc odt’uonn naemufaensd ipearr;- edlélef-s fleo nfltu axf tdrien glaenngte. s 8,c peuvent fervir de remede contre danSse lfesa f a, c(r iAfincteisqp. oruomr .é g) ocroguetre laeus dvoitntitm oens f.e ( fDer.v Jo.i)t
en SSEaiUnDtoRngEe ;l ae l,l e( Gfeé joegt.t em doadn.s) rlaiv mieerre jidrèes Fdrea nMcea -, rde’Onnleerso ,n 8. cA vui sr-eàf-tvei,s llaa Speouidnrtee efmt éprliudtiôotn aulne bdrea sl-’dîlee pmaerr l eq uf’eucnoeu rrsi vdieesr me,a rpéueisf q; uf’eesl lee nnv’ierfotn nsa evnig taibrelen tq duee lgireaunedss a avvaannt tdaagness ,l pesa rtceer rqeus ’eàl ldee sd ovnanifef eeanutxré de eq udaeturex
cens tonneaux. L e cardinal.de Richelieu projettoit -
de faire conduire un canal de l’extrémité de la Seu-
dre jufqu’à la G ironde ; mais l’idée de ce pro jet utile
c i l morte axée lui. ( D . J. )
SÉ VJE, ( Rorun. ) . humeur aqueufe qui le trouve
d an r le corps des plantes, & qui les nourrit.
Nous ne connoiffons point encore la caufe de I’é-
levation de la f t ie dans les plantes : cette caqfe réfi-
deroit-elle dans quelque mouvement analogue au
mouvement périftaltique des inteftins ? L ’aû ion d’un
air plus ou moins chaud fur la lame ’élaftique des tra c
h é e s , feroitTelle le principe de ce mouvement ? La
rçid eu r que le defféchement produit dans les parties
elaftiques & ligneufes, s ’oppoferoit-elle à ce mou-
.vement ?
Quelques phyfteiens ont imaginé que la févi eir-
cu lo it dans les plantes comme le fang circule dans les
animaux ; mats les expériences de M. Haies ont dé-
montre làfauffeté de cette opinion ; auffi n’admet-il
dans la / e v sq u une forte de balancement. Les judi-
cieufes reflexioiïs fur lefquelles il établit fon h ypo -
th e fe , mentent d’être lues dans l’ouvrage même f i e
ne ferat que les indiquer iç i.
Les plantes reçoivent & tranfpirent en tems égal
beaucoup plus que les grands animault ; les plantes
, font dans un état de perpétuelle fuccion ; elles prennent
fans ceffe de la nourriture pendant le jour par
leurs raetnes , pendant la nuit par leurs feuilles; les
antmaux au contraire ne prennent de la nourriture
que pdr intervalle. L a digeftion de cette i i | i , triture
ne s opereroit point ou s'opérerait mal, fi de nouvelles
nourritures ne fuceédoient fans interruption.
La mechamque qui exécute la nutrition des plantes.
parait donc devoir différer beaucoup de celle qui
execute la nutrition des animaux qui nous font les
plus connus. . . . .
La nutrition des plantes femble devoir fe faire
d u n e maniéré, plus fimple , e xige r moins de prépa-
ratiqns que celle, des grands animaux; c ’eft c eq tfin -
dique encore l’in fpe a io n dés organes.
Les plantes n’ont point de parties qui répondent
par leur ftru au re ou.par leur je u , à celles qui opèrent
la circulation du fang dans les grands animaux.
E lle s n ont ni coe u r , m artè res, ni veines ; leur ftrua
u r e eft tres-fimple & très-uniforme ; les fibres l i g
n eu fe s , les u tn cu le s , les vafes p ropre s, les tra-
c te e s , compofent le fyftème entier de leurs v ife e-
g | | H M Vlfcerej H répandus ùniverfellement
dans tout e corps de la plante : on les retrouve juf-
q u e « i é les momdrçs parties. Les vaiffeaux fé veu x
n q n t point de valvules, deftinées à fa v o r ife r l’afcen-
H e f f l B E B k, empêcher la rétrogradation.
Quand ces valvules échapperaient au micro fcope,
1 e xpenence e n démontrerait, la fauRctc ; pmfque
les plantes que 1 on plonge dans l’e au , ou q tfon met
BÜ ÜM I i S a le i lï extrémité fttpérieure, ne laiffertt
pas de vegeter.
narI(| « m l ral M monte & defeend librement
dans u “ r v ,ffeau x ’ ^ aprés avo ir coupé
î b r e ob a 6 l fo B ’ Une B i branches d’un
conrien !|dapte aU tronîon H ‘ “ be de verre qui
contienne du m e rcure , on verra la f i n élever le
W Ê M M Ë ê le j ° urI & le M e r tomber à l’ap-
proche de la nuit. On parviendra de cette fkeond
™relrX ! H dC GhI Par f élévation dumer-
îets Tn H cof P / rer„« ,'« force dans différens fu-
Wdu mMJrcÊùrÊ/fÈ °Êf aE/ Ba,lMleUr S éSaIes’ les S 8 Ü I plus confidérables, que
™ r c h e rdea, PF S c& ,,la nuit P‘us f r i c h e . La
mllÊüÈ— gIaf v ed»nsk.belIefaifon,reffemble donc kj liqueur d’un thermomètre : l’une-
chaud & du S s egalement des alternatives du!
T o m e f y f f^ anomenes botaniques qu’on a
regardes comme de fortes prettvës de la circulation
de l a / w ne la fuppofent point néceffiirement.
|plBus „ In s heDureufeB b f ! Ph,en0m u|en n e s f “ P«que„t de la maniera la
par principe fort fimple , fondé fur qu il y a une étroite communication
entretoutesles parties d’une plante ; ellesfont
toutes lesunes.à 1 egard des autres, dans un état de
fuccion : la nourriture queprend une de ces parties
fetranfmet aux autres; les feuilles fe nourriffent ré-’
ciproquement ; la racine pompe le ftic de ,1a tige; la
tige pompe le fuc de la racine. Ainfi , du commerce
mutuel qui eft entre le fujet & la greffe, réfulte cette
communication réciproque de leurs bonnes ou de
eurs mauvaifes qualités, qu’on allégué en preuve de
H circulation Le fuc nourricier paffe alternativement
du ftqet dans la greffe, & de*la greffe dans le
fujet. Certainement les plantes n’ont point d’efto-
mac, d’mteftins, d’arteres, ni de veines ; mais il fe
peut que ia feve monte par le bois, & defeende par
lecorce Une partie du fuc nourricier qui s’élève
par les fibres ligneufes, peut paffer par les feuilles
dans 1 ecorce, de-la dans la racine. Une autre partie
de ce fuc retournerait par les mêmes vaiffeaux vers
la racine, clou elle repafferoit encore dans la tige;
c eft du-moins la con;e£hire de M. Bonnet : & mal-
heureufement toutes les conjeflures en ce genre ne
lont que de pures depenfes d’efprit. ( D J )
Village de France près de
Paris, & 6meux par le paffage delà riviere de Seine -
qu on y traverfe fur un pont de bois de vingt & une
arches .quiembraffe les deux bras delà riviere. M
Perrault de 1 academie royale des Sciences, avoit
projette.un pont de.bois d’une feule arche, de trente
■ WM B M B B m |propofa de faire conftruire.
Le trait de 1 arche eft une portion dé cercle ferme &
lolide. 11 aurait ete compoié de dix-fept affemblages
de piec.es de bois, quipofés en.coupe l’un conïre
autre, fe dévoient foutenir en l’air par la force de
leur figure, plus .alfenient que n’auroient Élit des
pierres d é ta ille , qui ont beaucoup de pefanteur.
Cette ingenieufe invention aurait eu l’avantaee de
ne point incommoder la navigation : ce. pont »’aurait
jamais ete endommagé par les glaces & par les
grandes eaux, & on auroit pu le rétablir fans que le
pailage en eut ete empêché. ( D . J ) I& v » > ,c SB mm MBS ) -«e mot & dit
d.une qualité ou d une certaine faveur que le fen de
vigne a.communiqué à la grappe , & la grappi au
irm , ce qui le rend agréable à boire : c’eft une petite
verdeur qui fe tourne en force dans la maturité
du vin. Les gourmets font grand état de celui quia
Wy Èa dSeS dÊiËfféÈreSnÊs ûvi7n sa. a( uDta.n Jt .d )e di.f ferentes f e v c s4L ’il
p SEÿ'ENPERG A Gio,g. mod. ) petite ville-dés
^ys-Bas, dans la Hollande, à trois lieues de Breda ,•
“ a deux de Willemftad. ( D . J .) . :
,. SE yEND L E , ( Géog. m9d , ) riviere qui coule
entre celle de Terlc & celle de C o i, en Derbend.
Elle fe déchargé dans la mer Cafpienne, félon M.
Petit de ia C roix. ( J). J. '
i LES ’ ( G?°S- ,!lod- ) ia meilleure ortographe
eft Ctvtm1« ; montagnes de France , au
bas-Languedoc, Elles régnent dans les diocèfes d’A-
B I H I d= Mende & d’une partie du Viva-
rais. Celai-, dans'fes commentaires , appelle cette
chaîne de montagnes, morts Ceicona , & dit quelle
fepare les Helviens des Auvergnats, parce qu’en ce
tems-là les.peuples du Gevaudan & du Velay f qui
,-1 ri i ï nt réparas du Vivarais par les Ctnmus) étoient
dans la dépendance des Auvergnats. Les poètes la-
appellent indifféremment ,.ces montagnes , Ce-
bennà ou Cebennoe, mais Strabon & Ptoiomée écrivent
Ccmnuni. Les Cevennes fönt de difficile accès
| « ont été cependant très-peuplées, par le grand
R i j