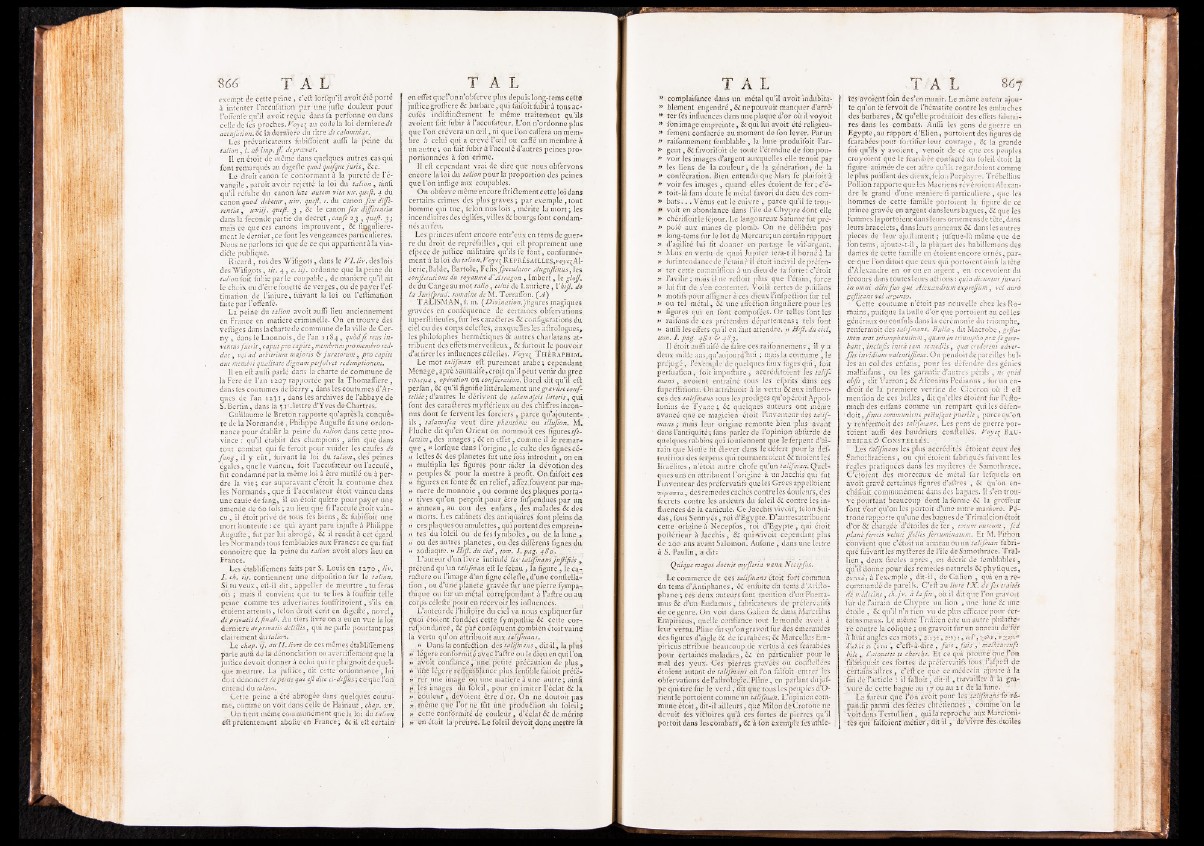
exempt de cette peine, ç’ eft lorfqu’ il avoit été porte
à intenter l’accufation par une juftc douleur pour
l’oftenfequ’il avoit reçue dans fa perfonne ôirdans
celle de fes proches. Voye{ au code là loi derniere<&
accufation. 6c la derniere du ritre 'de calomniât.
Les prévaricateurs fubiffoiént aiiffi la peine du
talion, l. abimp.fi. deproevar.
Il en é toit de meme dans quelques autres cas qui
font remarqués au digefte quod quifqtte juris, Scc.
Le droit canon le conformant à la pureté de l’évangile
, ’paroît avoir rejette la loi du talion, ainfi
qu’il réfulte du canon hoec autèiti vita xx. qiteff. 4 du
canon quod debetur, xiv. que(l. /.du canon je x difie-
rcntice, xxiij. qucfl. 3 , 8c le canon fe x difierentia
dans la fécondé partie du decret, caufe 23 , quejl. 3;
mais ce que ces canons improuvent, 8c fijjguliere-
ment le dernier, ce font les vengeances particulières.
Nous ne parlons ici que de ce qui appartient à la vin-
diète publique.
Ricard, roi des "Wifigots, dans le VI. liv. des lois'
des "Wifigots, tu. 4 , c. ïij. ordonne que la peine du
talion foit fubie par le coupable, de maniéré qu’il ait
le choix ou d’être fouetté de verges, ou de payer l’ef-
timation de l’injure, fuivant la loi ou l’eltimation
faite par l’offenfé.
La peine du talion avoit auffi lieu anciennement
en France en matière criminelle. On en trouvé des
veftiges dans la charte de-commune de la Ville de Cer-
ny , dans le Laonnois, de l’an 1 184, qubdjî reus in-
ventusfuerit, capntpro capite, membrumpro membro red-
dat, vtl ad arbitrium majoris & juratorum, pro capitt
aut membri qualitatt dignam perfolvct redemptiônem.
Il en eft auffi parlé dans la charte dé‘Commune de
la Fere de l’an 1207 rapportée par la Thomaffiere ,
dans lés coutumes de Berry, dans les coutumes d’Ar-
ques de l’an 123 1 , dans les archives de l’abbaye de
S. Bertin, dans la 51'. lettre d’Yves dé Chartres.
Guillaume le Breton rapporte qu’après la conquête
de la Normandie, Philippe Augufte fit une ordonnance
pour établir la peine dir talion dans cette province
: qu’il établit des champions , afin que dans
tout combat qui fe feroit pour vùider les caùfes de
fang, il y eût, fuivant la loi du talion, des peines
égales, que le vaincu, foit l’accufateuroù Taccufé,
fut condamné par la même loi à être mutilé ôu à perdre
la vie ; car auparavant c’étoit la coutume chez
les Normands, que fi l’accufâteur étoit vaincu dans
une caufe de fang, il en étoit quitte pour payer une
amende de 60 fols ; au lieu que fi l’accufé croit vaincu
, il étoit privé de tous fès biens , 8c fubiffoit une
mort honteufe : ce qui ayant paru injufte à Philippe
Augufte, fut par lui abrogé', 8c il rendit à cet égard
les Normandstous femblables aux Francs : ce qui fait
connoître que la peine du talion avoit alors lieu en
France.'
Les établificmens faits par S. Louis en 1270 , liv.
I. ch. ïij. contiennent une difpofiùon fur le talion.
Si tu veux, eft-il dit, appcller de meurtre , tu feras
.ois ; mais il convient que tu te lies à fôùffrir télljê'
peine comme tes adverlaires fouffriroient, s’ils en
étoient atteints, félon droit écrit en digefte, novçl,
de privàtis L.finali. Au tiers livre on a eu en Vue la loi
derniere depriyatis dcîïclis, qui ne parle pouftanfpas’
clairement du talion.
Le chap. i'j. au II. livre de ces mêmes établifiemens
parle auffi de la dénonciation ou aveftiffernënt que là'
juftice devoit donner à celui qui fe plaignoit de quelque
meurtre. La juftice, dit cette ordonnance , lui
doit dénoncer la peine qui ejldite ci-diffus', ce qùeTon'
entend du talion.
Cetre peine a été abrogée dans quelques coutume,
comme on voit dans celle de HairiâuÉ, chap. xv.
Ün tient même cômtnuriément qûela loi du talion
eft pféièntement abolie1 en France ; 8c il eft certain!
en effet que l’on n’obferve plus depuis long-tems Céfte
jufticegroffiere 8c barbare, qui faifoit fubir à tous ac-
cufés indiftinèfemént le même' traitement qu’ils
avoient fait fubir à l’accufateur. L’on n’ordonne plus
que l’on crèvera un oeil, ni que l’on caftera un membre
à celui qui a crevé l’oeil ou cafte un membre à
un autre ; on fait fubir à l’acculé d’autres peines proportionnées
à1 fon crime.
Il eft cependant vrai de dire que nous obfervons
encore la loi du talion pour la proportion des peines
que l ’on inflige aux coupables.
On obferve même encore ftriûement cette loi dans
certains crimes des plûs graves ; par exemple , fout
homme qui tue, félon nos lois , mérite la mort; les
incendiaires des églifes, villes 8c bourgs font condamnés
au feu.
Les princes ufent encore entr’ eüx en tems de guerre
du droit de repréfailles , qui eft proprement une
efpece de juftice militaire qu’ils fe font, conformément
à' la loi du talion.Voye^ REPRÉSAILLES,voyc^kl-
beric,Balde, Bartole, Félix Jpeculator Augufimus, les
conjîitutio/ts du royaume d'Arragon , Imbert, le gloff
de du Cangeaumot talio, celui de Lauriere, V/iiJl. de
la Jtirifprud. romaihi de M. TerralFon. (^7)
TALISMAN, f. m. (Divination.'jûgares magiques
gravées en conféquencè de certaines obfervations.
fuperftitieufes, lùr les caraôeres 8c configurations du
ciel ou des corps céleftes, auxquelles les aftr.ologues,'
les philofophes hermétiques & autres charlatans attribuent
des effets merveilleux, & fur'toüt le pouvoir
. d’attirer les influences céleftes. Voye^ T h é r a p h im .
Le mot talifman eft purement arabe; cependant
Ménagé, aprè Saumaife, croit qu’il peut venir du grec
tîMirpei, operation ou confécration. Borel dit qu’il eft
perfan, 8c qu’il fignifie littéralement une gravure conf-
tellée; d’autres le dérivent de lalamajcis litieris, qui
font des carafteres myftérieux ou des chiffres inconnus
dont fe fervent les forciers , parce cju’ajoutent-
ils , talamafca veut dire phantôme ou illujîon. M.
Pluclië dit qu’en Orient on iiommoit ces figures tfe-
latnim, des images ; & en effet, comme il le remarque
, « lorfque dans- l’origine, le culte, des lignés cé-
» leftes & des planètes fut une fois, introduit, on en-
» multiplia les figures pour aider la dévotion des
» peuples 8c pour la mettre à profit. On faifoit ces
» figures en fonte & en relief, affczfoiivent par ma-
» niere de monnoie , ou comme des plaques porta-
» tiVes qu’on perçoit pour, être fufpendues par un
» anneau, au. cou des enfans ,• des malades & des
» morts. Les Cabinets 'des antiquaires'font.pleins de.
» ces plaques ou amulettes, qui portent des emprein-
» tes' du foléil ou de fes fymboibs, q,ii 4e,.la lune ,
>> ou des autres plariet.es, ou des différens lignes, du
» zodiaque. » Hijl'. du ciel, tonf.'l.p .d g .^S o . .
L’auteur d’un livre ïntilfuré'/ês; tài^nmpsjujiiffép ,
prétend qu’un tdlïfman eft le fçëau , la figure., le.c'a-!
raûere ou l’image dûin figne céléfte , d’une conftella-
tion , ou d’Urié planetë gravée fur une pierre fympa-
thique ou fur un métal çprrefponé.aht à faftre ou au
corps célefté'poùr en récevoii; les influencés.
L’auteur dé l’hiftô'iré du ciel vâ noùs expliquer fur
«Jttdï'ètôiënt jfoiid'ées^çette. fÿmpathie. '6t cette cor-T
refpondancé, & paf conféquent çpmbièn étoit vaine
la vertu qu’on aftfiKiioit auxdàfy/nàns.
. « Dans la cpn-feèllon dzspàVffhidns, dit-il, la plus
» legere conformité avec l ’aftre ou le dieu en qui l’on
» avoit confiance -j'line' petite’ précâiition de plus,
légère réflèmblânçé. jftus.fe.nfible faifoit préfé-
»jter ùiie image .ou..ûnématfeYé.Vvtnè autre; ainfi
»jlês images .‘au foléil, pour .én'imjter l’éclat & la
couleur , ;deyoient, être d'p'r. .On pe doutoit pas
même que'l’or ne fût une produèlion du foléil j
>> cette conformité cle couleùr , d’ ecfiit & de mérite
>>' "en étoit la-prëuf'è.'Le foleiî devoit donc inettre fa
complaifance dans un métal qu’il avoit rndübitd-
» blement engendré, & ne pouvoit mancjuer d’arrê1
” ter fés influences dans une plaque d’or où il -voyoit
y> fon image empreinte, & qui lui avoit été religieu-
» fement confàcrée au moment de fon lever. Par un
» raifonnement femblable , la luné produifoit l’ar-
» gent, & favorifoit de toute l’étendue de fon pou-
» voir les images d’argent auxquelles elle tenoit par
» les liens de la couleur* de la génération, de' la
» confécration. Bien entendu que Mars fe pldifpit'à
** voir fes images , quand elles étoient dé fèr ; e’é-
» toit-là fans doute le métal faVori du dieu dés com-
» b a ts .. . Vénus eut le cuivre , parce qu’il fetrou-
>* voit en abondance dans File de Chypre dont elle
» chérifloitle féjour. Le langoureux Saturne fut pré-
» polé aux mines de plomb. On ne délibéra pas
» long-tems fur le lot de Mercure; un certain rapport
» d’agilité lui fit donner en partage le Vif-argent.
» Mais en vertu de quoi Jupiter fera-t il borné à la
» furintendancede l’étain? Il étoit incivil depréfen-
>> ter cettë commiffion à un dieu de fa1 forte: c’étoit
>> l’avilir ; mais il ne reftoit plus que l’étain, force'
>> lui fut de. s’en contenter. Voilà certes-de pùiffans-
» motifs pour affigner à cès dieux Pinfpeélion fur tel
» ou tel métal, & une affeèHon lingitliere pour les
figures qui en font èompofées. Or telles font les'
» raifons de :ces prétendus départemens ; tels font
» auffi les effets qu’il en faut attendre. » Hiß. du ciel,
tom. I. pag. 481 & 483. ..
Il étbit auffi aifé de faire ■ ces.raifonnemens',- il y a
deux miile aiis,qu’aujourd:hui ; niais la coutume , le
préjugé, l’exemple de quelques- faux fagés:quî, .foit
perfuafiôn', foit impofture, accréditbient les entiß
mans, avoient entraîné tous lés efprits 'dänS Ces
fuperftitions. Onattribùoit à la vertu & au x influer.*-
ces des .lahfmans tous les prodiges qu’operoit Appol-
lonius de Tyane ; 8c quelques auteurs ont .meide
avancé que ce magicien étoit l’inventeur de.s taüf-
mans ; mais leur origine remonte bien plus 'avànt
dans l’antiquité ; fans parler de l’Opinion abfitrde de
quelques rabbins qui foùtiennent que leferp.ent d’aü’
rain que Moïfe fit élever dans le défert' pourla déf-
truèrion des lerpens qui tourmento'ient Scïùoisnf lçf
Ifraëlites, n’étoit autre chofe qu’un talifman. Quël^
ques-uns en attribuent l ’origine -à unJacchis qui fut
l’inventeur des préfervatifs que les Grecs appelfcient
wep/twrr«, desremedes cachés contre lès douleurs, des
feçrets contre les ardeurs du foléil 8c contre les influences
de la Canicule. Ce Jacchis vivoity félon Suidas
, fous Sennyés, roi d’Egypte. D ’autres attribuent
cette origine à Necepfos, roi d’Egypte, qui étoit
poftérieur à Jacchis, 8c qui*vivoit cependant plus
de 200' ans avant Salomon. Auföne , dans line lettre
à S. Paulin, a dit :
Quique magos docuit myfferia vana Necepfos.
Le commerce de ces talifmans étoit foi't cômmun
du tems d’Antiphanes, 8c enfuite dti tenis d’Arifto-
phane ; cés deux auteurs font ipention d’UirPherta-
inus8c d'un Eudamus, fabricateurs de préfervatifs
de ce genre. On voit dans.Galien éc dans, Marcellus
Empiricus, quelle confiâhce tout le inondé à voit à
’leur veftu. Pline dit qu’oifgfavoit fur des émeraü’dés
des figures d’aigle 8c. de fearabées; 8c Marcellus Em-
piricus attribue beaUc'oup.dè vertus à ces fearabées
pour certaines maladies, ce en .pàrticuliér pour lè
mal des yeux. Ces pietréè ■ gfay’éês où 'éodfteiléès
étoient autant de talfmdris oùl’ôn faifoit entrer les
obfervations de l’aftroJoVié^ Pline, ën parlant dujaf-
pe qui tiré für le verd tftt .qùe tous les peuples d’O-
rientle portoient comméim t dH f main. L’opinion commune
étoit. dit-il ailleurs^ <5jUe Milon dé Çrotohé ilè
devoit fes victoires qu’à cès fortes de pierres^ qu’il
portoit dans les combats’, 8c à -fon exemple fés athlëtés
avoiëht fom de s’én munir. Le même àutëiir ajoute
qu’on fè fervoit de l’hématite contré les embûches
des barbares, 8c qu’elle -produifoit des effets falutai-
res dans les combats-. Auffi les gens de guerre en
Egypte ,au rapport d’Elien, portoient des figures de
fearabées-pour fortifier leur courage , 8c la grandô
foi-qu’ils y avoient, venoit de ce que'ces peuples
croy-oient que le fearabée eonfacré au foléil étoit la
figuré1 animée de cet aftre qu’ils regardoient comme
le plus puiffant des-dieux, félon Porphy re. Trébeilius
Pbllion rapporte que les Macriens révéraient Alexandre
le grand - d’une maniéré fi particulière , que les
hommes de cette famille portoient la figure de cé
prince gravée en argent dansleurs bagues, 8cque les
femmes la portoient dans leurs ornemens de tête',’ dans
leurs bracelets, dans leurs anneaux 8c dans les autres
pièces.de - leur ajuftement ; jufque-là même que de
fon tems, ajoute-t-il, la plupart des habillemens des
daniës de Cette famille en étoient encore ornés, par-,
ce queTon diloit que-ceu-x-qui portoient ainfi la tête
d’Aîe.xandre en or ou en argent, en recevoient du
fe’cours dans toutes leurs aftions : quia dicuntur juvari
in omni aciu fuo qui Alexandrum exprejfüm, vel aurô
gejlitant vel drgento.
Cetié coutume n’étoit pas nouvelle chez les Roj
mains, puifque la bulle d’or que portoient au col les
généraux ou confuls dans la cérémonie du triomphe,
renfermoit des talifmans. Bùlla, dit Maerobe, gefta-
fnen erat triumphantium , quant in triumphoprie fegere-
baht, inçlifis intrà eam remediis, quoe credzrent adver-
fus invidiam valentiffîma. On pendoit de pareilles bulles
àu col des enfans, pour les défendre des génies
ma'îfaifans , ou les garantir d’autres périls , ne quid
Varron ; 8c Afconius Pedianùs-, fur vin endroit
dé là; première verrine de Cicéron où il eft
mention de .ces bulles , dit qu’ elles étoient'fur l’ tfto-4
maeh des enfans conimé un rempart qui les défen-
• doit y jîrius.communiens peclufque puerile , parce qu’on
y r.enfërmbît des talifmans. Les cens de guerre por-.
tbienf auffi des baudriers coriftellés. Voye^ Baudriers.
1# C onstellés.
LëS fàlif/ridns les plus accrédités étoient ceux des
Sarfi'dfRrac'iëns , ou qiii étoient fabriqués fuivant lés
feglës' pfàtiquées dans les myfteres de Samothrace.
C ’étorent des morceaux dé métal fur lefquels on
âvd?t gfbvé1 certaines figures1 d’aftres , 8t qu’on en-
châfl'oit communément d^ns.des bagües. Il s’en trouve
p'Swtâht beaù'cbiip dbnt la forme 8c la groffèur
font v'oir aù’on les pbrfoit d’une autre maniéré; Pé-
ïrdiië rapporte 'qu’une des bagues de Trimalcion étoit
d’or 8c chargée d’étoiles de fer , tôt uni aunum , fed
plané ferreis velutt JleUis ferruminatum. Et M. Pithou
c'onvient que c’étoitun anneau ou un talifman fabriqué
fuivkîit les myfteres de Trie de Samothrace. Tral-
lien , deux fieclés apr.ès , .en décrit de femblables ,
qvi’il'don'ne pour des remèdes naturels 8c phyfiques,
à l’exemple , dit-il, de Galien , qui en à recommandé
de parèife." C ’ëft au livre IX. de fes traités
de'inédecine , ch.jv. à la f in , où il dit que l’on gravoit
fur de l’âiràin de Chypre un lion , vtné lune 8c uns
étoile , 8c qu’ il n’a tien vu de plus cfficacépour certains
maux. Le même Trallien cite un autre nlnlafre“-'
'éé Contre la eblique ; ongravoitfurun anneau de'fér
à huit' angles ces mot$',‘ Qïvyi, , /oJ'V ; 1» zepù*
aï'Ç»«/ % c’èft-à-dire , fu is , fuis'.,'mafàsùreufs
bile Valouette te c/ieriîitt.- Ët ce qùr prouvé qùe. Pon
1 fabriqUo'it ces fortes dé préfervatifs fotis. l’çfp0^ de
cèftàinsaftres , è’ ëft ce qùé ce méderiri .ajoute à la
"fin* de l ’article i il falloit, dit-il , tfavalller à là gra-
viir'é' idë_:cette bague au i f o i i au 21 de là hincl:
‘ !. 'La fureur qùé FôÀ'àvôit pour léfidîifmjfftfç ré*
pandit parmi des fëétcs clÙ-étiennëè'1,'’ c'Ônïipe on lé
' voit dans Terrullieri , qui la reproche^àùx'Marcioni-
tfs qui ' fatfoie nt mét'ièVdit^il, dWiYrë dès. étoiles