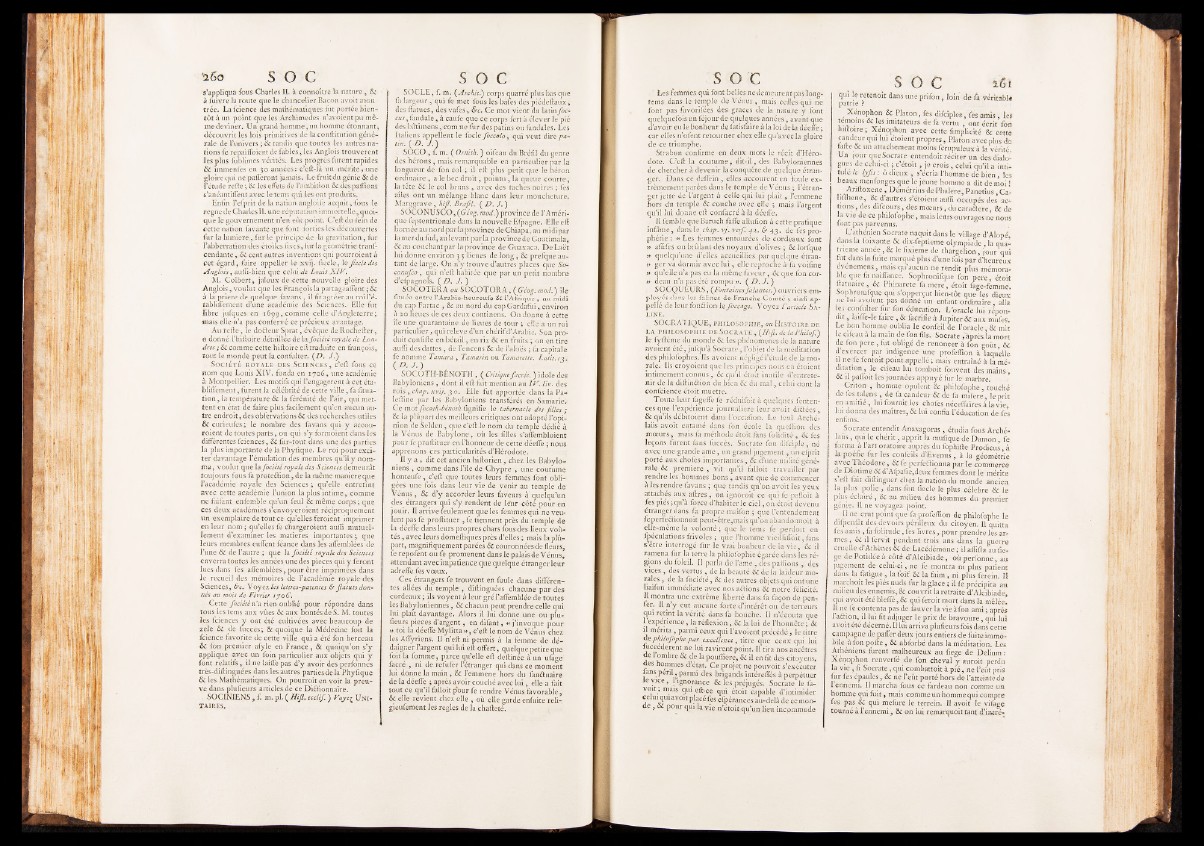
s’appliqua fous CharlesII. à connoîtrèla nature, &
à fuivre la route que le chancelier Bacon ayoit mon
trée. La fcience des mathématiques fut portée bientôt
à un point que les Archimeaes n’ayoient pu même
deviner. Un grand homme,un homme étonnant,
découvrit les lois primitives de la conftitutiôn générale
de l’univers ; & tandis que toutes les autres nations
fe repaiffoient de fables, les Anglois trouvèrent
les plus fuMimes vérités. Les progrès furent rapides
6c immenfes en 30 années; c’efl-ià un mérite, une
gloire qui ne pafferont jamais. Le fruit du génie & de
l’étude refte ; 6c les effets de l’ambition 6c des pallions
s’anéantilfent avec le tems qui ries ont produits.
Enfin l’efprit de la nation angloife acquit, fous le
regne de CharlesII. une réputation immortelle, quoique
le gouvernement n’en eût point. C’eft du fein de
cette nation favante que dont lorties les decouvertes
fur la lumière, fur-le principe de la gravitation, fur
l’abberration des étoiles fixes ,fur la.géométrie tranf-
cendante, 6c cent autres inventions qui pourroient à
cet égard, faire appeller le xvij. fiecle, le fiecle des
Anglois, aufiî-bien que celui de Louis XIV.
M. Golbert, jaloux de cette nouvelle gloire des
Anglois, voulut que les François la partagealfent ; 6c
à la priere de quelque favans, il fit agréer au roi l’é-
tablilfement d’une académie des Sciences. Elle fut
libre jufquesen 1690, comme celle d’Angleterre;
mais elle-n’a pas confervé ce précieux avantage.
Au tefte, le dofteur Sprat, évêque deRochefter,
a donné,l’hiftoire détaillée de la fociété royale de Londres
; 6c comme cette hiftoire efttraduite en françois,
-tout le mondé peut la confulter. (ZL /.)
S o c i é t é r o y a l e d e s S c i e n c e s , c’eft fous ce
nom que Louis XIV. fonda en 1706, une académie
à Montpellier. Les motifs qui l’engagerent à cet éta-
bliflèment, furent la célébrité de cette ville, fa fitua- ■
tion, la température 6c la férénité de l’air, qui mettent
en état de faire plus facilement qu’en aucun autre
endroit, des obfervations 6c des recherches utiles
& curieufes ; le nombre des favans qui y accou-
roient de toutes parts, ou qui s’y formoient dans les
différentes fciences, 6c fur-tout dans une des parties
la plus importante de la Phyfique. Le roi pour exciter
davantage l’émulation des membres qu’il y nomma,
voulut que la fociété royale des Sciences demeurât
toujours fous fa proteéfion, de la même maniéré que
l’académie royale des Sciences ; qu’elle entretint
avec cette académie l’union la plus intime, comme
ne faifant enfemble qu’un feul 6c même corps ; que
ces deux académies s’envoyeroient réciproquement
lin exemplaire de tout ce qu’elles feroient imprimer
en leur nom ; qu’elles fe chargeroient aufli mutuellement
d’examiner les matières importantes ; que
leurs membres euffent féance dans les affemblées de
l’une 6c de l’autre ; que la fociété royale des Sciences
enverra toutes les années une des pièces qui y feront
lues dans fes affemblées, pour être imprimées dans
le recueil des mémoires de l’académie royale des
Sciences, &c. Voyez les lettres-patentes & fiatuts donnés
au mois de Février tyoG.
Cette fociété n’a rien oublié pour répondre dans
tous les tems aux vues 6c aux bontés de S. M. toutes
les fciences y ont été cultivées avec beaucoup de
zele 6c de fuccès; & quoique la Médecine foit la
fcience favorite de cette ville qui a été fon berceau
& fon premier afyle en France, & quoiqu’on s’y
applique avec un foin particulier aux objets qui y
font relatifs, il ne laiffe pas d’y avoir des perfonnes
très-diftinguées dans les autres parties de la Phyfique
& les Mathématiques. On pourroit en voir la preuve
dans plufieurs articles de ce Di&ionnaire.
, SOCINIENS , f. m. pl. ( Hiß, eccléf. ) Voyeç Uni-
JAIRE S.
SOCLE, f. m. (Architl) corps quarré plus bas que
fa largeur,' qui fe met fous les baies des piédeftaux,
des ftatues, des vafes, &c. Ce mot vient du latin foc-
eus, fandale, à caufe que ce corps fert à élever le pié
desbâtimens ,'Com,ne fur des patins ou fandales. Les
Italiens appellent le focle foccolo qui veut dire pa-
t i n . ( D . f )
SOCO , f. m. ( Omith. ) oifeau du Bréfil du genre
des hérons, mais remarquable en particulier par la
longueur de fon col ; il eft plus petit que le héron
ordinaire , a le bec droit, pointu , la queue courte,
la tête & le col bruns , avec des taches noires ; fes
ailes ont un mélange blanc dans leur moucheture.
Marggrave, hiß. Brafil. (Z). / .)
SOCONUSCO, (G-éog. mod.') province de l’Amérique
feptentrionale dans la nouvelle Efpagne. Elle eft
bornée au nord par la province deChiapa, au midi par
la mer du fud, au levant parla province de Guatimala,
& au couchant par la province de Guaxaca. De La et
lui donne environ 3 5 lieues de long , 6c prefque autant
de large. On n’y trouve d’autres places que So-
conufeo , qui n’eft habitée que par un petit nombre
d’efpagnols. (Z ) . J . )
SOCOTERA ou SO COTO R A , ( Géog. mod. ) île
fituée entre l’Arabie-heureufe 6c l’Afrique , au midi
du cap Fartac , & au nord du capGardafi.fi, environ
à zo lieues de ces deux continens. On donne à cette
île une quarantaine de lieues de tour ; elle a un roi
particulier, qui releve d’un chérifd’Arabie. Son produit
confifte en bétail, en riz 6c en fruits ; on en tire
aufli des dattes, de l’encens 6c de l’aloës ; fa capitale
fe nomme Tamara , Tamarin ou Tamarette. Latit.11.
( D. J. ) - „ ' s . .
SOCOTH-BÉNOTH , ( Critique facrée. ) idole des
Babyloniens , dont il eft fait mention au IV. liv. des
rois ydiap. xvij. 3 0. Elle fut apportée dans la Pa-
leftine par les Babyloniens transférés en Samarie,
Ce mot focoth-bénoth fignifie le tabernacle des filles ;
6c la plupart des meilleurs critiques ont adopté l’opinion
de Seiden, que c ’eft le nom du temple dédié à
la Vénus de Babylone, où les filles s’affembloient
pour fe proftituer en l’honneur de cette déeffe ; nous
apprenons ces particularités d’Hérodote.
Il y a , dit cet ancien hiftorien, chez les Babyloniens
, comme dans l’île de Chypre , une coutume
honteufe, c’eft que toutes leurs femmes font obligées
une fois dans leur vie de venir au temple de
Vénus, 6c d’y accorder leurs faveurs à quelqu’un
des étrangers qui s’y rendent de leur côte pour en
jouir. Il arrive feulement que les femmes qui ne veulent
pas fe proftituer , fe tiennent près du temple de
la déeffe dans leurs propres chars fous des lieux voûtés
, avec leurs domeftiques près d’elles ; mais la plû-
part, magnifiquement parées & couronnées de fleurs,
fe repofent ou fe promènent dans le palais de Vénus;
attendant avec impatience que quelque étranger leur
adreffe fes voeux.
Ces étrangers fe trouvent en foule dans differentes
allées du temple , diftinguées chacune par des
cordeaux ; ils voyent à leur gré l’affemblée de toutes
les Babyloniennes, & chacun peut prendre celle qui
lui plaît davantage. Alors il lui donne une ou plufieurs
pièces d’argent, en difant, « j’invoque pour
» toi la déeffe Mylitta » , c’eft le nom de Vénus chez
les Affyriens. Il n’eft ni permis à la femme de dédaigner
l’argent qui lui eft offert, quelque petite que
foit la fomme, parce qu’elle eft deftinée a un ufage
facré , ni de refufer l’étranger qui dans ce moment
lui donne la main , & l’emmene hors du fanftuaire
de la déeffe ; après avoir couché avec lu i, elle a fait
tout ce qu’il falloit pour fe rendre Vénus favorable,
ôç elle revient chez elle , oii elle garde enfuite r.eli-
gieufement les réglés de la chafteté.
’ Les femmes qui font belles ne demeurent pas Iong-
tems dans le temple de Vénus , mais celles qui ne
font pas favorifées des grâces de la nature y font
quelquefois un féjourde quelques années, avant que
d’avoir eu le bonheur de fatisfaire à la loi de la déeffe ;
car elles n’ofent retourner chez elle qu’avèc la gloire
de ce triomphe.
Strabon confirme en deux mots le récit d’Hérodote.
C ’eft la coutume, dit-il, des Babyloniennes
de chercher à devenir la conquête de quelque étranger.
Dans ce deffein, elles accourent en foule extrêmement
parées dans le-temple de Vénus ; l’étranger
jette de l’argent à celle qui lui plaît, l’emmene
hors du temple & couche avec elle ; mais l’argent
qu’il lui donne eft confacré à la déeffe.
Il femble que Baruch faffe allufion à cette pratique
infâme, dans le chap. vj. verf. 42. & 43. de fes prophétie
: « Les femmes entourées de cordeaux l'ont
» aflifes ou brûlant des noyaux d’olives ; 6c lorfque
» quelqu’une d’elles accueillies, par quelque étran-
» ger va dormir avec lu i, elle reproche à fa voifine
» qu’elle n’a pas eu la même faveur, 6c que fon cor-
» deau n’a pas été rompu ». ( D . J. )
SOCQU EU RS, (Fontaines falante s.') ouvriers employés
dans les falines de Franche-Comté ; ainfi ap-
pellé de leur fon&ion le fouage. Voyez l'article Saline.
SOCRATIQUE, philosophie, ou Histoire de
L A PHILOSOPHIE DE SOCRA TE , (H tfl. de là Philofi)
le fyftème du monde 6c les phénomènes de la nature
avoient été, jufqu’à Socrate, l’objet de la méditation
des philofophes. Ils avoient négligé l’étude de la morale.
Ils croyoient que les principes nous en étoient
intimement connus , 6c qu’il étoit inutile d’entretenir
de la diftin&ion du bien 6c du mal, celui dont la
confcience étoit muette.
Toute leur fageffe fe réduifoit à quelques, fenten-
ces que l’expérience journalière leur avoit didtées ,
& qu’ils débitaient dans l’occafion. Le fcul Arché-
laiis avoit entamé dans fon école la queftion des
moeurs, mais fa méthode étoit fans folidité , & fes
leçons furent fans fuccès. Socrate fon difciple, né
avec une grande ame, un grand jugement, un efiprit
porté aux chofes importantes , & d’une .utilité générale
6c première , vit qu’il falloit travailler par
rendre les hommes bons, avant que de commencer
à les rendre favans ; que tandis qu’on avoit les yeux
attachés aux aftres , on ignoroit ce qui fe paffoit à
Les piés ;qu’à force d’habiter le c ie l, on étoit devenu
etranger dans fa. propre maifon ; que l’entendement
feperfedionnoit peut-être,mais qu’on abandon'noit à
elle-même la volonté ; que le tems fe perdoit en
fpeculations frivoles ; que l’homme vieilliffoit, fans
s’être interrogé fur le vrai bonheur de la v ie, & il
ramena fur la terre la philofophie égarée dans les régions
du foleil. Il parla de l’ame, des paffions , des
vices , des vertus , de la beauté & de la laideur mQ- ;
raies , de la fociété, & des autres objets qui ont une
liaifon immédiate avec nos attions &: notre félicité.
Il montra une extrême liberté dans fa façon de pen-
fer. Il n’y eut aucune forte d’intérêt ou de terreurs
qui retint la vérité dans fa bouche. Il n’écouta que
l ’expérience, la réflexion, & la loi de l’honnête ; &
il mérita , parmi ceux qui l ’avoient précédé, le titre
de philofophe par excellence, titre que ceux qui lui
luccederent ne lui ravirent point. Il tira nos ancêtres
de 1 ombre & de lapoufliere, & il en fit des citoyens,
des hommes d’état. Ce projet ne pouvoit s’exécuter
lans perd, parmi des brigands intéreffés à perpétuer I
le v ic e , 1 ignorance & les préjugés. Socrate le fa-
v o it , mais qui eft-ce qui étoit capable d’intimider
celui qui avoit placé les efpérances au-delà de ce monde
, 6c pour qui la vie n’étoit qu’un lieu incommode
qui le reteftoit dans une prifon, loin de la véritable
patrie ?
, Xénophon & Platon, fes difciples, fes amis , IeS
témoins & les imitateurs de fa vertu , ont écrit fon
hiftoire ; Xénophon avec cette fimplicité & cette
candeur qui lui étoient propres, Platon avec plus de
faite & un attachement moins fcrupuleux à la vérité.
Un jour que Socrate entendoit réciter un des dialogues
de celui-ci ; c’é to it, je crois , celui qu’il a inti^
tulé le lyfis : ô dieux , s’écria l’homme de bien, les
beaux menfonges que le jeune homme a dit de moi !
Anftoxene, Demetrius de Phalere, Panetius Ca-
lifthene, & d’autres s’étoient aufli occupés des’ ac<*
tions, des difeours, des moeurs, du caraftere, & dé
la vie de ce philofophe, mais leurs ouvrages ne nous
font pas parvenus.
L’athénien Socrate nâquit dans le village d’Alopé,
dans la foixante & dix-feptieme olympiade , la qua«
trieme année, & le fixieme de thargelion, jour qui
fut dans la fuite marqué plus d’une fois par d’heureux
événemens, mais qu’aucun ne rendit plus mémorable
que fa naiffance. Sophronifque fon pere, étoit
ftatuaire , & Phinarete fa mere, étoit fage-femme',
Sophronifque qui s’opperçut bien-tôt que les dieux
ne lui avoient pas donné un enfant ordinaire, alla
les confulter fur fon éducation. L ’oracle lui répondit
, laiffe-le faire , & facrifie à Jupiter & aux mufeS.
Le bon homme oublia le confeil de l’oracle & mit
le cifeau à la main de fon fils. Socrate fàprès la mort
de fon pere , fut obligé de renoncer à fon goût, &
d’exercer par indigence une profeflion à laquelle
il ne-fe fentoit point appelle; mais entraîné à la méditation
, le cifeau lui tomboit fouvent des mains
& il paffoit les journées appuyé fur le marbre.
Criton , homme opulent 6c philofophe, touché
de fes talens , de fa candeur & de fa mifere, le prit
en amitié, lui fournit les chofes néceffaires à la vie,
lui donna des maîtres, 6c lui confia l’éducation de fes
enfans. '
Socrate entendit Anaxagoras , étudia fous Arché-
laiïs, qui le chérit, apprit la mufique de Damon, fe
forma à l’art oratoire auprès du fophifte Prodicus, à
la poéfie fur les confeils d’Evenus , à la géométrie
avec TTieodore, 6c fe perfectionna par le commerce
de Diotime 6c d’Afpafie,deux femmes dont le mérite
s’eft fait diftinguer chez la nation du monde ancien
la plus polie , dans fon fiecle le plus célébré 6c le
plus éclairé , & au milieu des hommes du premier
génie. Il ne voyagea point.
Il ne crut point que fa profeflion de philofophe le
difpenfât des devoirs périlleux du citoyen. Il quitta
fes amis , fa folitude, fes livres, pour prendre les arômes
, 6c il fervit pendant trois ans dans la guerre
cruelle d’Athènes 6c de Lacédémone ; il aflifta au fie?
ge de Potidée à côté d’Alcibiade, oii perfonne, au
jugement de celui-ci, ne fe montra ni plus patient
dans la fatigue, la foif & la faim , ni plus ferein. Il
marchoit les piés nuds fur la glace ; il fe précipita au
milieu des ennemis, 6c couvrit la retraite d’Alcibiade,
qui avoit été bleffé, 6c qui feroit mort dans la mêlée.
Il ne fe contenta pas de lauver la vie à fon ami ; après
l’a&ion, il lui fit adjuger le prix de bravoure, qui lui
avoit été décerné. Il lui arriva plufieurs fois dans cette
campagne de paffer deux jours entiers de fuite immobile
à Ion pofte, & abforbé dans la méditation. Les
Athéniens furent malheureux au fiege de Delium :
Xénophon renverfé de fon cheval y auroit perdu
la vie , fi Socrate, qui combattoit à p ié, ne l’eût pris
fur fes épaules, 6c ne l’eût porté hors de l’atteinte de
1 ennemi. Il marcha fous ce fardeau non comme un
homme qui fuit, mais comme un homme qui compte
fes pas 6c qui mefure le terrein. Il avoit le vifage
tourné à l’ennemi, 6c on lui remarquoit tant d’intré