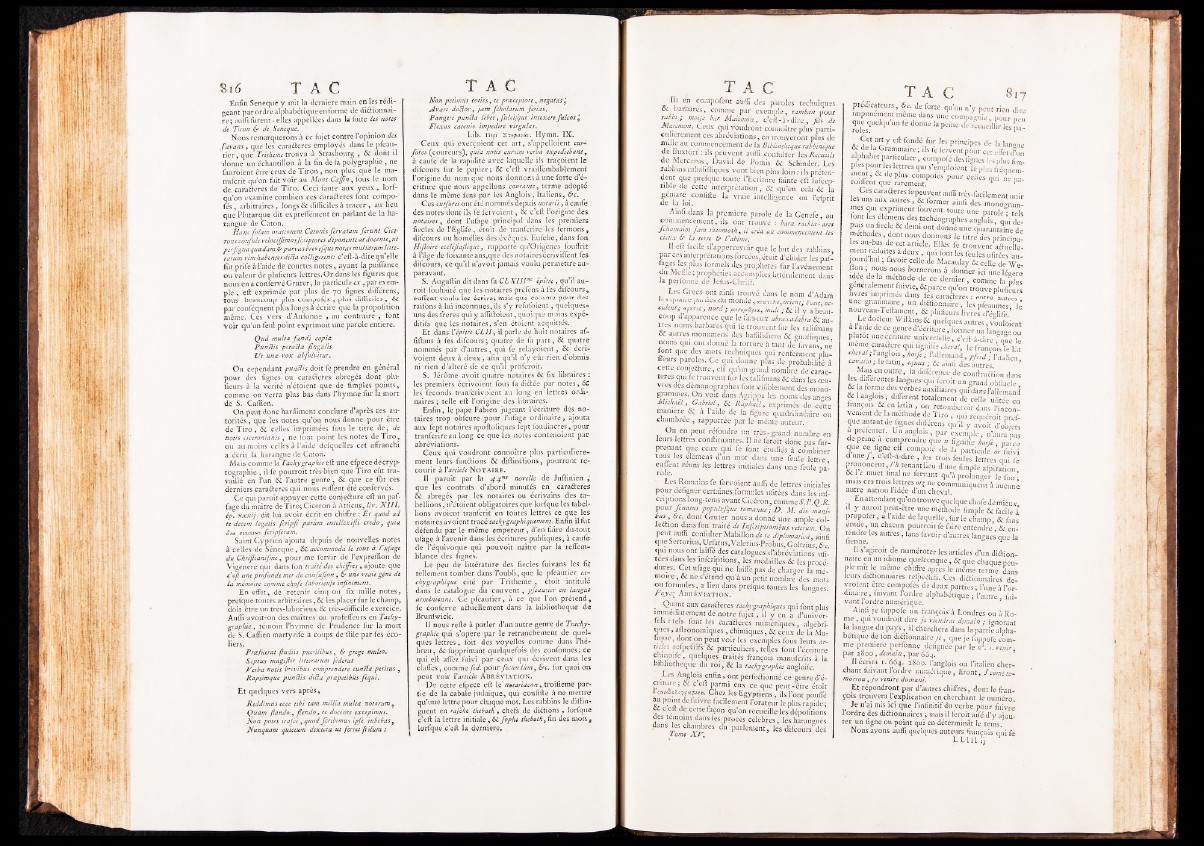
Enfin Sêneque y mit la derniere thain en les rédigeant
p a r ordre alphabétique en forme de dictionnaire
; auffi furent - elles appellées dans la fuite les notes
de Tiron & de Seneque.
Nous remarquerons à ce fujet contre l’opinion des
favans, que les caraCteres employés dans le pfeau-
t ie r , que T ri thème trouva à Strasbourg , Ôc dont il
donne un échantillon à la fin de fa polygrapliie , ne
fauroient être ceux de Tiron , non plus que le ma-
nuferit qu’on fait voir au Mont Caffin, fous le nom
de carafteres de Tiro. Ceci faute aux y e u x , lorsqu'on
examine combien ces carafteres font composés
, arbitraires, longs & difficiles à tracer , au lieu
que Plutarque dit expreffément en parlant de la harangue
de Caton.
Hanc folam orationem Catonis fervatam ferunt Cicérone
confule velociffimosferiptotes deponente at docente, ut
perjîgnaquetdam &parvasbrevefquenotasmultarumlitte-
rarum vint habtntes dicta colligèrent: c’eft-à-dire qu’elle
fut prife à l’aide de courtes notes, ayant la puiffance
ou valeur de plufieurs lettres. Or dans les figures que
nous en a confervé Gruter, la particule e x , par exemple
, eft exprimée par plus de Jo Signes différens,
tous beaucoup plus compofés , plus difficiles , &
par conséquent plus longs à écrire que la propofition
même. Ces vers d’Aufonne , au contraire , font
voir qu’un Seul point exprimoit une parole entière.
Quâ multa fandi copia.
Punclis peracta fingulis
Ut una yox abfolvitur.
Ou cependant punclis doit Se prendre en général
pour des Signes ou caraéreres abrégés dont plufieurs
à la vérité n’étoient que de Simples points ,
comme on verra plus bas dans l’hymne fur la mort
de S. Caffien. ^
On peut donc hardiment conclure d’après ces autorités
, que les notes qu’on nous donne pour être
de T i r o , & celles imprimées fous le titre de, de
notis ciceronianis, ne font point les notes de T iro ,
ou au-moins celles à l’aide defquelles cet affranchi
a écrit la harangue de Caton.
Mais comme la Tachygraphie eft une efpece de cryptographie
, il fe pourroit très-bien que T iro eût travaillé
en l’un &: l’autre genre, & que ce fût ces
derniers cara&eres qui nous euffent été confervés. .
Ce qui paroît appuyer cette conjecture eft un paf-
Sage du maître de Tiro; Cicéron à Atticus, liv. X I I I .
ép. xxxij. dit lui avoir écrit en chiffre : Et quod ad
te decem legatis fcripji parîim intellexifli credo, quia
■ S'ia. rtifMiuv feripferam.
Saint Cyprien ajouta depuis de nouvelles notes
•à celles de Séneque , & accommoda le tout à l'ufage
du Chriflianifme, pour me Servir de l’expreffion de
Vigenere qui dans Son traite des chiffres, ajoute que
cefl une profonde mer de confüjîon , & une vraie gène de
la mémoire comme chofe laborieufe infiniment.
En effet, de retenir cinq ou Six mille notes,
prefque toutes arbitraires, & les placer fur le champ,
doit être un très-laborieux & très-difficile exercice.
Auffi avoit-on des maîtres ou profeffeurs en Tachy-
graphie, témoin l’hymne de Prudence fur la mort
de S. Caffien martyrifé à coups de ftile par Ses écoliers.
Proefuerat fludiis puenlibus, & grege multa.
Septus magijler Litterarum fédérât
Verba notis brevibus comprendere cuncta peritus ,
Raptïmque punclis dicta prapetibus fequi.
Et quelques vers après,
Reddimus ecce tibi tam millia multa notarum,
Qùam flando, fiendo, te docente excepimtis.
Non potes irafei , quod fcribimus ipfe jubebas,
Hunquam quietum dextera ut ftrret (iilum :
Non petimuS toties, te praceptore, negatai}
Avare doclor, jam fcholarum ferias.
Pangere puncta libet, fülcifque intexere fulcos *
Flexas catenis impedire virgulas.
Lib. nep STepai-wi'. Hymn. IX.
Ceüx qui exerçoient cet art, s’appelloient ctir•*
fores (coureurs), quia notis cutslm verba expedièbant,
à caufe' de la rapidité avec laquelle ils traçoient le
difeours fur le papier; & c’eft vraiflembablement
l’origine du nom que nous donnons à une forte d’écriture
que nous appelions courante, terme adopté
dans le même Sens par les Anglois, Italiens, &c.
Ces curfores ont été nommés depuis notant, à caufe
des notes dont ils fe fervoient, & c’ eft l’origine des
notaires, dont l’ufage principal dans les premiers
fiecles de l’Eglife, étoit de tranferire les fermons ,
difeours ou homélies des évêques. Eufebe, dans Son
Hifloire eccléjiafliqtte, rapporte qu’Origènes Souffrit
à l’âge de Soixante ans,que des notaires écriviffent Ses
difeours, ce qu’il n’avoit jamais voulu permettre auparavant.
S. Auguftin dit dans fa CL X IIIme èpître, qu’il au-
roit Souhaité que les notaires préfens à fes difeours ,
euffent voulu les écrire; mais que comme pour des
raifons à lui inconnues, ils s’y refufoient, quelques-
uns des freres qui y afliftoient, quoique moins expéditifs
que les notaires, s’en étoient acquittés.
Et dans Yépitre CL1I , il parle de huit notaires af-
fiftans à fes <1 ifeours ; quatre de fa part, & quatre
nommés par d’autres, qui fe relayoient, & écri-
voient deux à deux, afin qu’il n’y eût rien d’obmis
ni rien d’altéré de ce qu’il proferoit.
S. Jérôme avoit quatre notaires & fix libraires t
les premiers écrivoient fous fa diftée par notes, ÔC
les Seconds tranferivoient au long en lettres ordinaires
; telle eft l’origine des libraires.
Enfin, le pape Fabien jugeant l’écriture des notaires
trop obfcure pour l’ufage ordinaire, ajouta
aux fept notaires apoftoliques Sept foudiacres, pour
tranferire au long ce que les notes contenoient par
abréviations.
Ceux qui voudront connoître plus particulièrement
leurs fondions & diftinûions, pourront re-,
courir à l’article Notaire.
Il paroît par la 44™ novelle de Juftinien
que les contrats d’abord minutés en caraéleres
& abrégés par les notaires ou écrivains des tabellions
, n’étoient obligatoires que lorfque les tabellions
avoient tranferit en toutes lettres ce que les
notaires avoient tracé tachy graphiquement. Enfin il fut
défendu par le même empereur, d’en faire du-tout
ufage à l’avenir dans les écritures publiques, à caufe
de l’équivoque qui pouvoit naître par la reffem-
blance des lignes.
Le peu de littérature des fiecles fuivans les fit
tellement tomber dans l’oubli, que le pfeautier tachy
graphique cité par Tritheme, etoit intitulé
dans le catalogue du couvent, pfeautier en langue
arménienne. Ce pfeautier, à ce que l’on prétend,
fie conferve actuellement dans la bibliothèque de
Brunfwick.
Il nous refte à parler d’un autre genre de Trachy-
graphie qui s’opère par le retranchement de quelques
lettres, Soit des voyelles comme dans l’hébreu
, & Supprimant quelquefois des confonnés ; ce
qui eft affez Suivi par ceux qui écrivent dans les
claffes, comme fed. pour fecundwn, &c. fur quoi on
peut voir l’article Abréviation.
De cette efpece eft le notariacon, troifieme partie
de la cabale judaïque, qui confifte à ne mettre
j qu’une lettre pour chaque mot. Les rabbins le diftin-
guent en rafehe theboth, chefs de dictions, lorfque
c’eft la lettre initiale, & foph» theboth, fin des mots j,
lorfque c’eft la derniere»
Ils en compofent auffi des paroles techniques
Gc barbares, comme par exemple, ramban pour
■» moif i bar Maiemon, c’eft-à-dire , fils de
Maiemon. Ceux qui voudront connoître plus particulièrement
ces abréviations, en trouveront plus de
mille au commencement de la Bibliothèque rabbinique de Buxtorf : ils peuvent auffi confulter les Recueils
de Mercerus, David de Pomis & Schinder. Les
rabbins cabahftiques vont bien plus loin : ils prétendent
que prefque toute l’Ecriture Sainte eft fufeep-
,1e de cette interprétation, &t qu’en cela & la
gemare confifte la vraie intelligence ou l’efprit
de la loi. 1
Amfi dans la première parole de la Genefe au
commencement,-ils ont trouvé : bara rackia-ares
Jchamaim jam theomoth, il créa au commencement les
cuux & la terre & 1'abîme.
H eft facile d’appercevoir que le but des rabbins,
par ces interprétations forcées, étoit d’éluder lès paf-
lages les plus formels des prophètes fur l’avénement
ou Meme ; prophéties accomplies littéralement dans
la perlonne de Jefus-Chrift.
Les Grecs ont ainfi trouvé dans le nom d’Adam
les quatre parties du monde, «««a», orient; oc-
culcnt; y .r o t , nord ; midi ; & il y a beaucoup
d apparence que le fameux aimxadakra & autres
noms barbares qui fe trouvent fur les taliftnans
oc autres monumens des baflîlidiens k gnoltiques
noms qui ont donné la torture à tant de, favans ne
font que des mots techniques qui renferment plu-
fieurs paroles. Ce qui donne plus.de probabilité à
cette conjecture, eft qu’un grand nombre de caractères
qui fe trouvent fur les talifmans & dans les oeuvres
dès démonographes font vifiblement des mono-
grammes. On voit dans Agrippa les noms des anges.
Michael y Gabriel y & Raphaël y exprimés’ de cette
manière^ & à l’aide de la figure quadrilinéaire ou
chambrée , rapportée par le même auteur.
On en peut réfoudre un très-grand nombre en
leurs lettres conftituantes. Il fie Seroit donc pas Surprenant
que ceux qui fe font étudiés' à combiner
tous les élemens d’un mot dans une feule lettré
euffent réuni les lettres initiales dans une feule parole.
r
Les Romains fe fervoient auffi de lettres initiales
pour défigner certaines formulés ufitées dans lés inf-
criptions long-tems avant Cicéron, comme S.P. Q.R.
pour fenatus populufytu romnnus; D. M. dis manî-
bus &c dont Gruter nous a donné une ample col-
lection dans Son traité de Infcriptionibus veterum. On
peut auffi confulter M abilion^ re diplomaticâ, ainfi
queSertonus, ürfatus,Valerius-Probus,Goltzius &c
qui nous ont laiffé des catalogues d’abréviations ufi-
tees dans les mferiptions, les médailles & les procédures.
Cet ufage qui ne laiffe pas de charger la mémoire
, & ne s’étend qu’à un petit nombre des mots
ou formules , a lieu dans preique toutes les langues. Voyeç Abréviation.
. Quant aux caraéleres tachy graphiques qui font plus
immédiatement de notre fujet, il y en a d’univer-
, lels : tels font lés cara.fteres numériques , algébriques,
aftrônomiques , chimiques , & ceux de la Mu-
fique, dont on peut voir les exemples fous leurs ar-
ttcles refpeéhfs & particuliers, telles font l’écriture
k-i!r0li ’ <^ue^clues. traités françois manuferits à la
bibliothèque du roi, & la tachy graphie angloife.
.Les Anglois enfin, ont perfectionné ce genre d’écriture
; & c’eft parmi eux ce que peut - être étoit
limZoXcyçavK*. Chez les Egyptiens , ils l’ont pouffé
àu point de Suivre facilement l’orateur le plus rapide ;.
ce c eit de cettefaçon qu’on recueille les dépolirions
des témoins dans les,procès célébrés, les harangués
dans les chambres du parlement, les difeours des
Tome X F ,
prédicateurs, &c. de forte qu’on n’y peut rien dire
impunément même dans une compagnie, pour neu
rolesqUe qU Un d° ” ne la prine * recueillir les pa-
Cet art y eft fondé fur les principes de la langue
t l n t h ' f 6’ lk k ftrvent P°ur cet d’un
£ , 0 f r iculler , compofe des lignes les plus f,,„.
pies pour les lettres qui s’emploient le plus fréquemment,
& déplus compofés pour celles qui nè pâ-
roiffent que rarement. ^ P
Ces caraâeresfe peuvent auffi très-facilement unir
les uns aux autres , & former ainfi des monogrammes
qui expriment fouvent toute une parole® tSs
font les elemens des tachéographes anglois, qui de-
puis un fiecle & demi ont donné une quarantaine de
méthodes dont nous donnons le titre des principales
au-bas de cet article. Elles fe trouvent aanellement
réduites à deux , qui font les feules ufitées au-
rourdhui; favoir celle de Macaulay & cellede
ftonyi|>|s nous, bornerons è donner ici une légère
idee delà méthode de ce dernier, comme la lin s
généralement fiiiviej&parce qu’on trouve plufieurs
livres imprimés dans fès caractères ; entre* autres
une grammaire, un diaionnaire, les pfeaumes, lé
nouveau-Teftament, & plufieurs livres' d’églife
à l’a i * “le1*“ 1 Wllk'" s,& .q>'e!ques autres, vouloient
à 1 aide de ce genre d'écriture, former un lan«a«eou
pmtot une écriture univerlelle, c’eft-à-dire que le
même c a r a fe e qui lignifie cheval, le françori le lût
cheval;l anglois , horfe; l’allemand, pferd]l’italien
cavallo; le latin, eqans ; & ainfi des autres.
l e ^ ? f f * nOUT ’ la llli% ncc de “ nftruaion dans
fos differentes langues qui icroit un grand obftacle,
& a n X ! des^ erb“ auxiliaires qui dans l’allemand
«clanglois, different totalement de celle ufitée en
hançois ot cn lan n , on retomberoit dans l’inconvénient
de la méthode de Tiro , qui requéroit prefque
autant deTignes differens qu’il y avoit d’objets
à prefenter. Un anglois , par exemple, n’aura pas
de peineA comprendre que n lignifie' horfe pai-ce
que ce figne eft compolé de I M B ü j
d une ƒ , c eft-à-dire , les trois feules lettres qui fe
prononcent / li tenantheu d'une fimple afpiration!
& lu, muet finalité fervent qu’à prolonger le fon-
mais ces trois lettres oq ne communiquent à aucune
autre nation 1 idee d un cheval.
En attendant qu’on trouve quelque chofe demieex
il y auroit peut-être une méthode fimple &fàcile h
pvopofer, à l’aide de laquelle, fur le champ, & fans
etude, un chacun pourroit fe faire entendre & en-
tendre les autres, ians favoir d’autres langues’ que la
lienne. 0 ^
Il s’agiroit de numéroter les articles d’iin diaion-
nqireen un idiome quelconque , & que chaque peuple
mit le même chiffre après le même terme dans
leurs dictionnaires refpeftifs. Ces dictionnaires devraient
etre compofés de deux parties ; l’u n e à l’or-
dmaire, fuivant 1 ordre alphabétique ; l’autre fui-
. vant l’ordre numérique.
Ainfi je fuppofe un françois à Londres ou à Rome
, qui voudroit dire je viendrai demain ; ignorant
la langue du pays, il cherchera dans la partie alphabétique
de fon dictionnaire/*, que je fuppofe comme
première perfonne défignée par le n°. /.venir
par 2800, demain, par 66a.
Il écrira i . '664. 2800. l’anglois ou l’italien cherchant
fuivant l’ordre numérique, liront, J corne to*
morrou, jo venire do ma ni.
Et répondront par d’autres chiffres, dont le fran-»
çois trouvera l’explication en cherchant le numéro.
Je n’ai mis ici que l’infinitif du verbe pour fuivre
l’ordre des dictionnaires ; mais il feroit aifé d’y ajouter
un figne ou point qui en déterminât le tems.
Nous ayons auffi quelques auteurs françois qui Ce
L L l l l i j