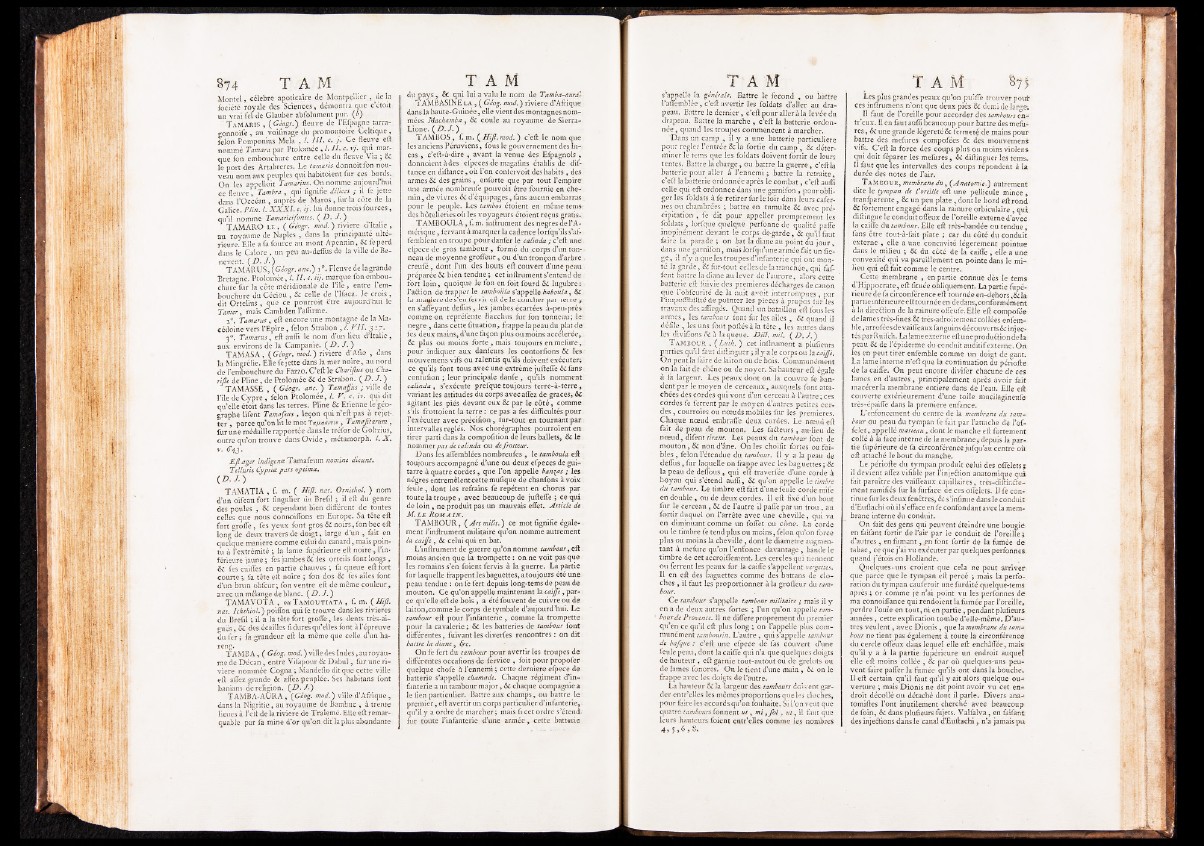
Mont.el, cclebre apoticaire de Montpellier , delà
fociété royale des Sciences, démontra que c’étoit
un vrai fef de Glauber abfolument pur. (b)
Tamaris , ( Géogr.) fleuve de l’Efpagne tarra-,
gonnoife , au voifinage du promontoire Celtique ,
l'elon Pomponius Mêla , /. I U c- j- Ce fleuve eft
nommé Tamara par Ptolomée ,/ ./ / . c. vj. qui marque
fon embouchure entre celle du fleuve Via ; &
le port des Artabreres. Le tamaris donnoit Ton nouveau
nom aux peuples qui habitoient fur ces bords, ,
On les apnelloit Tamarins. On nomme aujourd’hui
ce fleuve *Tambra , qui fignifie délices ; il fe jette
dans l’Occéan , auprès de Maros, fur la côte de la
Galice. P Un. I. X X X I . c. ij. lui donne trois fources,
qu’il nomme Tamaricifontes. ( D . J. )
TAMARO l e , (Géogr. mod. ) riviere d’Italie,
au royaume de Naples , dans la principauté^ ultérieure.
Elle a fa fource au mont Apennin , & feperd
dans le Calore , un peu au-deffus de la ville de Be-
nevent. ( D. J. ) •
TAMARUS, (Géogr. anc.) i° . Fleuve de la grande
Bretagne. Ptolomée, 1. II. c. iij. marque fon embouchure
fur la côte méridionale de l’î le , entre l’embouchure
du Céciou , & celle de l’Ifaca. Je crois ,
dit Ortelius , que ce pourroit être aujourd’hui le
Tamer, mais Cambden l’affirme.
2°. Tamarus ,• eft encore une montagne de la Macédoine
vers l’Epire, félon Strabon , l. V I I . j 2y.
30. Tamarus, eft aufli le nom d’un lieu d’Italie,
aux environs de la Campanie. (D . J. )
TAM ASA, (Géogr. mod.') riviere d’Afie , dans
la Mingrélie. Elle fe jette dans la mer noire, au nord
de l’embouchure du Fazzo. C ’eft le Charißus ou C/ia-
rifle de Pline, de Ptolomée & de Strabon. (D . J. )
TAMASSE , ( Géogr. anc. ) Tamafus ; ville de
l ’île de Cypre , félon Ptolomée, l. V. c. iv. qui dit
qu’elle étoit dans les terres. Pline & Etienne le géographe
lifent Tamajeus , leçon qui n’eft pas à rejet-,
ter , parce qu’on lit le mot Ta/j-ctsirov, Tamofitarum ,
fur une médaille rapportée dans le tréfor de Goltzius,
outre qu’on trouve dans Ovide > metamorph. I. X .
y. 643*
Efiager indigence Tamafeum nomine dicunl.
Telluris Cypria pars optima.
( D . J . )
TAMATIA , f. m. ( Hiß. nat. Ornithol. ) nom
d’un oifeau fort fingulier du Brefxl ; il eft du genre
des poules , & cependant bien différent de toutes
celles que nous connoiffons en Europe. Sa tête eft
fort grofle, fes yeux font gros & noirs, fon bec eft
long de deux travers de doigt , large d’un , fait en
quelque maniéré comme celui du canard, mais pointu
à l’extrémité ; la lame fupérieure eft noire , l’inférieure
jaune ; fes jambes & fes orteils font longs,
& fes cuiffes en partie chauves ; fa queue eft fort
courte ; fa tête eft noire ; fon dos & fes ailes font
d’un brun obfeur; fon ventre eft de même couleur,
avec un mélange de blanc. (D . J . )
T AM A V O T A , omTamoutiata , f. m. (Hiß.
nat. Ichthiol.) poiflon quife trouve dans les rivières
du Brefil ; il a la tête fort gToffe, les dents très-aiguës,
& des écailles fi dures qu’elles font à l’épreuve
du fer ; fa grandeur eft la même que celle d’un ha-
reng.
TA MBA, ( Géog. mod. ) ville des Indes, au royaume
de Décan, entre Vilàpour & Dabul, fur une riviere
nommée Cogna ; Mandeflo dit que cette ville
eft affez grande & affez peuplée. Ses habitans font
banians de religion. (D .J . )
TAMBA-AURA, (Géog. mod.) ville d’Afrique,
dans la Nigritie, au royaume de Bambuc , à trente
lieues à l’elt de la riviere de Tralemé. Elle eft remarquable
par fa mine d’or qu’on dit la plus abondante
du pays , & qui lui a valu,le nom de Tamba-aural
TAMBASINE l a , ( Géog. mod. ) riviere d’Afrique
dans la haute-Guinée, elle vient des montagnes nommées
Machamba, & coule au royaume de Sierra-
Lione. ( D. J. )
TAM BCS, f. m. ( Hiß. mod. ) c’ eft le nom que
les anciens Péruviens, fous le gouvernement des In-,
cas , c’eft-à-dire , avant la venue des Efpagnols ,
donnoient à des ' efpeces de magafins établis de distance
en diftance,ou l’on conlervoit des habits , des
armes & des grains, enforte que par tout l’empire
une armée nombreufe pouvoit être fournie en chemin,
de vivres & d’équipages, fans aucun embarras
pour le peuple. Les tambos étoient en même tems;
des hôtelleries oîi les voyageurs étoient reçus gratis...
TAMBOULA, f. m. infiniment des negres de l’Amérique
, fervant à marquer la cadence lorfqu’ils s’af-
femblent en troupe pour danfer le calinda ; c’eft une
efpece de gros tambour , formé du .corps d’un tonneau
de moyenne groffeur, ou d’un tronçon d’arbre
creufé, dont l’un des bouts eft couvert d’une peau
préparée & bien tendue ; cet inftrument s’entend de
fort loin, quoique le fon en foit fourd & lugubre ::
l’a&ion de frapper le tambo'ùla s’appelle baboula, Si
la ma%iere de s’en fervir eft de le coucher par terre *
en s’afl'eyant defliis, les jambes écartées à-peu-près
comme on repréfente Bacchus fur fon tonneau ; le'
negre , dans cette fituation, frappe la peau du plat de
lès deux mains, d’une façon plus ou moins accélérée,..
& plus ou moins forte , mais toujours en mefitre,.
pour indiquer aux danfeurs les contorfions & les
mouvemens vifs ou ralentis qu’ils doivent exécuter;
ce qu’ils font tous avec une extrême jufteffe & fans
confufion ; leur principale danfe , qu’ils nomment
calinda , s’exécute prefque toujours terre-à-terre
variant les attitudes du corps avec affez de grâces, &
agitant les piés devant eux &c par le cô té, comme
s’ils frottoient la terre : ce pas a fes difficultés pour
l’exécuter avec précifion, ïur-tout en tournant par
intervalles réglés. Nos chorégraphes pourroient en
tirer parti dans la compofition de leurs ballets, & le
nommer pas de calinda ou de frotteur.
Dans les affemblées nombreufes , le tamboula eft
toujours accompagné d’une ou deux efpeces de gui-
tarre à quatre cordes, que l’on appelle bandas ; les
nègres entremêlent cette mufique de chanfons à voix '
feule, dont les refrains fe répètent en chorus par
toute la troupe, avec beaucoup de jufteffe ; ce qui
de loin , ne produit pas un mauvais effet. Article de M.le Romain.
TAMBOUR, (Artmilit.) ce mot fignifie égale--
ment l’inftrument militaire qu’on nomme autrement
la caiffe , & celui qui en bat.
L’inftrument de guerre qu’on nomme tambour ,eft
moins ancien que la trompette : on ne voit pas que
les romains s’en foient fervis à la guerre. La partie
fur laquelle frappent les baguettes, a toujours été une
peau tendue : onfe fert depuis long-temsde peau de
mouton. Ce qu’on appelle maintenant la caiß'e, parce
qu’elle eft de bois, a été fouvent de cuivre ou de
laiton,comme le corps detymbale d’aujourd’hui. Le
tambour eft pour l’infanterie , comme la trompette.
pour la cavalerie ; & les batteries de tambour font
différentes, fuivant les diverfes rencontres : on dit
battre la diane, &c.
On fe fert du tambour pour avertir les troupes de
différentes occafions de fervice , foit pour propofer
quelque chofe à l’ennemi ; cette derniere efpece de
batterie s’appelle chamade. Chaque régiment d’infanterie
a un tambour major, & chaque compagnie a
le lien particulier. Battre aux champs, ou battre le
premier, eft avertir Un corps particulier d’infanterie,.
qu’il y a ordre de marcher; mais fi cet ordre s’étend,
lur toute l’infanterie d’une armée, cette batterie
s’appelle la générale. Battre le fécond , ou battre
l’affemblée, c’eft avertir les foldats d’aller au drapeau.
Battre le dernier, c’eft pour aller à la levée du
drapeau. Battre la marche , c’eft la batterie ordonnée
, quand les troupes commencent à marcher.
'Dans un camp , il y a une batterie particulière
pour regler l’entrée & la fortie du camp , & déterminer
le tems que les foldats doivent fortir de leurs
tentes. Battre la charge, ou battre, la guerre, c’eft la
batterie pour aller à l’ennemi ; battre la retraite,
c’eft la batterie ordonnée après le combat, c ’eft aufli
celle qui eft ordonnée dans une garnifon , pour obliger
les foldats à fe retirer fur le foir dans leurs cafer-
nes ou chambrées ; battre en tumulte & avec précipitation
, fe dit pour appeller promptement les
foldats , lorfque quelque perfonné de qualité paffe
inopinément devant le corps de-garde, & qu’il faut
faire la parade; on bat la diane au point du jou r ,
dans une garnifon, maislorfqu’une armée fait un fie*-
g e , il n’y a que les troupes d’infanterie qui ont monté
la garde, & fur-tout celles de la tranchée, qui faf-
fcnt battre la diane au lever de l’aurore, alors cette
batterie eft fuivie des premières décharges de canon
que l'obfcurité de la nuit avoit interrompues, par
l ’impoffibilité de pointer les pièces à propos fur les
travaux des afliegés. Quand un bataillon eft fous les
armes, les tambours font fur les aîles , & quand il
défile , les uns font poftés à la tête , les autres dans
les divisions ÔC à la queue. Dut. mil. ( D. J. )
T ambour , (Luth. ) cet infiniment a plufieurs
parties qu’il faut diftinguer ; il y ale corps ou la caifjé.
On peut la faire de laiton ou de bois. Communément
on-la fait de chêne ou de noyer. Sa hauteur eft égale
à là largeur. Les peaux dont on la couvre fe bandent
par le moyen de cerceaux, auxquels font attachées
des cordes qui vont d’un cerceau à l’autre; ces
cordes fe ferrent par le moyen d’autres petites cordes
, courroies ou noeuds mobiles fur les premières.
Chaque noeud embrafle deux cordes. Le noeud eft
fait de peau de mouton. Les fafteurs , au-lieu de
noeud, difent tirant. Les peaux du tambour font de
mouton, & non d’âne. On les choifit fortes ou foi-
bles , félon l’étendue du tambour. Il y a la peau de
deffus, fur laquelle on frappe avec les bag uettes ; &
la peau de deffous , qui eft traverfée d’une corde à
boyau qui s’étend aufli, & qu’on appelle le timbre
du tambour. Le timbre eft foit d’une feule corde mife
en double , ou de deux cordes. Il eft fixé d’un bout
fur le cerceau , & de l’autre il paffe par un trou, au
fortir duquel on l’arrête avec une cheville, qui va
en diminuant comme un foffet ou cône. La corde
ou le timbre fe tend plus ou moins, félon qu’on force
plus où moins la cheville, dont le diamètre augmentant
à mefure qu’on l’enfonce davantage , bande le
timbre de cet accroiffement. Les cercles qui tiennent
ou ferrent les peaux fur la caiffe s’appellent vergettes.
Il en eft des baguettes comme des battans de cloches
, il fout les proportionner à la groffeur du tambour.
Ce tambour s’appelle tambour militaire ; mais il y
en a de deux autres fortes ; l’un qu’on appelle tambour
de Provence. Il ne différé proprement du premier
qu’en ce qu’il eft plus long ; on l’appelle plus communément
tambourin. L’autre, qui s’appelle tambour
de bafque : c’eft une efpece de fas couvert d’une
feule peau, dont la caiffe qui n’a que quelques doigts
de hauteur, eft garnie tout-autout ou de grelots ou
de lames fonores. On le tient d’une main , & on le
frappe avec les doigts de l’autre.
La hauteur & la largeur des tambours doivent garder
entr’elles les mêmes proportions que les cloches,
pour faire les accords qu’on fouhaite. Si l’on veut que
quatre tambours fonnent u t, mi 9f o l , u t, il faut que
leurs hauteurs foient entr’elles comme les nombres I M
Les plus grandes peaux qu’on puiffe trouver pouf
ces inftrumens n’ont que deux piés & demi de large;
Il faut de l’oreille pour accorder des tambours en-
tr’eux. Il en fout aafli beaucoup pour battre desmefu-
res, & une grande légèreté & fermeté de mains pour
battre des mefures compofées & des mouvemens
vifs. C’eft la force des coups plus ou moins violens
qui doit féparer les mefures, & diftinguer les temsi
Il fout que les intervalles des coups répondent à la
durée des notes de l’air.
T ambour, membrane du 9 (Anatomie.) autrement
dite le tympan de l'oreille eft une pellicule mince ;
tranfparente, & un peu plate, dont le bord eft rond
& fortement engagé dans la rainure orbiculaire , qui
diftingue le conduitofîeux de l’oreille externe d’avec
la caiffe du tambour. Elle eft très-bandée ou tendue ;
fans être tout-à-fait plate ; car du côté du Conduit
externe * elle aune concavité légèrement pointue
dans le milieu ; & du côté de la caiffe , elle a une
convexité qui va pareillement en pointe dans le milieu
qui eft fait comme le centre..
Cette membrane , en partie connue dès le tems
d'Hippocrate, eft fituée obliquement. La partie fupérieure
de fa circonférence eft tournée en-dehors ,ôda
partie inférieure efttournée en dedans, conformément
à la direftion de la rainure offeufe. Elle eft compoféè
de lames très-fines & très-adroitement collées enfem-
ble ,-arrofées de vaiffeaux fanguins découverts & injectés
par Ruifch. Lalame externe eft une production delà
peau & de l’épiderme du conduit auditif externe. On
les en peut tirer enfemble comme un doigt de gant;
La lame interne n’eft que la continuation du périofte
de la caiffe. On peut encore divifer chacune de ces
lames en d’autres, principalement après avoir foit
macérer la membrane entière dans de l’eau. Elle eft
couverte extérieurement d’une toile mucilagineufe
très-épaiffe dans la première enfonce.
L’enfoncement du centre de la membrane du tambour
ou peau du tympan fe foit par Rattache de l’of-
felet, appellé marteau , dont le manche eft fortement
collé à la face interne de la membrane * depuis la partie
fupérieure de fa circonférence julqu’au centre où
eft attaché le bout du manche.
Le périofte du tympan produit celui des offelets ;
il devient affez vifible par l’injeftion anatomique qui
fait paroître des vaiffeaux capillaires, très-diitincle-
ment ramifiés fur la furface de ces offelets. Il fe continue
fur les deux fenêtres, & s ’infinu e dans le conduit
d’Euftachi où il s’efface en fe confondant avec la membrane
interne du conduit.
On fait des gens qui peuvent éteindre une bougie
en faifont fortir de l’air par le conduit de l’oreille ;
d’autres , en fumant, .en font fortir de la fumée de
tabac, ce que j’ai vu exécuter par quelques perfonnes.
quand j’étois en Hollande;
Quelques-uns croient que cela ne peut arriver:
que parce que le tympan eft percé ; mais la perforation
du tympan cauferoit une furdité quelque-tems
après ; or comme je n’ai point vu les perfonnes de
ma connoiffance qui rendoient la fumée par l’oreille,
perdre l’ouïe en tout, ni en partie, pendant plufieurs
années, cette explication tombe d’elle-même. D ’autres
veulent, avec Dionis, que la membrane du tant*
bour ne tient pas également à toute la circonférence
du cercle offeux dans lequel elle eft enchâffée, mais
qu’il y a à la partie fupérieure un endroit auquel
elle eft moins collée , & par où quelques-uns peuvent
faire paffer la fumée qu’ils ont dans la bouche;
Il eft certain qu’il faut qu’il y ait alors quelque ou-»
verture ; mais Dionis ne dit point avoir vu cet endroit
décollé ou détaché dont il parle. Divers anaJ
tomiftes l’ont inutilement cherché avec beaucoup
de foin, & dans plufieurs fujets. Valfalva, en foifant
des in je étions dans le canal d’Euftachi, n’a jamais pu