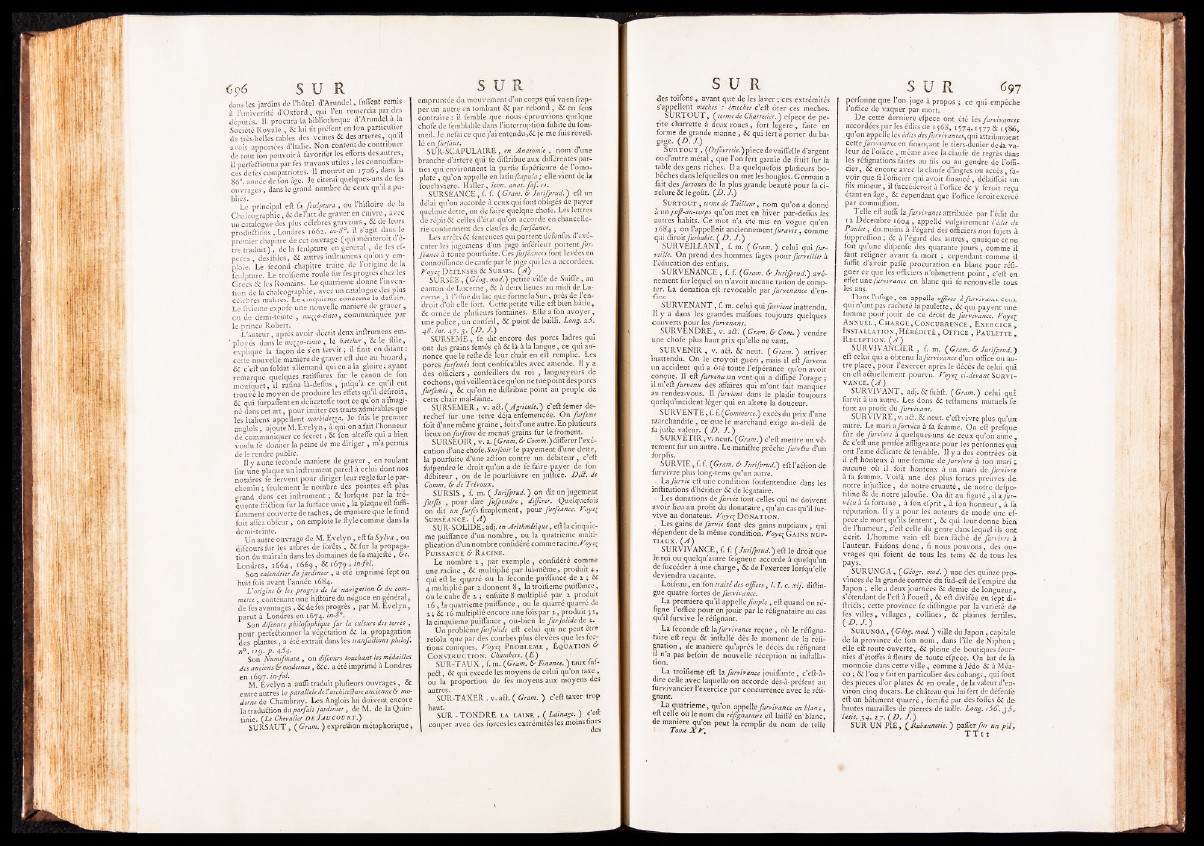
dans les jardins de l’hôtel d’Arundel, fdffent remis
à l’univerfilé d’Oxford, qui l’en remfrcia par des
députés. Il procura la bibliothèque cl Arundel a la
. Société Royale , 6c lui fit préfent en fan particulier
de très-belles tables des veines 6c des arteres, qu il
avoit apportées d’Italie. Non content de contribuer
de tout fon pouvoir à favoriser les efforts des autres,
il perfeélionna par les travaux utiles , les connoifian-
ces de Tes compatriotes. Il mourut en 1706 , dans la
86e. année de fon âge. Je citerai quelques-uns de fes
ouvrages, dans le grand nombre de ceux qu’il a pu-
Le principal eft fa fculptura , ou l’hiftoire de la
Chalcographie, 6c de l’art de graver en cuivre, avec
un catalogue des plus célébrés graveurs, & de leurs
productions, Londres i66z. in-8°. il s’agit dans le
premier chapitre de cet ouvrage (qui mériter oit d e-
tre traduit), de la fculpture en général, de fes ef-
peces , des Hiles, fie autres inftrumens qu’on y emploie.
Le fécond chapitre traite de l’origine de la
fculpture. Le troifieme roule fur fes progrès chez les
Grecs & ies Romains. Le quatrième donne l’invention
de la chalcographie, avec un catalogue des plus
célébrés maîtres. Le cinquième concerne le deffein.
Le fixieme expol'e une nouvelle maniéré de graver ,
ou de demi-teinte , me^o-tinto, communiquée par
le prince Robert.
L’auteur, après avoir décrit deux inftrumens employés
dans le me^jp-tinto , le hatcher ^ Sc le Hile,
explique la façon de s’en fervir ; il finit en difant :
cette nouvelle maniéré de graver eft due au hazard,
& c ’eft un foldat allemand qui en a la gloire; ayant
remarqué quelques ratiffures fur le canon d^e fon
moufquet, il rafina là-deffus , jufqu’à ce qu’il eut
trouve le moyen de produire les effets qu’il denroit,
& qui furpaüent en délicateffe tout ce qu’on a imaginé
dans cet art, pour imiter ces traits admirables que
les Italiens appellent morbide^a. Je fuis le premier
anglois, ajoute M.Evelyn, à qui on afaitl honneur
de communiquer ce fecret, 6c fon alteffe qui a bien
voulu fe donner la peine de me diriger , m’a permis
de le rendre public. _
Il y a une fécondé maniéré de graver, en roulant
fur une plaque un infiniment pareil à celui dont nos
notaires fe fervent pour diriger leur réglé fur le parchemin
; feulement le nombre des pointes eft plus
orand dans cet infiniment ; fie lorique par la fréquente
friftion fur la furface unie, la plaque eftfuffi-
famment couverte de taches, de maniéré que le fond
fait affez obfcur, on emploie le ftyle comme dans la
demi-teinte.
Un autre ouvrage de M. E v elyn , eft fa Sylva, ou
difcours fur les arbres de forêts , 6c fur la propagation
du mairain dans les domaines de fa majefté, &c.
Londres, 1664, 1669, 6 c i6 jy , in-fol.
Son calendrier du jardinier, a ete imprime fept ou
huit fois avant l’année 1684.
L'origine & les progris de la navigation & du. commerce
, contenant une hiftoire du négoce en général,
de fes avantages, & de fes progrès , par M. Evelyn,
parut à Londres en 1674. in-8°.
Son difcours philofophique fur la culture des terres ,
pour perfectionner la végétation fie la propagation
des plantes, a été extrait dans les tranfactions philof.
n ° . n<). ƒ>• 4^4* ,
Son Numifmata , ou difcours touchant les médaillés
des anciens & modernes, 8ec. a été imprimé à Londres
en 1697. in-fol. # _
M. Evelyn a aufli traduit pîufieurs ouvrages, oc
entre autres le parallèle de P architecture anciennes moderne
de Chambray. Les Anglois lui doivent encore
la traduction du parfait jardinier, de M. de la Quin-
tinie. (Le Chevalier D E J A U C O U R T . )
SURSAUT, ( Gram. ) expreffion métaphorique,
empruntée du mouvement d’un corps qui Va en frapper
un autre en toihbant fie par rebond , fie en fens
contraire : il femble que nous éprouvions quelque
chofe de femblable dans l’interruption fubite du fom-
meil. Je nefaice que j’ai entendu,& je me fuis reveillé
en furfaut.
SUR-SCAPULAIRE, en Anatomie , nom d’une
branche d’artere qui fe diftribue aux différentes parties
qui environnent la partie fupérieure de l’omoplate
, qu’on appelle en latin fcapula; elle vient de la
fouclaviere. Haller, icon. anat.faf //.
SURSÉANCE, f. f. ( Gram. & Jurifprud.) eft un
délai qu’on accorde à ceux qui font obligés de payer
quelque dette, ou de faire quelque chofe. Les lettres
de répit fie celles d’état qu’on accorde en chancellerie
contiennent des claules de furféance.
Les arrêts fie fentenees qui portent défenfes d’exécuter
les jugemens d’un juge inférieur portent fur-
feance à toute pourfuite. Ces fu/Jéances font levées en
connoiffance de caufe par le juge qui.les a accordées.
| Voye{ D éfenses 8e Sursis. (A )
SURSÉE, (Géog. mod.) petite ville de Suiffe, au
canton de Lucerne, fie à deux lieues au midi de Lucerne
, à l’iffue du lac que forme la Sur, près de l’endroit
d’où elle fort. Cette petite ville eft bien bâtie,
fie ornée de pîufieurs fontaines. Elle a fon avoyer,
une police, un confeil, fie point de bailli. Long. z 5.
48. lat. 4 j . 3 . (D . J.)
SURSEMÉ, fe dit encore des porcs ladres qui
ont des grains femés çà fie là à la langue, ce qui annonce
que le refte de leur chair en eft remplie. Les
porcs furfemés font confifcables avec amende. Il y a
des officiers , confeillers du roi , langueyeurs de
cochons, qui veillent à ce qu’on ne tue point des porcs
furfemés, fic qu’on ne diftribue point au peuple de
cetts chair mal-faine.
SURSEMER, v. z&.(Agricult.) c’ eftfemer derechef
fur une terre déjà enfemencée. On furfeme
fait d’une même graine, toit d’une autre. En pîufieurs
lieux on furfeme de menus grains fur le froment.
SURSEOIR, v . a. {Gram. & Comm.) différer l’exécution
d’une chofe.Surfeoir le payement d’une dette,
la pourfuite d’une a&ion contre un débiteur, c’ eft
fufpendre le droit qu’on a de fe faire payer de fon
débiteur , ou de le pourfuivre en juftice. Dict. de
Comm. & deTrévoux.
SURSIS , f. m. ( Jurifprud. ) on dit un jugement
furfis , pour dire fufpendre , différer. Quelquefois
on dit un furfis Amplement, pour furféance. V>yei
Surséan ce. ( A)
SUR-SOLIDE, adj. en Arithmétique, eft la cinquième
puiffance d’un nombre, ou la quatrième multiplication
d’un nombreconfidéré comme racine.^oyei
Puissance & Racin e.
Le nombre z , par exemple , confidéré comme
une racine , 8e multiplié par lui-même, produit 4 ,
qui eft le quarré ou la fécondé puiffance de 2 ; fie
4 multiplié par 2 donnent 8, la troifieme puiffance ,
ou le cube de 2 ; enfuite 8 multiplié par 2 produit
16 , la quatrième puiffance , ou le quarré quarré de
2 ; fie 16 multiplié encore une fois par 2, produit 3 2,
la cinquième puiffance , ou-bien le fur-Jolide de z.
Ün problème furfolide eft celui qui ne peut être
refolu que par des courbes plus élevées que les fec-
tions coniques. Koye[ PROBLEME , ÉQUATION &
C onstru ct ion. Chambers. (E )
SUR-TAUX , f. m. (Gram. & Finance. ) taux fuf-
pe&, fie qui excede les moyens de celui qu’on taxe ,
ou la proportion de fes moyens aux moyens des
autres.,
SUR-TAXER . v. a£L ( Gram. ) c’eft taxer trop
haut. I s , æ
SUR - TONDRE la laine , ( Lainage. ) c elt
couper avec des forces les extrémités les mo ins fines
<ües toifons , ayant que de les laver ; ces extrémités
s’appellent meches : émecher c’eft ôter ces meches.
SURTOUT, (termede Charretier. ) efpece de petite
charrette à deux roues , fort légère , faite en
forme de grande manne, fie qui fert à porter du ba-
gage. {D. J.) g j ü M Ü
Su r to u t , (Orfèvrerie.')piece de vaiffelle d’argent
ou d’autre métal, qué l’on l'ert garnie de fruit fur la
table des gens riches. Il a quelquefois pîufieurs bobèches
dafts lefquelles on met les bougies. Germain a
fait des furtouts de la plus grande beauté pour la ci-
zelure fie le goût. (D . J.)
Su rto ut , terme de Tailleur, nom qu’on a donné
à un jufi-au-corps qu’on met en hiver par-deffus les
outres habits. Ce mot n’a été mis en vogue qu’en
1684 ; on l’appelloit anciennementfuravit, comme
qui diroitfurhabit. ( D . J .)
SURVEILLANT, f. m. ( Gram. ) celui qui '/âr- :
veille. On prend des hommes fages pour furveiller à
l’éducation des enfans.
SURVENANCE ', f. f. (Gram. & Jurifprud.) avènement
fur lequel on n’avoit aucune raifon de compter.
La donation eft revocable par furvenance d’en-
fans.
SURVENANT, f. m. celui qui furvient inattendu.
Il y a dans les grandes maifons toujours quelques
couverts pour les furvenans.
SURVENDRE, v._aél. (Gram. G Com. ) vendre
une chofe plus haut prix qu’elle ne vaut.
SURVENIR , v. a£t. ôc neut. ( Gram. ) arriver
inattendu. On le croyoit gué ri, mais il eft furvenu
un accident qui a ôté toute l’efpérance qu’on avoit
conçue. Il eft furvenu un vent qui a diffipé l’orale ;
iLm’eft furvenu des affaires qui m’ont fait manquer
au rendez-vous. Il furvient dans le plailir toujours
quelqu’incident léger qui en altéré la douceur.
SURVENTE, f. f. (Commerce.) excès du prix d’une
niarchandife , ce que le marchand exige au-delà de
fa jufte valeur. ( D . J .)
: SURVÊTIR, v. neut. (Gram.) c’eft mettre un vêtement
fur un autre. Le miniftre prêche furvttu d’un
furplis.
SURVIE, f. f. (Gram. & Jurifprudè) eft l’aélion de
Ikrvivre plus long-tems qu’un autre.
Lzfurvie eft une condition foufentendue dans les
inftitutions d’héritier fie de légataire.
■ Les donations de furvie font celles qui ne doivent
avoir lieu au profit du donataire, qu’au cas qu’il fur-
vive au donateur. Fcye^ D o n a t io n .
. L e s gains de furvie font des gains nuptiaux, qui
dépendent de la même condition. Voye^Gains nupt
iau x . (A )
SURVIVANCE, f. f. (Jurijprud.) eû le drok que
le roi ou quelqu’autre feigneur accorde à quélqu’un
de fuccéder à une charge, fie de l’exercer lorsqu'elle
deviendra vacante.
Loifeau, en fon traité des offices, /. I. c. x ij. diftin-
gue quatre fortes de furvivance.
La première qu’il appelle fimple , eft quand on ré-
figne l’office pour en jouir par le réfignataire au cas
qu’il furvive le réfignant.
La fécondé eft la furvivance reçue , où le réfignataire
eft reçu ôc inftallé dès le moment de la réfi-
gnation, de maniéré qu’après le décès du réfignant
il n’a pas befoin de nouvelle réception ni inflalla-
tion.
La troifieme eft la furvivance jouiffante , c’ eft-à-
dire celle avec laquelle on accorde dès-à-préfent au
furvivancier l’exercice par concurrence avec le rélignant.
La quatrième, qu’on appelle furvivance en blanc,
eft celle où le nom du réfignataire eft laiffé en' blanc,
de maniéré qu’on peut la remplir du nom de telle
Tome X K ,
perfonne que l’on juge à propos ; ce qui empêche
l’office de vaquer par mort.
De cette derniere efpece ont été lès furvivances
accordées par les édits de 1568, 1574,1577 & ï 586,
.qu’on appelle les édits desfurvivances, qui attribuoient
cette furvivance en finançant le tiers-denier deia valeur
de l’office ,.même avec la claufe de regrès Han<?
les refignations faites au fils pu au gendre de l’officier,
& encore avec la claufe-d’ingrès ou accès, fa-
voir que fi l ’officier qui avoit financé, délaiffoit un
fils mineur, il fuccéderoit à l’office fie y feroit reçu
étant en âge, fie cependant que l’office feroit exercé
par commiffion.
Telle eft aufli la furvivance attribuée par l’édit du
12 Décembre 1604, appelle vulgairement l'édit de
Poulet, du-moins à l’égard des officiers non fujets à
fuppreffion; fie à l’égard des autres, quoique ce ne
foit qu’une difpenfe des quarante jours , comme il
faut refigner avant fa mort ; cependant comme il
fuffit d’avoir paffé procuration en blanc pour réfi-
gner ce que les officiers n’obmettent point, c’eft en
effet une furvivance en blanc qui fe renouvelle tous
les ans.
Dans 1 ufage, on appelle offices d furvivance ceux
qui n ont pas racheté la paulette, fie qui payent une
fomme pouf jouir de ce droit de furvivance. Koye1
Annuel , C h a r g e ,C oncurrence , Ex er c ic e ,
Instal lation,H ér é d it é , Office , Pau le t t e ,
Réception. (A )
SURVIVANCIER , f. m. (Gram. & Jurifprud.j
eft celui qui a obtenu la furvivance d’un office ou autre
place, pour l’exercer après le décès de celui qui
en eft aôuellement pourvu. Koye{ ci-devant Survivan
c e . (A )
SURVIVANT, adj. fiefubft. (Gram.) celui qui
furvit a un autre. Les dons fie teftamens mutuels fe
font au profit du furvivant.
SURVIVRE, v. a£l. Se neut. c’eft vivre plus qu’un
autre. Le mari a furvècu à fa femme. On eft prefque
fur de furvivre à quelques-uns de ceux qu’on aime ,
fie c’eft une penfee affligeante pour les perfonnes qui
ont l’ame délicate fie fenfible. Il y a des contrées où
il eft honteux à une femme de jiirvivre à fon mari;
aucune où il fait honteux à un mari de furvivre
à fa femme. Voilà une des plus fortes preuves de
notre injuftice, de notre cruauté, de notre defpo-
tifme fie de notre jaloufie. On dit au figuré , il a fur-
vécu à fa fortune , à fon e fprit, à fon honneur, à fa
réputation. Il y a pour ies auteurs de mode une efpece
de mort qu’ils fentent, 6c qui leur donne bien
de l’humeur, c’eft celle du genre dans lequel ils ont
écrit. L’homme vain eft bien fâché de furvivre à
l’auteur. Faifons donc, fi nous pouvons, des ou-,
vrages qui foient de tous les tems fie de tous lès
pays.
SURUNGA, ( Gèogr. mod. ) une des quinze provinces
de la grande contrée du fud-eft de l’empire du
Japon ; elle a deux journées fic demie de longueur ,
s’ étendant de l’efl à l’oueft, fie eft divifée en fept di-
llriéls; cette province fe diftingue par la variété, de
fes villes, villages, collines , fie plaines fertiles.
{D .J .- )
Surun ga, (Géog. mod. ) ville du Japon, capitale
de la province de fon nom, dansTîle deNiphon;
elle eft toute ouverte, 6c pleine de boutiques fournies
d’étoffes à fleurs de toute efpece. On bat de la
monnoie dans cette v ille , comme à Jédo 6c à Méa-
Co ; 6c l’on y fait en particulier des cobangs, qui font
des pièces d’or plates fic en ovale, delà valeur d’environ
cinq ducats. Le château qui lui fert de défenfe
eft un bâtiment quarré, fortifie par des foflés fie de
hautes murailles de pierres de taille. Long. 15G. 3 J ,
latit. 34. x j . (D . J .)
SUR UN PIÊ, ( Rubannerie. ) paffer fur un pié,
T T 1 1