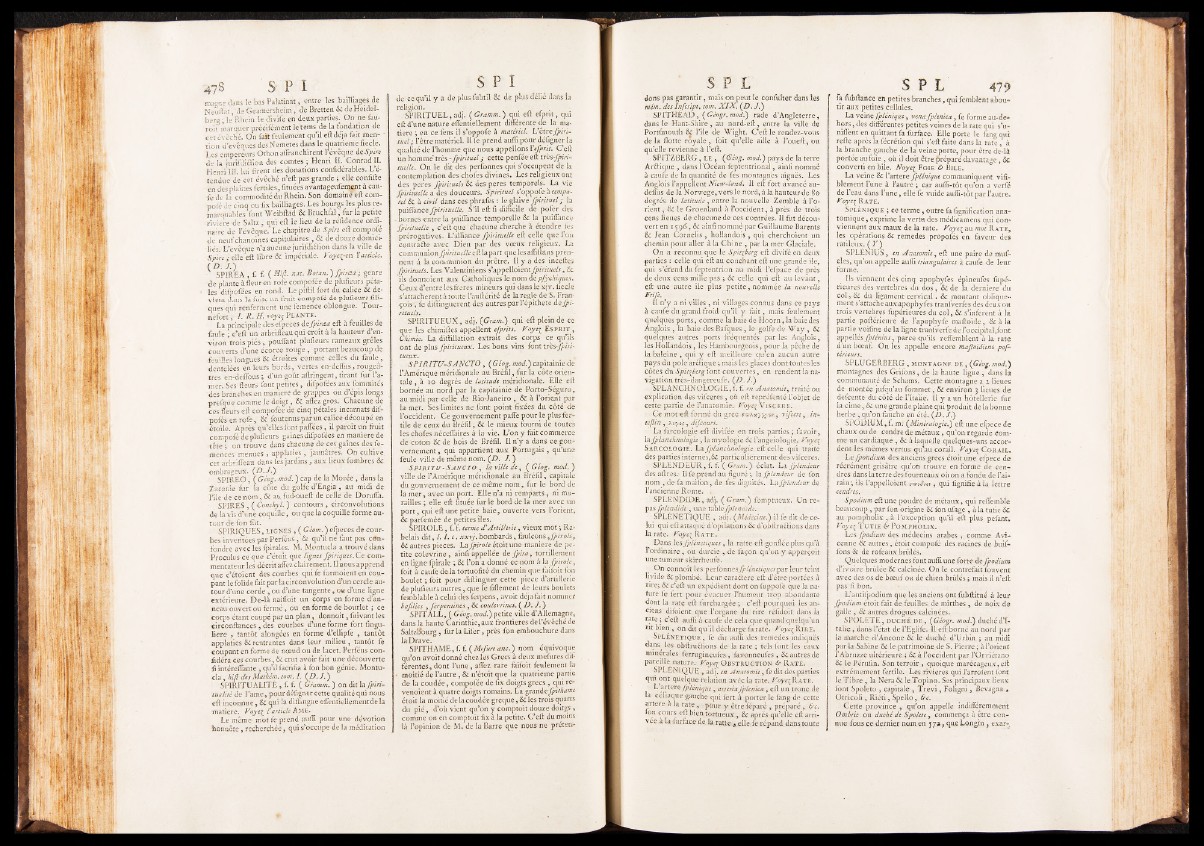
magne dans le bas Palatinat, entre les bailliages de
Neuftat, de Geainersheim, de Bretten & de Heidelberg
; le Rhein le divife en deux parties. On ne fau-
roit marquer précifément le'tems de la fondation de
cet évêché. On fait feulement qu’il eft déjà fait men- ‘
tion d’evêques desNemetes dans le quatrième fiecle.
Les empereurs Othon affranchirent Pévêque d é li r e
de la jurifdiftion des comtes ; Henri II. Conrad II.
Henri III. lui firent des donations confidérables. L’étendue
de cet évêché n’eft pas grande ; elle confifte
en des plaines fertiles, fituées avantageufeir^nt à cau-
fe de la commodité du Rhein. Son domaine eft compofé
de cinq ou fix bailliages. Les bourgs les plus remarquables
font V eibftad 6c Bruchfal, fur la petite
rivière de Saltz , qui eft le lieu de la réfidence ordinaire
de l’évêque. Le chapitre de Spire eft compofé
de neuf chanoines capitulaires , 6c de douze domiciliés.
L’evêque n’a aucune jurifdiôion dans la ville de
Spire ; elle eft libre 6c impériale. Voye^-en l’article.
(D. J .|
SPIREA , f. f. ( Hiß. nit. Botan.) fpiræa ; genre
de plante à fleur en rofe compofée de plufieurs pétales
difpofées en rond. Le piftil fort du calice 6c devient
dans la fuite un fruit compofé de plufieurs fili-
ques qui renferment une femence oblongue. Tour—
n é f o r t 1. R . H. voye^ Plante.
La principale des efpeces dejpircsa elt à feuilles de
faule ; c’eft un arbrifl'eau qui croît à la hauteur d’environ’trois
p ies, pouflant plufieurs rameaux grêles
couverts d’une écorce rouge , portant beaucoup de
feuilles longues 6c étroites comme celles du faule ,
dentelées en leurs bords, vertes en-deffus, rougeâtres
en-deflous ; d’un goût aftringent, tirant fur l’amer.
Ses fleurs font petites, difpofées aux fommités
des branches en maniéré de grappes ou d’épis longs
prefque comme le doigt, 6c allez gros. Chacune de
ces fleurs eft compofée de cinq pétales incarnats dif-
polés en rofe, 6c foutenus par un calice découpé en
étoile. Après qu’elles font paffées , il paroît un fruit
compofé de plufieurs gaînes difpofées en maniéré de
tête ; on trouve dans chacune de ces gaînes desfe-
mences menues , applaties, jaunâtres. On cultive
cet arbrifl'eau dans les jardins , aux lieux fombres 6c
ombrageux. (Z?./.) ' t
SPIREO, (Géog. mod. ) cap de la Moree , dans la
Zacanie fur la côte du golfe d’Engia , au midi de
rîle de ce nom, 6c au fud-oueft de celle de Doruffa.
SPIRES , ( Conchyl. ) contours , circonvolutions
de la vis d’une coquille, ou que la coquillé forme autour
dè fon fut.
SPIRIQUES /LIGN E S , ( Géom. ) efpeces de courbes
inventées par Perféus, & qu’il ne faut pas confondre
avec les fpirales. M. Montucla a trouvé dans
Proculus ce que c’étoit que lignes fpiriques. Ce commentateur
les décrit aflfez clairement. Il nous apprend
que c’étoient des courbes qui fe formoient en coupant
le folide fait par la circonvolution d’un cercle autour
d’une corde , ou d’une tangente, ou d’une ligne
extérieure. De-là naiffoit un corps en forme d’anneau
ouvert ou fermé, ou en forme de bourlet ; ce
corps étant coupé par un plan, donnoit, fuivant les
circonftances , des courbes d’une forme fort fingu-
liere , tantôt alongées en forme d’ellipfe , tantôt
applaties 6c rentrantes dans leur milieu, tantôt fe
coupant en forme de noeud ou de lacet. Perféus con-
fidéra ces courbes, 6c crut avoir fait une découverte
fi intéreffante , qu’il facrifia à fon bon génie. Montucla
, hiß des Mathém. tom. I. (D . J. )
SPIRITUALITÉ , f. f. ( Gramm. ) on dit la Spiritualité
de lam e, pour défigner cette qualité qui nous
eft inconnue, 6c qui la diftingue effentiellementde la
matière. Voyez Carticle Ame.
Le même mot fe prend aufli pour une dévotion
honnête, recherchée, qui s’occupe de la méditation
defse qu’il y a de pUiafubtü & de plus délié dans ta
religion.
SPIRITUEL, adj. ( Gramm. ) qui eft efprit, qui
eft d’une nature effentiellement différente de la matière
; en ce fens il s’oppofe à matériel. L’êtreSpirituel;
l’être matériel. Il fe prend aufli pour défigner la
qualité de l’homme que nous appelions V eSprit. C’eû
un homme' très - Spirituel ; cette penfée eft très-^zW-
tuelle. On le dit des personnes qui s’occupent de la
contemplation des chofes divines. Les religieux ont
des peres Spirituels 6c des peres temporels. La vie
Spirituelle a des douceurs. Spirituel s’oppofe à temporel
6c à civil dans ces phrafes : le glaive Spirituel ; la
puiffanceSpirituelle. S’il eft fi difficile de pofer des
„ bornes entre la puiffance temporelle 6c la puiffance
Spirituelle , c’eft que chacune cherché à étendre les
prérogatives. L’alliance Spirituelle eft celle que l’on
contracte avec Dieu par des voeux religieux. La
communion Spirituelle eft la part que les afliftans prennent
â la communion du prêtre. Il y a des inceftes
Spirituels. Les Valentiniens s'appelaient Spirituels, 6c
ils donnoient aux Catholiques le nom de pSychiques.
Ceux d’entre lesfreres mineurs qui dans lé xjv. fiecle
s’attachèrent a toute l’auftérité de la réglé de S. François'",
fe diftinguerent des autres par l’épithete de^z-
rituels.
SPIRITUEUX, adj. (Gram.) qui eft plein de ce
que les chimiftes appellent ejprits. Voyei Esprit ,
Chimie. La diftillation extrait des corps ce qu’ils
ont de plus Spiritueux. Les bons vins font trbs-Jpiri-
tueux.
S P IR ITU-S J N CTO , ( Géog. mod.') capitainie de
l’Amérique méridionale au Bréfil, fur la côte orientale
, à io degrés de latitude méridionale. Elle eft
bornée au nord par la capitainie de Porto-Séguro,
au midi par celle de Rio-Janeiro , & à l’orient par
la mer. Ses limites ne font point fixées du côté de
l’occident. Ce gouvernement paffe pour le plus fertile
de ceux du Bréfil, 6c le mieux fourni de toutes
les chofes néceffaires à la vie. L’on y fait commerce
de coton 6c de bois de Bréfil. Il n’y a dans ce gouvernement
, qui appartient aux Portugais, qu’une
feule ville de même nom. (D . J. )
S p i r i t u - S A N C TO , la ville de, ( Géog. mod. )
ville de l’Amérique méridionale au Bréfil, capitale
du gouvernement de ce même nom, fur le bord de
la mer, avec un port. Elle n’a ni remparts, ni murailles
; elle eft fituée fur le bord de la mer avec un
port, qui eft une petite baie, ouverte vers l’orient,
6c parfemée de petitesîles.
SPIROLE, f. f. terme d"Artillerie, vieux mot ; Rabelais
dit, /. I. c. xxvj. bombards, faulcons ,SpiroUy
6c autres pièces. La Jpirole étoit une maniéré de petite
colevrine , ainfi appellée de Spira •> tortillement
en ligne fpirale ; 6c l’on a donné ce nom à la Spirole,
foit à caufe de la tortuofité du chemin que failoit fon
boulet ; foit pour diftinguer cette piece d’artillerie
de plufieurs autres, que le fiflement de leurs boulets
femblable à celui des ferpens, avoit déjà fait nommer
bafilics , Serpentines , 6c coulevrines. (D . J .)
SPITALL, ( Géog. mod.) petite ville d’Allemagne,
dans la haute Carinthie, aux frontières de l’évêché de
SaltzUourg, fur la L ifer, près fon embouchure dans
laDrave.
SPITHAME, f. f. ( MeSure anc. ) nom équivoque
qu’on avoit donné chez les Grecs à deux mefures differentes,
dont l’une, affez rare faifoit feulement la
» moitié de l’autre, 6c n’étoit que la quatrième partie
de la coudée, compofée de fix doigts grecs , qui re-
venoient à quatre doigts romains. La grandeJpithame
étoit la moitié delà coudée greque, 6c les trois quarts
du pié, d’où vient qu’on y comptôit douze doitgs ,
comme on en comptoit fix à la petite. C’eft du moins
là l’opinion de M, de la Barre que nous ne préteadons
pas garantir, mais on peut le confûlter dans les
mérn. des InScript, tom. X IX . (D . J.)
SPITHÉÂD, ( Géogr. mod.) rade d’Angleterre,
dans le' Hant-Shire , au nord-eft, entre la ville de
Portfmouth 6c l’île de Wight. C’eft le rendez-vous
de la flotte royale , foit qu’elle aille à l ’oueft, ou
qu’elle revienne à l’ eft.
SPITZBERG, le , (Géog. mod.) pays de la terre
Arélique , dans l ’Océan feptentrional, ainfi nommé
à caufe de la quantité de fes montagnes aiguës. Les
Anglois l’appellent Niew-land. Il eft fort avancé au-
deflus de la Norwege, vers le nord, à la hauteur de 8o
degrés de latitude , entre la nouvelle Zemble à l’orient
, 6c le Groenland à l’occident, à près de trois
cens lieues de chacune de ces contrées. Il fut découvert
en 1 5 9 6 ,6c ainfi nommé par Guillaume Barents 6c Jean Cornelis , hollandois , qui cherchoient un
chemin pour aller à la Chine , par la mer Glaciale.
On a reconnu que le Spit\berg eft divifé en deux
parties : celle qui eft au couchant eft une grande île,
qui s’étend du leptentrion au midi l’efpace de près
de deux cens mille pas ; 6c celle qui eft au levant,
eft une autre île plus petite, nommée la nouvelle
FriSe.
Il n’y a ni villes , ni villages connus dans çe pays
à caufe du grand froid qu’il y fa it , mais feulement
quelques ports, comme la baie de Hoorn, la baie des
Anglois , la baie des Bafques , le golfe de V a y , 6c
quelques autres ports fréquentés parles Anglois,
les Hollandois , les Hambourgeois, pour la pêche de
la baleine, qui y eft meilleure qu’en aucun autre
pays du pôle ar&ique ; mais les glaces dont toutes les
côtes du Spielberg font couvertes, en rendent la navigation
très-dangefeufe. (D . J.)
• SPLANCHNOLOGIE,!. f. en Anatomie, traité ou
explication des vifeeres, où eft reprefenté l’objet de
cette partie de l’anatomie. Voye[ V isçere.
Ce mot*eft formé du grec «■ 'ürAa>%î'oi'., vi/cere, in-
tefiin , Xoyoç, diScours.
■ La farcologie eft divifée en trois parties ; fa voir,
laSplunchnologie, lamyologie 6c l’angeiologie. Voye{
Sarcologie. La Splan£hnologie eù c e lie qui traite
des parties internes,& particuliérement des vifeeres.
SPLENDEUR, f. f. (Gram.) éclat. La Splendeur
des aftres.' Il fe prend au figuré ; la Spltudeur de fon
nom , de fa maifon, de fes dignités. La Splendeur de
l’ancienne Rome. .
SPLENDIDE, adj. (Gram.) fomptueux. Un repas
Splendide, une table Splendide.
SPLÉNETIQUE , adj. (Médecine.) il fe dit de celui
qui eft attaqué d’opilations 6c d'obftruérions dans
la rate. Voyez Ra t e .
Dans les Splénedques, la ratte eft gonflée plus qu’à
l’ordinaire , ou durcie , de façon qu’on y apperçoit
une tumeur skirrheufe.
On connoît les perfonnesSplénetiques par leur teint
livide 6c plombé. Leur caraétere eft d’être portées à
rire; 6c c’eft un expédient dont on fuppofe que la nature
fe fert pour évacuer l’humeur trop abondante
dont la rate eft furchargée ; c’eft pourquoi les anciens
difoient que l’organe du rire réfidoit dans la
rate ; c’eft aufli à caufe de cela que quand quelqu’un
rit bien , on dit qu ’il décharge fa rate. Voye^ Rire,
Splénetique, fe dit aufli des remedes indiques
dans^ les obftruftions de la rate ; tels font les eaux
minérales ferrugineufes, favonneufes , & autres de
pareille nature. Voyei Obstruction «S* Ra t e .
SPLÉNIQUE, adj . en Anatomie, fe dit des parties
qui ont quelque relation avéc.lg rate. Voye^ Rate.
L artere jplenique, arteria Jplenica, eft un tronc de
la celiaque gauche qui fert à porter le fang de cette
artere à la rate., pour y être féparé ,. préparé , &c.
Ion çours eft bien tortueux,, 6c après qu’elle eft arrivée
à la furfae.e de la ratte^ elkife répand dans, toute
fa fubftance en petites branches, qui femblent aboutir
aux petites cellules.
La wdmt Splénique, venuSplenica, fe forme au-de*
hors, des différentes petites veines de la rate qui s’unifient
en quittant fa furface. Elle porte le fang qui
refte après la fécrétion qui s’eft faite dans la rate, à
la branche gauche de la veine porte, pour être de-là
portée au foie , où il doit être préparé davantage, Sc
converti en bile. Noyei Foie & Bile.
La veine 6c l’artere Splénique communiquent vifi-
blement l’une à l’autre ; car aufli-tôt qu’on a verfé
de l’eau dans l’une, elle fe vuide aufli-tôt par Pautre.
Voyc^ Ra te.
Splénique ; ce terme, outre fa fignification anatomique
, exprime la vert« des médicamens qui conviennent
aux maux de la rate. Voye^ au mat R ate,
les opérations 6c remedes propofés en faveur des
ratileux. ( Y )
SPLENIUS, en Anatomie, eft une paire de rouf-
des, qu’on appelle aufli triangulaires à caufe de leur
forme.
Ils viennent des cinq apophyfes épineufes fupé~
rieures dés vertebres du dos , 6c de la derniere du
co l, 6c du ligament cervical, 6c montant obliquement
s’attache aux apophyfes tranfverfes des deux ou
trois vertebres fupérieures du co l, & s’inferent à la
partie poftérieuré de l’apophyfe maftoïde, & à la
partie voifine de la ligne tranfverfe de l’occipital,font
appellés Splénius, parce qu’ils reffemblent a la rate
d’un boeuf. On les appelle encore maStoidiens pof-
térieurs.
SPLUGERBERG, montagne de , (Géog. mod.)
montagnes des Grifons, de la haute ligue ; dans la
communauté de Schams. Cette montagne a z lieues
de montée jufqu’au foramet, & environ 3 lieues de
defeente du côté de l’Itaiie. Il y a un hôtellerie fur
la cime, St une grande plaine qui produit de la bonne
herbe y qu’on fauche en été. (D . J.)
SPODIUM, f. m: (Minéralogie.) eft une efpece de
chaux ou de cendre de métaux, qu’on regarde comme
un‘.cardiaque , 6c à laquelle quelques-uns accordent
les mêmes vertus qu’au corail. Voye^ C orail.
Le Spo'ndium des anciens grecs étoit une efpece de
récrément grisâtre qu’on trouve en forme de cen-
. dres dans la terre des fourneaux où on a fondu de l’airain;
ils l’appelloient 7woJW , qui lignifie à la lettre
cendres.
Spodium eft une poudre de métaux, qui reffemble
beaucoup, par fon origine 6c fon ufage , à la tutie 6c
au pompholix , à l ’exception qu’il eft plus pefant.
Voyei T utie & Pompholix.
Les Sp°diunz .des médecins arabes , comme Avicenne
6c autres, étoit compofé des.racines de buif*
fôns & dé rofeaux brûlés.
Quelques modernes font aufli une forte de Spodium
d’ivoire brûlée 6c calcinée. On le contrefait fouvent
avec des os de boeuf ou de chien brûlés ; mais il n’eft
pas fi bon.
L’antilpodium que les anciens ont fubftitué à leur
Spodium étoit fait de. feuilles de mirthes , de noix de
galle , 6c autres drogues calcinées.
SPOLETE, DUCHÉ DE, (Géogr. mod.) duché d’Italie
, dans l’état de l’Eglife. Il; eft borné au nord par
la marche d’An.cone & le duché d’Urbin ; au midi
par la Sahine 6c le patrimoine de S. Pierre ; à l’orient
l’Abruzze ultérieure ; 6c à l’occident par l’Orviétano 6c le Pérufin. Son terroir , quoique marécageux, eft
extrêmement fertile.,- Les rivières qui l’arroîent font
le T ibre , la Néra 6c leTopino. Ses principaux lieux
font. Spoleto , capitale , T r e v i, Foligni, Bevagna ,
Otricoli, Riéti, Spello, &c.
Cette province , qu’on appelle indifféremment
Ombrie :ou duché de Spolete, commença à être connue
fous ce dernier nom en 57*, queLongin, exar-,