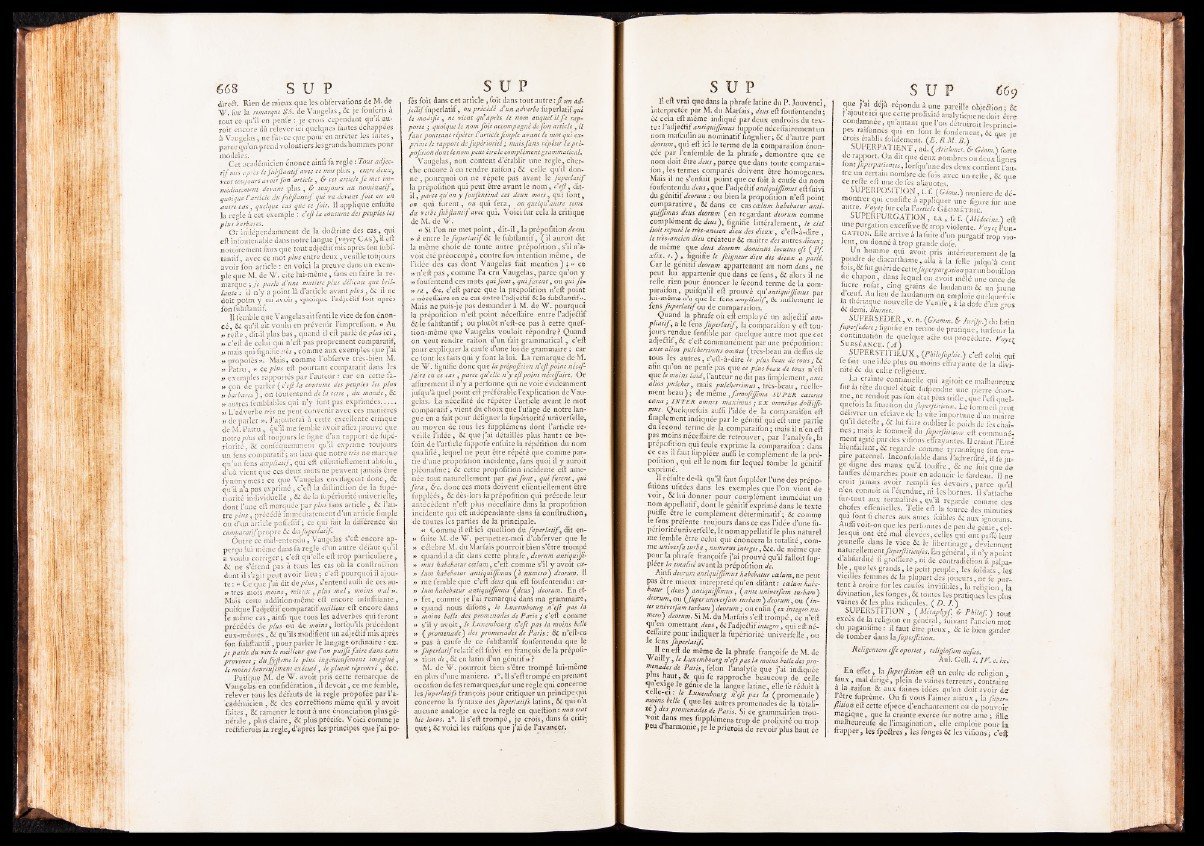
direfr. Rien de mieux que les obfervations de M. de
"W. fur la remarque 85. de Vaugelas, & je foufcris à
tout ce qu’il en penie : je crois cependant qu’il au-
roit encore dû relever ici quelques fautes échappées
à Vaugelas, ne fût-ce que pour en arrêter les fuites,
parce qu’on prend volontiers les grands hommes pour
modèles. , t _
Cet académicien énonce ainfna réglé : Tout adject
i f mis après le fiibflanttf avec ce mot plus , entre deux,
veut toujours avoir fon article , & cet article Je met immédiatement
devant plus , & toujours au nominatif,
quoique l'article du. fubflantif qui va devant J'oit en un
autre cas, quelque cas que ce J'oit. Il applique enfuite
la réglé à cet exemple : c’ejl la coutume des peuples les
plus barbares.
Or indépendamment de la doftrine des cas, qui
eft infoutenable dans notre langue (voye[ Cas), il eft
notoirement faux que tout adjeCtif mis apres fon lubf-
tantif, avec ce mot plus entre deux , veuille toujours
avoir fon article : en voici la preuve dans un exemple
que M. de \V. cite lui-même, fans en faire la remarque
; je parle d’une matière plus délicate que brillante
: il n’y a point là d’article avant plus, 6c il ne
doit point y en avoir, quoique 1 adjeCtif loit apres
fon fubftantif.
Il femble que Vaugelas aitfenri le vice de fon énoncé
6c qu’il ait voulu en prévenir l’imprelîion. « Au
» refte, dit-il plus bas, quand il eft parlé de plus i c i ,
» c’eft de celui qui n’eft pas proprement comparatif,
.» mais qui fignifie très , comme aux exemples que j’ai
» propofés». Mais, comme l ’obferve très-bien M.
» Patru, « ce plus eft pourtant comparatif dans les
» exemples rapportés par l’auteur : car en cette fa-
» çon de parler {défi la coutume des peuples les plus
» barbares ) , on foulentend de la terre , du monde, 6c
» autres, femblables qui n’y font pas exprimées.. . . .
■ » L’adverbe très ne peut convenir avec ces maniérés
» de parler ». J’ajouterai à cette excellente critique
de M. Patru , qu’il me femble avoir affez prouvé que
notre plus eft toujours le figne d’un rapport de fupériorité,
& conféquemment qu’il exprime toujours
un fens comparatif ; au lieu que notre très ne marque
qu’un fens ampliatif, qui eft effentiellement abfolu,
d’où vient que ces deux mots ne peuvent jamais être
fynonymes; ce que Vaugelas envifageoit donc, &
qu’il n’a pas exprimé, c’eft la diftin&ion de la fupériorité
individuelle , & de la fupériorité univerfelle,
dont l’uné eft marquée par plus fans article, 6c l’autre
plus,-, précédé immédiatement d ’un article fimple
ou d’un, article poffefîif ; ce qui fait la différence du
comparatif propre 6c du Juperlatif
Outré ce mal-entendu, Vaugelas s eft encore ap-
perçu lui-même dans fa réglé d un autre defaut qu il
a voulu corriger ; c’eft qu’elle eft trop particulière,
& ne s’étend pas à tous les cas où la conftrucHon
dont il s’agit peut avoir lieu ; c’eft pourquoi il ajoute
: « Ce que j’ai dit de plus, s’entend aufli de ces au-
» très mots moins, mieux, plus mal, moins mal».
Maïs cette addition-même eft encore inlùfîifante,
puifquel’adjectif comparatif meilleur eft encore dans
le meme cas, ainfi qiie tous lès adverbes qui feront
précédés de plus ou de moins, lorfqu’ils précédent
eux-mêmes', & qu’ils modifient un adjedif mis après
fon fubftantif, pour parler le langage ordinaire : ex.
je parle du vin le meilleur que Von puijfe faire dans cette
province ; du fyfiwe le plus ingenieufement imaginé,
le moins heurtujèment exécute , le plutôt réprouvé , ôcc.
Puifque ^1. de W. avoit pris cette remarque de
Yaugelas eij çonfidération, il devoit, ce me femble,
relever tous les défauts de la réglé p ropofee par l’a-
cadémicïen , & des correftions meme qu’il y avoit
faites, 6c ramener le tout à une énonciation plus generale
., plus claire, & plùs précife. Voici comme je
rectifîérois ,1a réglé, d’après les‘principès que j’ai pofés
foit dans cet article, foit dans tout autre : J i un ad*
jeelif luperlatif, ou précédé d’un adverbe fuperlatif qui
le modifie , ne vient q i l après le nom auquel il f ; rapporte
; quoique le nom foit accompagné de fon article , il
faut pourtant répéter C article fimple avant le mot qui exprime
le rapport de fupériorité ; mais fans répéter la prépofition
dont le nom peut être le complément grammatical.
Vaugelas, non content d’établir une réglé, cherche
encore à en rendre raifon ; 6c celle qu’il donne
, pourquoi on ne répété pas avant le fuperlatif
la prépofition qui peut être avant le nom, défi, dit-
il , parce qu’on y foufenitnd ces deux mots, qui font,
ou qui furent, ou qui fera, ou quclqu’autre tems
du verbe fubfiantif avec qui. Voici fur cela la critique
de M. de W.
« Si l’on ne met point, d it-il, la prépofition de ou
» à entre le fuperlatif 6c le fubftantif, ( il auroit dit
la même chofe de toute autre prépofition ,■ s’il n’a-
voit été préoccupé, contre fon intention même, de
l’idée des cas dont Vaugelas fait mention ) ; « ce
» n’ eft pas, comme l’a cru Vaugelas, parce qu’on y
» foufentend ces mots qui fon t, qui furent, ou qui Je-
» ra , &c. c’eft parce que la prépofition n’eft point
» néceffaire en ce cas entre l’adjeétif & le fubftantif».
Mais ne puis-je pas demander à M. de V . pourquoi
la prépofition n’eft point néceffaire entre l’adjedif
&>le fubftantif ; ou plutôt n’eft-ce pas à cette quef-
tion-même que Vaugelas vouloit répondre? Quand
on veut rendre raifon d’un fait grammatical, c’eft
pour expliquer la caufe d’une loi de grammaire ; car
ce font les taits qui y font la loi. La remarque de M.
de W . fignifie donc que la prépofition nefi point nécef-
Jaire en ce cas , parce qu’elle n y cjl point néceffaire. Or
affurement il n’y a perfonne qui ne voie évidemment
jufqu’à quel point eft préférable l’explication de Vaugelas.
La néceflité de répéter l’article avant le mot
comparatif, vient du choix que l’ufage de notre langue
en a fait pour défignerla fupériorité univerfelle,
au moyen de tous les fùpplémens dont l’article reveille
l’idée, 6c que j’ai détaillés plus haut: ce be-
foin de l’article fuppofe enfuite la répétition du nom
qualifié, lequel ne peut être répété que comme partie
d'une propofition incidente, fans quoi il y auroit
pléonafme ; 6c cette propofition incidente eft amenée
tout naturellement par qui fon t, qui furent, qui
fera, &c. donc ces mots doivent effentiellement être
fuppléés, 6c dès-lors la prépofition qui précédé leur
antécédent n’eft plus néceffaire dans la propofition
incidente qui eft indépendante dans fa conftruftion,
de toutes les parties de la principale.
« Comme il eft ici queftion du fuperlatif, dit en-
» fuite M. de W. permettez-moi d’obferver que le
» célébré M. du Mariais pourroit bien s’être trompé
» quand il a dit dans cette phrafe, deorum antiquijfi-
i » mus habebatur ccelum, c’eft comme s’il y avoit cce-
» lum habebatur antiquijfimus (è numéro ) deorum. Il
» me femble que c’eft deus qui eft foufentendu : coe-
» lum habebatur antiquijfimus (deus) deorum. En ef-
» fet, comme je l’ai remarqué dans ma grammaire,
» quand nous difons, le Luxembourg n’eft pas lu
» moins belle des promenades de Paris ; c’eft comme
» s’il y avoit, le Luxembourg n’eft pas la moins belle
» ( promenade ) des promenades de Parts : 6c n’eft-ce
» pas à caufe de ce fubftantif foufentendu que le
» fuperlatif relatif eft fuivi en françois de là prépofi-
» tion de, 6cen latin d’un génitif » ?
M. de W. pourroit bien s’être trompé lui-meme
en plus d’une maniéré. i° . Il s’efl trompé en prenant
occafion de fes remarques,fur une règle qui concerne
les fuperlatifs françois pour critiquer un principe qui
concerne la fyntaxe des fuperlatifs latins, 6c qui na
aucune analogie avec la réglé en queftion: non erat
hic locus. z°. Il s’eft trompé, je crois, dans fa çriti^
que ; 6c voici les raifons que j5ai de l’avancex.
ïî eft vrai que dans la phrafe latine du P. Jouvenci,
xoterpretee par M. du Marfais, deus eft foufentendu;
6c cela eft meme indiqué par deux endroits du texte:
l ’adjeélif antiquijfimus luppofe néceffairement un
nom mafeulin au nominatif fingulier; 6c d’autre part
deorum, qui eft ici le terme de la comparaifon énoncée
par l’enfemble de la phrafe, démontré que ce
nom doit être deus, parce que dans temte comparaifon,
les termes comparés doivent être homogènes.
Mais il ne s’enfuit point que ce foit à caufe du nom
foufentendu deus, que l’adjeâif antiquijfimus eft fuivi
du génitif deorum : ou bien la propofition n’eft point
comparative, & dans ce cas ccelum habebatur anti-
quifjitnus deus deorum (en regardant deorum comme
complément de deus), fignifie littéralement, le ciel
étoit réputé le très-ancien dieu des dieux, c’eft-à-dire ,
le très-ancien dieu créateur 6c maître des autres dieux;
de même que deus deorum dominas locutus eft ( Pfi
xlix. /. ) , fignifie le feigneur dieu des dieux a parlé.
Car le génitif deorum appartenant au nom deus, ne
peut lui appartenir que dans ce fens, 6c alors il ne
refte rien pour énoncer le fécond terme de la comparaifon,
puifqu’il eft prouvé qu’antiquijfimus par
lui-même n a que le fens ampliatif, 6c nullement le
fens fuperlatif ou de comparaifon.
Quand la phrafe où eft employé un adjeclir ampliatif,
a le fens fuperlatif, la comparaifon y eft toujours
rendue fenfible par quelque autre mot que cet
âdjeélif, 6c c’eft communément par une prépofition :
ante alios pulcherrimus omnes (très-beau au deffus de
tous les autres, c’eft-à-dire le plus beau de tous j 6c
afin qu’on ne penfe pas que ce plus beau de tous n’eft
que le moins laid, l’auteur ne dit pas fimplement, ante
alios pulcher, mais pulcherrimus , très-beau, réellement
beau); de même, famofiffima SUPER cæteras
ccena ; INTER omnes maximus ; EX omnibus docliffi-
wus- Quelquefois aufiï l’idée de la comparaifon eft
fimplement indiquée par le génitif qui eft une partie
du fécond terme de la comparaifon; mais il n’en eft
pas moins néceffaire de retrouver, par l’analyfe,la
prépofition qui feule exprime la comparaifon : dans
ce cas il faut fuppleer aufli le complément de la prépofition
, qui eft le nom fur lequel tombe le génitif
exprimé.
Il réfulte de-là qu’il faut fuppléer l’une des prépo-
fitions ufitees dans les exemples que l’on vient de
voir, & lui donner pour complément immédiat un
nom appellatif, dont le génitif exprimé dans le texte
puiffe être le complément déterminatif ; 6c comme
le fens préfente toujours dans ce cas l’idée d’une fu-
periorité univerfelle, le nom appellatif le plus naturel
me femble etre celui qui énoncera la totalité, comme
univerfa turba, numerus integer, 6cc. de même que
pour la phrafe françoife j ’ai prouvé qu’il falloit fup- ;
pleer la totalité avant la prépofition de.
SgHsjdeorum antiquijfimus habebatur ccelum, ne peut
pas être mieux intrepreté qu’en difant : ccelum habebatur
( deus ) antiquijfimus, ( ante univerfam turbam )
deorum, ou (fuper univerfam turbam') deorum, ou (inter
univerfam turbam ) deorum ; ou enfin ( ex integro nu-
mero) deorum. Si M. du Marfais s’eft trompé, ce n’eft
qu en omettant deus, &c l’adjeftif integro, qui eft néceffaire
pour indiquer la fupériorité univerfelle , ou
le fens fuperlatif.
Il en eft de même de la phrafe françoife de M. de
W ailly , le Luxembourg n’eft pas la moins belle des pro-
r «d‘ sde Paris, (eIon l’analyfe que j’ài indiquée
plus haut, & qui fe rapproche beaucoup de celle
qu exige le genie de la langue latine, elle fe réduit à
celle-ci: le Luxembourg n’eft pas la (promenade)
moins belle ( que les autres promenades de la -tôtaii-
te ) es promenades de Paris. Si ce grammairien trpu-
r V ™ 5 me? fùpplémens trop de prolixité ou troj>
peu d harmonie, je le prierois de revoir plus haut ce
B H B r«Pondu à ‘“ e pareille ob/eèion; &
J ajoute ici que cette prolixité analytique ne doit être
' condamnée, qu autant que l'on détruirait les princi-
pes railonnes qui en font le fondement, 6c que ie
crois établis folidement. (E. R M. B.)
SUPÈRPAT1EN T, ad. (Arithmet. & Géom.\ forte
de rapport. On dit que deux nombres ou deux lianes
iom fuperpaùentes, lorfqu’une des deux contient l’autre
un certain nombre de fois avec un refte, 6c que
ce refte eft une de fes aliquotes.
SUPERPOSITION, 1. f. (Géom.) maniéré de démontrer
qui confifte à appliquer une figure fur une
autre. Voye^ fur cela 'farticle Géométrie.
SUPERPURGATION, l a , f. f. (Médecine.) eft
«ne purgation exceflive 6c trop violente, l'oyez Purga
t io n . Elle arrive à la fuite d’un purgatif trop violent
, ou donné à trop grande dofe.
- gH | B | pris intérieurement de la
poudre de diacarthame, alla à la Telle jufqu’à cent
j ls * l *ut 8uc.n de cet tejuperpurgaùon par un bouillon
de chapon, dans lequel on avoit mêlé une once de
j,lCref r° fat» c^ncï grains de laudanum 6c un jaune
d oeuf. Au lieu de laudanum on emploie quelquefois
la thenaque nouvelle de Venife, à la dofe d’un eros
6c demi. Burnet. °
r ’ V' m (P ramni- & Lurijp.) du latin
JuperJedere; fignifie en terme de pratique, furfeoir la
continuation de quelque a£te ou procédure. Vovez
Sürseance. (A ) J '•
SUPERSTITIEUX, (Philofophie.) c’eft celui qui
le tait une idee plus ou moins effrayante de la divinité
6c du culte religieux.
La crainte continuelle qui agitoit ce malheureux
lur la tete duquel étoit lufpendue une pierre énorme,
ne rendoit pas fon état plus trifte, que l’eft quelquefois
la fituation du fuperjiicieux. Le fommeil peut
délivrer un efclave de la vûe importune d’un maître
qu il detefte, 6c lui faire oublier ie poids de fes chaînes
; mais le fommeil du fuperftiiieux eft communément
agité par des vifions effrayantes. Il craint l’Etre
hienfaifanr, 6c regarde comme tyrannique fon empire
paternel. Inconfolable dans Tadverfité , il fe ju-
ge digne des maux qu’il fouffre, & ne fuit que de
raufles démarches pour en adoucir le fardeau? II ne
croit jamais avoir rempli fes devoirs, parce qu’il
n’en connoît ni l’étendue, ni les bornes. Il s’attache
fur-tout aux formalités, qu’il regarde comme des
choies effentielles. Telle eft la fource des minuties
qui font fi cheres aux âmes foibles 6c aux i<morans.
Aufli voit-on que lès perfonnes de peu de génie, celles
qui ont ete mal elevees, celles qui ont paflè leur
jeuneffe dans le vice 6c le libertinage, deviennent
naturellernem fupéfiitieufes. En général, il n’y a point
d abfurdité fi grôflieré, ni de contradiction fi palpa-
ble, que les grands, le petit peuple, les foldats , les
vieilles femmes & la plupart des joueurs, ne fe por-
tent à croire fur les caufes. invifibles, la relirion, la
divination, les fonges,& toutes les pratiquesles plus
vaines 6c lès, plus: ridicules. (D . J . )
SUPERSTITION , (Métaphyf & Philof. ) tout
èxces de la religion en général, fuivant l’ancien mot
du paganifme : il faut être pieux, 6c fe bien garder
de tomber dans la fuperfiition.
En effet, la fuperfiition eft un culte de religion ,
faux, mal dirige, plein de vaines terreurs, contraire
àda raifon & aux faines idées qu’on doit avoir de
Ç*re fupreme. Ou. fi vous l’aimez mieux , la ftiper-
fiiiion eft cette efpèce d’enchantement ou de pouvoir
magique, que la crainte exerce fur notre ame ; fille
malheureufe de l’imagination, elle emploie pour la
frapper , les ipeCtres, les fonges êç les viûohs; c’eft