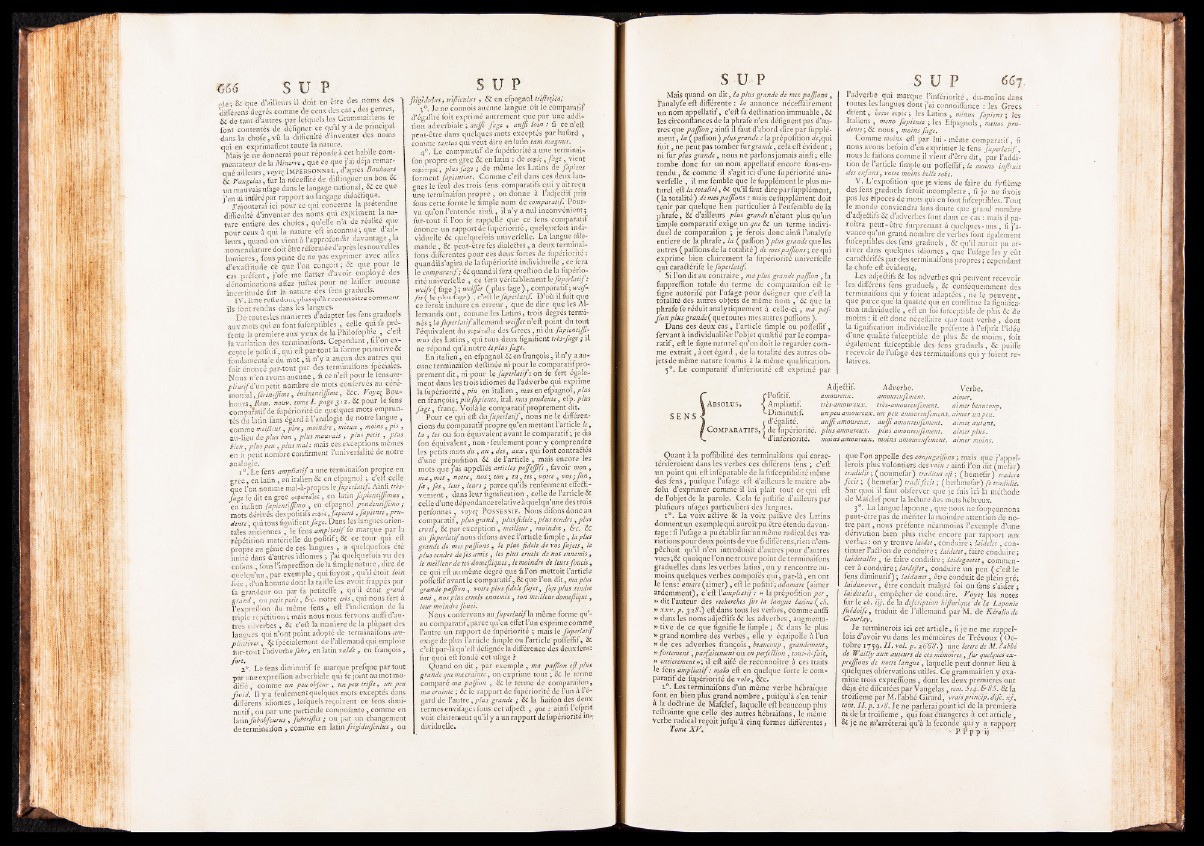
< 4 e; &T'que d 'a i lle u r s i l d o i t en ê t r e d e s n om s des
r iifféren s d e g r é s com m e d e c e u x d e s c a s , d e s g en re s ,
& d e tan t d’a u t r e s p a r le fq u e ls les G ram m a ir ien s le
fo n t co n te n té s d e défig-ner c e qu ’i l y à d e p r in c ip a l
■ dans la c h o f e , v u la d ifficu lté d ’ in v e n t e r d e s nom s
■ qui en exprimaffent toute la nature. • - .
M a is je n e d on n era i p o u r r é p o n f e à c e t h ab ile c om m
e n ta te u r d e la Minerve, q u e c e q u e j ’a i d é jà r em a r q
u é a i l le u r s , IMPERSONNEL, d ’ap res Bouhours
& Vaugelas, fu r la n é c e ffité de d ift in g u e r u n b o n oL
•un m a u v a is ad a ge dans le lan g a g e n a t io n a l, & c e q u e
j ’ en a i in fé r é p a r r a p p o r t au la n g a g e d id a éh q u e .
J’ajouterai ici pour ce qui concerne la prétendue
■ difficulté d’inventer des noms qui expriment la nature
entière, des chofes, qu’elle n’a de réalité que
pour ceux à qui la nature eft inconnue; que dail-
leurs, quand on vient à l’approfondir davantage , la
nomenclature doit être réformée d’apres les nouvelles
lumières , fous peine de ne pas exprimer avec allez
d’exaftitude ce que,l’on conçoit; & que pour le
cas prëfent, j’ofe me flatter d’avoir employé des
dénominations affez julles pour ne laiffer aucune
incertitude fur la nature des fens graduels.
. IV. Il ne relie donc plus qu’à reconnoitre'comment
ils font rendus dans les langues.
De toutes les maniérés d’adapter les fens graduels
aux mets qui en font fufceptibles , celle qui fe pré^
fente la première aux yeux de la Philofopbie , c elt
la variation des terminaifons. Cependant, fil on ex-
ceote le pofitif, qui ell par-tout la forme primitive &
fondamentale du m ot, il n’y a aucun des autres qui
foit énoncé par-tout par des terminaifons lpeciales.
Nous n’en avons aucune, fi ce n’ell pour le fens ampliatif
d’un petit nombre de mots conferves au cére-
monial .fèréniffime, éminentifimt, &c. Voye^ Bouhours,
Rem. nouv. tome 1. page 312. & pour le lens
comparatif de fupérioritc de quelques mots empruntés
du latin fans égard à l’analogie de notre langue ,
tomme meilleur, pire, moindre , mieux , moins, pis ,
au-lieu de plus bon , plus mauvais, plus petit , plus
bien, plus peu, plus mal: mais ces exceptions mêmes
en fi* petit nombre confirment l’univerfalite de notre
analogie.' ( . ■ ,
1 °.v'Le fens ampliatif a une terminaifon propre en
grec * en latin, en italien & en efpagnol ; c’eft celle
que l’on.nomme mal-à-propos \q fuperlatif Ainfi très-
fa ge fe dit en grec c-ctpdncflcç, en latin fapienùffimus,
en italien fapientïffimo , en efpagnol prudentiffimo ;
mots dérivés despofitifs çefot, fapiens ,fapiente, prudente’,
qui tous lignifient fage. Dans les langues orientales
anciennes , le'fens ampliatif fe marque par la
répétition matérielle dupofitif; & ce tour qui eft
propre au génie de ces langues , a quelquefois ete
imité dans d’autres idiomes ; j’ai quelquefois vu des
enfans , fous l’impreflion de la fimple nature, dire de
quelqu’un, par exemple, quifuyoit, qu’il etoit loin
loin, d’un homme dont la taille les avoit frappés par
fa grandeur ou par fa petitefle , qu’il étoit grand
grand, ou petit petit, &c- notre très, qui nous fert à
l’expreffion du même fens , eft l’indication de la
triple répétition ; mais nous nous fervons auffi d’autres
adverbes , &: c’eft la manière de la plupart des
langues qui n’ont point adopté de terminaifons ampliatives
, dg. fpéc.ialement- de l’allemand qui emploie
iur-tout l’adverbe fehr, en latin valdè , en françois,
fort.
20. Le fens diminutif fe marque prefque par tout
par une expreffion adverbiale qui fe joint au mot modifié
comme un peu obfcur , un peu trifie, un peu
froid. I l y a feulement quelques mots exceptés dans
différens' idiomes, lefquels reçoivent ce fens diminutif,
ou par une particule compofante, comme en
latin fubobfcurus , fubtriflis ; ou par un changement
de terminaifon , comme en latin frigidiufculus, ou
frVgidulus, tn f iculus , ôt en efpaghöl trijleficdl
3°. Je ne connois aucune langue ,oii le comparatif
d’égalité foit exprimé autrement que par une addition
adverbiale ; auffi fage , auffi loin : fi ce n’eft
peut-être dans quelques mots exceptés par hafard ,
. comme tantus qui veut dire en latin tam magnus.
40. Le comparatif de fupériorité a une terminaifon
propre en greG & en latin : de troçôç, fage , vient
(roponpoi, plus fage ; de même les Latins de fapiens
forment fapientior. Comme c’eft dans ces deux langues
le feul des trois fens comparatifs qui y ait reçu
une terminaifon propre , on donne à l’adjeélif pris
fous cette forme le fimple nom de comparatif. Pour-1
vu qu’on l’entende ainfi , il n’y a nul inconvénient ;
fur-tout fi l’on fe rappelle que ce fens comparatif
énonce un rapport de fupériorité, quelquefois individuelle
&c quelquefois univerfelie. La langue aile-
I mande, & peut-etre fes dialeftes, a deux terminaifons
différentes pour ces deux fortes de fupériorité:
quandil s’agira de la fupériorité individuelle , cetera
le comparatif; & quandil fera queftion de la fupériorité
univerfelie , ce fera véritablement lefuperlatif i
Weifs ( fage ) ; w e if er ( plus fage ) , comparatif ; weif-*,
f it ( le.plus fage) , c’ eft le fuperlatif. D’où il fuit que
ce feroit induire en erreur , que de dire que les Allemands
ont, comme les Latins, trois degrés terminés
; le fuperlatif allemand Weifet n’ eft point du tout
l’équivalent du « çÛtuIcs des Grecs , ni du fapientiffi
mus des Latins, qui tous deux fignifient très-fage ; il
ne répond qu’à notre le plus fage.
En italien, en efpagnol & en françois, il n’y a aucune
terminaifon deftinée ni pour le comparatifpro-
prementdit, ni pour le fuperlatif : on fe fert également
dans les trois idiomes de l’adverbe qui exprime
la fupériorité, piu en italien , mas en efpagnol, plus
en françois; piufapiente, ital. mas prudente, efp. plus
fage, franç. Voilà le comparatif proprement dit.
Pour ce qui eft du fuperlatif, nous ne le différencions
du comparatif propre qu’en mettant l’article le,
la , les ou fon équivalent avant le comparatif ; je dis
fon équivalent, non - feulement pour y comprendre
les petits mots du, au , des, aux, qui font contractés
d’une prépofition & de l’article , mais encore les
mots que j’ai appèllés articles poffeffifs, favoir mon,
ma ,mes , notre, nos ; ton, ta, tes, votre , vos; fon,
f a , fe s , leur, leurs ; parce qu’ils renferment effectivement
, dans leur lignification , celle de l’article &
celle d’une dépendance relative à quelqu’une des trois
perfonnes , voyt{ Possessif. Nous difons donc au
comparatif, plus grand, plusfidele, plus tendre , plus
cruel, & par exception , meilleur, moindre , &c. ÔC
au fuperlatif noos difons avec l’article fimple , la plus
grande de mes pafjions , le plus fidele de vos fujets, le
plus tendre de fes amis , les plus cruels de nos ennemis ,
le meilleur de tes domeftiques, le moindre de leurs foucis,
ce qui eft au même degré que fi l’on mettoit l’article
pofleffif avant le comparatif, & que l’on dît, ma plus
grande paffion , votre plus fidelefujet, fo/i plus tendre
ami , nos plus cruels ennemis , ton meilleur domefiique ,
leur moindre fouet.
Nous confervons au fuperlatif la même forme qu’au
comparatif,parce qu’en effet l’un exprime comme
l’autre un rapport de fupériorité ; mais le fuperlatif
exige de plus l’article fimple ou l’article' pofleffif, &
c’eft par-là qu’eft défignée la différence des deux fens:
fur quoi eft fondé cet ufage ?
Quand on dit, par exemple , ma paffion efi plus
grande que ma crainte, on exprime tout ; & le terme'
comparé ma paffion , &: le terme de comparaifon ,
ma crainte ; & le rapport de fupériorité de l’un à 1 e-
gard de l’autre, plus grande ; & la liaifon des deux
1 termes envifagés fous cet afp eft , que: ainfi l’efprit
j voit clairement qu’il y a un rapport de fupériorité m-
dividucLle. .
Mais quand on dit, la plus grande de mes paffions ',
l’analyfe eft différente : la annonce néceffairement
un nom appellatif, c’eft fa deftination immuable, &
les circonftances de la phrafe n’en défignent pas d’autres
que paffion; ainfi il faut d’abord dire par fupplé-
ment, la ( paffion ) plus grande : la prépofition de,qui
fu it, ne peut pas tomber fur grande, cela eft évident ;
ni fur plus grande, nous ne parlons jamais ainfi; elle
tombe donc fur un nom appellatif encore fous-en-
îendu , & comme il s’agit ici d’une fupériorité uni-
verfelle , il me femble que le fupplément le plus naturel
eft la totalité, & qu’il faut dire par fupplément,
( la totalité) de mes paffions : mais ce fupplément doit
tenir par quelque lien particulier à l’enfemble de la
phrafe, & d’ailleurs plus grande n’étant plus qu’un
fimple comparatif exige un que & un terme individuel
de comparaifon ; je ferois donc ainfi l’analyfe
entière de la phrafe, la ( paffion ) plus grande que les
autres ( paffions de la totalité) de mes paffions ; ce qui
exprime bien clairement la fupériorité univerfelie
qui caraélérife le fuperlatif.
Si l’on dit au contraire, ma plus grande paffion , la
fuppreffion totale du terme de comparaifon eft le
ligne autorifé par l’ufage pour défigner que c’eft la
totalité des autres objets de même nom , & que la
phrafe fe réduit analytiquement à celle-ci, ma pafi
jion plus grande ( que toutes mes autres paffions ).
Dans ces deux cas , l’article fimple ou pofleffif,
fervantà individualifer l’objet qualifié par le comparatif,
eft le ligne naturel qu’on doit le regarder comme
extrait, à cet égard , de la totalité des autres objets
de même nature fournis à la même.qualification.
50. Le comparatif d’infériorité eft exprimé par
6 6 7 .
1 adverjbe qui marque l’infériorité, du-moins dans
toutes les langues dont j’ai connoiffance : les Grecs
dilent, navov rc<poc ; les Latins , minus fapiens ; les
Italiens , meno fapiente ; les Efpagnols , mtnos prudente
; & nous , moins fage.
Comme moins eft par lui - même comparatif, fi
nous avons befoin d’en exprimer le fens fuperlatif,
nous le faifons comme il vient d’être dit, par l’addition
de l’article fimple ou pofleffif ; le moins inflruit
des enfans, votre moins belle ro^e.
V. L expofition que je viens de faire du fyftème
des fens graduels feroit incomplette , fi je ne fixois
pas les bipeces de mots qui en font fufceptibles. Tout
le monde conviendra fans doute que grand nombre
d’adjeélifs & d’adverbes font dans ce cas : mais il pa-
roîtra peut-être furprenant à quelques-uns , fi j’avance
qu’un grand nombre de verbes font également
fufceptibles des fens graduels , 6c qu’il auroit pu arriver
dans quelques idiomes , que l’ufage les y eut
caraélérifés çar des terminaifons propres ; cependant
la chofe eft évidente.
Les adjeélifs & les adverbes qui peuvent recevoir
les, differens fens graduels, & conféquemment des
terminaifons qui y foient adaptées, ne le peuvent,
que parce que la qualité qui en conftitue la fignificâ-
tion individuelle , eft en foi fufceptible de plus & d’e
moins : il eft donc néceffaire que tout verbe , dont
la lignification individuelle préfente à l’efprit l’idée
d’une qualité fufceptible de plus &: de moins, foit
également fufceptible des fens graduels, & puiffe
recevoir dé l’ufage des terminaifons qui y foient relatives.
S E N S
Adjeélif. Adverbe.
{Pofitif. amoureux. amoureufement.
Ampliatif. très-amoureux, très-amoureufement.
Diminutif. un peu amoureux, un peu amoureufement.
r d’egalite. auffi amoureux, auffi amoureufement.
COM P A R A T IF S ,< de fupériorité. plus amoureux, plus amoureufement.
d’infériorité. moins amoureux, moins amoureufement.
Verbe.
aimer.
aimer beaucoup,
aimer un peu.
aimer, autant,
aimer plus,
aimer moins.
r Quant à la poffibilité des terminaifons qui carac-
tériferoient dans les verbes ces différens fens ; c’eft
un point qui eft inféparable de lafufceptibilité même
des fens, puifque l’ufage eft d’ailleurs le maître ab-
folu d’exprimer comme il lui plaît tout ce qui eft
de l’objet de la parole. Cela fe juftifie d’ailleurs par
plufieurs ufages particuliers des langues.
i° . La voix aélive & la voix paflïve des Latins
donnent un exemple qui auroit pu être étendu davantage
: fi l’ufage a pu établir fur un même radical des variations
pour deux points de vue fi différens,rien n’em-
pêchoit qu’il n’en introduisît d’autres pour d’autres
vues ;& quoique l’on ne trouve point de terminaifons
graduelles dans les verbes latins, on y rencontre au-
moins quelques verbes compofés qui, par-là, en ont
le fens: amare (aimer) , eft le pofitif; adamare (aimer
ardemment), c ’eft l’ampliatif : « la prépofition per,
» dit l’auteur des recherches fur la langue latine ( ch.
» xxv. p. 328.') eft dans tous les verbes, comme auffi
» dans les noms adjeélifs & les adverbes, augmentà-
» tive de ce que lignifie le fimple ; & dans le plus
» grand nombre des verbes, elle y équipolle à l’un
» de ces adverbes françois, beaucoup , grandement,
» fortement, parfaitement ou en perfection , tout-à-fait,
» entièrement >>; il eft aifé de reconnoître à ces traits
le fens ampliatif : maïo eft en quelque forte le comparatif
de fupériorité de volo, &c.
20. Les terminaifons d’un même verbe hébraïque
font en bien plus grand nombre, puifqu’à s’en tenir
à la doétrine de Mafclef, laquelle eft beaucoup plus
reftrainte que celle des autres hçbraïfaijs, le même
Verbe radical reçoit jufqu’à cinq formes differentes,
Tome X V .
que l’on appelle des conjugaifons ; mais que j ’appel-
lerois plus volontiers des voix : ainfi l’on dit (mefar)
tradidit ; ( noumefar) traditus efi ; (hemefir) iradere
fecit ; (hemefar) tradifecit ; ( hethmefar)yè tradidit.
Sur quoi il faut obferver que je fuis ici la méthode
de Mafclef pour la leéture des mots hébreux. ;
30. La langue laponne , que nous ne foupçonnons
peut-être pas de mériter la moindre attention de notre
p art, nous préfente néanmoins l’exemple d’une
dérivation bien plus riche encore par rapport aux
verbes : on y trouve laidet, conduire ; laidelet, continuer
Paélion de conduire; laidetet, faire Conduire ;
laidetallet, fe faire conduire ; laidegaetet, commencer
à conduire ; laidtfiet, conduire un peu ( c ’eft le
fens diminutif) ; laidanet, être conduit de pleiri gré;
laidanovet, être Conduit malgré foi bu fans s’aider ;
laidetalet, empêcher de conduire. Voye{ les notes
fur le ch. iij. de la defeription hiftoriqué de la Laponie
fuédoife, traduit de l ’allemand par M. de Kèraliode
Gourlay.
Je terminerois ici cet article , fi je ne me rappel-
lois d’avoir Vu dans les mémoires de Trévoux (O c tobre
1759. I I . vol. p. 2(f(fè.') une lettre de M. l'abbé
de Wailly aux auteurs de ces mémoires, fur quelques ex-
preffions de notre langue, laquelle peut donner lieu à
quelques obfervations Utiles. Ce grammairien y examine
trois expreffions, dont les deux premières ont
déjà été difeutées par Vaugelàs , rem. 5tq .& 86. & ïa
troifiem.e par M. l’abbé Girard, vraisprinblp. dife. x f,
iom.II. p.218. Je ne parlerai point ic i de la premiers
ni de la troifieme , qui font étrangères à cet a rticle,
& je ne m’arrêterai qu’à la fécondé'cfai' y a rapport