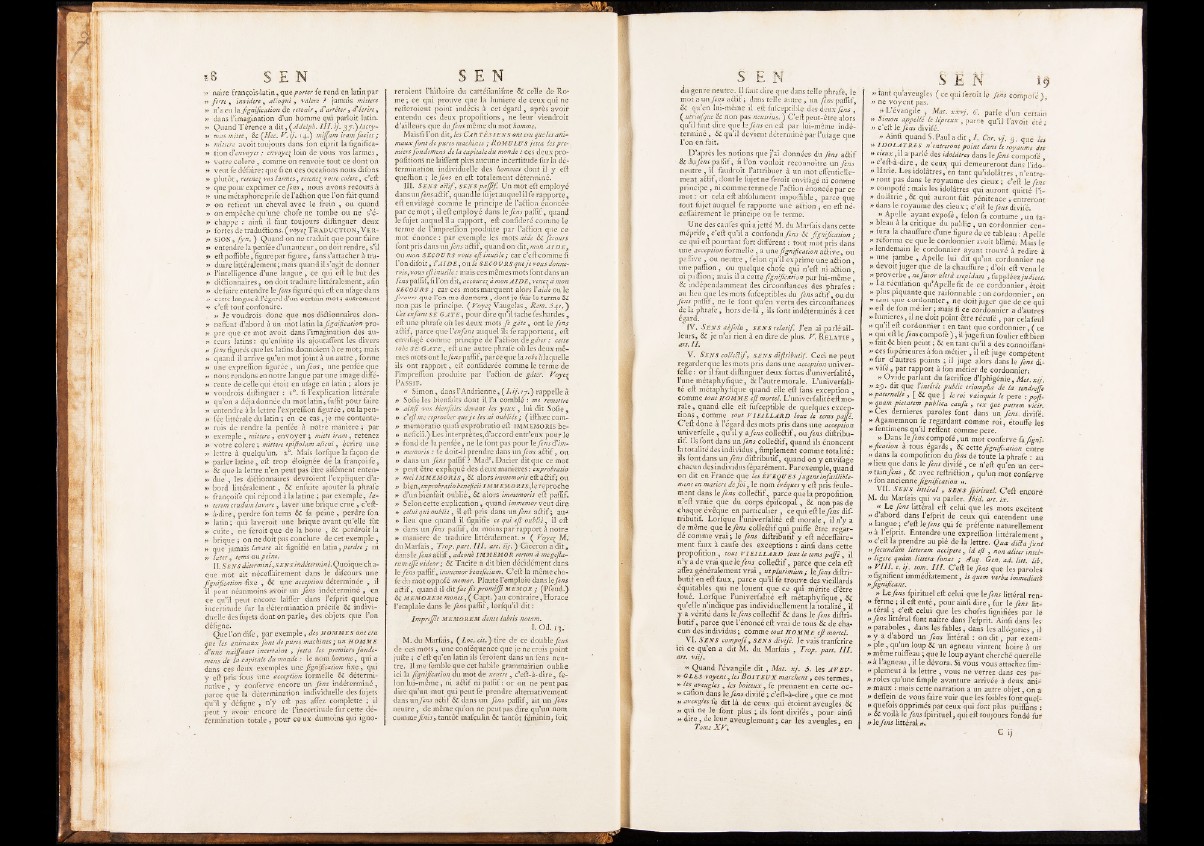
» naire françois-latin, que porter fe rend en Iatîn par
» ferre , invidere , allô qui valere ? jamais mittere
» n’a eu la fignification de retenir, d'arrêter , d?écrire ,
» dans l’imagination d’un homme qui parloit latin.
» Quan d Térence a d it, ( Addph. III. ij. 3 7 .) lacry-
» mas mitte, ôc (i&c. V .ij. 14.) mïjfarn iram faciet ;
» mittere avoit toujours dans fon efprit la fignifica-
» tion d’envoyer : e/zvoye^ loin de vous vos larmes,
» votre colere , comme on renvoie tout ce dont on
» veutfe défaire : que fi en ces occafions nous difons
» plutôt, retenez vos larmes, retenez votre colere, c’eft
» que pour exprimer ce fens, nous avons recours à
» une métaphore prife de l’aâion que l’on fait quand
» on retient un cheval avec le Frein , ou quand
» on empêche qu’une chofe ne tombe ou ne s’é-
» chappe : ainn il faut toujours diftinguer deux
» fortes de traduftions. ( vo/c^Traduc tio n, V er-
» sion , fyn. ) Quand on ne traduit que pour faire
» entendre la penfée d’un auteur, on doit rendre, s’il
» eft polîible, figure par figure, fans s’attacher à tra-
» duire littéralement ; mais quand il s’agit de donner
» l’intelligence d’une langue , ce qui eft le but des
» diôionnaires, on doit traduire littéralement, afin
» de faire entendre le fens figuré qui eft en ufage dans
» cette langue à l’égard d’un certain mot ; autrement
•» c’eft tout confondre.
» Je voudrois donc que nos diélionnaires don-
» naffent d’abord à un mot latin la fignificaùon pro-
» pre que ce mot avoit dans l’imagination des au-
» teurs latins : qu’enfuite ils ajoutaffent les divers
» fens figurés que les latins donnoient à ce mot ; mais
» quand il arrive qu’un mot joint à un autre, forme
» une exprefiion figurée , un fens, une penfée que
» nous rendons en notre langue par une image diffé-
» rente de celle qui étoit en ufage en latin ; alors je
s» voudrois diftinguer : i°. fi l’explication littérale
» qu’on a déjà donnée du mot latin, fuffit pour faire
» entendre à la lettre l’exprefîion figurée, ou lapen-
» fée littérale du latin ; en ce cas, je me contente-
» rois de rendre la penfée à notre maniéré ; par
» exemple , mittere, envoyer ; mitte iram, retenez
» votre colere ; mittere epiftolam alicui, écrire une
» lettre à quelqu’un. 20. Mais lorfque la façon de
» parler latine, eft trop éloignée de la françoife,
» & que la lettre n’en peut pas être aifément enten-
» due , les dictionnaires devroient l’expliquer d’a-
» bord littéralement, & enfuite ajouter la phrafe
» françoife qui répond à la latine ; par exemple , la-
» terem crudum lavare , laver une brique crue , c’eft-
» à-dire, perdre fon tems & fa peine , perdre fon
» latin ; qui laveroit une brique avant qu’elle fut
» cuite ne feroit que de la boue , ÔC perdroit la
» brique ; on ne doit pas conclure de cet exemple ,
» que jamais lavare ait lignifié en latin, perdre ; ni
» later, tems ou peine.
II. S ens déterminé, sen s indéterminé. Quoique chaque
mot ait néceffairement dans le difeours une
ftgnification -fixe , & une acception déterminée , il
il peut néanmoins avoir un fens indéterminé , en
ce qu’il peut encore laiffer dans l’efprit quelque
incertitude fur la détermination précife & individuelle
des fujets dont on parle, des objets que l’on
défigne.
Que l’on dife, par exemple, des h om m e s ont cru
que les animaux font de pures machines ; un HOMME
d'une' naiffance incertaine , jetta les premiers fonde-
mens de la capitale du monde : le nom homme, qui a
dans ces deux exemples une fignification fixe , qui
y eft pris fous une acception formelle & déterminative
, y conferve encore un fens indéterminé,
parce que la détermination individuelle des fujets
qu’il y défigne , n’y eft pas affez complette ; il
peut y avoir encore de l’incertitude fur cette défémination
totale, pour ce ux dumoins qui îgnorerolent
ï’hiftoirë du taftéfianifme & celle de R01
me ; ce qui prouve que la lumière de ceux qui né
refteroient point indécis à cet égard , après avoir
entendu ces deux propofitions, ne leur vieridroit
d ’ailleurs que du fens même du mot homme.
Maisli l’on dit, les Car té s iens ont eru que les animaux
font de pures machines ; Rom U LU S jetta les pre-,
miers fondemens de la capitale du monde : ces deux propositions
ne laiffent plus aucune incertitude fur la détermination
individuelle des hommes dont il y eft
queftion ; le fens en eft totalement déterminé.
III. Se n s actif, s e n s paffifi Un mot eft employé
dans un fens a£tif, quand le fujet auquel il fe rapporte,
eft envifagé comme le principe de l’aftion énoncée
par ce mot ; il eft employé dans le fens paftif, quand
le fujet auquel il a rapport, eft confideré comme lé
terme de l’imprefîion produite par l’aftiqn que ce
mot énonce : par exemple les mots aide & fecours
font pris dans un fens aftif, quand on dit, mon a id e ,
ou mon se c ou r s vous efi inutile; car c’eft comme fi
l’on difoit, l'AIDE, ou le se c o u r s que je vous donne*
rois, vous efi inutile : mais ces mêmes mots font dans un
fens palfif, fi l’on dit, accoure£ à mon AIDE, vene[ à mon
secour s ; car ces mots marquent alors l'aide ou le
fecours que l’on me donnera , dont je fuis le terme ôc
non pas le principe. ( Voye^ Vaugelas, Rem. S41.')
Cet enfant s e ga te , pour dire qu’il tache fes hardes ,
eft une phrafe oîi les deux mots fe gâte, ont le fens
aftif, parce que Y enfant auquel ils fe rapportent, eft
envifagé comme principe de l’aftion de gâter : cette
robe se g â t e , eft une autre phrafe où les deux mêmes
mots ont lefens palfif, parce que la robe à laquelle
ils ont rapport, eft confiderée comme le terme de
l’impreflion produite par l’aftion de gâter. Voye£
Pa ssif.
« Simon, dansl’Andrienne,( ƒ .i j . /y.) rappelle â
» Sofie les bienfaits dont il l’a comblé : me remettre
» ainfi vos bienfaits devant les yeux , lui dit Sofie ,
» c'efi me reprocher que je les ai oubliés ; ( ifthæc com-
» memoratio quafi exprobratio eft immemoris be-
» rieficii.) Les interprètes,d’accord entr’eux pour le
»' fond de la penfée, ne le font pas pour le finsd'im-
» menions : fe doit-il prendre dans un fens a f tif, ou
» dans un fens palfif ? Made. Dacier dit que ce mot
» peut être expliqué des deux maniérés : exprobratio
» mei im m em o r is , & alors immemoris eft aftif% ou
» bien,exprobratiobeneficii IMM£MOR/5,le reproche
» d’un bienfait oublié, & alors immemoris eft palfif.
» Selon cette explication, quand immemor veut dire
» celui qui oublie , il eft pris dans un fens aftif ; au-1
» lieu que quand il lignifié ce qui efi oublié, il eft
» dans un fens palfif, du moins par rapport à notre
» maniéré de traduire littéralement. » ( Voye[ M.'
duMarfais, Trop.part. III. art. iij. ) Cicéron a d it,
dans le fens a ftif, adeonê im m em or rerum à megefia-
rum ejfevideor ; &C Tacite a dit bien décidément dans
le fens paftif, immemor beneficium. C’eft la même chofe
du mot oppofé memor. Plaute l’emploie dans le fens
aftif, quand il ditfacfispromijfi mem or ; (Pfeud.)
& memorem mortes, ( Capt. ) au contraire, Horace
l’emploie dans le fens paftif, lorfqu’il dit :
Imprejfit MEMOREM dente labris notam.
I. Od. 13.
M. du Mariais, ( Loc. cit. ) tire de ce double fens
de ces mots, une conféquence que je ne crois point
jufte ; c’eft qu’en latin ils feroient dans un fens neutre.
Il me femble que cet habile grammairien oublie
ici la fignification du mot de neutre, c’eft-à-dire, félon
lui-même, ni aftif ni palfif : or on ne peut pas
dire qu’un mot qui peut fe prendre alternativement
dans un fens aftif & dans un fens palfif, ait un fens
neutre, de même qu’on ne peut pas dire qu’un nom
comme finis, tantôt mafculin & tantôt féminin, foit
du genre neutre. Il faut dire que dans telle phralè, le
mot a un fins aftif ; dans telle a u t r e u n fens palfif,
&c qu’en lui-même il eft fufceptible des deux fins ,
( utriujque & non pas neuirius. j C’eft peut-être alors
qu’il faut dire que le fins en eft par lui-même indéterminé
, & qu’il devient déterminé par l’ufage que
l’on en fait.'
D ’après les notions que j’ai données du fins aftif
& dufins paftif, fi l’on vouloit reconnoître un fins
neutre , il faudroit l’attribuer à un mot elfentielle-
ment aftif, dont le fujet ne feroit envifagé ni comme
pri ncipe, ni comme terme de l’aftion énoncée par ce
mot : or céla eft abfolument iinpoflible, parce que
tout fujet auqüel fe rapporte une aftion j en eft né-
eeflairement le principe ou le terme.
Une des eau fes qui a jetté M. du Marfais dans cette
méprife, c’eft qu’il a confondu fins & fignification ;
ce qui eft pourtant fort différent : tout mot pris dans
une acception formelle , a une fignification aftive, ou
paftîve , ou neutre , félon qu’il exprime une aftion,
unepaflion, ou quelque chofe qui n’eft ni aftion,
ni paflion; mais il a cette fignification par lui-même,
& indépendamment des circonftances des phrafes :
au lieu que les mots fufceptibles du fins a ftif, ou du
fens palfif, ne le font qu’en vertu des circonftances
de la phrafe, hors de-là , ils font indéterminés à cet
égard.
IV. Se n s abfolu, s e n s relatif J’en ai parlé ailleurs,
& je n’ai rien à en dire de plus. V. Relat if ,
art. II.
V . S en s collectif, s en s difiribuùf. Ceci ne peut
regarder que les mots pris dans une acception univer-
felle : or il faut diftinguer deux fortes d’univerfalité,
l’une métaphyfique, & l’autre morale. L’univerfali-
té eft métaphyfique quand elle eft fans exception ,
comme tout h om m e efi mortel. L’univerfalité eft morale
, quand elle eft fufceptible de quelques exceptions
, comme tout v ie il l a r d loue le tems pajfé.
C ’eft donc à l’égard des mots pris dans une acception
univerfelle , qu’il y a fins colleftif, ou fins diftribu-
tifi Ils font dans un fens colleftif, quand ils énoncent
la totalité des individus, Amplement comme totalité :
ils font dans un fins diftributif, quand on y envifage
chacun des individus féparément. Par exemple, quand
on dit en France que les è v e q u e s jugent infailliblement
en matière de fo i, le nom évêques y eft pris feulement
dans le fin s colleftif, parce que la propofition
n’eft vraie que du corps épifcopal, & non pas de
chaque évêque en particulier , ce qui eft le fens diftributif.
Lorfque l’univerfalité eft morale , il n’y a
de même que le fin s colleftif qui puiffe être regardé
comme vrai ; le fins diftributif y eft néceffairement
faux à caufe des exceptions : ainfi dans cette
propofition , tout v ie il l a r d loue le tems pajfé, il
n’y a de vrai que le fin s colleftif, parce que cela eft
affez généralement v r a i, utplurimùm; le fins diftributif
en eft faux, parce qu’il fe trouve des vieillards
équitables qui ne louent que ce qui mérite d’être
loué. Lorfque Puniverfalité eft métaphyfique, &
qu’elle n’indique pas individuellement la totalité, il
y a vérité dans \e fin s colleftif & dans le fins diftri-
Dutif, parce que l’énoncé eft vrai de tous & de chacun
des individus ; comme tout h om m e efi morteL
VI. S e n s compojé, sen s divifé. Je vais tranferire
ici ce qu’en a dit M. du Marfais , Trop. part. I II.
art. viij.
« Quand l’évangile d i t , Mat. x j. 5. les a v e u -
» g l e s voyent, les B o i t eu x marchent, ces termes,
» les aveugles , les boiteux, fe prennent en cette oc-
» cafion dans le y«/« divifé ; c’eft-à-dire , que ce mot
» aveugles fe dit là de ceux qui étoient aveugles &
»qui ne le font plus ils. font divifés, pour ainfi
» dire, de leur aveuglement; car les aveugles, en
Tome XK*
» tant qu’aveugles ( ce qui feroit le fens compofé )
» ne voyent pas.
» L’évangile , Mat. xxvj. S. parle d’un certain
» Simon appelle le lépreux , paroe qu’il l’avoit été :
» c’eft 1 e fins divifé.
» Ainfi quand S. Paul a dit j I. Cor. vj. ÿ , p § /es
» I d o l â t r e s n'entreront point dans le royaume des
» deux, il a parlé des idolâtres dans le fins compofé ,
» c’eft-à-dire , de ceü^ qui demeureront dans l’ido-
» lâtrie. Les idolâtres, en tarit qu’idolâtres , n’entre-
» ront pas^ dans le royaume des cieüx ; c’eft le fins
» compofé : mais les idolâtres qui auront quitté l’i-
» dolatrie , & qui aurorit fait pénitence ; entreront
» dans le royaume des deux ; c’eft le fens divifé.
» Apelle ayant expofé, félon fa coutume, un ta-
» bleau à la critique du public , un cordonnier cen-
» fura la chauffure d’une figure de ce tableau : Apelle
» réforma ce que le cordonnier avdit blâmé: Mais lé
» lendemain le cordonnier ayant trouvé à redire à
» urie jambe , Apelle lui dit qu’un cordonnier ne
» devoit juger que de la chauffure ; d’où eft venu le
» proverbe, ne fut or ultra crepidam , fuppléez judicet.
» La reeufation qu’Apelle fit de ce cordonnier j étoit
» plus piquante que raiforinable : un cordonnier, en
» tant que cordonnier, ne doit juger que de ce qui
» elt de fon mécier ; mais fi ce cordonnier a d’autres
>> lumières, il ne doit point être réeufé , par celafeul
» qu’il eft cordonnier : en tant que cordonnier, ( ce
» qui eft le fins compofé ) , il juge fi un foulier eft biert
» fait & bien peint ; & en tant qu’il a des connoiffan-i
» ces fuperieures a ion metier, il eft juge compétent
»fur d’autres points ; il juge alors dans le fins di-
» v ife , par rapport à fon métier de cordonnier;
» Ovide parlant du facrifice d’Iphigénie, Mer. xi).
»29 . dit que l'intérêt public triompha de la iendrejfe
» paternelle , [ & que ] le roi vainquit le pere : pojl-
» quam pietatem publica caufa , rex que- pattern vicin
» Ces dernieres paroles font dans un fens, divifé.
» Agamèmnon fe regardant comme ro i, étouffe les
» fentimens qu’il reffeht comme pere.
» Dans le fins compofé, un mot conferve lafigni-
»jication à tous égards, & cette fignification entre
» dans la compofition du fens de toute la phrafe : au
» lieu que dans 1 e fins divifé , ce n’eft qu’en un cer-*
» xamfenS' , & avec reftriftion , qu’uq mot conferve
» fon ancienne fignification »,
VII. S en s littéral,- s e n s fpiritueL C ’eft eueoré
M. du Marfais qui va parler. Ibid. art. ix.
« Le fins littéral eft celui que les mots excitent
» d’abord dans l’efprit de ceux qui entendent une
» langue ; c’eft le fins qui fe préfente naturellement
» à l’efprit. Entendre une exprefiion littéralement,
» c’eft la prendre au pié de la lettre. Quoe dicta funt
yyfecundàm litteram accipere, id eft , non aliter intel-
» ligere quàm littera fonat ; Aug. Gen. ad. lin. lib.
» y I I I . c. ij. tom. I I I . C ’eft le fins que les paroles
» lignifient immédiatement, is quem verba immediatï
»fignificant.
» Lefiens fpirituel eft celui que lefins littéral ren-
» ferme ; il eft enté, pour ainfi dire, fur le fens lit—
» teral ; c eft celui que les chofes lignifiées par lé
»fins littéral font naître dans l’efprit. Ainfi dans les
» paraboles, dans les fables, dans les allégories, il
» y a d’abord un fens littéral : on d i t , par exem-
» pie , qu’un loup & un agneau vinrent boire à uil
» même ruiffeau ; que le loup ayant cherché querellé
» à 1 agneau, il le dévora. Si vous vous attachez fim-
» plemeut à la lettre , vous ne verrez daris c es pa-
» rôles qu’une fimple avanture arrivée à deux ani-
» maux : mais cette narration a un autre objet, on a
» deffein de vous faire voir que les foibles font quel2
» quefois opprimés par ceux qui font plus puiflans :
» & voilà le fins fpirituel ,. qui eft toujours fondé fur
» le fens littéral m,
G i j