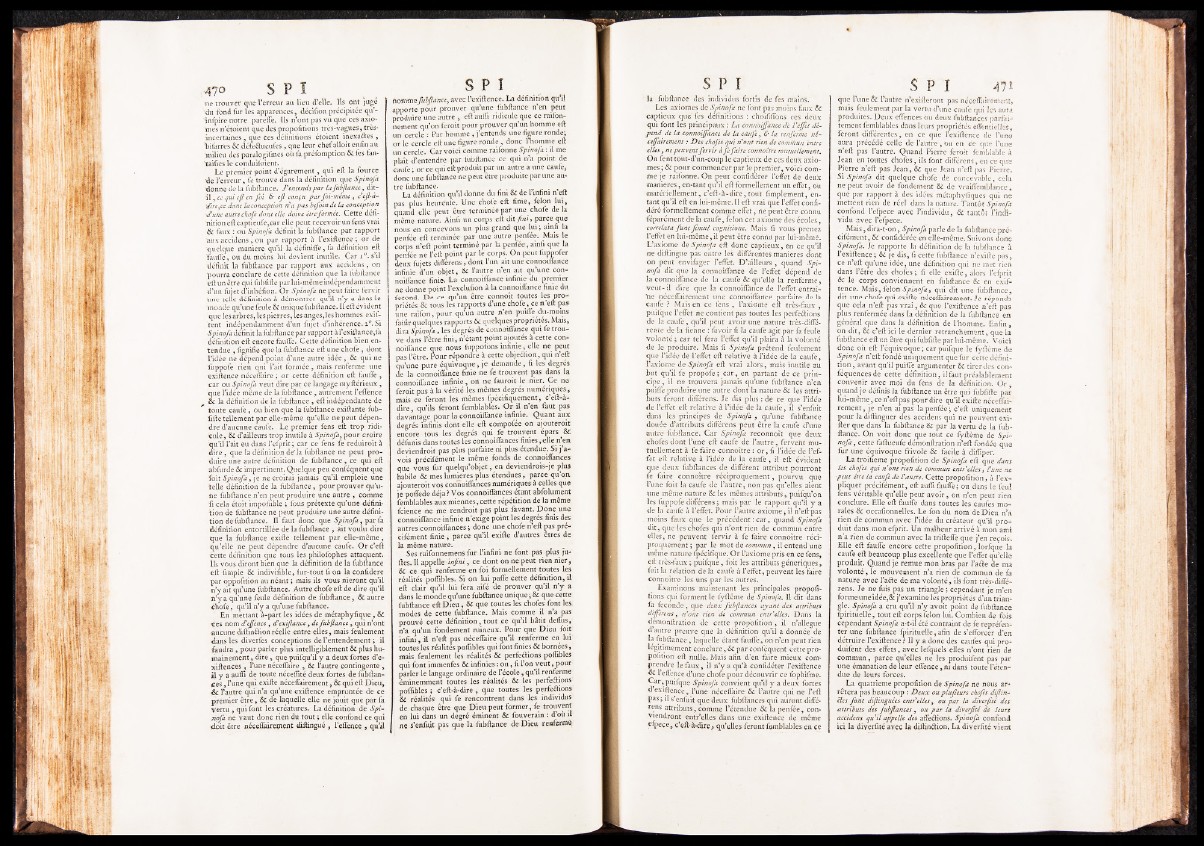
ne trouver que l ’erreur au lieu d’elle. Ils ont juge
'du fond fur les apparences, décifion précipitée qu’-
'infpire notre pareffe. Ils n’ont pas vu que ces axio«-
mes n’étoient que des proportions très-vagues * très-
incertaines , que Ces définitions étoient inexaftes ,
Warr'es &.défeâueu'fes , que leur chef alloit enfin aù
milieu des paralogifmes où la préfomption & fes fan-
taifies le conduiloient.
Le premier point d’égarement, qui eft la fource
•de l’erreur, fe trouve dans la définition que Spinofa
donne de la fubftance. J'entends par la fubftance, dit-
i l , ce qui eft en fo i & ejl conçu par foi-même , c'cft-à-
'dire.ce dont la conception na pas befoin de la conception
'cCufie autre chojt dont elle doive être formée. Cette définition
eft captieufe,car elle peut recevoir un fens vrai
& faux t ou Spinofa définit la fubftance par rapport
'aux accidens , ou par rapport à l’exiftence ; or de
quelque maniéré qu’il la définilTe, la définition eft
'faillie, ou du moins lui devient inutile. Car i°. s’il
définit la fubftance par rapport aux accidens , on
pourra conclure de cette définition que la fubftance
eft un être qui fubfifte par lui-même indépendamment
d’un fujet d’inhéfion. Or Spinofa ne peut faire fervir
Une telle définition à démontrer qu’il n’y a dans le
mondé qu’une feule & unique fubftance. Il eft évident
que les afbres, les pierres, les anges,les hommes exif-
tent indépendamment d’un fujet d’inhérence. 2°. Si
Spinofa définit la fubftance par rapport à l’exiftance,la
définition eft encore faufle. Cette définition bien entendue
, lignifie que la fubftance eft une chofe , dont
l’idée ne dépend point d’une autre idée , & qui ne
ïuppofe rien qui l’ait formée, mais renferme une
exiftence néceflaire ; or cette définition eft faufle ,
car ou Spinofa veut dire par ce langage myftérieux,
que l’idée même de la fubftance, autrement l’effence
& la définition de la fubftance , eft indépendante de
toute caufe, ou bien que la fubftance exiftante fubfifte
tellement par elle-même qu’elle ne peut dépendre
d’aucune caufe. Le premier fens eft trop ridicule
, & d’ailleurs trop inutile à Spinofa, pour croire
iqu’il l’ait eu dans l’efprit; car ce fens fie reduiroit à
dire , que la définition de* la fubftance ne peut produire
une autre définition de fubftance, ce qui eft
abfurde & impertinent. Quelque peu conféquent que
foit Spinofa, je ne croirai jamais qu’il emploie une
telle définition de la fubftance, pour prouver qu’une
fubftance n’en peut produire une autre , comme
ii cela étoit impofiible ; fous prétexte qu’une définition
de fubftance ne peut produire une autre définition
de fuhftance. Il faut donc que Spinofa, par fa
définition entortillée de la fubftance , ait voulu dire
que la fubftance exifte tellement par elle-même,
tau’elle ne peut dépendre d’aucune caufe. Or c’eft
cette définition que tous les philofophes attaquent.
Ils vous diront bien que la définition de la fubftance
eft {impie & indivifible, lur-tout fi on la confidere
par oppofition au néant ; mais ils vous nieront qu’il
n’y ait qu’une fubftance. Autre chofe eft de dire qu’il
n’y a qu’une feule définition de fubftance, & autre
chofe, qu’il n’y a qu’une fubftance.
En mettant à-part les idées de métaphyfique, &
Ces nom tFeffence , d'exiftance, de fubflance, qui n’ont
-aucune diftinûion réelle entre elles, mais feulement
dans les diverfes conceptions de l’entendement ; il
faudra , pour parler plus intelligiblement & plus humainement
, dire, que puifqu’il y a deux fortes d’e-
xiftences , l’une néceflaire , & l’autre contingente ,
i l y a aufli de toute néceflité deux fortes de fubftan-
c e s , l’une qui exifte néceflairement, & qui eft Dieu,
•& l’autre qui n’a qu’une exiftence empruntée de ce
premier être, & de laquelle elle ne jouit que par fa
vertu , qui font les créatures. La définition de Spinofa
ne vaut donc rien du tout ; elle confond ce qui
doit être néceflairepient diftingué , l’effence , qu’il
ftomme fubftance, avec l’exiftence. La définition qu4U
apporte pour prouver qu’une fubftance n’en peut
produire une autre , eft aufli ridicule que ce raifon-
nement qu’on feroit pour prouver qu’un homme eft
un cercle : Par homme , j’entends une figure ronde;
or le cercle eft une figure ronde, donc l’homme eft
un cercle. Car voici comme raifonne Spinofa : il me
plaît d’entendre par fubftance ce qui n’a point de
caufe ; or ce qui eft produit par un autre a une caufe*
donc une fubftance ne peut être produite par une autre
fubftance. .
La définition qu’il donne du fini & de 1 infini n elt
pas plus heuréiue. Une chofe eft finie, félon lui*
quand elle peut être terminée par une chofe delà
même nature. Ainfi un corps eft dit fin i, parce que
nous en concevons un plus grand que lui; ainfi la
penfée eft terminée par une autre penfee. Mais le
corps n’eft point terminé par la penfée, ainfi que la
penfée ne l’eft point par le corps. On peut fuppofer
deux fujets différens » dont l’un ait une connoiflance
infinie d’un objet, & l’autre n’en ait qu’une con-
noifl'ance finie. La connoiflance infinie du premier
i ne donne point l’exclufion à la connoiflance finie du
fécond. De ce qu’un être connoît toutes les propriétés
& tous les rapports d’une chofe, ce n’eft pas
une raifon, pour qu’un autre n’en puifle du-moins
faifir quelques rapports & quelques propriétés. Mais,
dira Spinofa, les degrés de connoiflance qui fe trouve
dans l’être fini, n’étant point ajoutés à cette connoiflance
que nous fuppofons infinie, elle ne peut
pas l’être. Pour répondre à cette objeétion, qui n’eft
qu’une pure équivoque, je demande, fi les degrés
de la connoiflance finie ne fe trouvent pas dans la
connoiflance infinie, Ori ne fauroit Je nier. Ce ne
feroit pas à la vérité les mêmes degrés numériques *
mais ce feront les mêmes fpécifîquement, c’eft-à-
dire, qu’ils feront femblables. Or il n’en faut pas
davantage pour la connoiflance infinie. Quant aux
degrés infinis dont elle eft compofée on ajouteroit
encore tous les degrés qui fe trouvent épars ftC
défunis dans toutes les connoiflànces finies,elle n’en
deviendroit pas plus parfaite ni plus étendue. Si j’a-
vois précifément le même fonds de connoiflànces
que vous fur quelqu’objet, en deviendrois-je plus
habile & mes lumières plus étendues, parce qu’on
ajouteroit vos connoiflànces numériques à celles que
je poflede déjà? Vos connoiflànces étant abfolument
femblables aux miennes,cette répétition de la même
fcience ne me rendroit pas plus lavant. Donc une
connoiflance infinie n’exige point les degrés finis des
autres connoiflànces ; donc une chofe n eft pas pre-
cifément finie, parce qu’il exifte d’autres êtres de
la même nature.
Ses raifonnemens fur l’infini ne font pas plus ju-
ftes. Il appelle infini, ce dont on ne peut rien nier,
& ce qui renferme en foi formellement toutes les
réalités poflibles. Si on lui paffe cette définition, il
eft clair qu’il lui fera aifé de prouver qu’il n’y a
dans le monde qu’une fubftance unique; & que cette
fubftance eft D ieu , & que toutes les chofes font les.
modes de cette fubftance. Mais comme il n’a pas
prouvé cette définition, tout .ce qu’il bâtit defliis,
n’a qu’un fondement ruineux. Pour que Dieu foit
infini, il n’eft pas néceflaire qu’ il renferme en lui
toutes les réalités poflibles qui font finies & bornées,
mais feulement les réalités & perfeûions poflibles
qui font immenfes & infinies : o u , fi l’on veut, pour
parler le langage ordinaire de l’école, qu’il renferme
éminemment toutes les réalités & les perfeftions
poffibles ; c’eft-à-dire , que toutes les perfections
& réalités qui fe rencontrent dans les individus
de chaque être que Dieu peut former, fe trouvent
en lui dans un degré éminent & fouverain : d’ou il
I ne s’enfuit pas que la fubftance de Dieu renferme.
la fubftance des individus fortis de fes mainS.
Les axiomes dé Spinofa ne font pas moins faux &
captieux que fes définitions : choififlons ces déiix
qui font les principaux : La Connbiffàhce de l'effet dépend
de la connoijfance de la cdufe, & la renferme ni-
ceffairement : Des chofes qui ti'ont rien de coin fri un entre
elles, ne peuvent fervir à fe faire connoître mhtuellemefit.
On fent tout-d’un-coup le Captieux de ces deux axiomes
; & pour commencer par le premier, voici comme
je raifonne. On peut confidérer l’effet de deux
maniérés, en-tant qu’il eft formellement un effet, ou
matériellement, c’eft-à-dite, tout Amplement, entant
qu’il eft en lui-même. Il eft vrai que l’effet confi-
ftéré formellement comme effet, ne peut être connu
féparément de la caufe, félon cet axiome des éüoleS,
1correlata jhint fimtil cognitiohe. Mais fi VOUS prenez
l’effet en lui-même, il peut être connu par lui-même.
L’axiome de Spinojd eft donc captieux, en Ce qu’il
ne diftingué pas entre les différentes maniérés dont
on peut'envifager l’effet. D ’ailleurs, quand Spi<-
nofa dit que la connoiflance de l’effet dépend de
la connoiflance de la caufe & qu’elle la renferme *
veut-il dire que la connoiflance de l’effet entraîne
néceflairement une connoiflance parfaite de là
caufe ? Mais en ce fens , l’axiome eft très-faux *
puifque l’effet ne contient pas toutes les perfe&ions
de la caufe, qu’il peut avoir une nature très-différente
de la fienne : fuvoir fi la caitfe agit par fa feulé
volonté ; car tel fera l’effet qu’il plaira à la Volonté
de le produire. Mais fi Spinofa prétend feulement
que l’idée de l’effet eft relative à l’idée de la caufe,
l’axiome de Spinofa eft vrai alors, mais inutile au
but qu’il fe propofe ; ca r, en partant de ce principe,
il ne trouvera jamais qu’une fubftance n’ en
puifle produire une autre dont la nature & les attributs
feront différens. Je dis plus : de ce que l’idéè
de l’effet eft relative à l’idée de la caufe, il s’ enfuit
dans les principes de Spinofa , qu’une fubftance
douée d’attributs différens peut être la caufe d’une
autre fubftance. Car Spinofa reconnoît que deux
chofes dont l’une eft caufe de l’autre, fervent mutuellement
à fe faire connoître : o r , fi l’idée de l’effet
eft relative à l’idée de la caufe, il eft évident
que deux fubftances de différent attribut pourront
fe faire connoître réciproquement, pourvu que
l’une foit la caufe de l’autre, non pas qu’elles aient
une même nature & les mêmes attributs, piiifqu’on
les fuppofe différens ; mais par le rapport qu’il y a
de la caufe à l’effet. Pour l’autre axiome * il n’eft pas
, moins faux que le précédent : car* quand Spinofa
dit, que les chofes qui n’ont rien de commun entre
elles, ne peuvent fervir à fe faire connoître réciproquement
; par le mot de commun, il entend unè
même nature fpécifique. O r lfaxiome pris en ce fens,
eft très-faux ; puifque, foit les attributs génériques,
foit la relation de la caufe à l’effet, peuvent les faire
connoître les uns par les autres.
Examinons maintenant les principales prOpofi-
tiôns qui forment le fyftême de Spinofa. Il dit dans
fa fécondé, que deux fubjlances 'ayant des attributs
différens, n'ont rien de commun entr''elles. Dans là
démonftration de cette propofition * il n’allegue
d’autre preuve que la définition qu’il a donnée de
la fubftance, laquelle étant faufle, on n’en peut rien
légitimement conclure, & par conféquent cette pro-
polition eft nulle. Mais afin d’en faire mieux comprendre
le faux, il n’y a qu’à confidéter l’exiftence
& l’effence d’une choie pour découvrir ce fophifme.
Car, puifque Spinofa convient qu’il y a deux fortes
d exiftence,' l’une néceflaire & l’autre qui ne l’eft
pas ; il s’enfuit que deux fubftances qui auront différens
attributs, comme l’étendue & la penfée, conviendront
entr’elles dans une exiftence de même
. pece, c’eft-à-dire* qu’elles feront femblables en ce
que l’une &: l’autre n’exifteront pas néceflaîrémcrit*
mais feulement par la vertu d’une caufe qui les aura
produites. Deux effenees ou deux fubftances parfais
tement femblables dans leurs propriétés effentielles *
feront différentes, en ce que l’exiftence de l’une
aura précédé celle de l’aütre, ou en Ce que l’une
n’eft pas l’autre. Quand Pierre feroit fémblable à
Jean en toutes chofes* ils font différens, en ce que
Pierre n’eft pas Jean, & que Jean n’eft pas Pierre*
Si Spinofa dit quelque chofe de concevable, cela
ne peut avoir de fondement & de vraiffemblance,
qué par rapport à des idées métaphyfiques qui ne
mettent rien de réel dans la nature. Tantôt Spinofd
confond l’efpece avec l’individu, & tantôt l’individu
avec l’efpece.
Mais, dira-t-on, Spinofa parle de la fubftanéè précifément,
& confidérée en elle-même. Suivons donc
Spinofa. Je rapporte la définition de la fubftance à
l’exiftence; & je dis* fi cette fubftance n’exifte pas,
ce n’eft qu’une idée, une définition qui ne met rieri
dans l’être des chofes ; fi elle exifte, àlors l’efprit
& le corps conviennent en fubftance & en exiftence;
Mais, félon Spinofa * qui dit une fubftance,
dit une chofe qui exifte néceflairement; Je réponds
que cela n’eft pas vrai, & que l’exiftence n’eft pas
plus renfermée dans la définition de la fubftance en
général que dans la définition de l’homme. Enfin ,
on dit, & c’eft ici le dernier retranchement, que la
fubftance eft un être qui fubfifte par lui-même. Voici
donc où eft l’équivoque; car puifque le fyftème de
Spinofa n’ eft fondé uniquement que fur cette définition,
avant qu’il puifle argumenter & tirer des con-
féquences de cette définition, il faut préalablement
convenir avec moi du fens de la définition. Or *
quand je définis la fubftance un être qui fubfifte par
lui-même , ce n’eftpas pour dire qu’il exifte néceflairement,
je n’en ai pas la penfée; c’eft uniquement
pour la diftinguer des accidens qui ne peuvent exi-
fter que dans la fubftance & par la vertu de la fubftance.
On voit donc que tout ce fyftème de Spi~
nofa, cette faftueufe démonftration n’eft fondée que
fur une équivoque frivole & facil.e à diflïper.
La troifieme propofition de Spinofa eft que dans
les chofes qui n'ont rien de commun entr elles * Lune ni
■ peut être la caufe de Cautte. Cette propofition, à l’expliquer
précifément, eft aufli faufle; ou dans le feu!
fens véritable qu’elle peut avoir, on n’en peut rien
conclure. Elle eft faufle dans toutes les caufes morales
& occafionnelles. Le fon du nom de Dieu n’à
rien de commun avec l’idée du créateur qit’il produit
dans mon efprit. Un malheur arrivé à mon ami
n’a rien de commun avec la trifteffe que j’en reçois*
Elle eft faufle encore cette propofition, lorfque là
caufe eft beaucoup plus excellente que l’effet qu’elle
produit. Quand je remue mon bras par l’afte de mâ
volonté, le mouvement n’a rien de commun de fa
nature avec l’a&e de ma volonté, ils font très-diffé-
rens. Je ne fuis pas un triangle ; cependant je m’en
forme une idée,& j’examine les propriétés d’un triangle.
Spinofa a cru qu’il n’y avoit point de fubftance
lpirituelle, tout eft corps félon lui. Combien de fois
cependant Spinofa a-t-il été contraint de fe repréfen-
ter une fubftance fpirituelle, afin de s’efforcer d’en
détruire l’exiftence ? Il y a donc des caufes qui proa
duifent des effets, avec lefquels elles n’ont rien de
commun, parce qu’elles ne les produifent pas par
une émanation de leur effence, ni dans toute l’éten*
due de leurs forces.
La quatrième propofition de Spinofd ne nous ar-*
rêtera pas beaucoup : Deux ou plujieurs chofes diftin•*
clés font diftinguées entr*elles, ou par la diverftiê des
attributs des Jubftances, ou par la diverfitê de leurs
accidens qu'il appelle des affeéfions. Spinofa confond
ici la diyerfité ayec la diftinttion, La diyerfité vient