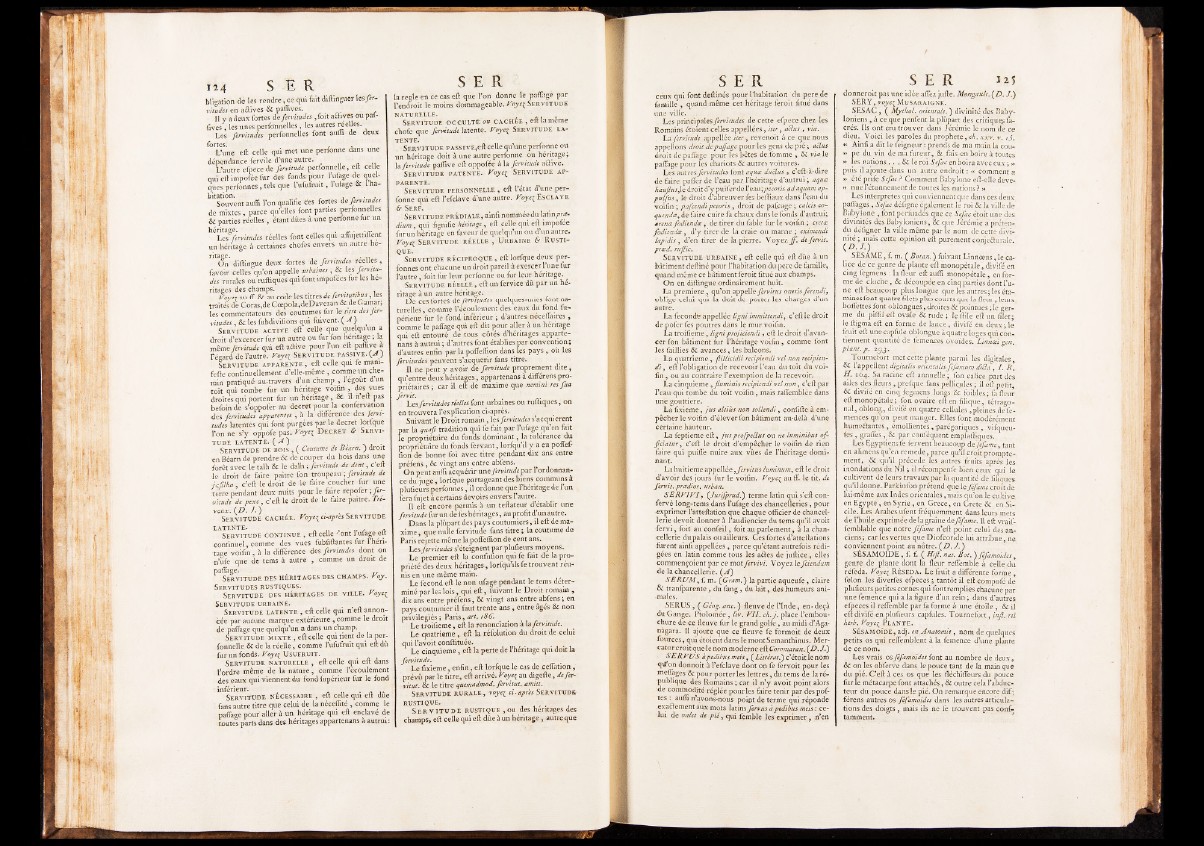
bligation de les rendre, ce qui fait diftinguer lesfervitudes
en aâives & paflives. _
Il y a deux fortes de fervitudcs , foit aéhves ou pal-
fives les unes perfo'nnelles, les autres reelles.
Lés fervitudcs perfonnélles font aufli de deux
fortes! - H , ;
L’une eft celle qui met une perfonne dans une
dépendance fervile d’une autre. « a u
L’autre efpece de fervitude perfonnelle, eit celle
qui eftimpofee far des. fonds pbur l’ufage de quel-
ques perfonnes, tels que l’ufufruit, l’ulage & 1 habitation.
W Ë Ê È Ê Ê A r ■ J Souvent suffi l'on qualifie Ces fortes ie.fervuudcs
de mixtes , parce qu’elles font parties peffonnelles
& parties réelles:, étant ducs à. une perfonne fur un
hCL'e s ’f ir vm d a réelles font celles qui affujettiffent
un héritage à certaines chofes envers un autre héritage.
, J ’ . ~j‘ V
On diftingue deux fortes de fervitudes reelles ,
favoir celles qu’on appelle urbaines , & les fervitti-
des rurales ou ruftiques qui fontimpofëes lur les héritages
des champs. . \
• Voyez au ff. & au code les titres de fervitutibus, les
traités de Coras,de Coepola,deDavezan & de Gamar;
les commentateurs des coutumes fur le titre des Jer-
vitudes, &C les fubdivifions qui fuivent. ( A ) I
S e r v i t u d e a c t i v e eft celle que quelquun a
droit d’excercer fur un autre ou fur fon héritage, la
même fervitude qui eftaftive pour l’un eft pafîive à
fégard de l’autre. Voye[ S e r v i t u d e p a s s i v e . ( A )
S e r v i t u d e a p p a r e n t e , eft celle qui fe mani-
fefte continuellement d’elle-même , comme un chemin
pratiqué au-travers d’un champ , l’égoût d’un
toit qui tombe fur un héritage voifin , des vues
droites qui portent fur un héritage, ôc il < n’eft pas
befoin de s’oppofer au1 decret pour la conférvation
des fervitudes apparentes , à la différence des fervitudes
latentes qui font purgées par le decret lorfque
l’on ne s’y oppofe pas: Voye.^ D e c r e t & S e r v i t
u d e LATENTE. ( A )
S e r v i t u d e d e b o i s , ( Coutume de Bearn. ) droit
en Béarn de prendre & de couper du bois dans une
forêt avec le talh & le dalh ; Jervitude de dent, c eft
le droit de faire paître fon troupeau ; fervitude de
ja fû h a , c’eft le droit de le faire coucher fur une
terre pendant deux nuits pour le faire repofer ;fer-
vitude de p e x e , c’eft le droit de le faire paître. Trévoux.
(D . J - ) ' ■ ‘ . c
S e r v i t u d e c a c h é e . Voye^ci-après S e r v i t u d e
l a t e n t e . - a
S e r v i t u d e c o n t in u e , eft celle '’ont Image elt
continuel, comme des vues fubfiftantes fur 1 héritage
voifin , à la différence des fervitudes dont on
n’ufe que de tems à autre , comme un droit de
paffage.
S e r v i t u d e d e s h é r i t a g e s d e s c h a m p s . Voy.
S e r v i t u d e s r u s t i q u e s .
S e r v i t u d e d e s h é r i t a g e s d e v i l l e . Voyeç
S e r v i t u d e u r b a in e .
S e r v i t u d e l a t e n t e , eft celle qui n’eft annoncée
par aucune marque extérieure , comme le droit
de paffage que quelqu’un a dans un champ.
S e r v i t u d e m i x t e , eft celle qui tient de la perfonnelle
& de la réelle, comme l’ufufruit qui eft dû
fur un fonds. Voye[ U s u f r u i t .
S e r v i t u d e n a t u r e l l e , eft celle qui eft dans
l’ordre même de la nature , comme l’écoulement
des eaux qui viennent du fond fupérieur fur le fond
^ S e r v i t u d e n é c e s s a i r e , eft celle qui eft dûe
' fans autre titre que celui de la néceffité , comme le
paffage pour aller à un héritage qui eft enclavé de
toutes parts dans de* héritages appartenans à autrui:
la réglé en ce cas eft que l’on donne le paffage par
l’endroit le moins dommageable. Voye^S e r v i t u d e
NATURELLE. • A
S e r v i t u d e o c c u l t e ou c a c h e e , eft la meme
chofe que fervitude latente. Voye^ S e r v i t u d e l a t
e n t e . Y
S e r v i t u d e p a s s i v e ,eft celle qu’une perfonne ou
un héritage doit à une autre perfonne ou héritage ;
la fervitude paflive eft oppofée à la fervitude a&ive.
S e r v i t u d e p a t e n t e . Voye{ S e r v i t u d e a p p
a r e n t e .
S e r v i t u d e p e r s o n n e l l e , e ft 1 é ta t d u n e p e r fo
n n e q u i e ft l’ e f c k v e d ’u n e a u t r e . Voye^ E s c l a v e
& S e r f . ,
S e r v i t u d e p r é d i a l e , ainfi nommee du latinpra-
dium, qui fignifie héritage, eft celle qui efl impofee
fur un héritage en faveur de quelqu’un ou d’i\n autre.
Voye{ S e r v i t u d e r é e l l e , U r b a in e & R u s t i q
u e . ■
S e r v i t u d e r é c i p r o q u e , eft lorfque deux perfonnes
ont chacune un droit pareil à exercer l’une fur
l’autre, foit fur leur perfonne ou fur leur héritage. ^
. Se r v i t u d e r é e l l e , e ft u n fe r v i c e d û p a r u n h é r
ita g e à u n au t re h é r ita g e ..
De ces fortes de fervitudes quelques-unes font naturelles
, comme l’écoulement des eaux du fond fupérieur
fur le fond inférieur ; d’autres néceffaires ,
comme le paffage qui eft dit pour aller à un héritage
qui eft entouré de tous côtés d’heritages appartenans
à autrui ; d’autres font établies par convention;
d’autres enfin par la poffeflion dans les pays, ou les
fervitudes peuvent s’acquérir fans titre.
Il ne peut y avoir de fervitude proprement dite ,
qu’entre deux héritages, appartenans à différens propriétaires;
car il eft de maxime que nemini res fu a
Jrrvit. ; . •
Les,fervitudes réelles font urbaines ou ruftiques, on
en t r o u v e r a l ’ e x p lic a t io n c i-ap rè s .
Suivant le Droit romain, les fervitudes s’acquierent
par la quafi tradition qui fe fait, par l’nfage qu’en fait
le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du
propriétaire du fonds fervant, lorfqu’il y a eu poffef-
fion de bonne foi avec titre pendant dix ans entre
préfens, & vingt ans entre abfens.
On peut aufli acquérir une fervitude par l’ordonnance
du juge, lorfque partageant des biens communs à
plufieürs perfonnes, il ordonne que l’héritage de l’un
fera fujet à certains devoirs envers l’autre.
Il eft encore permis à un teftateur d’établir une
fervitude fur un de fes héritages, au profit d’un autre.
Dans la plûpart des pays coutumiers, il eft de maxime
, que nulle fervitude fans titre ; la coutume de
Paris rejette même la poffeflion de cent ans.
Les fervitudes s’éteignent par plusieurs moyens.
Le premier eft la confufion qui fe fait de la propriété
des deux héritages, lorfqu’ilsfe trouvent réunis
en une même main. t
Le fécond eft le non ufage pendant le tems déterminé
par les lois, qui eft, luivant le Droit romain ,
dix ans entre préfens, & vingt ans entre abfens ; en
pays coutumier il faut trente ans, entre âgés & non
privilégiés; Paris, art. 186.
Le troifieme, eft la renonciation à \a fervitude.
Le quatrième , eft la xéfolution du droit de celui
qui l’avoit conftituée.
Le cinquième, eft la perte de l’héritage qui doit la
fervitude.
Le fixieme, enfin, eft lorfque le cas de ceffation,
prévû par le titre, eft arrivé. Voye^ au digefte, defer-
vitut. & le titre quemadmod. fervitut. amitt.
S e r v i t u d e r u r a l e , voye^ ci-après S e r v i t u d e
r u s t i q u e . f ■ .. <
S E R v i t u d e r u s t i q u e , ou des héritages des
champs, eft celle qui eft dûe à un héritage , autre que
ceux qui font deftinés pour l’habitation du pere de
famille , quand même cet héritage feroit fitué dans
une ville. .
Les principales fervitudes de cette efpece chez les
Romains étaient celles appellées, iter, aclus, via.
La fervitude appellée iter, revenoit à ce que nous
appelions droit de paffage pour les gens de pié ; aclus
droit de paffage pour les bêtes de.fomme , & via le
paffage pour les chariots & autres voitures.
Les autres fervitudes font aquæ dttclus, c’eft-à-dire
de faire paffer de l’eau par. l’héritage d’autrui ; aquee
haufus,le droit d’y puifer de l’eau;pecoris adaquam ap-
pulfus, le droit d’abreuver fes beftiaux dans l’eau du
voifin ; pafeendi pecoris, droit de pafcage ; calcis co-,
quendoe, de faire cuire fa chaux dans le fonds d’autrui;
arence fodiendee, de tirer du fable fur le voifin ; entez
fodienda, d’y tirer de la craie ou marne ; eximendi
lap.-dis , d’en tirer de la pierre. Voyez ff. de fervit.
preed. ruflic.
S e r v i t u d e u r b a i n e , e f t c e lle q u i e ft d û e à un
b â t im en t d e ftin é p o u r l ’ h a b ita t io n d u p e r e de fam ille ,
q u an d m êm e c e b â t im en t fe ro it fitu é a u x ch am ps .
On en diftingue ordinairement huit.
La première, qu’on appelle fervitus oneris ferendi,
oblige celui qui la doit de porteries charges d’un
autre.
La fécondé appellée ligni immitttndi, c’eft le droit
de pofer fes poutres dans le mur voifin.
La troifieme, ligni projiciendi, eft le droit d’avancer
fon bâtiment fur l’héritage voifin, comme font
les faillies & avances, les balcons.
La quatrième, fiillicidii recipiendi vel non recipien-
d i, eft l’obligation de recevoir l’eau du toit du voifin
, ou au contraire l’exemption de la recevoir.
La cinquième ,Jluminis recipiendi vel non, c’eft par
l’eau qui tombe du toit voifin, mais raffemblée dans
unë gouttière.
La fixieme, jus altius non tolltndi, confifte à empêcher
le voifin d’élever fon bâtiment au-delà d’une
certaine hauteur.
La feptieme eft, jus profpeclus ou ne luminibus of-
f eiatur, c’eft le droit d’empêcher le voifin de rien
faire qui puiffe nuire aux vûes de l’héritage dominant.
La huitième appellée, fervitus luminum, eft le droit
d’avoir des jours fur le voifin. Voyeq_ au ff. le tit. de
fervit. preedior. urban.
SE R V IV I , ( Jurifprud.) terme latin qui s’eft con-
fervé long-tems dans l’ufage des chancelleries, pour
exprimer l’atteftation que chaque officier de chancellerie
devoit donner à l’audiencier du tems qu’il avoit
fe rvi, foit au confeil, foit au parlement, a la chancellerie
du palais ou ailleurs. Ces fortes d’atteftations
-furent ainfi appellées, parce qu’étant autrefois rédigées
en latin comme tous les attes de juftice:, elles
commençoient par ce mot fervivi. Voyez 1 efeiendum
de la chancellerie; (^/)
SERUM, f. m. ( Gram.) la partie aqueufe, claire
& tranfparente , du fang, du lait, des humeurs animales.
SERUS , ( Géog. anc. ) fleuve de l’Inde, en* deçà
du Gange. Ptolomée, liv. VU. ch.j. place l’embouchure
de ce fleuve fur le grand golfe, au midi d’Aga-
nàgara. Il ajoute que ce fleuve fe formoit de deux
fources, qui étoient dans le montSemanthinus. Mer-
cator croit que le nom moderne eft Coromaran. (D. /.)
SE R VUS à pedibus meis, ( Littéral.) c’étoit le nom
qu’on donnoit à l’efclave dont on fe fervoit pour les
meffages & pour porteries lettres, du tems de la république
des Romains ; car il n’y avoit point alors
de commodité réglée pour les faire tenir par des pof-
tes : aufli n’avons-nous point de terme qui réponde
exaéiement aux mots latins fervus à pedibus meis : celui
de valet de pié, qui femble les exprimer, n’en
donneroit pas une idée affez jufte. Mongault. (Z). /.)
SERY, voye{ M u s a r a i g n e .
SESAC, ( Mythol. orientale. ) divinité des Babyloniens
, à ce que penfent la plupart des critiques fa-
crés. Ils ont cru trouver dans Jérémie le nom de ce
dieu. Voici les paroles du prophète, ch. xxv. v. jS .
« Ainfi a dit le feigneur : prends de ma main la cou-
» pe du vin de ma fureur, & fais-en boire à toutes
» les nations,. . . & le roi Sefac en boira avec eux ; »
puis il ajoute dans un autre endroit : « comment a
» été prife Sefac ? Comment Babylone eft-elle deve-
» nue l’étonnement de toutes les nations? »
Les interprètes qui conviennent que dans ces deux
paflages , Sefac défigne également le roi & la ville de
Babylone , font perl'uades que ce Sefac étoitune des
divinités des Babyloniens, & que Jérémie a prétendu
défigner la ville même par le nom de cette divinité
; mais cette opinion eft purement conie&urale.
{ D J . )
SESAME, f. m. ( Botan. ) fuivant Linnoeus, le calice
de ce genre de plante eft monopétale, divifé en
cing fegmens : la fleur eft aufli monopétale, en forme
de cloche, & découpée en cinq parties dont l’une
eft beaucoup plus longue que les autres; les étamines
font quatre filets plus courts que la fleur ; leurs
boffettes font oblongues, droites & pointues ;le germe
du piftil eft ovale & rude ; le ftile eft un filet;
leftigmaeft en forme de lance, divifé en deux; le
fruit eft une capfule oblongue à quatre loges qui contiennent
quantité de femences ovoïdes. Linnoti gen.
plant, p . zc>j,
Tournetbrt met cette plante parmi les digitales,
& l’appellent digitâlis orientales fefamum dicta , /. R.
H. 164. Sa racine eft annuelle ; fon calice part çles
ailes des fleurs , prefque fans pellicules; il eft petit,
&: divifé en cinq fegmens longs & foibles ; fa fleur
eft monopétale ; fon ovaire eft en filique, tétrago-
nal, oblong, divifé en quatre cellules ,pleinesde femences
qu’on peut manger. Elles font modérément
hume&antesémollientes, -parégoriques , vifqueu-
fes , graffes, & par conféquent emplaftiques.
Les Egyptiens fe fervent beaucoup de f famé, tant
en alimèns qu’en remede, parce qu’il croît promptement,
& qu’il précédé les autres fruits après les
inondations du Nil ; il récompenfe bien ceux qui le
cultivent dé leurs travaux par la quantité de filiaues
qu’il donne. Parkinfon prétend que le J'éfame croît de
lui-même aux Indes orientales, mais qu’on le cultive
en Egypte, en Syrie, en Grece, en Crete & en Sicile.
Les Arabes ufent fréquemment dans leurs mets
de l’huile exprimée de la graine de féfame. Il eft vraif-
femblable que notre féfame n’eft point celui des anciens;.
car les vertus que Diofcoride lui attribue, ne
conviennent point au nôtre. ( D. J. )
SÉSAMOIDE, f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) féfamoides,
genre de plante dont la fleur reffemble à celle du
réfeda. Voye^ R é s é d a . Le fruit a différente forijaie ,
félon les diverfes efpeces ; tantôt il eft compofé de
plufieurs petites cornes qui font remplies chacune par
une femence qui a la figure d’un rein ; dans d’autres
efpeces il reffemble par fa forme à une étoile , & il
eft divifé en plufieurs capfules. Tournefort, infl. ni
herb. Voye{ PLANTE.
SÉSAMOÏDE, adj. en Anatomie, nom de quelques,
petits os qui reffemblent à la femence d’une plante
de ce nom.
. Les vrais os féfamoides font au nombre de deux,
& on les obferVe dans le pouce tant de la main que
du pié. C’eft à ces os que les fléchiffeurs du pouce
furie métacarpe font attachés, & outre cela l'abducteur
du pouce dans le pié. On remarque encore dif-j
férens autres os féfamoides dans les autres articulations
des doigts, mais ils ne fe trouvent pas constamment.