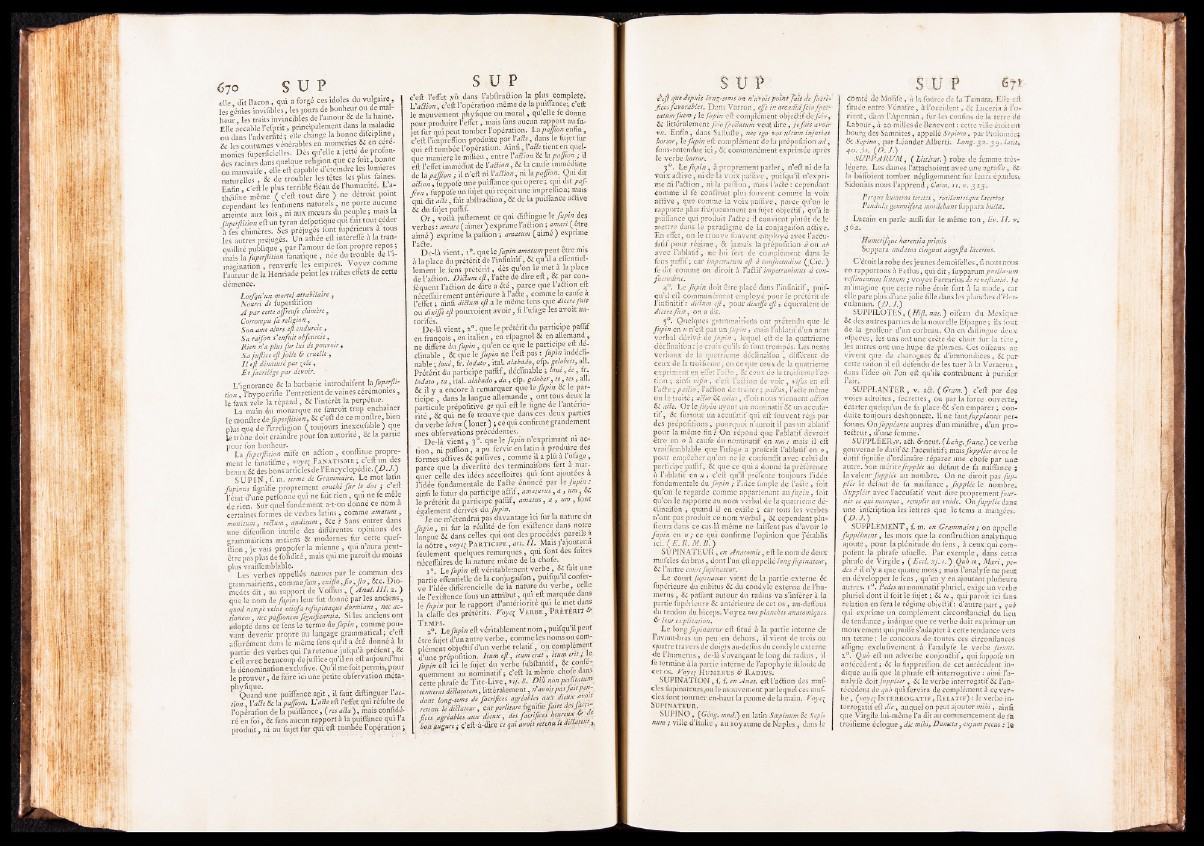
6 7 ° S U P
«lie dit Bacon I qui a forgé ces idoles du vulgaire,
les génies invifibles, les jours de bonheur ou de malheur
, les traits invincibles de l’amour & de la haine.
Elle accable l’efprit, principalement dans la maladie
ou dans i’adverfité ; elle change la bonne difciplme,
& les coutumes vénérables en momeries & en ceremonies
fuperficielles. Dès qu’elle a jette de profondes
racines dans quelque religion que ce foit, bonne
ou mauvaife , elle elt capable d’éteindre les lumières
naturelles ï 8c de troubler les têtes les plus laines.
Enfin c’ell le plus terrible fléau de l’humanité. L a-
théifme même ( c’eft tout dire ) ne détruit point
cependant les fentimens naturels, ne porte aucune
atteinte aux lois, ni aux moeurs du peuple ; mais la
W m B M eft un tyran defpotique qui fait tout ceder
à fes chimères. Ses préjugés font fupéneurs à tous
les autres préjugés. Un athée eft mtérené a la tranquillité
publique , par l’amour de fon propre repos ;
mais la fuvcrflüwn fanatique , nee du trouble de 11-
magination , renverfe les empires. Voyez comme
l’auteur de la Henriade peint les trilles effets de cette
Lorfquyun mortel atrabilaire ,
Nourri de fuperftition
A par cette ajfreufe chimère,
Corrompu fa religion,
Son ame alors eft endurcie ,
Sa rai fon s'enfuit obfcarde ,
Rien n'a plus fur lui de pouvoir ,
Sa juftice ejl folle & cruelle ,
I l ejl dénaturé par ^ele ,
E t facrilége par devoir. °
L ’ignorance Si la barbarie introduifent la fuperfti-
ùon l’hypocrifie l’entretient de vaines cérémonies,
le faux zele la répand, Si l’intérêt la perpetue. I
La main du monarque ne fauroit trop enchaîner
le monftre de fuperflition, Si c’eft de ce monftre, bien
plus que de l’irréligion (toujours inexcufable) que
le trône doit craindre pour fon autorité, & la partie
pour fon bonheur.
La fuperftition mife en aéhon , conftitue proprement
le fanatifme, voycç Fanatisme; c’eft un des
beaux Si des bons articles de l’Encyclopedie. {D. J.)
SU P IN f. m. term e d e G r am m a ir e . Le mot latin
fupinus fignîfie proprement couché fu r b dits ; c’ eft
l’ état d’une personne qui ne fait rien, qui ne fe mele
de rien. Sur quel fondement a-t-on donné ce nom à
certaines formes de verbes latins , comme am a tum ,
monhum, T e c tum , a u d ï t i cm , 8cc ? Sans entrer dans
Une difeuflion inutile des différentes opinions des;
grammairiens anciens & modernes fur cette quef-
ftion je vais propofer la mienne , qui n’aura peut-
être pas plus de folidité, mais qui me paroît du moins
plus vraiffemblable.
Les verbes appellés neutres par le commun des
grammairiens, commefum, exifto ,jio ,fto , & c . Dio-
medes d it , au rapport de Voflius , ( Anal. III. 2. )
que le nom de fupins leur fut donne par les anciens,
quod nempè velut oùofa refupinaque dormiant , nec ac-
tioriem, nec pàftionem Jignificantia. Si les anciens ont
adopté dans ce fens le terme de fupin, comme pouvant
devenir propre au langage grammatical ; c eft
aflurément dans le même fens qu’il a été donné à la
partie des verbes qui l’a retenue jufqu’à prefentI Si
c’eft avec beaucoup de juftice qu’il en eft aujourd’hui
la dénomination exclufive. Qu’il me foit permis, pour
le prouver, de faire ici une petite obfervation méta-?
phyfique. ’
Quand une puiflance agit, il faut diftinguer'l acr,
tion, Y acte S i la pajjion. Vacle eft l’effet qui réfulte de
l’opération de la puiflance, ( res acla ) , mais coiifidé-
ré en fo i, Si fans aiicün rapport à la puiflance qui l’a
produit, ni au fujet fur qui eft tombée l’opération ;
S U P c’ çft l’effet .vù .dans l’abftra&ion la plus, completel
L’action, c’ eft l ’opération même de la puiflance; c’eft
le 'mouvement phyfique ou moral, quelle fe Sonne
pour produire l’effet, mais fans aucun rapport au fujet
fur qui peut tomber l’opération. La pajjion enfin,
c’ eft l’imprefiion produite par Lacté ; dans le fujet fur
qui eft tombée l’opération. Ainfi, 1 acte tient en quelque
maniéré le milieu',' entre action 8c la paflion ; il
eft l’effet immédiat de Vaction , 8c la caufe immédiate
de la pajjion ; il n’eft ni l’action, ni lapaflion. Qui dit
action, ïuppofé une puiflance qui opéré ; qui dit paf.
lion, fuppofe un fuj et qui reçoit une impreffioo; mais
qui dit a ie , fait abftraaion, 8c de la puiflance ithve
& du fujet paffffï l . ' I ■ , - . .,
Or , voilà juftement ce qui diltingue le jupmaes
verbes : amare (aimer) exprime l’aftiôn ; amari ( être
aimé) exprime la paflion ; amatum (aime) exprime
l’afte. A
De-là vient, i° . que le fupin amatum peut etre mis
à la place du prétérit de l’infinitif, Si qu’il a efîentiel-
lement le fens prétérit, dès qu’on le met à la place
de l ’aftion. Diclum eft, l’aûe de dire eft, Si par con-
féquent l’aftion de dire a été , parce que l’aéhon eft
néceflairement antérieure à i’a fte, comme la caufe à
l’effet ; ainfi diclum eft a le même fens que duérefuu
ou dixiffe eft pourroient avo ir, fi l’ufagé les avoit au-
torifés., .
De-là vient, î ° . que le prétérit du participe pallit
en françois , en italien, en efpagnol 8t en allemand ,
ne différé du fupin, qu’en ce que le participe eft déclinable
, Si que le fupin ne l’eft pas : fupin indéclinable
; loué, fr. lodatp, ital. alabado, efp. gelobett, ail.
Prétérit du participe paflif, déclinable ; loué, ée, fr.
lodato, ta, ital. alabado, da, efp. gelober, te , tes, ail.
& il y a encore à remarquer >que 1 efupin Si le participe
, dans la langue allemande , ont tous deux la
particule prépofitive ge qui eft le ligne de l ’antériorité
, Si qui ne fe trouve que dans ces deux parties
du verbe loben ( louer ) ; ce qui confirme grandement
mes obfervations précédentes.
De-là vient, 30. que le fupin n’exprimant m ac-
f tion ni paflion, a pu fervir en latin à produire des
formes a&ives & paflives, comme il a plû à l’ufage ,
parce que la diverfité des terminaifons fert à marquer
celle, des idées.acceffoires qui font ajoutées à
l ’idée fondamentale de l’aûe énoncé par le fupin:
‘ ainfi le fiitur du participe aftif, amaturus, a , um, &
le prétérit du participe paflif, amatus, a , um, font
• également dérivés du fupin. . .
" Je ne m’étendrai pas davantage ici fur la nature du
■ fupin, ni fur la réalité de fon.exiftence dans notre
’ langue & dans celles qui ont des procédés pareils à
• la nôtre, voyei Pa r t ic ip e , art. I I . Mais j’ajoutera*
feulement quelques remarques, qui font des fuites
néceffaires de la nature même de la chofe. '
i° . Le fupin eft véritablement v erb e, & fait une
partie effentielle de la conjugaifon, puifqu’il confer-
ve l’idée différencielle de la nature du verbe, celle
■ de l’exiftence fous un attribut, qui eft marquée dans
lé Cupin par le rapport d’antériorité qui le met dans
i la claffe des prétérits. Voye{ V e r b e , Pr é t é r it^
: T e m E s . ,, . . . . . ’ c -
20. "Le fupin eft véritablement nom, puilqu il peut
être fujet d’un autre verbe, comme les npms ou çomplément
;obj e ô if d’jm..verbe relatif ? ; OU çpmplénymt
d’une pf épofition. Imm ‘f i , iium 'erat ,_ Uuip ent ; le.
; fupin eft ici le fujet du verbe; fubftàritif,
qüemment au nominatif j'c ’eft lamettiè chofodans
! cêttèphrafe:deTité-Live, v ifi8. p iimnpera tam^
' ténuérai diÈiatorem, littéralement , n’ayoïppasfa“ Pfp-
' dont long-tems de facrificcs agréables au* dtç/tx
l retend UdïéCauur ficbx perliiarefiÿàfio faire desJant-
! 0 s ' agréablesaux dieux, des factificei heureux.O
tari augure ; ç’eft-à-dire « 2“ « ’«f» rele/ut le dict^eur ^
S U P
èeft qtie déplus long-temS 'on h'xévoit poih't fait de fatri~
fccs favorables. Dans Varron, ejfe in arcadiâfcïo fpec-
tatùmfu'em ; le fupin eft complément obje&if dejcio,-
& littéralement fciofpeclatum veut d ire, je fais avoir
vu. Enfin , dans Sallufte, nec ego vos ultum injurias
liortor, le jupiti eft complément de la prépofition ad -,
fous-entendue ici > $c communément exprimée après
le verbe hor'tor\ -,
3°. Le fupin, à proprement parler ; ri’ eft ni de-la;
Voix aélive, ni de la voix paflive, puifqu’il n’expii-
me ni l’a&ion , ni la paflion, mais l’afté : cependant
tomme il fé conftruit plus fouverit comme la voix
àélive ^ que comme la voix paflive, parce qu’on le
rapporte plus fréquemment au fiijet obje&if ; qu’à là
puiflance qui produit l’a&e ; il convient plutôt dë lé
mettre dans le, paradigme de la conjugaifon aâive.
En effet, ôn le trouve fouvent employé avec l’ac'cu-
fatif pour régime , & jamais la prépofition à ou ab
avec l’ablâtif, ne lui fert de complément dans le
fens paflif ; car impetratum eft à confuetudinè ( Cic. )■
fe dit comme On d'iroit à l’actif impetravimïts à con-
juetudine-.
4°. Le fupin doit être placé dans l’infinitif, puifqu’il
eft communément employé pour le prétérit de
l’infinitif: diclum eft, pour dixiffe eft , équivalent de
dicerefuit, on a dit.
5°. Quelques grammairiens ont prétendu qtte lé
fupin en k n’eft pas un fupin, mais l’ablatif d’un nom
verbal dérivé de fupin -, lequel eft de la quatrième
déclinaifon : je crois qu’ils fe font trompés. Les noms
verbaux de la quatrième déclinaifon , différent de
ceux de la troifieme, en ce que ceux de la quatrième
expriment en effet l’acte, & ceux de la troifieme l’aci
tion ; ainfi vijio , c’eft l’aétion de v o ir , vifas en eft
l ’aéte ; paclio, l’aétion de traiter ; pacius, l’aéte même
ou le traité; actio & aclus, d’ofi nous viennent action
& acte-. Or le fupin 'ayant un nominatif & un accufa-
t i f , & fiirrout urt accufatif qui eft fouvent régi par
des prépofitions, pourquoi n’auroit-il pas un ablatif
pour la même fin } On répond que l’ablatif devroit
être en o à caufe du nominatif en um ■: mais il eft
vraiffemblable que l’ufage a proferit l’ablatif en o ,
pour empêcher qu’on ne le confondît avec celui du
participe paflif, & que ce qui a donné la préférence
à l’ablatif en a , c’eft qu’il préfente toujours l’idée
fondamentale du fupin ; l’idée fimple de l’aéte , foit
qu’on le regarde comme appartenant auJ ’upin, foit
qu’on le rapporte au nom verbal de la quatrième déclinaifon
, quand il en exifte ; car tous les verbes
n’ont pas produit ce nom verbal, & cependant plu-
lieurs dans ce cas-là même ne laiffent pas d’avoir le
fupin en u ; ce qui confirme l’opinion que j’établis
ici. ( ET.R.M.B. )
SUPINATEUR, en Anatomie, eft le nom de deux
mufcles du bras, dont l’un eft appelle longfupinateur,
& l’autre court fupinateur.
Le court fupinateur vient de la partie externe &
fupérieure du cubitus & du condyle externe de l’hu-
merus , & paflant autour du radius va s’inférer à la
partie fupérieure Si. antérieure de cet o s , au-deflous
du tendon du biceps. V oyez nos planches anatomiques
G leur explication.
Le long fupinateur eft fitué à la partie interne de
l’avant-bras un peu en dehors, il vient de trois pu
quatre travers de doigts au-deflus du condyle externe
<le l’humerus, de-là s’avançant le long du radius , il
Je termine à la partie interne de l’apophyfe ftiloïde de
cet os. Voye{ Humérus & Radius.
SUPINATION, f. f. en Anat. eft l ’aftion des muf-
clés fupinateurSjOu le mouvement par lequel ces mufcles
font tourner en-haut la paume de la main. Voye^
Su pin ateur.
SUPINO, (Géog. mod.) en latin Soepinum Si Scpi-
num ; ville d’Italie, au royaume de Naples, dans le
S f. ü P ê n
comté de Molife, à là foûrce de la Tamara. Elle eft
limée-entre Vénafre, à l’occident, ôf Luceria à l’o-:
rient, d’ans l’Apennin, fur les confins de la terre dé
Labour, à 20 milles de Benevent : cette ville étoit urt
bourg des Samnites, appellé Sepium, par Ptolomée;
Si Scpino, par Léander Alberti; Long. 32. 3 9. latit,
40. Sr. (D .J .)
St/PPARUM -, ( Littérati ) robe de femme très-
legere. • Les dames l’attachoient avec une agraffe, Scia
laiflbient tomber négligemment fur leürs épaules*
Sidoniiis nous l’apprend, Carrn. 11. v. 323.
Perqüe humeros tercies ; rutilantesqùe Îacértos
Penduhi gemmiferà moidebant fuppara bulles.
Lucain en parle auflî fur le même ton , liv: I I . vi 362. v
Humerifque hcereniia primis
Suppara riudatos clngunt augufta lacèrtôs-.
C ’étoit la robe des jeunes demoifelles, fi nous nous
én rapportons à Feftus, qui dit , fupparum puellarum
' veftimenturn lineum ; voyez Ferrarius de re veftiarid. Je
m’ima'gine que cette robe étoit fort à là mode, car
elle pare plus d’une jolie fille dans les planches d’Her-,
eulanum. (£>.ƒ.)
• SUPPILOTES, (Hift. nàt. ) oifeâu du Mexique
Si des autres parties de la nouvelle Efpagne ; ils font
de la groffeur d’un corbeau. On en diltingue deux
efpeces, les uns ont une crête de chair fur la tê te ,
les autres ont une hupe de .plumes. Ces oifeaux ne
vivent que de charognes & d’immondices, & par-
cette railon il eft défendu de les tuer à la Veracruz ,
dans l’idée oii l’on eft qu’ils contribuent à purifier
l’air.
SUPPLANTER, v. aét. (Gram. ) c’eft par des
voies adroites, fecrettes, ou par la force ouverte,
écarter quelqu’un de fa placé & s’en emparer ; conduite
toujours deshonnêîte. Il ne fautfupplanter per-
fonne; On fupplante auprès d’un miniftre, d’un protecteur
, d’iine femme*
SUPPLÉER,v. a£h, 6* neuf. (Lahg. françi) ce verbe
gouverne le datif & l’accufatif; mais fuppléer avec le
datif lignifie d’ordinaire réparer une chofe par une
autre. Son méritefupplée ati défaut de fa naiflance ;
la valeur fupplée au nombre. On ne diroit pas fupplée
le défaut de fa naiflance , fupplée le nombrei
Suppléer avec l’accufatif veut dire proprement foun
nir ce qui manque, remplir un vuide. On fupplée dans
une infeription les lettres que le fems a mangées*
■ H .
SUPPLÉMENT, f. m. en Grammaire ; on appelle
fupplément, les mots que la conftruétion analytique
ajoute, pour la plénitude du fens, à ceux qui com-
polent la phrafe ufuelle. Par exemple, dans cette
phrafe de Virgile, ( Eccl. x j:! •.*) Qub te, Moeri, pe-
des ? il n’y a que quatre mots ; mais l’analyfe ne peut
en développer le lens , qu’en y en ajoutant plufieurs
autres. i° . Pedes au nominatif pluriel, exige un verbe
pluriel dont il foit le fujet ; Si te , qui paroît ici fans
relation en fera le régime obje&if : d’autre part, qub
qui exprime un complément circonftanciel du lieu
de tendance , indique que ce verbe doit exprimer un
mouvement qui puiffe s’adapter à cette tendance vers
un terme : le concours de toutes ces circonftances
aflîgne exclufivement à l’analyfe le verbe ferunu
20. Qub eft un adverbe conjonétif, qui fuppofe un
antécédent; Si la fuppreffioa.de cet antécédent indique
auffi que la phrafe eft interrogative : ainfi l’analyfe
doit fuppléer, Sc le Verbe interrogatif & l’antécédent
de qub qui fervira de complément à ce verbe
, (yoye{ Interrogatif , Relatif) : le verbe interrogatif
eft die, auquel on peut ajouter miki, ainfi
que Virgile lui-même l’a dit au commencement de fa
troifieme éclogue, die mihi3 Dameta, cujum pecus ; le