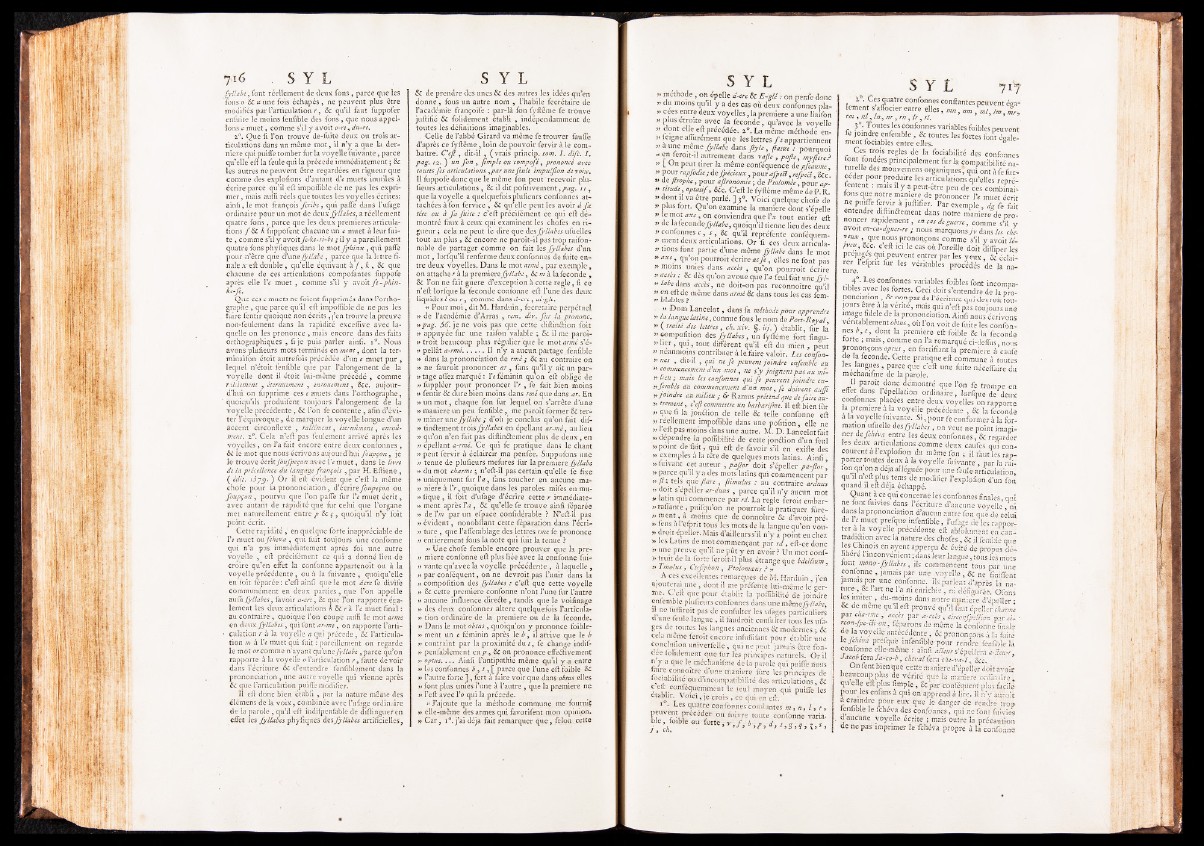
fyllabe, font réellement de deux fons , parce que les
fons o &: u une fois échapés , ne peuvent plus être
modifiés par l’articulation r , 6c qu’il faut fuppofer
enfuite le moins fenfible des fons , que nous appelions
e muet, comme s’il y a voit o-rc, du-re.
2°. Que fi l’on trouve de-fuite deux ou trois articulations
dans un même mot, il n’y a que la dernière
qui puifle tomber fur la voyelle fuivante, parce
qu’elle eft la feule qui la précédé immédiatement ; 6c
les autres ne peuvent être regardées en rigueur que
comme des explofions d’autant cYe muets inutiles à
écrire parce qu’il eft impoflible de ne pas les exprimer
, mais aulîi réels que toutes lés voyelles écrites:
ainfi, le mot françois fcribt, qui pafle dans l’ufage
ordinaire pour un mot de deux fyllabes, a réellement
quatre fons , parce que les deux premières articulations
f 6c k fuppofent chacune un e muet à leur fuite
, comme s’il y avoit fe-ke-ri-be; il y a pareillement
quatre fons phyfiques dans le mot fphinx , qui pafle
pour n’être que d’une fyllabe , parce que la lettre finale
.r eft double, qu’elle équivaut à ƒ , k , 6c que
chacune de ces articulations compofantes fuppofe
après elle Ve muet , comme s’il y avoit fe-phin-
Que ces e muets ne foient fupprimés dans l’orthographe
, que parce qu’il eft impoflible de ne pas les
faire fentir quoique non écrits , )’en trouve la preuve
non^feulement dans la rapidité exceflive avec laquelle
on les prononce , mais encore dans des faits
orthographiques , fi je puis parler ainfi. i° . Nous
avons plufieurs mots terminés en ment, dont la ter-
minaifon étoit autrefois précédée d’un e muet pur ,
lequel n’étoit fenfible que par l’alongement de la
voyelle dont il étoit lui-même précédé , comme
ralliement , éternuement , enrouement, & c . aujourd’hui
on fupprime ces e muets dans l’orthographe,
quoiqu’ils produifent toujours l’alongement de la
voyelle précédente, 6c l’on fe contente , afin d’éviter
l’équivoque, de marquer la voyelle longue d’un
accent circonflexe , rallîment, éterniiment, enrou-
'ment. i° . Cela n’eft pas feulement arrivé après les
voyelles , on l’a fait encore entre deux confonnes ,
& le mot que nous écrivons aujourd'hui foupçon, je
le trouve écritfoufpeçon avec 1’« m uet, dans le livre
de la précellence du langage françois , par H. Eftiene ,
( édit. i jy ÿ . ) Or il eft évident que c’eft la même
chofe pour la prononciation, d’ecrire foupeçon ou
foupçon, pourvu que l’on paffè fur Ve muet écrit,
avec autanr de rapidité que fur celui que l’organe
met naturellement entre p 6c ç , quoiqu'il n’y foit
point écrit.
Cette rapidité J en quelque forte inappréciable de
Ve muet ou fcheva , qui fuit toujours une confonne
qui n’a pas immédiatement après foi une autre
voyelle , eft précifément ce qui a donné lieu de
croire qu’en effet la confonne appartenoit ou à la
voyelle précédente , ou à la fuivante , quoiqu’elle
èn foit féparée : c’eft ainfi que le mot âcre fe divife
communément en deux parties, que l?on appelle
aufii fyllabes, favoir a-crt, 6c que l’on rapporte également
les deux articulations k & r à Ve muet final :
au contraire , quoique l’on coupe auffi le mot arme
en deux fyllabes, qui font ar-mï, on rapporte Parti-
• culation r à la voyelle a qui précédé, 6c l’articulation
m à Ve muet qui fuit : pareillement on regarde
le mot or comme n’ayant qu’üne fyllabe , parce qu’on
rapporte à la voyelle o l’articulation r , faute devoir
dans l’écriture 6c d’entendre fenfiblement dans la
prononciation , une autre voyèlle qui vienne après
6c que l’articulation pui(Te modifier.
Il eft donc bien établi , par la nature mêpie des
élémens de la v o ix , combinée avec l’ufage ordinaire
de la parole , qu’il eft indifpenfable de diftinguer'en
effet les fyllabes phyfiques des fyllabes artificielles,
6c de prendre des unes 6c des autres les idées qu’en
donne , fous un autre nom , l’habile fecrétaire de
l’académie françoife : par-là fon fyftême fe trouve
juftifié 6c folidement établi , indépendamment de
toutes les définitions imaginables.
. Celle de l’abbé Girard va même fe trouver faillie
d’après ce fyftême, loin de pouvoir fervir à le combattre.
C'ejl, dit-il , (vrais princip. tom. 1. dife. I .
pag. 12. ) un fon , fimple ou compofé, prononcé avec
toutes fes articulations,par une feule impuljion de voix.
Il fuppofe donc que le même fon peut ' recevoir plufieurs
articulations , 6c il dit pofitivement, pag. /1 ,
que la voyelle a quelquefois plufieurs confonnes attachées
à fon fervice , 6c qu’elle peut les avoir à fa
tête ou à fa fuite : c’eft précifément ce qui eft démontré
faux à ceux qui examinent les chofes en rigueur
; cela ne peut fe dire que des fyllabes ufuelles
tout au plus, 6c encore ne paroît-il pas trop raifon-
nable de partager comme on fait les fyllabes d’un
mot, lorfqu’il renferme deux confonnes de fuite entre
deux voyelles. Dans le mot armé, par exemple,
on attache r à la première fyllabe, 6c m à la fécondé ,
6c l’on ne fait guere d’exception à cette réglé, fi ce
n’eft lorfque la fécondé confonne eft l’une des deux
liquides l ou r , comme dans â-cre, ai gle.
« Pour moi, dit M. Harduin, fecretaire perpétuel
» de l’académie d’Arras , rem. div. fur la prononc.
» pag. 56. je ne vois pas que cette diftin&ion foit
» appuyée fur une raifon valable ; & il me paroî-
» troît beaucoup plus régulier que le mot armé s’é-
» peliât a-rmé..........Il n’y a aucun partage fenfible
» dans la prononciation de rmè ; 6c au contraire on
» ne fauroit prononcer ar , fans qu’il y ait un par-
» tage allez marqué : Ve féminin qu’on eft obligé de
» fuppléer pour prononcer l’r , fe fait bien moins
» fentir 6c dure bien moins dans rmè que dans ar. En
>» un mot, chaque fon fur lequel on s’arrête d’une
» maniéré un peu fenfible , me paroît former 6c ter-
» miner une fyllabe ; d’où je conclus qu’on fait dif-
» tinélement trois fyllabes en épellant ar-mé, au lieu
>> qu’on n’en fait pas diftinâement plus de deux, en
» epellant a-rmé. Ce qui fe pratique dans le chant
» peut fervir à éclaircir ma penfée. Suppofons une
» tenue de plufieurs mefures fur la première fyllabe
» du mot charme ; n’eft-il pas certain qu’elle fe fixe
» uniquement fur Va, fans toucher en aucune ma-
» niere à l’r , quoique dans les paroles mifes en mu-
» lique , il foit d’ufage d’écrire cette r immédiate-
» ment après Va , 6c qu’elle fe trouve ainfi féparée
» de Vm par un efpace confidérable ? N’eft-il pas
» évident, nonobftant cette féparation dans l’écri-
» ture , que l’aflfemblage des lettres r/«e fe prononce
» entièrement fous la note qui fuit la tenue ?
» Une chofe femble encore prouver que la pre-
» miere confonne eft plus liée avec la confonne fui-
» vante qu’avec la voyelle précédente , à laquelle,
» par confisquent, on ne devroit pas l’unir dans la
» compofition des fyllabes : c’eft que cette voyelle
» 6c cette première confonne n’ont Tune fur l’autre
» aucune influence direéle , tandis que le voifinage
» des deux confonnes altéré quelquefois l’articula-
» tion ordinaire de la première ou de la fécondé.
» Dans le mot obtus, quoiqu’on y prononce foible-
» ment un e féminin après le b , il arrive que le b
» contraint par la proximité du /, fe change indif-
» penfablement en p , 6c on prononce effe&ivement
» optus.. . . Ainfi l’antipathie même qu’il y a entre
» les confonnes b , t , [ parce que l’une eft foible 6c
» l’autre forte ] , fert à faire voir que dans obtus elles
» font plus unies l’une à l’autre , que la première ne
» l’eft avec Vo qui la précédé.
» J’ajoute que la méthode commune me fournil
» elle-même des armes qui favorifent mon opinipn.
» C a r , i°. j’ai déjà fait remarquer que, félon .cette
S Y L » méthode, oh épelle â-cre 6c E -glè : on penle donc
» du moins qu’il y a des cas où deux confonnes pla-
» cees entre deux voyelles, la première a une liaifon
>> plus étroite avec la fécondé, qu’avec la voyelle
» dont elle eft précédée. 2°. La même méthode en-
» teigne alfurément que les lettres ƒ / appartiennent
» à une meme fyllabe dans fly le , jiatue : pourquoi
a en leroit-il autrement dans vajle , pojle, myflere ?
» [ On peut tirer la même conféquence de pfeaume,
» pour rapfodie ; de fpècieux, pour afpecl, refpecl, & c .
» de flrophe, pour ajlronomie ; de Ptolomèe, pour ap-
» titude, optatif, & c . C’eft le fyftême même de P. R.
» dont il va etre parlé. ] 30. Voici quelque chofe de
» plus fort. Qu’on examine la maniéré dont s’épelle
» le mot axe , on conviendra que Vx tout entier eft
» de la fécon d fyllabe, quoiqu’il tienne lieu des deux
» confonnes c , s , 6c qu’il repréfente conféquem-
» ment deux articulations. Or fi ces deux articula-
» tions font partie d’une même fyllabe dans le mot
» axe, qu’on pourroit écrire ac fe , elles ne font pas
» moins unies dans accès , qu’on pourroit écrire
» aesès : 6c dès qu’on avoue que Va feulfait une fy l-
» labe dans accès, ne doit-on pas reconnoître qu’il
» en eft de même dans armé 6c dans tous les cas fem-
» blables ?
. » Dom Lancelot, dans fk méthode pour apprendre
» la langue latine, connue fous le nom de P on-Roy al
» ( traité des lettres, ch. xiv. §. üj, ) établit, fur la
» compofition des fyllabes, un fyftême fort fingu-
» lie r , q ui, tout different qu’il eft du mien , peut
» neanmoins contribuer à le faire valoir. Les confon-
» nés , dit-il , qui ne fe peuvent joindre enfenible au
» commencejiient d’un mot, ne s'y joignent pas au mt-
» lieu ; mais les confonnes qui fe peuvent joindre en-
» femble au commencement d'un mot, fe doivent auffi
» joindre au milieu ; & Ramus prétend que de faire au-
» trement, c'efl commettre un barbarifme. Il eft bien fur
» que fi la jonélion de telle 6c telle confonne eft
» réellement impoflible dans une pofition, elle ne
» l’eft pas moins dans une autre. M. D. Lancelot fait
» dépendre la poflibilité de cette jonélion d’un feul
>» point de fait, qui eft de favoir s’il en exifte des
» exemples à la tête de quelques mots latins. A in fi,
« fuivant cet auteur , pafior doit s’épeller pa-ftor,
» parce qu il y a des mots latins qui commencent par
* r m’. tels que f are 9 flimulus : au contraire arduus
» doit s’épeller ar-duus , parce qu’il n’y aucun mot
» latin qui commence par rd. La réglé feroit embar-
« raflànre, puifqu’on ne pourroit la pratiquer fïire-
ment 9k moins que de Cônnoître 6c d’avoir pré-
>> fens a l efprit tous les mots de la langue qu’on vou-
» droit epeller;Mais d’ailleurs s’il n’y a point eu chez
» les Latins de mot commençant par rd, eft-ce donc
» une preuve qu’il ne put y èn avoir? Un mot confi-
» truit de la forte feroit-il plus étrange que bdellium,
» Tmolus y Ctefphon , Ptolomeeus ? »
A ces excellentes remarques de M. Harduin , j’en
ajouterai une, dont il me préfente lui-même lé germe.
C’éft que pour établir la poflibilité de joindre
énfemble plufieurs confonnes dans une mêmefyllabe,
n ne fùffiroit pas de confulter les ufages particuliers
d une feule langue , il faudrôit confulter tous les ufà*
ges déboutés le$ langues anciennes &modemès ; 6c
cela même feroit encore infuffifant pour établir une
conclufion univerfelle, qui ne peut jamais être fondée
folidement. que fur les principes naturels. Or il
n y a que le méchanifme de la parole qui puifle nous
aire cqnnoitre d’une maniéré fùre les principes dé
iociabilite-ou-d’incompatibilité des articulations, &
C, e“ c°nféquemment le féul moyen qui puifle les
établir. Voici , je çi-ois, ce qui eh eft.
1 . Les quatre confonnes confiantes tn j n } l , r>
peuvent précéder ou fuivre toute confonne variaf
j 'j f * •*'***
S Y L 717
I E l c o n f o n n e s ccnftantes peuvent éea-
lemenf saffocier entre elles, m n ,nm , ml,
rm , tîL 9 ln , n r , rn9 l r , ri.
Y : Toutes les éonfonnes variables foibles peuvent
ie joindre enfcmble, & toutes les fortes font eeale-
ment fociabies entre elles. 5 IH W BD fociabilité des confonnes
font fondées principalement fur la compatibilité naturelle
des mouvemens organiques, qui ont à fe fuc.
ceder pour produire les articulations qu’elles, repré-
tetatent ; mars il y a peUPêtre peu de cfes&nbinai>-
tons que notre minière de prononcer 1% muet écrit
ne puifle fervir a juftjfer. Par exemple ds fe fait
entendre diftincteraent dans notre maniéré de prononcer
rapidement, tn cas comme s’il y
Avait ete^dguer-re ; hûus marquons j v dans les .c l^
veux , qué-tfqûs prononçons pomme s’il y avoit //-
m u . Sec. c’eft ici le cas oftftpreille && diffiper les
prejuges qui peuvent entrer par les yeux -, 6c éclair
rer 1 efprit fur les véritables procédés de la nature.
... ^ ’ ^es cpnfonnes variables Foibles font incompa-
tibies avec les fortes. Ceci doit s’entendre de la pro.
nonciation , & non pas de l’écriture qui dVroit tou-
jours être à la vente, mais qui n’eft pas toujours unê
image fidele de la prononciation. Ainfi nous dérivons
véritablement otoiÿiii B» voit de fuite les doiifoh-
nes i , 1 , dont la première eft foible & la féconda,
torte ; mais, comme on l’a remarqué ci-deffiÈSfe
prpnonçons G p i u s , en fortifiant la première à Caufe
de la fécondé. Cette pratiqué eft commune à toutes
les langues , parce qù;é c’êft une fuire iiééeffaire du
mechamfme de la parole. H D H H Von fe trompe en
efet dans lépellaîfon ordinaire, iôffque de deux
confonnes p aCeés entre deux Voyelles ton rapporte
la première à la voyelle précédente , & la fécondé
à la Vflyelle fuivante. Si, pour fe conformer à la for.
mation ufttdle des#&&V,'on veut ne point imaginer
de fcheva entre des deux, confonnes, & regarder
fos deux^ art.cuîatioiii Conime deux caufeii qui concourent
à 1 explofi’on du Hiênrefiori ; il f e t lès rapporter
toutes deux à la voy elle fuivanté par 1a -ai-
fon qqfon a déjà alléguée jour une feule articulation,
qu il n eft plus tems de modifier l’explbïion d’un fon
quand il eft déjà échappé.
Quant à tfe qui concerne l|i:confonhes finales qui
D B IB iBD B d’aucune voÿelle ni
dans la prQnonciatioh d’aucun autre fon que de celui
de le muet prefque ihfenflble, l’ufage dèles rapoor-
ter a la voyelle précédente eft abfolumeht en con-
tradiction avec la nature des chofes , 6c il femble que
! ? ,e H” 0is en ‘?yent aPPefçü & évité de propos dé-
*ibere l inconvénient ;dans leur-langue, tous les mots
font mono -fyllabes , ils commencent tous par une
confonne , jamais pàr une voyelle , 6c ne finiflent
jamais par une confonne. Iis parient d’après là nature,
& l’art ne l’a ni enrichie , ni déiWiréê.'Ofohs
les imiter , du-moins dans notre maniéré d’épQÏIer *
& de même qu'il eft prouvé qu’il faut épellcr* 'chirmi
par eku-rme , accès {iar a-çih i circonffcBiou par ci- -
rcon-Jpc-cli-ou, léparons de même la confonne finals
de la voyelle antécédente, & prononçons à la fuite
le y c ta « prefquê inlënfible pour rendre fenfible la
conlonhe elle-même : ainfi âffeitr s’épellera à-âeû-r
Jàcob fera ja-co-b , chevâifetaèhe-và-ï ècc. ' I
beaucoup plus de vérité que la maniefë ordinaire ,
qu elle eft plus fimple, & par conféquenr pins facile
boni-les enfons à qui ob apprentl à lire. Il ii'y hu'roit
a craindre pour etix quc ïc danger de rentré troo
fenfible le Ichéva des confonnes, qui ne font fuivie*s
d’aucune yoyefle écrite i-taaii6utre la précaution
ue nepayimprimeHe ichéva pWprê î l a ctonlbnne