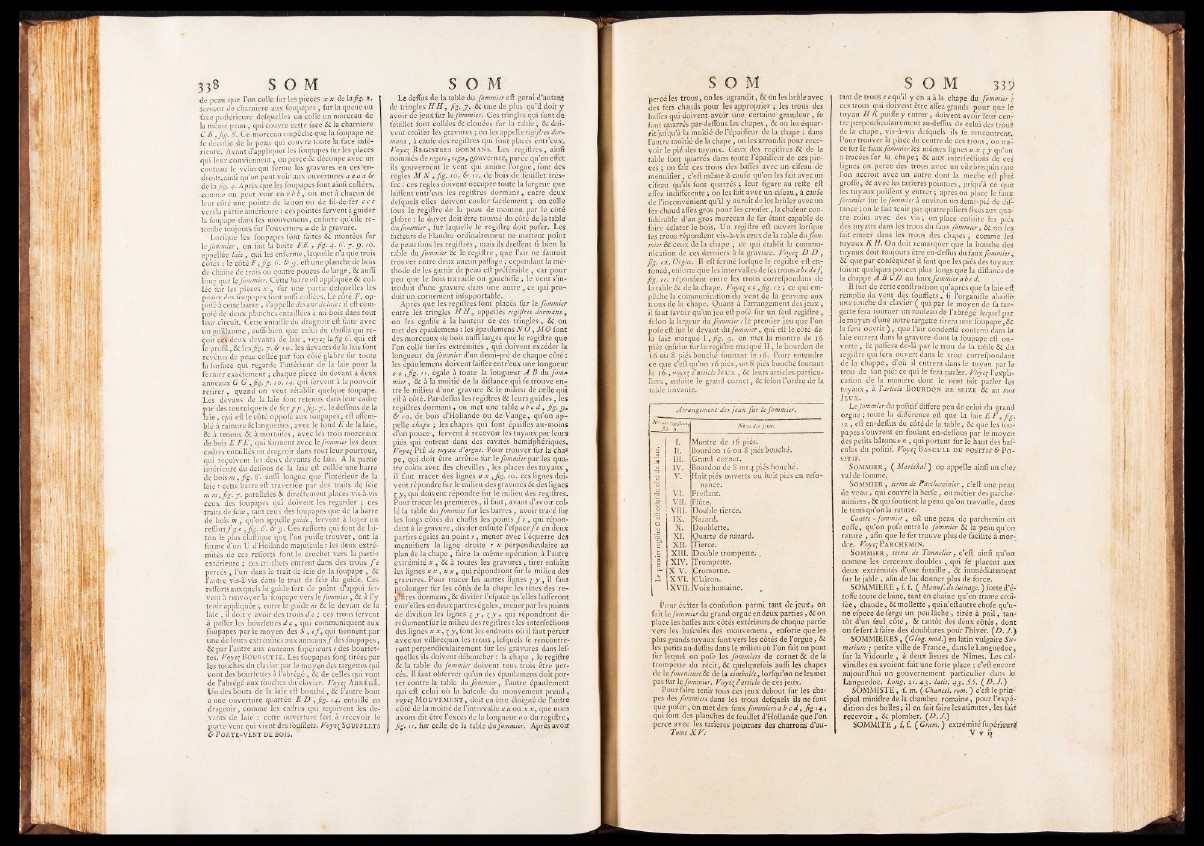
-de peau que l’on colle fur les pièces x x de lajÇg. *.
fervent de charnière aux ioupapes', fur la queue ou
face poftérieure defquelles on colle un morceau de
la meme peau, qui couvre cette face & la charnière
C B yfig. 8. Ce morceau empêche que la foupape ne
fe décolle de la peau qui couvre toute la face inférieure.
Avant d’appliquer les foupapes fur les places -
. qui leur conviennent, on perce découpe avec un
-couteau le vélin qui ferme les gravures en ces*en-
droits, ainfi qu’on peut voir’aux ouvertures aa a a&
de la fig. 4. Après queles foupapes font ainfi collées, ,
comme on peut voir en b b b, on met à chacun de
leur côté une pointe de laiton ou de fil-de-fer c c c
vers la partie antérieure : cès pointes fervent à guider
la foupape dans fes. mouvemens, enforte qu’elle retombe
toujours fur l’ouverture a de la gravure.
Lorfque les foupapes font faites & montées fur
le fommier, on fait la boîte F E , fig. 4. G. y. $ .1 o.
appellée laie , qui les enferme, laquelle n’a que trois
côtés : le côté F , fig. (T. & $ . eft une planche de bois
de chaîne dé trois ou quatre pouces de large, & aufli
long que lefommier. Cette barre eft appliquée & collée
fur les pièces x , fur une partie desquelles les
peaux des foupapes font aufli collées. Le côté F , op-
pôfé à cette barre, s’appelle devant de laie : il eft compote
de deux planches entaillées à mi-bois dans tout
leur circuit. Cette entaille du drageoir eft faite avec
im guillaume, aufli-bien que celui du chafîis qui re-
-çoit cés deux devants de laie , voyez la fig G. qui eft
le profil, & les fig. y. & /o. les devants delà laie font
revêtus, de peau collée par fon côté glabre fur toute
la furface qui regarde l’intérieur de la laie pour la
fermer exattement ; chaque piece du devant a deux
anneaux G G y fig. y. -/o. 14•. qui fervent à la pouvoir
retirer , quand on veut rétablir quelque foupape.
Les devans de la laie font retenus dans leur cadre
par des tourniquets de fer pp ,fig. y. le deffous de la
la ie, qui eft le côté oppol'é aux foupapes, eft affem-
blé à rainure & languettes, avec le fond E de la laie,
&: à tenons & à mortaifes, avec les trois morceaux
de bois E F E , qui forment avec 1 tfommier les deux
cadres entaillés en drageoir dans tout leur pourtour,
qui reçoivent les deux devants de laie. A la partie
intérieure du deffous de la laie eft collée une barre
de bois /», fig. G. aufli longue que l’intérieur de la
laie : cette barre eft traverfée par des traits de fçie
m m,fig. y. parallèles & direttement placés vis-à-vis
ceux 'des foupapes qui doivent les regarder ; ces
traits de fc ie, tant ceux des foupapes que de la barre
de bois m , qu’on appelle guide, fervent ,à loger un
reffort ƒ g e ,fig. 6. & 9 . Ces reflorts qui font de laiton
le plus élaftique quç l’on puiffe trouver, ont la
forme d’un TJ d’Hollande majufcule : les deux extrémités
de ces reflorts fpnt le crochet vers la partie
extérieure ; ces crochets entrent dans des trous f e
percés , l’un dans le trait de fcie de la foupape , &
l’autre vis-à-vis dans le trait de fcie du guide. Ces
reflorts auxquels le guide fert de point d’appui fervent
à renvoyer la foupape vers le fommier, & à l’y
tenir appliquée ; entre le gu-ide m & le devant de la
laie , il doit y avoir des trous de ; ces trous fervent
-à paffer les boûrfettes d e , qui communiquent aux
foupapes par le moyen des S , e ƒ , qui tiennent par
une de leurs extrémités aux anneaux ƒ des foupapes,
& par l’autre aux anneaux fupérieurs e des bourfet-
tes. Voyez Boursette. Les foupapes font tirées par
les touches du clavier par le moyen des targettes qui
vont des bourfettes à l’abrégé, & de celles qui vont
de l’abrégé aux touches du clavier. Voyey A brégé.
Un des bouts de la laie eft bouché, & l’autre bout
aune ouverture quarrée E D y fig. 14. entaillé en
drageoir, comme les cadres qui reçoivent les devants
de laie : cette ouverture fert à recevoir le
. porte-vent qui vient des fopfîlets. Vyyez Soufflets
P orte- vent de bois.
Le deffus de la table du fommier eft garni d’autant
de tringles H H , fig. y . & une de plus qu’il doit y
avoir de jeux fur le fommier. Ces tringles qui font de
feuillet font collées & clouées fur la table , & doivent
croifer les gravures ; on les appelle régi (1res dor-
mans , à caufe des regiftres qui font placés entr’eux.
Voyez Registres dormans. Les regiftres, ainfi
nommés de regere, rego,y gouverner-, parce qu’en effet
ils gouvernent le vent qui anime l’orgue, font des
réglés M N > fig.. 10. 6* //. de bois de feuillet très-
fec : ces réglés doivent occuper toute la largeur que
laiffent entr’eux les regiftres dormans , entre deux
defquels elles doivent couler facilement ; on colle
fous le regiftre de la peau de mouton par le côté
glabre : le duvet doit être tourné du côte de la table
du fommier, fur laquelle le regiftre doit pofer. Les
fadeurs de Flandre ordinairement ne mettent point
de peau fous les regiftres, mais ils dreffent fi bien la
table du fommier 6c le regiftre , que l’air ne fauroit
trouver entre deux aucun paffage ; cependant la mér
thode de les garnir de peau eft préférable , car pour
peu que le bois travaille ou gauchiffe, le vent s’introduit
d’une gravure dans une autre , ce qui produit
un cornement infupportable.
Après que les regiftres font placés fur le fommier
entre les tringles H H , appellés regiftres dormans ,
on les égalife à la hauteur de ces tringles , & on
met des épaulemens : les épaulemens N O , MO font
des morceaux de bois aufli larges que le regiftre que
l’on colle fur fes extrémités, qui doivent excéder la
longueur -du fommier d’un demi-pié de chaque côté :
les epaulemens doivent Iaiffer entr’eux une longueur
o 0 yfig. n . égale à toute la longueur A B du fom*
mier, & à la moitié de la diftance qui fe trouve en-?
tre le milieu d’une gravure & le milieu de celle qui
eft à côté. Par-defliis les regiftres & leurs guides, les
regiftres dormans, on met une table a b c d , fig. y ,
& 10. de. bois d’Hollande ou de Vauge, qu’on appelle
chape ; les chapes qui font épaiffes au-moins
<l’un pouce , fervent à recevoir les tuyaux par leurs
piés qui entrent dans des cavités hémifphéfiques.
Voyez PiÉ de tuyau d'orgue. Pour trouver fur la cha*
pe, qui doit être arrêtée fur le fommier par les quatre
coins avec des chevilles , les places des tuyaux ,
il faut tracer des lignes u x ,fig. 10. ces lignes doivent
répondre fur le milieu des gravures & des lignes
Z y y qui doivent répondre fur le milieu des regiftres.
Pour tracer les premières, il faut, avant d’avoir collé
la table du fommier fur les barres , avoir tracé fur
les longs côtés du chaflis les points ƒ t , qui répondent
à la gravure, divifer enfuite l’efpace f e en deux
parties égales au point r , mener avec l’équerre des
menuifiers la ligne . droite r u perpendiculaire au
plan de la chape, faire la même opération, à l’autre
extrémité x , & à toutes les gravures, tirer enfuite
les lignes u x , u x , qui répondront fur le milieu des
gravures. Pour tracer les autres lignes z y , il faut
prolonger fur les côtés de la chape les têtes des re-
gmres dormans, 6c divifer l’efpace qu’elles laifferont
entr’elles en deux parties égales, mener par les points
de divifion les lignes { y , [ y , qui répondront directement
fur le milieu des regiftres : les interférions
des lignes u x , zy-, font les endroits où il faut percer
avec un vilbrequin les trous , lefquels fe rencontreront
perpendiculairement fur les gravures dans lef-
quelles ils doivent déboucher : la chape , le regiftre
& la table du fommier doivent tous trois être percés.
Il faut obferver qu’un des épaulemens doit porter
contre la table du fommier, l’autre épaulement
- qui eft celui où la bafcule du mouvement prend,
voyez Mo u v em en t , doit en être éloigné de l’autre
côté de la moitié de l’intervalle u u ou x x , que nous
avons dit être l’excès de la longueur 0 0 du regiftre ,
fig. / /.fur celle de la table dufommier. Après avoiy
|>erceles trous, ôn les agrandit, & on les brûle avec
des fers chauds pour les approprier ; les trous des
baffes qui doivent avoir une certaine grandeur , fe
font quarrés par-deflbus les chapes, & on les équar-
rit jufqu’à la moitié de f épaifleur de la chape ; dans
f autre moitié de la chape, on les arrondit pour recevoir
le pié des tuyaux. Ceux des regiftres &: de la
table font quarres dans toute l’épaifleur de c es pièces
; on fiait ces trous des baffes avec un cifeau dé
menuifief ; c*eft même à caufe qu’on les fait avec un
cifeaù Qu’ils font quarrés ; leur figure au refte eft
allez indifférente ; on les fait avec un cifeau, à caufe
de l’inconvénient qu’il y auroit de les brûler avec itn
fer chaud a fiez gros pour les creufer ,1a chaleur con-
fidérable d’un gros morceau de fer étant capable de
faire éclater le bois. Un regiftre eft ouvert lorfque
fes trous répondent vis-à-vis ceux de la table du fommier
& ceux de la chape , èe qui établit la communication
de ces derniers à la gravure. Voyez D D ,
fig. 12. Orgue. Il eft fermé lorfque le regiftre eft enfoncé,
enforté que les intervalles de fes trous abc de f i
fig. 11. répondent entre les trous correfpondans de
la table & de la chape. Voyez e c y fig. 12 ; ce qui empêche
la communication du vent de la gravure aux
trous de la chape. Quant à l’arrangement des jeux ,
il faut favoir qu’un jeu eft pofé fur un feul regiftre ,
félon la largeur du fommier : le premier jeu que l’on
pofe eft fur le devant du fommier, qui eft le côté de
la laie marqué I ,fig. 5». on met la montre de 16
pies enfuite fur le regiftre marqué I I , le bourdon de
î6 où 8 piés bouché fonnant le i 6. Pour fentendre
ce que c’èft qu’un 16 piés, un 8 piés bouché fonnant
le 16 y voyez l'article Jeux , & leurs articles particuliers
, ertfiiite le grand cornet, & félon l’ordre de la
table fuivante.
Arrangement des jeux fur le fommier.
Nv.dtsrcgijircs, Noms des jeux.
I. Montre de 16' pies.,
II. Bourdon 16 ou 8 piés bouché;
III. Grand cornet.
IV. Bourdon de 8 ou 4 piés bouché.
S
V. Huit piés ouverts ou huit piés en refo-
■ Ü narice; VL Preftant;
A VII. Flûte.
VIII. Double tierce;
IX. Nazar d.
X. Doublette.
XI. Quarte de nàzard;
»? XII; Tierce;
A XIII. Double trompette; |
XIV. Trompette.
S. X V. Cromorne;
X V I . Clairon. 1 Ixvii. Voix humaine.
Pour éviter là confùfion parmi tant d e je u î, ôh
fait le fommier du grand orgue en deux parties , & on
place les baffes aux côtés extérieurs de chaque partie
■ vers les bafculés dès mouvemens, enforte que le$
plus grands tuyaux font vers les côtés de l’orgue, &
les petits au-deffus dans lè milieu où l’on fait un pont
fur lequel on pofe les fommiers de cornet & de là
trompette du récit, & quelquefois aiifli les chapes
de la fourniture Si de là cimballe, lorfqu’on ne les met
pas fur le fommier. Voyez?article de ces jeifx;
Pour faire tenir tous ces jeux debout fur les chapes
des fommiers dans les trous defquels ils ne font
que pofer, on met des faux fommiers a b c d , fig 14,
qui font des planches de feuillet d’Hollande que l’on
perce avec les tarières pointues des charrons d’au-
TomeXVj
tant de trous ƒ e qu’il y eri a à la chape du fommier i
ces trous qui doivent être àffez grands pour que lé
tuyau H A puifle y entrer * doivent avoir leur centre
perpendiculairement au-deffus de celui des troué
de la chape, vis-à-vis defquels ils fe rencontrent.
Pour trouver là place du centre de ces trous, ôn trace
fur le faux_/ô/tt//«e/-les mêmes lignes u x z y qu’oii
a tracées fur la chape ; & aux .interfeélions de ces
lignes on perce des trous avec un vilebrequin que
l’on accroît avec un autre dont la nieche. eft plus!
groflè, & avec lès tarières pointues, jufqu’à cé quë
les tuyaux puiffent y entrer ; après 011 place le faux
fommier fur le fommier à environ un demi-pié de diftance
; on le fait tenir par quatre piliers fixés aux quatre
coins avec des vis ; on place enfuite les piés
des tuyaux dans les trous du faux fommier, & on les
fait entrer dans les trous des chapes ^ comme les
tuyaux K H . On doit remarquer que la bouche des
tuyaux doit toujours être en-deffus du faux fommier ÿ
' & que par confisquent il faut que les piés des tuyaux
foient quelques pouces plus longs que la diftance de
la chappe A .B CD au fauxfammier abc d. ,
Il fuit de cette cpnftru&ion qu’après que la laie eft
remplie du vent des foufflets , fi l’organifte abaiffé
une touche du clavier ( qui par le moyen de fa targette
fera tourner un rouleau de l’abrégé lequel par
le moyen d’une autre targette tirera une foupape, &■
la fera ouvrir ) , que l’air condertfé contenu dans là
laie entrera dans la gravure dont la foupape eft ou-*
verte , & paffera de-là par le trou de la table & du
regiftre qui fera ouvert dans le trou correfpondant
de la chappe, d’où il entrera dans le tuyau par le
trou de fon pié: ce qui le fera parler. Voyez l'explication
de la maniéré dont le vent fait parler les
tuyaux, à l’article Bourdon de seize & au mot
Jeu x.
Le fommier du pofitif différé peu de celui du grand
orgue ; toute la différence eft que la laie E F y fig,
12 y eft en-deffus du côté de la table $ & que les fou-
pâpes s’ouvrent en foulant en-deffous par le moyen
des petits bâtons o n , qui portent fur le haut des baf-
cules du pofitif. Voyez Bascule du positif & Po s
it if .
Sommier , ( Maréchal) op appelle ainfi un che^
val de fomme.
Sommier , terme de Parcheminier, c’eft une peau
de veau > qui couvre la herfe, ou métier des parche-
miniers, Sc qui foutient la peau qu’on travaille, dans
le tems qü’on la rature;
Contre - fommier , eft une peau de parchemin en
coflè, qu’on pofe entre le fommier & la peau qu’on
rature , afin que le fer trouve p.lus de facilité à mordre.
V oye{ Parchemin. .
Som m ier , terme de Tonneliery c’eft ainfi qu’on
nomme les cerceaux doublés , qui fé placent aux
deux extrémités d’iine futaille # & immédiatement
fur le jable, afin de lui donner plus de force.
SOMMIERE , f. f. ( Manufi de lainage. ) forte d’étoffe
toute de laine, tant en chaîne qu’en trame croi-
féè, chaude, & mollette , qui n’eft autre chofe qu’une
efpece de ferge un peu lâche, tirée à p o il, tantôt
d’un feuL côté, & tantôt des deux côtés -, dont
on fe fert à faire des doublures, pour l’hiver. {D . ƒ .)
SOMMIÈRES, ( Gcog. mod.) en latin vulgaire Su-
merittm ; petite ville de France, dans le Languedoc*
fur la Vidourle , à deux lieues de Nîmes. Les cal-
viniftes en avoient fait une forte place ; ç’eft encore
aujourd’hui un gouvernement particulier dans le
Languedoc. Long, 21. 43. latit. 43. 55. ( Z>. /. )
SOMMISTÈ, f. m* ( Chancel. rom. ) c’eft le principal
miniftre de la chambre. romaine, pour l’expédition
des bulles ; il en fait faire les minutes ,- les fait
recevoir , & plomber. (Z>. /.)
SOMMITÉ > f, f, ( Gram, ) extrémité fupérieurÿ
' y T Îj