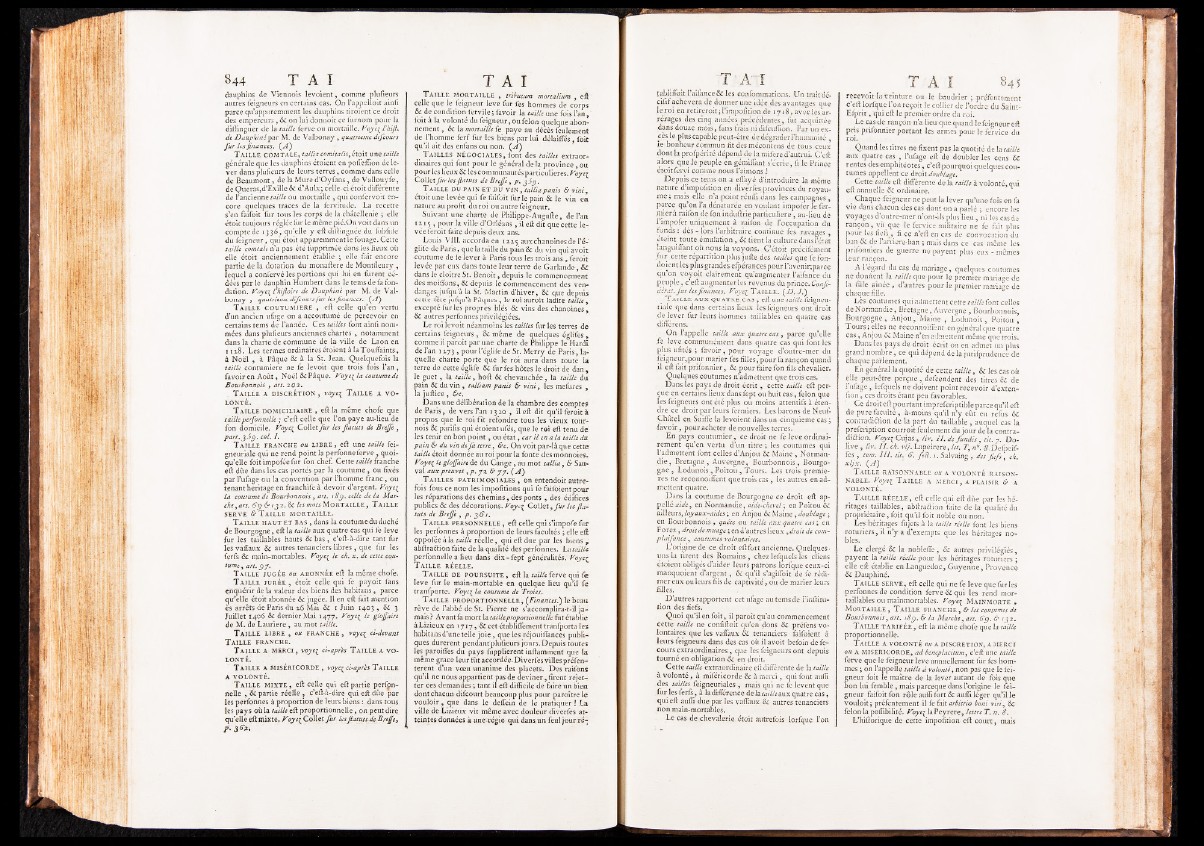
844 T A I dauphins de Viennois levoient, comme plufieurs
autres feigneurs en certains cas. On i’appelloit ainfi
parce qu’apparemment les dauphins tiroient'ce droit
des empereurs, & on lui donnoit ce furnom pour la
diftinguer de la taille ferve ou mortaille. Voye^ L'hijl.
de Dauphiné par M. de Valbonay, quatrième dijcours
fur les finances. (^ )
T a i l l e c OjMTALE, tailla comitalis, étoit une taille
générale que les dauphins étoient en pofleffion de lever
dans plulieurs de leurs terres, comme dans celle
de Beaumont, de la Mure d’Oyfans, de Vallouyfe,
de Queras,d’Exille & d’Aulx; celle- ci étoit différente
de l’ancienne taille ou mortaille , qui confervoit encore
quelques traces de la lervitude. La recette
s’en faifoit fur tous les corps de la châtellenie ; elle
étoit toujours réglée fur le même pié.On voit dans un
compte de 1336, qu’elle y eft diftinguée du fubfide
du feigneur, qui étoit apparemment le fouage. Celte
taille comtale n’a pas été fupprimée dans les lieux où
elle étoit anciennement établie ; elle fait encore
partie de la dotation du monaftere de Montfleury ,
lequel a confervé les portions qui lui en furent cédées
par le dauphin Humbert dans le tems de fa fondation.
Voye{ l'hifioire de Dauphiné par M. de Valbonay
, quatrième difeours fur les finances. (yf)
T a ille co utum ière , eft celle qu’en vertu
d’un ancien ufage on a accoutumé de percevoir en
certains tems de l’année. Ces tailles font ainfi nommées
dans plufieurs anciennes chartes , notamment
dans la charte de commune de la ville de Laon en
1 n S . Les termes ordinaires étoient à laTouflaints,
à Noël , à Pâque & à la St. Jean. Quelquefois la
taille contumiere ne fe levoit que trois lois l’an ,
favoir en Août, Noël & Pâque. V?ye{ la coutume de
Bourbonnois , art. 202.
T a ille a d iscré tion , voyei T aille a v o lo
n t é .
T aille domiciliaire , eft la même chofe que
taillepérfonnelle ; c’eft celle que l’on paye au-lieu de
fon domicile. Voye\ Collet fur les Jlatuts de BreJJé ,
part, 3 Sg, col. I.
T aille franche ou libre , eft une taille fei—
gneuriale qui ne rend point la perfonne ferve , quoiqu’elle
foit impofée fur fon chef. Cette taille franche
eft due dans les cas portés par la coutume, ou fixés
par l’ufage ou la convention par l’homme franc, ou
tenant héritage en franchife à devoir d’argent. Voyeç
la coutume de Bourbonnois , art. 18g. celle de la Mar-
che, art. Gc) & 13 2 . & les mots M O R T A IL L E , T aille
serve & T a ille mo rtaille.
T a ille haut et bas , dans la coutume du duché
de Bourgogne, eft la taille aux quatre cas qui fe leve
fur les taillables hauts & bas, c’eft-à-dire tant fur
les vaflaux & autres tenanciers libres , que fur les
ferfs & main-mortables. Voyt^ le ch. x. de cette coutume
, art. ÿ j .
T aille jugée ou abonnée eft la même chofe.
T aille ju r é e , étoit celle qui fe payoit fans
enquérir de la valeur des biens des habitans, parce
qu’elle étoit abonnée & jugée. Il en eft fait mention
ès arrêts de Paris du 26 Mai & 1 Juin 1403 , & 3
Juillet 1406 & dernier Mai 1477. V o y e le glojfaire
de M. de Lauriere, au mot taille.
T aille libre , ou franche , voye{ ci-devant
T aille franche.
T a ille a merci , voyeç d-aprïs T aille a volo
nt é.
T aille a miséricorde , voyeç ci-aprh T aille
a vo lo n t é .
T aille m ix t e , eft celle qui eft partie perfon-
nelle , & partie réelle , c’eft-à-dire qui eft due par
les perfonnes à proportion de leurs biens : dans tous
les pays où la taille eft proportionnelle, on peut dire
qu’elle eft mixte. Voye^ Collet fur les jlatuts de B refie,
P- 36'^
T A I
T A IL L E MORTAILLE , iributum mortalium , eft
celle que le feigneur leve fur fes hommes de corps
& de condition fervile; favoir la taille une fois l’an,
foit à la volonté du feigneur, ou félon quelque abonnement
, & la mortaille fe paye au décès feulement
de l’homme ferf fur les biens par lui délaiffés, foit
qu’il ait des enfans ou non. ('A )
Tailles negociales, font des taillés extraordinaires
qui font pour lé général de la province ou
pour les lieux & les communautés particulières, Voyc{
Collet Jurles fia tut s de Brefie, p. 36$,
Taille DU pain ET DU V IN , tallia panis & vini,
étoit une levée qui fe faifoit fur le pain & le vin en
nature au profit du roi ou autre feigneur.
Suivant une charte de Philippe-Augufte, de l’an
1215 , pour la ville d’Orléans , il eft dit que cette levée
leroit faite depuis deux ans.
Louis VIII. accorda en 1225 aux chanoines de I’é-
glife de Paris, que la taille du pain & du vin qui avoit
coutume de fe lever à Paris tous les trois ans , feroit
levée par eux dans toute leur terre de Garlande, &
dans le cloître St. Benoît, depuis le commencement
des moiflons, & depuis le commencement des vendanges
jufqu a la St. Martin d’hiver, & que depuis
cette fête jufqu’à Pâques, le roi auroit ladite taille ,
excepté fur les propres blés & vins des chanoines,
& autres perfonnes privilégiées.
Le roi levoit néanmoins les tailles fur les terres de
certains feigneurs , & même de quelques églifes ,
comme il paroît par une charte de Philippe le Hardi
de l’an 1273 , pour l’églife de St. Merry de Paris, laquelle
charte porte que le roi aura dans toute la
terre de cette églife & fur fes hôtes le droit de dan,
le guet , la taille, hoft &. chevauchée, la titille du
pain & du vin , talliàm panis & vini, les mefures
la juftice, &c.
Dans une délibération de la chambre des comptes
de Paris, de vers l’an 1320 , il eft dit qu’il feroit à
propos que le roi fît refondre tous les vieux tournois
& parifis qui étoient ufés, que le rdi eft tenu dé
les tenir en bon p oint, ou é tat, car il en a la taille du.
pain & du vin de fa terre, &c. On voit par-là que cette
taille étoit donnée au roi pour la fonte des monnoies.
Vyye{ le glojfaire de du Cange , au mot tallia, & Sauvai
aux preuves , p. y 2 & yy. ( A )
Tailles patrimoniales, on entendoit autrefois
fous ce nom les impofitions qui fe faifoient poqr
les réparations des chemins, des ponts , des édifices
publics & des décorations. Voye^ Collet, fur les fia-
tuts de Brefie , p. $61.
Taille personnelle , eft celle qui s’impofe fur
les perfonnes à proportion de leurs facultés ; elle eft
oppofée à la taille réelle, qui eft due par les biens ,
abftra&ion faite de la qualité des perfonnes. La taille
perfonnelle a lieu dans dix - fept généralités. Voye^
Taille réelle.
Taille de poursuite , eft la taille ferve qui fia
leve fur le main-mortablé en quelque lieu qu’il fe
tranfporte. Voyes^ la coutume de Troies.
Taille proportionnelle, ( Finances.) le beau
rêve de l’abbé de St. Pierre ne s’accomplira-t-il jamais?
Avant fa mort la taille proportionnelle fut établie
à Lizieux en 17 1 7 , & cet établiflement tranfporta les
habitans d’une telle joie , que les réjouiffances publiques
durèrent pendant plufieurs jours. Depuis toutes
les paroifles du pays fupplierent inftamment que la
même grâce leur fut accordée. Di verfes villes préfen-
terent d’un voeu unanime des placets. Des raifons
qu’il ne nous appartient pas de deviner, firent rejet-
ter ces demandes ; tant il eft difficile de faire un bien
dont chacun difeourt beaucoup plus pour paroître le
vouloir, que dans le deflein de le pratiquer 1 La
ville de Lizieux vit même avec douleur diverfes atteintes
données à une-régie qui dans, un feul jour ré-
'T ’ A"I tabliflbit l’aifance & les confommations. Un trairdé-
cifif achèvera de donner une idée des avantages que
le roi en retireroit ; l’impofition de 1718, ave,c les arrerages
des cinq années précédentes, fut acquittée
.dans douze mois, fans frais ni difeuffion. Par. un excès
le plus capable peut-être de dégrader l'humanité ,
le bonheur commun fit des mécontens de tous ceux
dont la profpérité dépend de la mifere d’autrui. Ç’eft
alors que le peuple en gémiffant s’écrie, fi le Prince
étoit feryi comme nous l’aimons !
Depuis ce tems on a eflayé d’introduire la même
nature d’impofition en diverfes provinces du royaume;
mais elle n’a point réuffi dans les campagnes ,
parce qu’on l’a,dénaturée en voulant impofer le fermier
à raifon de fon induftrie particulière , au-lieu de
1 impofer uniquement à raifon de l’occupation du
fonds : dès - lors l’arbitraire continué fes ravages -,
eteint toute émulation, & tient la culture dans l’état
languiflant où-nous la voyons. C ’étoit précifément
fut cette répartition plus jufte des tailles que fe fon-
.doient les plus grandes efperances pour l’avenir;parce
qu’on voyoit clairement qu’augmenter l’aifance du
peuple, c’eft augmenter les revenus du prince. Conji-
dérac.jur lesfinances. Poyt{ T a i l l e . (Z>. /.)
T a i l l e a u x q u a t r e c a s -, eft une taille feigneu-
riale que dans certains lieux les feigneurs ont droit
.de lever fur leurs hommes taillables en quatre cas
différens. .
On l’appelle taille aux quatre cas, parce qu’elle
.fe leve communément dans quatre cas qui font les
plus ufités ; favoir, pour voyage d’outre-mer du
feigneur, pour marier fes filles, pour fa rançon quand
il eft fait prifonnier, & pour faire fon fils chevalier.
Quelques coutumes n’admettent que trois cas.
Dans les pays de droit éc r it, cette taille eft perçue
en certains lieux dans fept ou huit cas, félon que
les feigneurs ont été plus ou moins attentifs à étendre
ce droit par leurs fermiers. Les barons de Neuf-
Çhâtel en Suifle la levoient dans un cinquième cas ;
favoir, pour acheter de nouvelles terres.
En pays coutumier, ce droit ne fe leve ordinairement
qu’en vertu d’un titre ; les coutumes qui
l’admettent font celles d’Anjou & Maine , Normandie,
Bretagne, Auvergne, Bourbonnois;, Bourgogne
, Lodunois, Poitou , Tours. Les trois premières
ne reconnoifîent que trois cas , les autres en admettent
quatre.
Dans la coutume de Bourgogne ce droit eft appelle
aide, en Normandie, aide-chevel; en Poitou &
ailleurs, loyaux-aides ; en Anjou & Maine, doublage ;
en Bourbonnois , quête ou taille aux quatre cas ; en
Forez, droit de muage ; en d’autres lieux, droit de corn-
plaifance, coutumes volontaires.
L’origine de ce droit eft fort ancienne. Quelques-
uns la tirent des Romains , chez lefquels les cliens
etoient obligés d’aider leurs patrons lorfque ceux-ci
manquoient d’argent, & qu’il s’agifloit de fe rédi-
mer eux ou leurs fils de captivité, ou de marier leurs
Elles.
D ’autres rapportent cet ufage au tems de l’inftitu-
tion des fiefs.
Quoi qu’il en foit, il paroît qu’au commencement
cette taille ne confiftoit qu’en jlons & préfens volontaires
que les vaflaux & tenanciers faifoient à
leurs feigneurs dans des cas où il avoit befoin de fe-
cours extraordinaires, que les feigneurs ont depuis
tourné en obligation & en droit.
Cette taille extraordinaire eft differente de la taille
à volonté, à miféricorde & à merci, qui font auffi
des tailles feigneuriales , mais qui ne le lèvent que
fur les ferfs, à la différence de la taille aux quatre cas,
qui eft auffi due par les vaflaux & autres tenanciers
non main-mortables.
Le cas de chevalerie étoit autrefois lorfque l’on
T A I 845
recevoit la teinture ou le baudrier; préfentement
c’eft lorfque l’on reçoit le collier de l’ordre du Saint-
E-fprit, qui eft le premier ordre du roi.
Le cas de rançon n’a lieu que quand le feigneur eft
pris prifonnier portant les armes pour le feryiee du
rôii
Quand les titres ne fixent pas la quotité de la taille
aux quatre cas , l’ufage eft de doubler les cens 6c
rentes des emphitéotes, c’eft pourquoi quelques coutumes
appellent ce droit doublage.
Cette taille eft différente de la taille à volonté, qui
eft annuelle & ordinaire.
, Chaque feigneur ne peut la lever qu’une fois en fa
vie dans chacun des cas dont on a parlé ; encore les
voyages d’outré-mer n’ontrils plus lieu, ni les cas de
rançon, vu que lé fervice militaire ne fe fait plus
pour les fiefs., fi ce n’eft en cas de convocation du
ban 6c de l’arriere-ban ; mais dans ce cas même les
prifonniers de guerre ne payent plus eux - mêmes
leur rançon.
A l ’égard du cas de mariage, quelques coutumes
ne donnent la taille que pour le premier mariage de
la fille aînée, d’autres pour le premier mariage de
chaque fille.
Les coutumes qui admettent cette taillelont celles
de Normandie, Bretagne, Auvergne, Bourbonnois,
Bourgogne , Anjou, Maine , Lodunois, Poitou ,
Tours; elles nereconnoiflent en général que quatre
cas, Anjou & Maine n’en admettent même qUe trois.
Dans les pays de droit écrit on en admet un plus
grand nombre, ce qui dépend de la jurifprudence de
chaque parlement.
En général la quotité de cette taille, & les cas où
elle peut-être perçue, defeendent des titres 6c de
1 ufage, lefquels ne doivent point recevoir d’exten-
fion, ces droits étant peu favorables.
Ce droit eft pourtant imprefcriptible parce qu’il eft
de pure faculté , à-moins qu’il n’y eût eu refus &
contradiction de la part du taillable , auquel cas la
prefeription courroit feulement du jour de la contradiction.
Foyei Cujas , liv. II. de fundis, tit. y. Do-
livë , liv. 11. ch. vij. Lapeirere, let. 71, n°. £.Defpeif-
fes , tom. III. tit. G. f i ci.,. Salvaing, des fiefs, ch.
xljx. {A)
T a i l l e r a i s o n n a b l e ou a v o l o n t é r a i s o n n
a b l e . P'oyei T a i l l e a m e r c i , a p l a i s i r & a
VO LO NT É.
T a i l l e r e e l l e , eft celle qui eft due par les héritage^
taillables, abftraétion faite de la qualité du
propriétaire, foit qu’il foit noble ou non.
Les héritages fujets à la taille réelle font les biens
roturiers, il n’y a d’exempts que les héritages nobles.
0
Le clergé Sc la noblefle, & autres privilégiés,
payent la taille réelle pour les héritages roturiers ;
elle eft établie en Languedoc, Guyenne, Provence
& Dauphiné. .
T a i l l e s e r v e , eft celle qui ne fe leve que fur les
perfonnes de condition ferve & qui les rend mor-
taillables ou mainmortables. Foye^ M a in m o r t e ,
M o r t a i l l e , T a i l l e f r a n c h e , b les coutumes de
Bourbonnois y art. 189. & la Marche, art. Gc).& 132.
T a i l l e t a r i f é e , eft la même chofe que la taille
proportionnelle.
T a i l l e a v o l o n t é ou a d i s c r é t i o n , a m e r c i
ou A MISERICORDE, ad beneplacitum, c’eft une taille
ferve que le feigneur leve annuellement fur fes hommes
; on l’appelle taille à volonté, non pas que le feigneur
foit le maître de la lever autant de fois que
bon lui femble, mais pareeque dans l’origine le feigneur
faifoit fon rôle auffi fort & auffi léger qu’il le
vouloit; préfentement il fe fait arbitrio boni viri, 6c
félon la poffibilité. Foye^ laPeyrere, lettre T. n. 8.
L’hiftorique de cette impofition eft court, mais