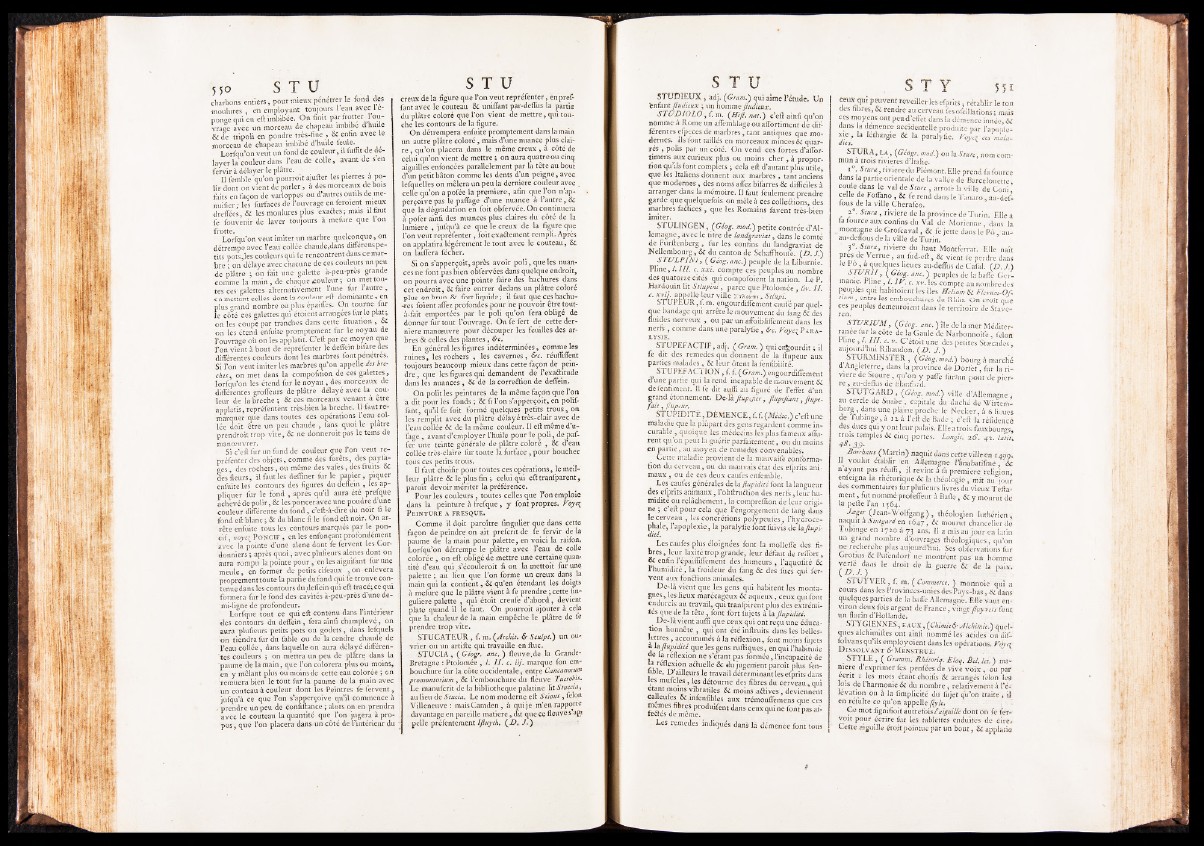
5 5° S T U charbons entiers, pour mieux pénétrer le fond des
moulures , eïi employant toujours l ’eau avec le -
ponge qui en eft imbibée. On finit pa rfrotterl ouvrage
avec un morceau de chapeau imbibe d huile
6 de tripoli en poudre très-fine , & enfin avec le
morceau de chapeau imbibé d’huile feule. 7
Lorfqu’on veut un fond de couleur, il luffit de délayer
la couleur dans l’eau de colle, avant de s en
fervir à délayer le plâtre. . . . . ,
Il femble qu’on pourrait ajufter les pierres a polir
dont on vient de parler, à des morceaux de bois
faits en façon de varloppes ou d’autres outils de me-
nuifier; les furfaces de l’ouvrage en feraient mieux
dreffées, 8c les moulures plus exaftes; mais il faut
fe fouvenir de laver toujours à mefure que 1 on
frotte.
Lorfqu’on veut imiter un marbre quelconque, on
détrempe avec l’eau collée chaude,dans differens petits
pots,les couleurs qui fe rencontrent dans ce marbre
; on délaye avec chacune de ces couleurs un peu
de plâtre ; on fait une galette à-peu-près grande
comme la main, de chaque «couleur ; on met toutes
ces- galettes alternativement l’une fur 1 autre ,
en mettant celles dont la couleur eft dominante, en
plus grand nombre ou plus épaiffes. On tourne fur
le côté ces galettes qui étoientarrangées furie plat;
on les coupe par tranches dans cette lituation , 8c
on les étend enfuite promptement fur le noyau de
l’ouvrage où on les applatit. C’eft par ce moyen que
l’on vient à bout de repréfenter le deffein bifare des
différentes couleurs dont les marbres font pénétrés.
Si l’on veut imiter les marbres qu’on appelle des brèches,
on met dans la compofition de ces galettes,
lorfqu’on les étend fur le noyau , des^ morceaux de
différentes groffeurs de plâtre délayé avec la couleur
de la breche ; 8c ces morceaux venant à etre
applatis, repréfentènt très-bien la breche. 11 faut remarquer
que dans toutes ces operations 1 eau col-
lée doit être un peu chaude , fans quoi le plâtre
prendrait trop vite, & ne donnerait pas letems de
manoeuvrer.
Si c’eft fur un fond de couleur que 1 on veut repréfenter
des objets, comme des forêts, des payfa-
«es des rochers, ou même des vafes, des fruits 8c
des fleurs, il faut les defliner furie papier, piquer
enfuite les contours des figures du deffein , les appliquer
fur le fond , après qu’il aura été prefque
achevé de polir, 8c les poncer avec une poudre d’une
couleur différente du fond, c’ eft-à-dire du noir fi le
fond eft blanc ; & du blanc fi le fond eft noir. On arrête
enfuite tous les contours marqués par le ponc
i f, v o y e [ P o n c i f , en les enfonçant profondément
'avec la pointe d’une alene dont fe fervent les Cordonniers
; après quoi, avec plufieurs aienes dont on
aura rompu la pointe pour y en les aiguifant fur une
meule, en former de petits cifeaux , on enlevera
proprement toute la partie du fond qui fe trouve contenue
dans les contours du deffein qui eft tracé; ce qui
formera fur le fond des cavités à-peu-près d’une demi
ligne de profondeur.
Lorfque tout ce qui eft contenu dans l’interieur
des contours du deffein, feraainfi champleve, on
aura 'plufieurs petits pots ou godets, dans lefquels
on tiendra fur du fable ou de la cendre chaude de
l’eau collée, dans laquelle on aura délayé différen-
"tes couleurs ; .on mettra un peu de plâtre dans la
‘paume de la main, que l’on colorera plus ou: moins,
en y mêlant plus ou moins de cette eau colorée ; on
-remuera bien le tout fur la paume de la main avec
un couteau à couleur dont les Peintres fe fervent,
'jufqu’à ce que l’on s’apperçoive qu’il commence à
„ prendre un peu de confiftance ; alors on en prendra
avec le couteau la quantité que l’on jugera à propós,
que l’on placera dans un côté de l’intérieur du
S T ü creux de la figure que l’on veut repréfenter, en pref-
fant avec le couteau 8c unifiant par-deffus la partie
du plâtre coloré que l’on vient de mettre, qui touche
les contours de la figure.
On détrempera enfuite promptement dans la main
un autre plâtre coloré, mais d’une nuance plus claire
, qu’on placera dans le même creux , à côté de
celui qu’on vient de mettre ; on aura quatre ou cinq
aiguilles enfoncées parallèlement par la tête au bout
d’un petit bâton comme les dents d’un peigne, avec
lefquelles on mêlera un peu la derniere couleur avec .
celle qu’on a pofée la première, afin que l’on n’ap-
perçoive pas le paffage d’une nuance à l’autre, 8c
que la dégradation en foit obfervée. On continuera
à pofer ainfi des nuances plus claires du côté de la
lumière , jufqu’à ce que le creux de la figure que
l’on veut repréfenter, foit exactement rempli. Après
on applatira légèrement le tout avec le couteau, 8c
on laiffera fécher.
Si on s’apperçoit, après avoir poli, que les nuances
ne font pas bien obfervées dans quelque endroit,
on pourra avec une pointe faire des hachures dans
cet endroit, & faire entrer dedans un plâtre coloré
plus en brun 8c fort liquide; il faut que; ces hachu-
-res foient affez profondes pour ne pouvoir être tout-
à-fait emportées par' le poli qu’on fera obligé de
donner fur tout l’ouvrage. On fe fert de cette derniere
manoeuvre pour découper les feuilles des arbres
& celles des plantes, & c .
En général les figures indéterminées, comme les
ruines, les rochers , les cavernes, & c . réufliffent
toujours beaucoup mieux dans cette façon de peindre
, que les figures qui demandent de l’exaôitude
dans les nuances , 8c de la correction de deffein.
On polit les peintures de la même façon que l’on
a dit pour les fonds ; 8c fi l’on s’apperçoit, en polif-
fant, qu’il fe foit formé quelques petits trous, on
les remplit avec du plâtre délayé très-clair avec de
l’eau collée 8c de la même couleur. Il eft même d’u-
fage , avant d’employer l’huile pour le poli, de paf-
fer une teinte générale de plâtre coloré , 8c d’eau
collée très-claire fur toute la furface, pour boucher
tous ces petits trous.
Il faut choifir pour toutes ces opérations, le meilleur
plâtre 8c le plus fin ; celui qui eft tranfparent,
paroît devoir mériter la préférence.
Pour les couleurs , toutes celles que l’on emploie
dans la peinture àfrefque, y font propres. Voyi{
P e i n t u r e a f r e s q u e .
Comme il doit paraître fingulier que dans cette
façon de peindre on ait prefcritde fe fervir de la
paume de la main pour palette, en voici la raifon,
Lorfqu’on détrempe le plâtre avec l’eau de colle
colorée , on eft obligé de mettre une certaine quan*<
tité d’eau qui s’écoulerait fi on la mettoit fur une
palette ; au lieu que l’on forme un creux dans la
main qui la contient, 8c qu’en étendant les doigts,
à mefure que le plâtre vient à fe prendre ; cette fin-
guliere palette , qui étoit creufe d’abord, devient
plate quand il le faut. On pourroit ajouter à cela
que la chaleur de la main empêche le plâtre de fe
prendre trop vite.
STUCATEUR, f. m. ( A r ch it. & Scu lp t.) un ouvrier
ou un artifte qui travaille en ftuc.
STUCIA , ( Géogr. anc. ) fleuve.de la Grande-
Bretagne : Ptolomée, l. 11. c. iij. marque fon embouchure
fur la côte occidentale, entre Cancanoriun
promontorium, & l’embouchure du fleuve Tutrobis.
Le manufcrit de la bibliothèque palatine lit Stuccia,
au lieu de Stucia. Le nom moderne eft Seïous, félon
Villeneuve : maisCamden, à qüije m’en rapporte
davantage en pareille matière, dit que ce fleuve s ap*
. pelle préfentement IJluyth. (D , / .)
S T U STUDIEUX 5 adj» (Granu') qui aime l’étude. Un
infant ftudieux ; un homme (tudieux.
STU D IO L O , f. m. (Hijl. nat.) c’eft ainfi qu’on
nomme à Rome un affemblage ou affortiment de differentes
efpeces de marbres, tant antiques que modernes.
Ils font taillés en morceaux minces 8c quar-
res , polis par un côté. On vend ces fortes d’affor-
timens aux curieux plus ou moins cher , à proportion
qu’ils font complets ; cela eft d’autant plus utile,
que les Italiens donnent aux marbres , tant anciens
que modernes , des noms affez bifarres & difficiles à
arranger dans la mémoire. Il faut feulement prendre
garde que quelquefois on mêle à ces colle&ions, des
marbres fadices , que les Romains favent très-bien
imiter.
S f ULINGEN, (Géog, mod.) petite contrée d’Allemagne,
avec le titre de landgraviat, dans le comté
de Furftenberg , fur les confins du landgraviat de
Nellembourg, 8c du canton de Schaffhoufè. (D . J.)
STULPINJ , ( Géog. anc.) peuple de la Liburnie.
Pline, /. III. c. xxi. compte ces peuples au nombre
des quatorze cités qui compofoient la nation. Le P.
Hardouin lit Stlupini, parce que Ptolomée , liv. II.
c. xvij. appelle leur ville r TÀ&t'/•&i, S c tupi.
STUPEUR, f. m. engourdiffement caufé par quelque
bandage qui arrête le mouvement du fang 8c des
fluides nerveux , ou par un affoibliffement dans les
nerfs , comme dans une paralyfie, &c> Voye{ Paraly
sie.
STUPEFACTIF, adj. ( Gram. ) qui engourdit ; il
fe dit des remedes qui donnent de la ftupeur aux
parties malades , 8c leur ôtent là fenfibiiité.
I STUPEFACl IO N , f. f. (Gram.) engourdiffement
d’une partie qui la rend incapable de mouvement 8c
de fentiment. Il fe dit auffi au figuré de l’effet d’un
grand étonnement. DcAkJluptfier, fiupefiant, fiupe-
fa it, (lupeur.
STUPIDITÉ, DÉMENCE, f. f. (Midcc.) c’ eft une
maladie que la plupart des gens regardent comme incurable,
quoique les médecins les plus fameux affu-
rent qu’on peut la guérir parfaitement, ou du moins
en partie, au moyen de remedes convenables.
Cette maladie provient de la mauvaife conformation
du cerveau, ou du mauvais état des efprits animaux
, ou de ces deux caufes enfemble.
Les caufes générales de la (iupidité font la langueur
des efprits animaux, Pobftru&ion des nerfs, leur humidité
ou relâchement, la compreffion de leur origine
; c’eft pour cela que l’engorgement de fàng dans
le cerveau , les concrétions poiypeufes, l’hydroce-
phale, l’apoplexie, la paralyfie fontfuivis de la (tupi-
dite.
Les caufes plus éloignées font la molleffc des fibres
, leur laxité trop grande, leur défaut de reflort,
& enfin l’épaifliffement des humeurs , l’aquoiîté 8c
l’humidité , la froideur du fang 8c des fucs qui fervent
aux fondions animales.
De-là vient que les gens qui habitent les montagnes
, les lieux marécageux & aqueux, ceux qui font
endurcis au travail, qui tranfpirent plus des extrémités
que de la tête, font fort fujets à la Jlupidué.
. De-là vient auffi que ceux qui ont reçu une éducation
honnête , qui ont été inftruits dans les belles-
lettres , accoutumés à la réflexion, font moins fujets
à la Jlupiditè que les gens ruftiques, en qui l’habitude
de la.réflexion ne s’etant pas formée, l’incapacité de
la reflexion a&uelle & du jugement paroît plus fen-
fible. D ’ailleurs le travail déterminant les efprits dans
es mufcles, les détourné des fibres du cerveau, qui
H vibratiles 8c moins aâives , deviennent
calleufes & .infenfibles aux trémouffemens que ces
memes fibres produifent dans ceux qui ne font pas affectes
de même.
Les remedes indiqués dans là démence font tous
S T Y 55i ceux qui peuvent l'cyeiller les efprits i fétablir le ton
tles libres, & rendre au cerveau ïes ofcillatîons ; mais
ces moyens ont peu d’effet dans la démence innée, &
dans la demence accidentelle produite par l’apopie*
x<e , la léthargie & la paralyfie. F o r ces mata*
dus.
STURA, L A , (GéogK mit.} ou la State, nom «mu
mtin à trois rivières d’Italie.
i °. S tara, riviere du Piémont. Elle prend fa fourcè
dans la partie orientale de la vallée de Barcelonette,
coule dans le val de Sture , arrofe la ville de Coni,
celle de Foffano , & fe rend dans le Tanàro, au-def-
fous de la ville Cherafco,
r-0- 8tura , riviere de la province de Turin. Elle a
fa fource aux confins du Val de Morienne , dans la
montagne de Grofcaval, & fe jette dans le Pô ,a u -
au-deffous de la ville de Turin.
f . S tara, riviere du haut Mofltferrat. Elle naît
Pr^fA ejXerrue I au. iud-eft, & vient fe perdre dans
le Po , à quelques lieues au-deffus de Cafal. (D. J.)
W È Ê jsjjffî (Géog. anc.) peuples de la baffe Germanie.
Pline , l . I V . c . xv. les compte au nombre des
peuplés qui habitoient les îles Hélium 8c Flevum^Of*
tium, entre les embouchures du Rhin. On croit que
ces peuples demeuraient dans le territoire de Stave-
ren.
STURIUM 3 (Géog. anc. ) île de la mer Méditer-
ranee fur la cote de la Gaule de Narbonnoife, félon
Pline , /.///. c. v. C ’étoit une des petites Stæcades,
aujourd’hui Ribaudon. (D . J. )
? ™ RMINSTER » ( Géog. mod.) bourg à marché
d Angleterre, dans la province dè D o r fe t, fur la riviere
de Stoure, qu’on y paffe furnm pont de pierre
, au-deffus de Blanford.
STU TG A R D , (Géog. mod.) ville d’Allemagne ,
au cercle de Suabe , capitale du duché de Wîrteifi-
berg , dans une plaine proche', le Necker , à 6 lieues
de Tubinge, à 1 1 à l’eft de Bade ; c’eft la réfidencè
des ducs qui y ont leur palais. Elle a trois fauxbourgs,
trois temples & cinq portes. Longit. z 6 . 4%. latit.
48. $ 0:
j - -, 1 »....m a m piciiiicrre reugior
enfeigna la rhétorique 8c la théologie , mit au jou
des commentaires fur plufieurs livres du vieux Teffc
ment, fut nomme profeffeur à Bafle, 8c y mourut d
la pefte l’an 1564.
Joege? (Jean-Wolfgang) , théologien luthérien
naquit à Stutgard en 1647, 8c mourut chancelier il
Tubinge en ly z o à 73 ans. II a mis au jour en lati
un grand nombre d’ouvrages théologiques, qu’o
ne recherche plus aujourd’hui. Ses obfervations fu
Grotius & Pufendorf ne montrent pas un hdmm
( z P / ^ ailS ^ §uerre & de la paij
S TU YV ER , f. m. ( Commerce. ) moiînoïe qui
tours dans les Provincès-unies des Pays-bas, 8c dar
quelques parties de la bafle Allemagne, Ètlè vaut er
viron deux fols argent de France, vingt (iuyve 'rs for
un florin d’Hollande,
. STYGIENNES, e a u x , (Chimie & Alchimie!) quel-
qiies alchimiftes ont ainfi nommé lè$ acides ou dif^
folvans qu’ils employoient dans les opérations, Vàyei D i s s o l v a n t & M e n s t r u e ,
, STYLE , ( Grainhu Rhétoriq. Èloq. Écl. Ici.) ma*
ttiere d’exprimer fes penfées de vive voix , oit paf
écrit î les mots étant choifis 8c arrangés félon les
lois dè l’harmonie & du nombre, relativement à l’c-
levation ou à la fimplicité diï fujet qu’on traite * il
en réfulte ce qu’on appelle (lyle-.
Ce mot fignifioit autrefois C aiguille dont on fe fer-
voit pour écrire fur lés rablèrtes enduites de cirej
Cette aiguille étoit pointue par un bout, 8c applatis