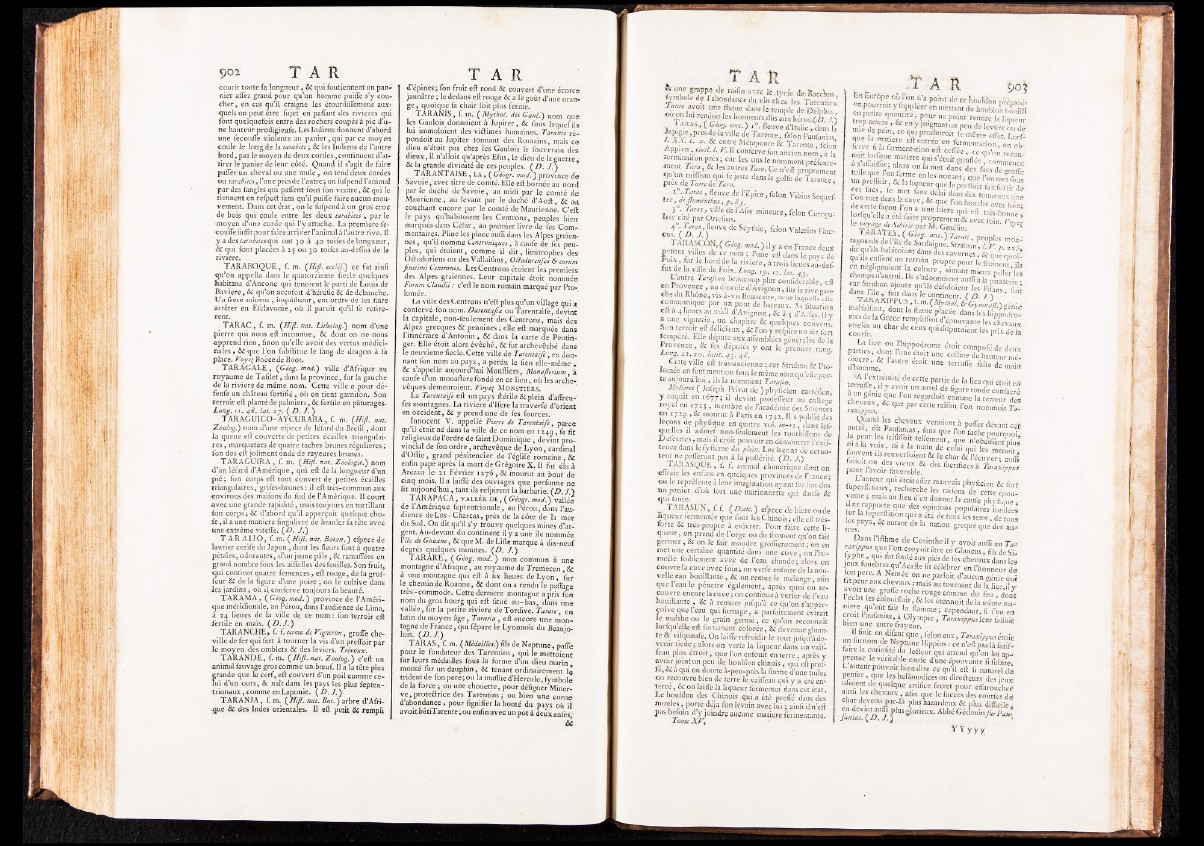
r i SM
W'ffiiil
i i i l i f
■ 1
I f i j
•courir toute fa longueur, & qui ifier affez grand pour qu’un nomfomueti epnunifefnet su’yn pcaonuqcuheelrs,
oenn pceaust qêutr’iel fcurajeigt neen lpeasf féatnotu drdeisf lreimvieènres sa uqxui
fnoen ht aquuteeluqru perfoodisi geineutrfee .d Lees sr oIncdhieernss cdoounpnéesn àt pdi’acb do’urd
•ucnoeu lef elceo uloflneg vdieo llean ttaer aabuit ep ;a &ni elers, qInudi ipeanrs cdee ml’aouyterne tbiroerrd l,e p paarn leie mr doey elenu dre c dôetué.x cQouradneds- , iclo sn’atigniut ednet fda’iarte
-poauf ftaerr aubnit ccsh,e lv’uanl eo pur èusn dee m l’auuletr,e ;o onn t efnufdp deenudx l’ acnoirmdeasl tpieanr ndeens tf aenng rleefsp qeufit fpaanffse qnut ’fiol upsu iffofen fvaeirnet arue,c u&n qmuoi ule
dvee mbeonist . qDuai ncso cuelet éetanttr,e o nl else fduefupxen tda ràa ubnit egsr,o sp acrr olec •mcoouyffeensu dff’uitn peo ucro fradier eq aurir ilv’ye ra lt’taancihme.a lL à al’ apurterme rièivree .f eIl- ■yôç a q dueis ftoarnat bpitltas c qéuesi ào n1t5 3o0u à3 04 0to itofeifse asu d-de elfofnusg udeeu lra, rivTièAreR.ABOQUE, f. m. {Hiß. eccléf.) ce fut ainfi •qhua’boitna nasp dp’eAllnac ôdnanes qluei qtuenatooireznitè mle ep afrietic dlee qLuoeuliqsu deés BUanv firèerree, m&i nqeuu’orn, iancqcuuifforitte udr’h, éeruétf ioer &dr ed ed ed élbeas ufcahiree. raernrêtt.er en Efclavonie, oh il paroît qu’il fe retirèpieTrrAe
RqAuiC n,o fu. sm e.f t {inHcioßn. nnuate., L&ith odloogn.t) onno mne dn’uonues anpapleresn, d& r iqeune, fli’noonn f quub’fetiltluee a vleo ifta ndges dvee rdturasg moné dài cfia
plaTceA. RVAoy Ge{A BLoEëc, ed{Ge éBoogo. tm. od.) ville d’Afrique au rdoey laau rmivei edree Tdea fmilêemt, ed annosm la. pCroevttien cvei,l lfeu ar lpa oguaru cdhée- tfeernrfoei ur nef ct hpâlatenatué dfoe rptaiflimé,i eorùs, o&n fteiertnilte g eanrn pifâotunr. agSeosn. LoTngA. R11A. G48U. IICntO. z-Ay.Y {CDU.R JA.')BA, f. m. Zoolog.') nom d’une efpece de léfard du B{réHfiilß,. dnoaritt. j rlae sq ,u meuaer qeufet tcéoeus vdeer qteu adter ep etatcitheess ébcrauinlleess rétrgiaunligèurelasi ;
ionT dAoRs AefGt jUoIliRmAe n, t of.n mclé. d{eH riaßy. enuarte. sZ boroulongeise..) nom dpi’uén; lféofnar dc odr’Apsm eéftr itqouuet, cqouui veefrtt ddee l ap leotintgesu eéucra dil’luens terniavnirgounlsa idreess ,m gariiffoens-sb druu nfeusd : dile el’fAt tmrèésr-icqoume.m Ilu cno auurxt aiovne cc uonrpes g ;r &an dde’ arbaopridd iqtéu,’ iml aapisp teoruçjooiut rsq ueenl tqoureti lclhaon-t fuen,e i le axutrnêem me avnitieéfrfée .f m{Zg)u.l iJer.)e de branler fa tête avec lauTri eAr RceArifIeJ Odu, Jfa. pmo.n (, Hdoißn.t nleast .f lBeoutras nf.o)n te àfp qecuea tdree gpréatanlde sn,o omdborrea nfoteuss, ldes’u ani fjfaeullnees pdâesle f,e u&il lreasm. Saoffne efsru eitn, qleuuir c &on tdiee nlat qfiugautrree dfe’umnee npcoeisr,e ;f to rno uleg ec,u dlteiv lae gdraonfs- lesT jaArRdiAnsM, Aoù, i(l, Gcoéongf.e mrvoed .t o)u pjoruorvsi nfac eb edaeu tlé’A. méri
qà u1e4 m léieriudeiso ndael el,a uv iPlléer odue, .dcaen sn ol’mau :d ifeonnc ete drer oLiirm eaf t ierTtiAleR eAn NmCaïHs.E .,( Df. .f .J t.e )rme de Vigneron, greffe chelvei
lmle odyee fne rd qeusi ofmerbt làe ttso &ur ndeers llae vviies rds’.u Tn rpérveofufxo.ir par aniTmÀalR fAauNvaDgEe .,g rfo. sm c.o m{Hmieß u. nn abtoe. Zufo.o Illo ag .l)a tcê’teef tp luuns glria ndd’uen q oueu rlse, c&e rnf,a eîtf td caonus vleesr tp da’yusn lpeos ipl lcuosm fmepet ecne-- IrTioÀnRaAuxN,.JcAom, mf. em e. n{ LHaipßo.n niea.t . {BDot.. )J .a)r.bre d’Afrique
& des Indes orientales. Il eft petit & rempli
d’épines; fon fruit eft rond & couvert d’une écorce
jaunâtre ; le dedans eft rouge & a le goût d’une orange
, quoique fa chair foit plus ferme.
TARANIS, f. m. {Mythol. des Ga u l.) nom que
les Gaulois donnoient à Jupiter, & fous lequel ils
lui immoloient des viûimes humaines. Taranis ré-
pondoitau Jupiter tonnant des Romains, mais ce
dieu n’étoit pas chez les Gaulois le fouverain des
dieux, il n’alloit qu’après Efus, le dieu de la guerre J
& la grande divinité de ces peuples. ( D . J . )
TARANTAISE, la , ( Géogr. mod. ) province de
Savoie, avec titre de comté.Elle eft bornée au nord
par le duché de Savoie, au midi par le comté de
Maurienne, au levant par le duché d’Aoft, & au
couchant encore par le comté de Maurienne. C’eft:
le pays qu’habitoient les Centrons, peuples bien
marqués dans Céfar, au premier livre de fes Commentaires.
Pline les place auffi dans les Alpes graïen-
nes, qu’il nomme Centroniques, à caufe de fes peuples,
qui étoient, comme il dit, limitrophes des
O&oduriens ou des Vallaifans, Oclodurenfes & eorunt
finitimi Centrones. Les Centrons étoient les premiers
des Alpes graïennes. Leur capitale étoit nommée
Forum Claudii : c’eft le nom romain marqué par Pto-
lomée.
La ville des Centrons n’eft plus qu’un village qui a
confervé fon nom.Darentajia ou Tarentaife, devint
la capitale, non-feulement des Centrons, mais des
Alpes grecques & pennines ; elle eft marquée dans
l’itinéraire d’Antonin , & dans la carte de Peutin-
ger. Elle étoit alors évêché, & fut archevêché dans
le neuvième fiecle. Cette ville de Tarentaife, en donnant
fon nom au pays, a perdu le fien elle-même ,
& s’appelle aujourd’hui Monftiers, Monafierium, à
caufe d’un monaftere fondé en ce lieu, où les archevêques
demeuroient. Voye{ Monstiers.
La Tarentaife eft un pays ftérile & plein d’affreu-
fes montagnes. La riviere d’ifere la traverfe d’orient
en occident, & y prend une de fes fources.
Innocent IV. appelle Pierre de Tarentaife, parce
qu’il étoit né dans la ville de ce nom en 1249, fe fit
religieux de l’ordre de faint Dominique , devint provincial
de fon ordre, archevêque de Lyon, cardinal
d’Oftie, grand pénitencier de l’églife romaine , &
enfin pape après la mort de Grégoire X. Il fut élu à
Arezzo le- 21 Février 1276 , & mourut au bout de
cinq mois. Il a laiffe des ouvrages que perfonne ne
lit aujourd’hui, tant ils refpirent la barbarie. (Z>. ƒ.)
TARAPACA, vallée de, ( Géogr. mod.) vallée
de l’Amérique feptentrionale, au Pérou, dans l’audience
de Los - Charcas, près de la côte de la mer
du Sud. On dit qu’il s’y trouve quelques mines d’argent.
Au-devant du continent il y a une île nommée
Mile de Gouane, & que M. de Lille marque à dix-neuf
degrés quelques minutes. {D . J .)
TARARE, { Géog. mod. ) nom commun à une
montagne d’Afrique, au royaume de Tremecen &
à une montagne qui eft à fix lieues de Lyon, fur
le chemin de Roanne, & dont on a rendu le paffage
très-commode. Cette derniere montagne a pris fon
nom du gros bourg qui eft fitué au-bas, dans une
vallée, fur la petite riviere de Tordive. Tarare, en
latin du moyen âge, Tararia, eft encore une montagne
de France, qui fépare le Lyonnois du Beaujo-
lois. {D . J .) 1 '
TARAS, f. m. {Médailles.) fils de Neptune, paflè
pour le fondateur des Tarentins , qui le mettoient
fur leurs médailles fous là forme d’un dieu marin
monté fur un dauphin, & tenant ordinairement le
trident de fon pere;ou la maffued’Hercule,fymbolé
de la force ; ou une chouette, pour défianer Minerve,
prote&rice des Tarentins ; ou bien°une corne
d’abondance, pour lignifier la bonté du pays où il
avoit bâtiTarente ; ou enfin avec un pot à deux anfes '
& ùne; grappe de raifinayêc B I fegaccW,
fyinbole i f 1 abondance du. yjn c h e z le s Tarentira
.Taras avoit une ftatue dans le temple de D e lp h e s
ou on lui rendoit les honneurs dûs aux-hcres.fi> 1 1
1 a r a s 1 ° . fleuve d'Italie , dans la
j am ? ,P ^ d e :lay,UedçTarepte-, ftlonvPaufenias,
. JLJL. c. x . & entre Metaponte & Tarente félon
. Appten y civil. /. Jf.ll conferve fon ancien nom à la
îerminaifon près,; car les uns le nommen t préfente,
ment Ta ra , S i les autres.TW.Çe n’eft proprement
S s d ^ d S " “ danSiCé0ifcd"
ÉlateB citHe pafrf OlrBtehjuisj. H l mineure, félon Cimn1a-
g j g g | J § dtSc>'tHc’ fel0B Valerius Fia?-
iA RiséôN, ( Géog. „,od. ) il y a en France deux
Petites villes de ce nom ; l’une eft dans le pays de
Mlus de lua rvvi lnle b da e FFo 6î xI.a LHong. E/2. ia uiieuesPaa-déf-
Lautre Tamfcon beaucoup plus confidérable, eft
i° ’ a“ dmcefe d’Avignon, fur la rive candie
du Rhône, vis-à-vis Beaucaire.avec laqüelleeüe
communique par un pont de bateaux. Situation
elt a 4 heues au midi d’Avignon, & à , d’Arïes II v
a une viguene un chapitre & quelques eoüiens.
Son terroir eft Jelicteux, & l’on y refpire un air fort
tempere. Elle député aux affemblées générales de la
Provence, & fes députés y ont le premier ran<*
Long. 22.20. latit. 4.3. 48. , 3 ( 5f
Cette ville eft très-ancienne ; car Strabon & Pto-
lomee en font mention fous le même nom qifteile port
te aujourd’hui ; ils la nomment Tarafco.
Moliercs ( Jofeph Privât de ) phyficien cartéfiem
y naquit en 16775 il devint profeffeur au collet;!
royal en 17*3 , membre de l’académie dçs.Sciences
en 1779 , Sc mourut à Paris en 174*. Il apûbiiéides
leçons de phylique en quatre vol. itwj dans let
qiielles il admet non-feulement les tourbillons de ,
Uelcartes, mais il croit pouvoir en démontrer l’exif-
tence dans lefyftème du plein. Les leçons de cet auteur
ne pafferont pas à la poftérité; (D . J )
TARASQUE , f. f. animal chimérique dont 6,n
ertraie les enfans en quelques provinces de France ;
on le repréfente à leur imagination ayant fur fon dos
Un panier d’où fort une marionnette qui danfe &
qui faute. *
TARASUN, f. f. { Diete. ) efpece de biere ou dé
liqueur termentee que font les Chinois; elle eft très-
forte & très-propre à enivrer. Pour faire cette liqueur,
on prend de l’orge ou du froment qu’on fait
germer, & on le fait moudre groflierement ; on en
met urie certaine quantité dans une cuve, on l’hu=
mefte foiblement avec de l’eau chaude; alors on
couvre la cuve avec foin; on verfe enfuite de la nouvelle
^eau bouillante , & on remue le mélange, afin
que l’eau le pénétré également, après quoi on recouvre
encore la cuve ; on continue à verfer de Peau
bouillante^ & à remuer jufqu’à ce qu’on s’apper-^
çoive quel eau qui fumage, a parfaitement extrait
le malthe ou le grain germé, ce qu’on reconnoit
lorlqu elle eft fortement colorée, & devenue gluante
& vifqueufe. On laiflè refroidir le tout jufqu’à de*
venir tiede■ ; alors on verfe la liqueur dans un vaif-
feau plus étroit, que l’on enfouit en terre, après y
avoir jomt un peu de houblon chinois, qui eft prêté
le, & a qui on donne àqieu-près la forme d’une tuile;
on recouvre bien de terre le vaiffeau qui y a été en*
m | on ^qweur fermenter dans cet état.
Le houblon des Chinois ,qui a été prefle dans des
moules, porte déjà fon levain avec lui ; ainfi il n’eft
pas bejom d’y joindre aucune matière fermentante.
Tome X V *
■ f À R fy b )
bhi Eufôpe ou l’on n’a point ‘de et' : 1 >' >■
■ WBHHiM lorfqu elle a été faite propremem& aree foh p "0 1
Par » Gméhn; ‘°ln- ^
wgnaras ael ue de Sardaigqe. 3ScWtrabo’ nW, / yi « „ K <
dit qu ils habitaient dans des cavernes
qu ils enflent un terrein propre pour le f ^
en. négligeofcnt la c ü ln ^ "^ ïm rm fe n x S ’ ,11!
champs d autrui. Ils s’adonnoient auffi à la piraterie-
car Strabon moute qu’ils dcfoloient les PiLns fhi?
dans 1 île ; foit dans le continent ( D J \ *
TARAXIPPUS.f. rn.{Myl;l;èG;Lln^ iualfaifant, dont la ftatue placée dans Ipc w ' ^ ,n ®
oouffe ar ceux quidifputoient les prix de là
MLa lic |e o|ù l1’hippodro1me étoit cotnnnr<i A* A ■ ,-■ dtemmèf ét°“ Une feitedemairf
M M B a l 1 on regardoit comme la terreur des
r S p p ^ l & q«« par cette railon l’on trommoit Tu.
; Quarid les chevaux venoientà pafler dévarit eeë
ni a la voix, rii à la main de celui qui les nienolr
fouvent ils renverfoient & le char B B IM M I S
faifoit-on des voeux Si des facrifioes à T -aU
pour l’avoir favorable. lacnhces a Tw x .p p u s
L’auteur qui étoit affez mauvais phyficién & fmü
fuperftxtieux, recherche les raifon! de cette énmS
vante S .mais au heu u en donner la caufe phyfime 4
uirr llaa lfuupeSrftvdiqoUne q u“i a Tété tde” tSo uPs° lPesu ,taeirrn“s , fdoen dtoéuess
les^ays, & autant de la nation greque que des au.
Ï5ahs l’ifthme de Corinthe il y avoit auffi un TAa
blyphÜe , quiÜ fbt fou "le0 ayuoxi tpéiterse d “e f eGs lcahuecvuasu, xfi dlsa dnes Sleis'
jeux funèbres qu Acafte fit célébrer en l’honneur dé
fon pere, A Nemée on neparloit d’aucun S o j
fît peur aux chevaux ; mais au tournant de la lice il v
. éclat les cblomffoit, & les etonnoit de la même ma.
^ • fp qU>Û- ,a flamme ; cependant, M
croit Paufanias, à Olympie , Taraxippusleut faifoit
bien une autre frayeur,
Hfinit en difantque jfeloneuxi Taratippùsètolé
un furnom de Neptune Hippius : ce n’eft pas-là fatifc
faire la curtofite du lefieur qui attend qu’on lui ap.-
pienne la véritable caufe d’une épouvante fifubites
L auteur pouvoit bien dire Ce qu’il eft 11 naturel dé
penfer, que ies hellanodicesoü direaeurs.des jeux
uloiept de quelque artifice fecret pour effaroucher'
ainfi les chevaux , afin que le fiieeès des eourfes dé
char devenu par-là plus hazardêUx & plus difficile.
J f “ Sl°rieU3S‘ AbMG é io a in f “ rP ‘ *
Y Ÿ y y y